Éphéméride du 27 Février
Capture d'écran, film "Jésus de Nazareth", de Franco Zefirelli
36 : Date possible du départ de Judée de Ponce Pilate, qui doit aller se justifier devant l'Empereur Tibère...
Ponce Pilate ne le sait pas encore, mais, arrivé à Rome en 37 - Tibère étant mort entre-temps - le nouvel empereur, Caligula, va le nommer en Gaule, à Vienne, où il mourra; et le même Caligula va également exiler en Gaule - à Saint Bertrand de Comminges - le roi Hérode Antipas, qui y mourra également.
Ainsi, deux des trois puissants qui ont eu à juger Jésus de Nazareth viendront-ils finir leurs jours dans ce pays qui n'est pas encore la France, mais qui va le devenir peu à peu...
Seul le Grand prêtre Joseph Caïphe restera à Jérusalem, pour y mourir. Encore son sort se trouve-t-il - d'une certaine manière - associé à celui des deux autres puisqu'il fut, lui aussi, déchu de sa fonction par le même légat de Syrie, Vitellius - nommé par l'empereur Tibère - qui contraignit Ponce Pilate à aller rendre compte de sa gestion, très critiquée, devant l'empereur, à Rome.
Petit retour en arrière...
Ponce Pilate avait été nommé Préfet de Judée par Tibère. Qui nomma également, par la suite, Lucius Vitellius Légat de Syrie.
Vitellius, mécontent de Pilate et de Caïphe - le Grand Prêtre - destitua le second et obligea le premier à aller se justifier devant l'empereur Tibère, à Rome.
À la même époque, mais de sa propre initiative, l'ambitieux roi Hérode partit aussi pour Rome, afin de se concilier les bonnes grâces de l'empereur; mais, on l'a vu, mal lui en prit.
Cet Hérode Antipas est le fils du roi Hérode le Grand, celui qui reçut les Mages, cherchant le roi des Juifs, dont ils avaient vu se lever l'étoile. Il leur demanda de venir le voir, une fois qu'il l'auraient trouvé, afin qu'il puisse, lui aussi, aller l'adorer, mais eux - disent les Évangiles - avertis en songe, rentrèrent dans leurs pays par un autre chemin. Furieux, Hérode fit périr tous les nouveaux-nés : ce fut le massacre des innocents...
Son fils, Hérode Antipas, avait une personnalité et des moeurs assez troublantes : il fit décapiter Jean le Baptiste, afin de complaire à sa nièce et épouse, Hérodiade - qu'il avait enlevée à son demi-frère... - mais aussi et surtout à Salomé, la fille qu'Hérodiade avait eue avant de l'épouser, et dont il était secrètement amoureux.
Puis c'est à lui que le Sanhédrin et Caïphe envoyèrent Jésus, pour le juger (photo ci-dessus).
Mais comme le vrai pouvoir appartenait aux Romains, et que ni le Sanhédrin ni le roi fantoche Hérode n'avaient le pouvoir de condamner Jésus, Hérode l'envoya à Pilate...
Les deux acteurs/témoins non-chrétiens de l'Affaire Jésus restèrent à peine deux ans en Gaule : arrivés en 37, ils disparurent tous deux dans le courant de l'année 39 :
• Ponce Pilate à Vienne, où il serait tombé d'une falaise ("aidé à tomber", il aurait plutôt été poussé, selon de tenaces traditions orales...) : le mont Pilat perpétuerait son souvenir;
• et Hérode Antipas à Saint-Bertrand de Comminges (appelée alors Lugdunum Convenarum).
Dion Cassius, Eusèbe de Césarée et Flavius Josèphe (dans ses Antiquités judaïques et dans La Guerre des Juifs) sont les principales sources traitant de ces événements lointains; s'ils se contredisent parfois, ou émettent des affirmations confuses ou incomplètes, le recoupement de leurs affirmations permet cependant d'arriver à une certitude d'ensemble : ainsi, par exemple, Flavius Joseph indique d'abord (dans les Antiquités judaïques) qu'Hérode fut exilé "à Lugdunum", et donc certains pensèrent qu'il fut exilé avec - ou "à côté de" - Ponce Pilate, dans l'actuelle ville de Lyon; mais, ensuite, dans La guerre des Juifs, le même Flavius Josèphe affirme que c'est "en Hispanie" que fut exilé Hérode : les frontières étant moins précises à l'époque qu'aujourd'hui, il ne peut donc plus s'agir que de Lugdunum convenarum, devenue Saint-Bertrand de Comminges, tout à côté de l'Espagne actuelle, et non pas de la "grande" Lugdunum, la Lyon d'aujourd'hui...
Ainsi donc, parmi les autres nations chrétiennes, c'est un sens particulier que prend, en Gaule - puis en France - l'expression "racines chrétiennes" : car, on vient de le voir, dès les débuts de la religion chrétienne, la Gaule fut associée, si l'on peut dire, et quelle qu'en soit la façon - en l'occurrence, paradoxale, pour employer un terme philosophique - à la nouvelle religion, qui n'allait pas tarder à devenir celle du peuple presque tout entier, par l'évangélisation : avec Saint Irénée, qui avait connu Polycarpe, disciple de Saint-Jean l'évangéliste (voir l'Éphéméride du 28 juin), ce sont des représentants des tous premiers disciples - et non plus seulement deux des trois acteurs/témoins des débuts du christianisme - qui arrivent en Gaule : saint Irénée, arrivé en 157, rejoint Pothin, à Lyon, dont il devint le deuxième évêque, puisqu'il succéda à Pothin, victime (avec Blandine et ses compagnons) de la grande persécution de Marc-Aurèle en 177.
Le mont Pilat est situé dans le département de la Loire, au sud-est de Saint-Étienne et au sud-ouest de Vienne et Givors : simple accident, suicide, ou bien "aidé à tomber", c'est de ce mont Pilat que Ponce Pilate - qui lui a donné son nom - aurait "chuté" en 39, cette même année qui vit disparaître également son comparse/complice dans "l'affaire Jésus" : le roi Hérode Antipas...
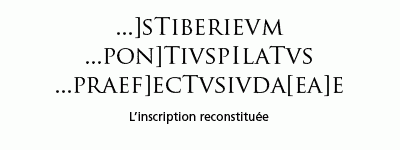 http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2007/arc_070316.htm
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2007/arc_070316.htm








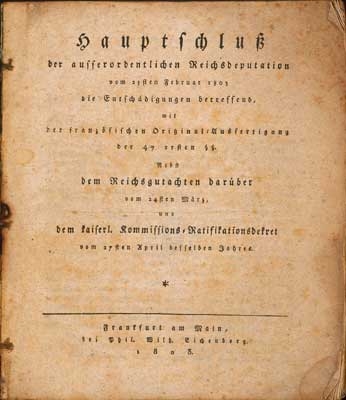





 Dix ans après le triomphe de Marignan, la déroute est totale, à Pavie, pour François Premier et son armée. Le roi de France est battu par un chef de guerre français, le Connétable de Bourbon, qui le servait dix ans auparavant, à Marignan, mais qui, depuis, a trahi, se ralliant aux
Dix ans après le triomphe de Marignan, la déroute est totale, à Pavie, pour François Premier et son armée. Le roi de France est battu par un chef de guerre français, le Connétable de Bourbon, qui le servait dix ans auparavant, à Marignan, mais qui, depuis, a trahi, se ralliant aux 




 Le roi Jean II (le Bon) était prisonnier à Londres, après sa défaite de Poitiers, en 1356. Il était, ainsi, le deuxième roi de France fait prisonnier sur le champ de bataille (voir l'
Le roi Jean II (le Bon) était prisonnier à Londres, après sa défaite de Poitiers, en 1356. Il était, ainsi, le deuxième roi de France fait prisonnier sur le champ de bataille (voir l'
 Mort sans enfants - comme ses deux frères, ayant régné avant lui, Louis X et Philippe V - Charles est le dernier des trois garçons de Philippe le Bel, qui a eu également une fille, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre.
Mort sans enfants - comme ses deux frères, ayant régné avant lui, Louis X et Philippe V - Charles est le dernier des trois garçons de Philippe le Bel, qui a eu également une fille, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre. 









