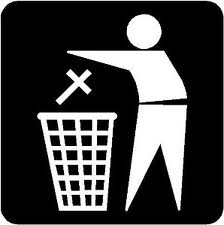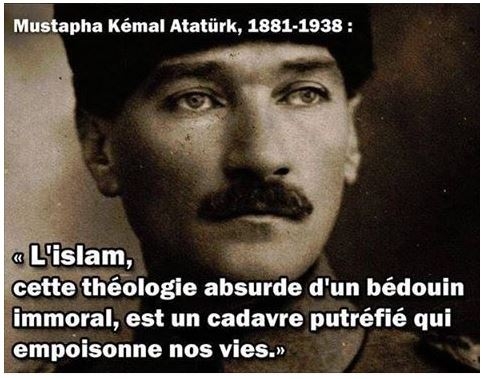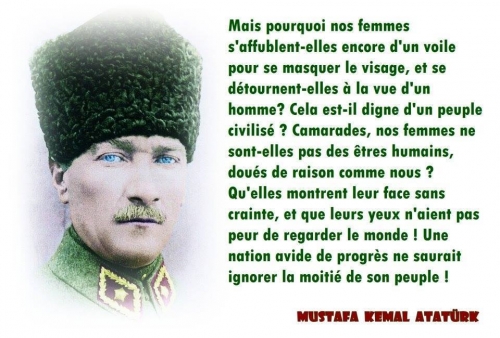Le pape François est décédé, à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican ce matin, le lendemain de son apparition sur le balcon de la Basilique Saint-Pierre :
"Ce matin à 7h35, l’évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père", a annoncé le cardinal Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican sur sa chaîne Telegram.
-----------
À lafautearousseau, nous n'avons jamais hésité à saluer les trop rares moments où François a délivré de beaux messages, dans la ligne de l'Église traditionnelle, depuis Laudato si' jusqu'à cette merveilleuse journée d'Ajaccio, il y a si peu de temps : une journée que nous avons tous suivie à la télévision, et dont on aurait tant aimé qu'elle ne s'achevât point...
Hélas !
Le journaliste de France info, qui a annoncé la nouvelle il y a quelques minutes, a eu ce mot, malheureusement trop juste : il laisse l'Église plus fracturée que jamais...
Nous formulerons ici, pour nous en tenir à l'essentiel, deux critiques de fond - mais tragiques - sur son pontificat :
1. Pourquoi donc a-t-il tenu, avec tant de sévérité, à se montrer - "à l'intérieur", si l'on peut dire - ce Pape de guerre civile qu'il a été, avec une persévérance et une dureté difficilement compréhensible ?
Et cela, alors que le bienfaisant Benoît XVI avait trouvé "la" solution pour cicatriser les plaies saignantes du problème du rite, en institutionnalisant, à côté du "rite ordinaire", le rite "extra-ordinaire". Agissant ainsi, le bienfaisant Benoît XVI - le temps aidant - avait remis l'Église et les fidèles sur le chemin de la pacification des querelles internes. François, d'une façon totalement insensée, a "cassé" tout cela, a ré-ouvert les plaies de l'immense cicatrice, a blessé "un nombre innombrable" de fidèles (le mot est de Montesquieu).
Un seul exemple de cette folie de guerre civile : tout le monde connaît, en France et dans l'Église, l'oeuvre apostolique magnifique de Monseigneur Rey, Évêque de Fréjus et Toulon : le nombre de séminaristes qui affluaient dans son diocèse depuis des années parlait pour cette excellence du Pasteur, qui menait bien son troupeau, par les bons sentiers. Cet évêque éminent fut "inspecté" (!), mal traité, finalement poussé à une démission, par obéissance, qui le grandit encore, mais qui fut, de toute évidence, une folie, une perte, une blessure pour l'Église : oui, pourquoi François a-t-il librement choisi d'être un Pape de guerre civile ?
2. Et pourquoi, donc, "à l'extérieur" - là aussi, si l'on peut dire - a-t-il choisi de s'opposer à ce point à Saint Jean-Paul II - qui, lui, parlait du "droit des Nations" - en se faisant l'apôtre de cette maléfique politique du migrantisme et du sans-frontiérisme ?
Cette obsession pour "les migrants" est le contraire de la charité vraie. Si l'on veut aider les pauvres et les malheureux, c'est en les aidant dans leurs pays qu'on y parviendra, peut-être; et non en se faisant "le grand caravanier" d'un grand déménagement démographique mondial, qui déstabilise tout, partout, mais fait le plus grand bien aux nouveaux trafiquants d'êtres humains. Ce qui est, on en conviendra, bien loin des devoirs prônés par l'Évangile !...
Alors, maintenant, qui va venir ?
Nous appelons de nos voeux l'élection du Cardinal Sarah comme Évêque de Rome et Souverain Pontife de l'Église universelle.
À défaut, nous souhaitons l'élection d'un Pape qui fera cesser cette querelle qui n'a pas lieu d'être entre "anciens" et "modernes"; d'abord car le texte du Concile Vatican II n'interdit ni ne limite le rite dit extra-ordinaire et, ensuite, parce que un Souverain catholique (c'est-à-dire universel) rassemble son Peuple, rassemble son Troupeau.
Nous redisons à la suite de nos Maîtres (Maurras, Bainville et Daudet) notre plein attachement à la Rome éternelle, maîtresse de Sagesse et de Vérité.
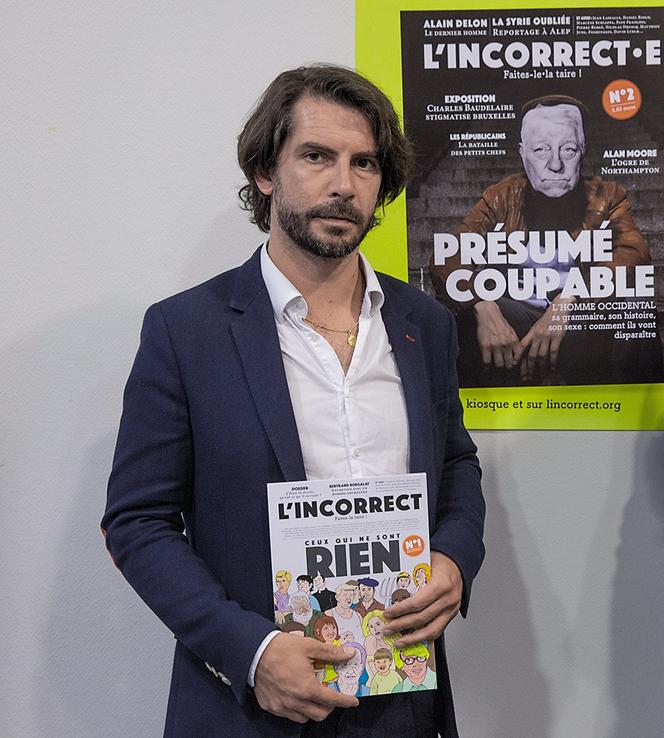














 Voici le deuxième des trois volets qu'Annie Laurent consacre à ce sujet.
Voici le deuxième des trois volets qu'Annie Laurent consacre à ce sujet.