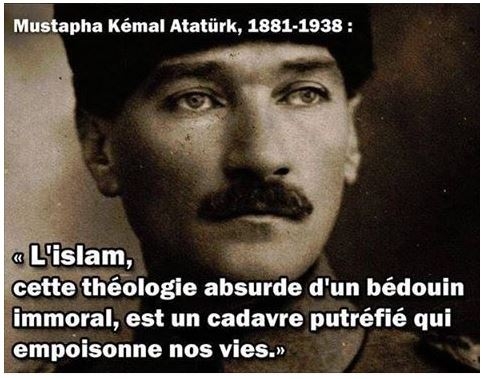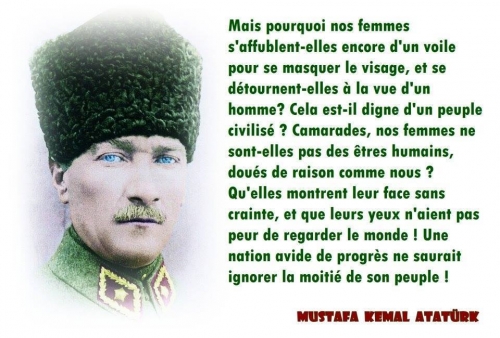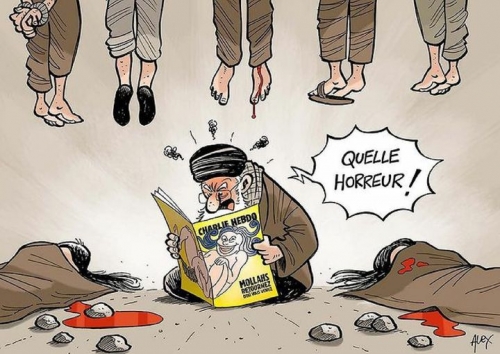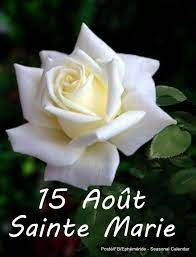Politique et Religion - Page 2
-
-
Iran, Afghanistan et autres lieux délicieux d'une certaine "religion de paix et d'amour"...
-
REMISES EN CAUSE SUR LE CORAN, par Annie Laurent
 Le Coran est-il réellement ce livre « incréé », émanant tout entier d’une dictée divine comme marque de l’unique religion inscrite dans la nature humaine et agréée comme telle par Adam ? Cette certitude, érigée en dogme au IXème siècle et sur laquelle repose jusqu’à nos jours la croyance des musulmans, non seulement quant à ses fondements religieux et spirituels mais aussi ses principes anthropologiques, juridiques et sociaux, pourrait-elle être remise en cause par la science ? Telle est la perspective ouverte au milieu du XIXème siècle grâce aux travaux de savants européens qualifiés.
Le Coran est-il réellement ce livre « incréé », émanant tout entier d’une dictée divine comme marque de l’unique religion inscrite dans la nature humaine et agréée comme telle par Adam ? Cette certitude, érigée en dogme au IXème siècle et sur laquelle repose jusqu’à nos jours la croyance des musulmans, non seulement quant à ses fondements religieux et spirituels mais aussi ses principes anthropologiques, juridiques et sociaux, pourrait-elle être remise en cause par la science ? Telle est la perspective ouverte au milieu du XIXème siècle grâce aux travaux de savants européens qualifiés.Aujourd’hui, l’intérêt pour le sujet ne cesse de croître, au point de susciter une abondance inédite de publications consacrées au contexte historique, avec ses diverses influences (religieuses, culturelles, linguistiques, politiques), qui a entouré l’émergence de l’islam au VIIème siècle. Il en résulte de solides remises en cause du schéma jusque-là universellement tenu pour acquis. « À partir de 1977, toute une série de recherches ont tendu à démontrer que l’histoire des débuts de l’islam, racontée par la tradition savante arabo-musulmane, était une reconstruction tardive, éloignée de la vérité et même mensongère », remarque Christian-Julien Robin, directeur de recherches honoraire au CNRS, co-auteur du livre Histoire du Coran. Contexte, origine, rédaction, publié récemment sous la direction de Mohammad-Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye (1).
Marqué par la liberté intellectuelle, l’audace du jugement et l’absence de tout présupposé idéologique de ses vingt-et-un contributeurs, cet épais volume apporte sur le sujet des éclairages novateurs et incontestables. L’ensemble permet de mieux appréhender les sources originelles de l’islam, de son inspiration à sa rédaction et à sa composition jusqu’à sa canonisation. Il offre les critères ouvrant la voie à une lecture intelligible du Coran, jusqu’ici gênée par bien des obstacles, dont l’absence de repères historiques crédibles.
Celle-ci se manifeste entre autres à travers des allusions imprécises sur les événements et personnages évoqués. Ainsi, le classement choisi n’est pas chronologique ; il obéit à un ordre de longueur décroissant, les 114 sourates mélangeant sans explication les deux périodes supposées de la prédication de Mahomet : La Mecque (610-622) et Médine (622-632). « Le Coran est malheureusement d’une pertinence très limitée pour reconstruire la vie de Mahomet et les divers événements relatifs à sa carrière prophétique », assure Stephen J. Shoemaker, professeur à l’Université d’Oregon (États-Unis). Par ailleurs, la version coranique officialisée sous le califat sunnite d’Abdel Malik (685-705) entretient une profonde discorde au sein de l’islam. Les chiites la considèrent comme ayant été censurée pour effacer le nom d’Ali, cousin et gendre de Mahomet, que Dieu aurait désigné comme son successeur et auquel ils se réfèrent.
Dans sa contribution, G. Dye constate le caractère « décousu, désordonné, déconcertant et obscur » du Coran, « texte polémique, fonctionnant par slogans » et dépourvu de « cadre narratif » lorsqu’il « met en scène des controverses entre le messager coranique et un groupe d’adversaires, dont l’identité reste dans l’ombre ». « Profondément anhistorique », le Coran est un corpus avant d’être un livre, en conclut-il.
Comment comprendre les autres étrangetés d’un texte attribué à Dieu, telles que ses nombreuses contradictions, mais aussi sa « divinisation » de la langue arabe, décrite comme « pure » alors qu’elle côtoie des variantes et emprunte à d’autres lexiques sémitiques, notamment ceux des juifs et des chrétiens, y compris dans leur terminologie religieuse, cultuelle et juridique ?
Sur cet aspect, plusieurs études substantielles consacrées au contexte religieux de l’Orient pré-islamique (Arabie, Palestine, Byzance, Perse, Éthiopie) font ressortir l’influence des hérésies chrétiennes sur le Coran. Muriel Debié, titulaire de la chaire « Christianismes orientaux » à l’École pratique des hautes études, et Vincent Déroche, professeur au Collège de France, soulignent les erreurs de jugement de leurs adeptes, lorsqu’au moment de la conquête arabe une partie d’entre eux ont adopté « une nouvelle religion qui n’était pas toujours perçue comme fondamentalement différente, surtout dans les débuts ». Une leçon pour notre temps rongé par les confusions ?
Ces multiples découvertes aboutiront-elles à une reconnaissance du Coran comme une construction humaine ? Telle pourrait être la perspective ouverte par une authentique exégèse historico-critique,dans le sillage de M-A. Amir-Moezzi, président du conseil scientifique du tout nouvel Institut français d’islamologie inauguré à la Sorbonne le 22 novembre dernier.
(Article paru dans La Nef n° 354 – Janvier 2023)
_____
1. du Cerf, 2022, 1092 p., 34 €. Cet ouvrage reprend une partie des textes parus dans Le Coran des historiens (Cerf, 2020, 3 vol.) et en ajoute d’autres.
-
HOMMAGE À L'IMMENSE PAPE BENOÎT XVI, QUI VIENT D'ENTRER DANS LA VIE...
Il fut l'ami, le bras droit et le continuateur de cet autre immense Pape que fut Saint Jean-Paul II, tombeur du communisme et beau défenseur de la Foi, autant qu'il lui fut possible...
En guise d'hommage respectueux au Pape Benoît, lafautearousseau redonne, simplement, les deux Grands Textes de notre série qui lui sont consacrés :
GRANDS TEXTES (13) : Discours du pape Benoît XVI au collège des Bernardins.
GRANDS TEXTES (5) : Benoît le Romain, d'Hilaire de Crémiers
-
À propos de cette Grande mosquée de Paris, qui veut "porter plainte" contre Houellebecq et Onfray...
Rien à rajouter, rien à retrancher dans ce court billet que nous avoins publié ici-même le 7 avril 2017 :
-
Liban : les derniers chrétiens d'Orient ?...
(vidéo 36'43)
Il y a peu de temps encore, quand la majorité des Libanais était des Chrétiens, le Liban était un pays riche, on l'appelait "la Suisse du Proche Orient", mais les musulmans (les Palestiniens et les Syriens) ont envahi le Liban, les musulmans ont répandu la terreur et l’islamisme dans ce pays. Partout où les musulmans ont chassé les chrétiens d’un pays (où les chrétiens se trouvaient avant eux), ces chrétiens travailleurs et honnêtes, la violence et la misère ont envahi ce pays...
Il est honteux que la France ne lance pas un grand plan d’aide a nos fréres Chrétiens Libanais (idem pour les Arméniens...). Encore faudrait-il que la France fût restée chrétienne et royale ! Comment voudrait-on que notre République idéologique laïcarde et anti chrétienne, se voulant elle-même la Nouvelle Religion Républicaine, dont le but premier est essentiel est de mener un combat d'extermination à l'Église catholique, comment voudrait-on qu'elle volât au secours de nos frères chrétiens du Liban et d'Arménie ? Qu'elle entreprît quoi que ce soit pour les défendre, pour les sauver ? Ce serait se renier elle-même, elle qui est la descendante et l'héritière de Robespierre et de la secte des Encyclopédistes, dont la devise bien connue est "Écrasons l'Infâme !"
La seule réponse à cette question n'est donc pas matérielle, humaine; elle ne peut qu'être spirituelle : comme en Égypte chrétienne (qui fait partie de la Terre Sainte puisqu'elle a acueilli la Sainte Famille fuyant Hérode) asservie par l'Islam depuis un millénaire et demi et où le christianisme se maintient...
-
L'Islam est-il une hérésie, par Annie Laurent
 Une étude sérieuse du Coran permet d’y découvrir la présence d’un nombre substantiel de passages semblant relever de doctrines jugées hérétiques par le Magistère de l’Église. Or, une prise en considération de ces hérésies chrétiennes dans le livre sacré des musulmans est nécessaire pour connaître réellement l’islam et entreprendre un dialogue en vérité avec les musulmans.
Une étude sérieuse du Coran permet d’y découvrir la présence d’un nombre substantiel de passages semblant relever de doctrines jugées hérétiques par le Magistère de l’Église. Or, une prise en considération de ces hérésies chrétiennes dans le livre sacré des musulmans est nécessaire pour connaître réellement l’islam et entreprendre un dialogue en vérité avec les musulmans.La complexité de cette question mérite donc une clarification. Telle est la tâche entreprise par Annie Laurent dans cette Petite Feuille Verte n° 94. Elle se présente comme une introduction générale au sujet (définitions, contexte historique, etc.); les suivantes exposeront les différentes hérésies les unes après les autres (millénarisme, arianisme, nestorianisme, pélagianisme, iconoclasme, etc.), avec leur contenu et leur application dans le Coran...
-
Reçu de l'Association Marie de Nazareth : Récit d’une soirée exceptionnelle à Paris, avec Gad Elmaleh...

Récit d’une soirée exceptionnelle à Paris, avec Gad Elmaleh
Chers amis,
Samedi 3 décembre, l’Association Marie de Nazareth a eu le plaisir d’organiser, en partenariat avec Saje, une projection du film de Gad Elmaleh, Reste un peu, dans un grand cinéma parisien. La soirée a été un immense succès pour les quelque 500 personnes présentes, pour l’acteur que nous remercions vivement, et pour tous les amis de l’association que nous avons eu la joie de voir.

Reste un peu, film dont Gad Elmaleh est le personnage principal et le réalisateur, met en lumière un itinéraire spirituel. Né au Maroc à Casablanca, dans une famille juive séfarade, Gad Elmaleh étudie dès son enfance le Talmud, et a sans doute toujours été réceptif à une forme de spiritualité religieuse. Mais l’histoire du film n’est pas axée uniquement sur ce cheminement, elle porte sur la révélation de son attirance pour le catholicisme, suite à une rencontre intime avec la Vierge Marie, alors qu’il n’avait que 6 ans. Il confie lors d’une interview : « Sans l’accord de mes parents alors que leur croyance l’interdisait, j’ai poussé la porte de l’église [Notre Dame de Lourdes à Casablanca] et suis tombé nez à nez devant une représentation gigantesque de la Sainte Vierge qui me regardait droit dans les yeux. » Une rencontre qu’il cache à ses parents qui finissent par apprendre la vérité par hasard en rangeant sa chambre.
Tout au long du film, nous voyons l’interrogation et la souffrance d’un père et d’une mère qui ne comprennent pas cette attirance pour la Vierge Marie et surtout ce détachement de la religion juive. Mais ce film est empreint d’amour. Il s’agit même d'une histoire d’amour entre les membres d’une famille qui ne veulent pas se faire souffrir ; et d’une histoire d’amour entre Gad Elmaleh et Marie.
À l’exception d’une jeune comédienne, les personnages jouent leur propre rôle. Chacun peut alors imaginer la dimension particulière et l’intensité de dialogues qui avaient été véritablement échangés par les acteurs. Une courte scène a été particulièrement touchante. Après un échange entre le comédien et le père Barthélémy qui s‘apprête à baptiser des catéchumènes, le regard du prêtre se porte sur son ami, il est alors empreint d’une certaine peine mais aussi d’un très grand respect et d’une bonté infinie.

À l’issue de la projection, Gad Elmaleh s’est joint aux spectateurs. Très généreusement, il a accordé une heure d’échanges avec une salle comble. De nombreuses questions lui ont été posées, auxquelles il a répondu avec humour et sérieux. La première fut particulièrement intéressante. L’une de nos invités a fait le parallèle entre le titre du film, Reste un peu, et le dialogue des pèlerins d’Emmaüs, Luc 24 (28-29) : « Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : “Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse.” Il entra donc pour rester avec eux. » Gad Elmaleh, qui a alors découvert ce passage de l’Évangile, a semblé très ému, puisque Reste un peu est inspiré des mots sa maman qui lui demande toujours de rester un peu avant de repartir. Rapprocher le titre de son film aux paroles saintes de l'Écriture l’a profondément marqué.
Quelques questions ont aussi porté sur la figure de Jésus et le rapport que Gad entretient avec le Fils de Dieu. Ses réponses ont été très intéressantes car il n’a pas (encore) vécu une expérience christique et n’a pas la relation quasi charnelle et si maternelle qu’il entretient avec Marie. Mais le comédien a semblé bien conscient que Marie pouvait le mener à son Fils.
Dans un autre échange, Gad a mentionné son papa, convaincu que « tout cela » avait été engendré… à cause d’une porte. C’est alors qu’Olivier Bonnassies, directeur de notre association, lui a fait remarquer que Jésus avait lui-même dit : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. [...] Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage » (Jean 10, 1-9). Une nouvelle fois, ces paroles bibliques ont touché l’acteur.
Nous avons abordé aussi la question de la laïcité, évoquée dans le film, mais qui efface, selon lui, les chemins de la spiritualité (avec ou sans Dieu) et empêche d’aborder le sujet de la religion sans crisper. Enfin, nous avons beaucoup ri lorsque Gad a évoqué sa retraite à l'abbaye de Sénanques et l’étonnement d’un moine qui ne comprenait pas le principe du « selfie », c’est-à-dire, pour l'acteur connu et reconnu, d’accepter de se laisser prendre en photo avec des gens inconnus.
Nous remercions de tout cœur Gad Elmaleh d’avoir permis aux amis de l’association qui étaient présents de le rencontrer et d’échanger avec lui. Quant à nous, nous étions une nouvelle fois ravis de mettre des visages sur des noms et de vous rencontrer toujours plus nombreux. Merci pour tous vos messages de remerciements et d'encouragements ; cela nous touche beaucoup. Si une suite est donnée à ce film, comme semble le souhaiter le réalisateur, nous serons très heureux de renouveler cette rencontre. Et n’hésitez-pas à consulter régulièrement la page actualité de notre site afin de vous informer sur les prochains événements que nous organiserons !
Bonne entrée dans le temps de l'Avent !
France Andrieux et toute l'équipe de Marie de Nazareth
-
Racines chrétiennes de la France...
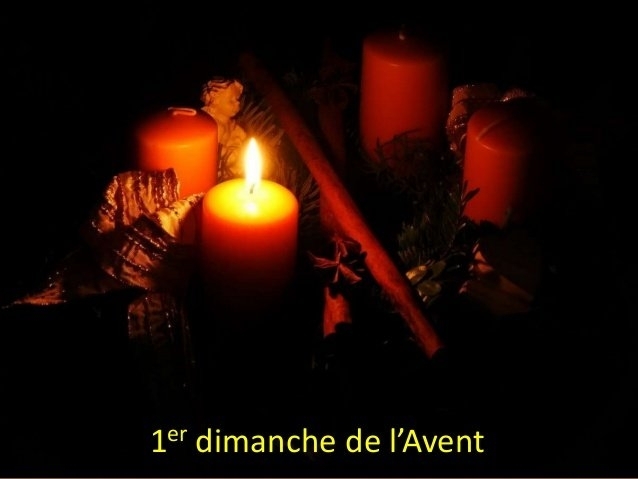
La crèche de lafautearousseau est installée...
-
L’islam peut-il être européen ? par Annie Laurent
 Alors que Charles III vient de succéder sur le trône britannique à sa mère, la reine Elizabeth II (décédée le 8 septembre 2022), certains médias se sont fait l’écho de son intérêt pour l’islam.
Alors que Charles III vient de succéder sur le trône britannique à sa mère, la reine Elizabeth II (décédée le 8 septembre 2022), certains médias se sont fait l’écho de son intérêt pour l’islam. Depuis le début des années 1990, en tant que prince héritier, il a en effet plusieurs fois exprimé publiquement sa conviction selon laquelle l’islam est une religion européenne et qu’il en tiendrait compte dans son pays lorsqu’il deviendrait roi. Il envisageait notamment d’en tirer des conséquences institutionnelles dès lors que l’anglicanisme ne détient plus la quasi-exclusivité qui était la sienne auparavant. Ainsi, « il a fait planer l’idée de transformer le titre de monarque britannique de “Défenseur de la Foi” en “Défenseur des fois” », rappelle le quotidien libanais L’Orient-Le Jour (20 septembre 2022). La polémique suscitée par ces propos l’avait cependant conduit à renoncer à ce changement de titre et à préciser qu’il s’agissait avant tout « de protéger la libre pratique de toutes les croyances » cohabitant au sein du Royaume-Uni (Id.).
Pour autant, ajoute ce journal, « son admiration pour l’islam ne semble pas avoir faibli, lui qui avait commencé à apprendre l’arabe pour mieux comprendre le Coran » et qui était devenu le mécène du Centre pour les études islamiques situé à Oxford (Id.).
L’Islam est certes présent en Europe, mais faut-il en déduire qu’il existe un Islam d’Europe ? Voici des éléments de réponse...
-
Islam et féminisme (suite et fin, 4/4), par Annie Laurent
 Le jeudi 16 juin dernier, nous donnions ici-même le premier texte de cette série de trois que consacre Annie Laurent au thème Islam et féminisme.
Le jeudi 16 juin dernier, nous donnions ici-même le premier texte de cette série de trois que consacre Annie Laurent au thème Islam et féminisme. Voici aujourd'hui la deuxième partie (et la fin) du troisième de ces textes, que vous pouvez retrouver ici :
• Islam et féminisme (1/3), par Annie Laurent
• Islam et féminisme (2/3), par Annie Laurent
• Islam et féminisme (3/3), première partie, par Annie Laurent
Un grand merci et un grand bravo à Annie Laurent, qui nous éclaire aussi parfaitement et aussi régulèrement...
François Davin, Blogmestre
-
L'Assomption : Fête nationale du Royaume, toujours élan de spiritualité intense et majeur dans le désert d'aujourd'hui ...
22 secondes, à Lourdes :
https://twitter.com/lourdes_france/status/1558938399288991745?s=20&t=whXhJRYVfvlyPconZQ4mmw
-
Islam et féminisme (3/3), par Annie Laurent
Le jeudi 16 juin dernier, nous donnions ici-même le premier texte de cette série de trois que consacre Annie Laurent au thème Islam et féminisme.
Hier, nous avons publié le deuxième volet de cette série, et vous pouvez retrouver ces deux premiers textes ici :
• Islam et féminisme (1/3), par Annie Laurent
• Islam et féminisme (2/3), par Annie Laurent
Voici, aujourd'hui la première partie du troisième et dernier texte de la série. Un grand merci et un grand bravo à Annie Laurent, qui nous éclaire aussi parfaitement et aussi régulèrement...
François Davin, Blogmestre
-
Islam et féminisme (2/3), par Annie Laurent
 Le jeudi 16 juin dernier, nous donnions ici-même le premier texte de cette série de trois que consacre Annie Laurent au thème Islam et féminisme. Vous pouvez le retrouver ici :
Le jeudi 16 juin dernier, nous donnions ici-même le premier texte de cette série de trois que consacre Annie Laurent au thème Islam et féminisme. Vous pouvez le retrouver ici :Islam et féminisme (1/3), par Annie Laurent
Voici, aujourd'hui le deuxième texte de la série, que viendra conclure celui que vous pourrez lire demain...
François Davin, Blogmestre
-
Islam et féminisme (1/3), par Annie Laurent
 Ce "numéro 89" est la première des trois Petites feuiles vertes qu'Annie Laurent consacre à ce thème : Islam et féminisme.
Ce "numéro 89" est la première des trois Petites feuiles vertes qu'Annie Laurent consacre à ce thème : Islam et féminisme. Nous donnerons évidemment - comme d'habitude - le lien de cet article-ci lors de la publication de la prochaine PFV (la 90) et le lien des deux premières lors de la parution de la troisième et dernière (sur le sujet) : afin que vous puissiez, comme d'habitude, consulter aisément l'ensemble de cette sorte de mini-dossier...
J'en profite pour renouveler mes remerciements personnels - et, j'en suis sûr, les vôtres... - à notre chère Annie Laurent, qui ne manque jamais de me communiquer les textes si éclairants et si nécessaires qu'elle publie très régulièrement, et qui nous aident tous à mieux comprendre ce "sujet" immense : l'Islam...
François Davin,
Blogmestre