Mathieu Bock-Côté
a publié sur son blog [27.07] une réflexion profonde qui nous intéresse particulièrement, nous qui devrions être classés parmi les opposants fondamentaux au système dominant. Mathieu Bock-Côté est, selon l'expression de Michel de Jaeghere, « mieux qu'un réactionnaire, un antimoderne », lorsqu'il constate « le caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer ». Et lorsqu'il ajoute : « On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. » Ainsi, comme jadis Bainville ou Maurras, Mathieu Bock-Côté dissipe les nuées qui nous enveloppent. Il faut en être reconnaissant, selon nous, à ce jeune intellectuel brillant, mais surtout perspicace et profond. Il n'est pas le seul de sa génération. Et c'est une grande chance. Lafautearousseau
 Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.
Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.
Les opposants modérés
Il y a d'un côté les opposants « modérés », « respectables », « responsables » : ce sont les opposants qui ne contestent pas les principes même du système dans lequel nous vivons mais qui demandent seulement qu'on les applique avec modération, qu'on évite les excès idéologiques. Devant l’enthousiasme progressiste, ils n’opposent pas une autre philosophie. Ils opposent généralement leur tiédeur, ou à l’occasion, un certain scepticisme sans dimension politique. Mais fondamentalement, ils évoluent dans les paramètres idéologiques et politiques prescrits par l'idéologie dominante : ils n'en représentent qu'une version plus fade. Évidemment, les êtres humains ne sont pas toujours parfaitement domestiqués par le système idéologique dans lequel ils vivent. Si de temps en temps, les opposants modérés se rebellent un peu trop contre l'idéologie dominante, on les menace clairement : ils jouent avec le feu, flirtent avec l'inacceptable et seront relégués dans les marges du système politico-idéologique, avec une vaste compagnie d'infréquentables.
Par ailleurs, le système idéologique dominant n’est pas statique : il a tendance à toujours vouloir radicaliser les principes dont il se réclame. Un système idéologique a tendance, inévitablement, à vouloir avaler toute la réalité pour le reconstruire selon ses préceptes. D’une génération à l’autre, le progressisme étend son empire et tolère de moins en moins que des segments de la réalité s’y dérobent. Ce qui veut dire que l’opposition « modérée » doit s’adapter si elle veut demeurer « modérée » et dans les bonnes grâces du système idéologique : ses positions aujourd’hui considérées modérées seront peut-être demain considérées comme inacceptables puisque le consensus idéologique dominant aura évolué. Ce qui encore hier était toléré peut être aujourd’hui inimaginable ou simplement interdit. Par exemple, la défense de la souveraineté nationale est devenue une aberration idéologique aujourd’hui. Celui qui s’entête sur cette position encore hier tolérable mais aujourd’hui disqualifiée moralement deviendra un extrémiste malgré lui, même si ses convictions fondamentales n’ont jamais varié.
En gros, l’opposition « modérée » et respectable, celle qui a mauvaise conscience d’être dans l’opposition mais qui s’y retrouve pour différentes raisons, doit toujours être vigilante et sur ses gardes pour parler le langage du système idéologique. Il lui suffit d’un écart de langage pour d’un coup subir une tempête médiatique en forme de rappel à l’ordre. Elle devra aussi de temps en temps donner des gages de soumission en partageant les indignations mises en scène par le système idéologique dominant : fondamentalement, l’opposition doit toujours rappeler qu’elle voit le monde comme le système idéologique dominant veut qu’on le voit, et se contenter de faire quelques petites réserves mineures qui souvent, même, passeront inaperçues. Dans son esprit complexé, il lui suffira à l’occasion de déplacer une virgule dans une phrase pour se croire emportée par la plus admirable audace.
Les opposants « radicaux »
Il y a une deuxième catégorie d’opposants : appelons-les opposants « fondamentaux » : ils ne sont pas seulement en désaccord avec l’application plus ou moins heureuse des principes du système idéologique dominant. Ils les remettent en question ouvertement. En d’autres mots, ils remettent en question un aspect fondamental du système et par là, son économie générale : ils se situent à l’extérieur du principe de légitimité qui traverse les institutions sociales et politiques et le système médiatique. Le système les désigne alors non pas comme des opposants respectables avec lesquels on pourrait discuter mais comme des radicaux, des extrémistes, des fanatiques, et en dernière instance, comme des ennemis du genre humain (ou du progrès humain). Ils sont disqualifiés moralement, on les présente comme les représentants d'une humanité dégénérée, avilie par la haine. Les sentiments qu’on leur prête sont généralement mauvais : nous serons devant la part maudite de l’humanité et on les associera aussi aux pires heures de l’histoire.
Je note qu’on les désigne souvent d’un terme dans lequel ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Ainsi, les partisans de la souveraineté nationale dans le débat sur le Brexit ne seront pas désignés comme des souverainistes, ni même comme des eurosceptiques, mais comme des europhobes – cette phobie référant aussi évidemment aux autres phobies qu’on leur prêtera par association. Mais c’est qu’il faut leur coller une étiquette bien effrayante pour faire comprendre au peuple qu’on se retrouve devant des mouvements ou des courants politiques peu recommandables et franchement détestables. S'il doit à tout prix en parler, le système médiatique devra faire comprendre à tout le monde que ceux dont ils parlent ne sont pas des gens respectables. Plus souvent qu’autrement, on les diabolisera. Dans certains cas, on les censurera moralement. Ou même légalement. Tous les moyens sont bons pour éviter que les opposants fondamentaux ne sortent des marges et quittent la seule fonction tribunicienne dans laquelle ils étaient cantonnés.
Évidemment, il arrive que les événements débordent du cadre dans lequel on voulait les contenir. Il arrive que l’imprévu surgisse dans l’histoire : tout était supposé se passer d’une certaine manière, puis le peuple inflige une mauvaise surprise aux élites. Il arrive que le peuple s’entiche d’un vilain. Si jamais les opposants fondamentaux se rapprochent du pouvoir, on mobilisera la mémoire des pires horreurs de l’histoire humaine pour alerter le peuple contre ces dangereux corsaires. Et si jamais, par le plus grand malheur, ils parviennent à gagner politiquement une bataille, même en suivant les règles prescrites par le système idéologique, par exemple un référendum visant à sortir leur pays de l’Union européenne, on cherchera à neutraliser leur victoire, à la renverser et on fera preuve d’une immense violence psychologique et médiatique à l’endroit du peuple qui se serait laissé bluffer par les démagogues.
De ce point de vue, on l’aura compris depuis le 24 juin, les Brexiters sont considérés comme des opposants fondamentaux, contre qui tout est permis. Leur victoire a frappé le système idéologique dominant dans ses fondements. Il faut donc annuler le référendum, le désamorcer politiquement, mettre en place un récit qui transforme un choix démocratique en aberration référendaire qui ne devrait pas hypothéquer l’avenir. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on peut être assurés que nos élites feront tout pour mater ce qu’il considère comme une rébellion inadmissible de la part de ceux qu’ils tenaient pour des proscrits et des malotrus. Pour nos élites, le référendum n’est qu’un accident : c’est un mauvais moment à traverser. Ne doutons pas de leur résolution à faire tout ce qu’il faut pour reprendre la situation en main. •
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d' Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.
Le blog de Mathieu Bock-Côté

 Ils disaient : nous sommes en guerre. Etat d'urgence. Nous contrôlons. Nous déjouons. Ça va mieux. Mais l'ennemi principal c'est évidemment le FN. Dur, mais nous maîtrisons. Nous avons pris toutes les précautions. Comptez sur nous. Restons généreux et ouverts. Vive la France qui saura résister et se montrera à la hauteur de sa vocation.
Ils disaient : nous sommes en guerre. Etat d'urgence. Nous contrôlons. Nous déjouons. Ça va mieux. Mais l'ennemi principal c'est évidemment le FN. Dur, mais nous maîtrisons. Nous avons pris toutes les précautions. Comptez sur nous. Restons généreux et ouverts. Vive la France qui saura résister et se montrera à la hauteur de sa vocation.
 C’est le 14 juillet. La fête nationale de la France. Un pays magnifique, qui a marqué pour le mieux l’histoire de l’humanité.
C’est le 14 juillet. La fête nationale de la France. Un pays magnifique, qui a marqué pour le mieux l’histoire de l’humanité.



 Le conseil municipal de Thionville en Lorraine a décidé de changer la dénomination de la place du Marché située au centre de la ville, et de la nommer dorénavant « Place Anne Grommerch », du nom du député du lieu, décédée en avril dernier après avoir été maire de 2015 à 2016. Et ce, contre l’avis d’une grande partie des habitants de cette ancienne cité, qui se sont mobilisés pour refuser cette modification arbitraire. En effet, cette place se nomme ainsi depuis sa construction, à l’époque où Thionville était terre d’Empire, et les pouvoirs successifs à travers les annexions depuis 1559 ont conservé cette appellation, symbole d’identité et de permanence de cette ancienne commune foraine.
Le conseil municipal de Thionville en Lorraine a décidé de changer la dénomination de la place du Marché située au centre de la ville, et de la nommer dorénavant « Place Anne Grommerch », du nom du député du lieu, décédée en avril dernier après avoir été maire de 2015 à 2016. Et ce, contre l’avis d’une grande partie des habitants de cette ancienne cité, qui se sont mobilisés pour refuser cette modification arbitraire. En effet, cette place se nomme ainsi depuis sa construction, à l’époque où Thionville était terre d’Empire, et les pouvoirs successifs à travers les annexions depuis 1559 ont conservé cette appellation, symbole d’identité et de permanence de cette ancienne commune foraine. 

 Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.
Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.
 Une des originalités de l'Action française est d'être un mouvement tout à fait laïc mais qui a joué un rôle central dans l'histoire de l'Église. Non seulement le parcours de l'AF dans le siècle est jalonné par des événements en rapport avec le catholicisme (défense des églises pendant les inventaires, polémique avec le Sillon, condamnation romaine) mais encore la condamnation de 1926 est une date-clé dans l'histoire de l'Église elle-même. Même si ses motivations n'étaient pas seulement doctrinales (comme le montre la levée sans contrepartie de cette condamnation en 1939), ses conséquences, en reversant le rapport de force entre modernistes et conservateurs, non seulement pour l'Église de France mais pour l'Église universelle, se feront sentir jusqu'au concile Vatican II et à la tempête révolutionnaire qui le suivra.
Une des originalités de l'Action française est d'être un mouvement tout à fait laïc mais qui a joué un rôle central dans l'histoire de l'Église. Non seulement le parcours de l'AF dans le siècle est jalonné par des événements en rapport avec le catholicisme (défense des églises pendant les inventaires, polémique avec le Sillon, condamnation romaine) mais encore la condamnation de 1926 est une date-clé dans l'histoire de l'Église elle-même. Même si ses motivations n'étaient pas seulement doctrinales (comme le montre la levée sans contrepartie de cette condamnation en 1939), ses conséquences, en reversant le rapport de force entre modernistes et conservateurs, non seulement pour l'Église de France mais pour l'Église universelle, se feront sentir jusqu'au concile Vatican II et à la tempête révolutionnaire qui le suivra.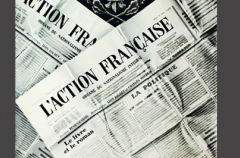 L'accusation la plus fréquente portée contre l'AF en cette matière serait d'avoir "instrumentalisé" l'Église. Cette idée, contredite par la formule de saint Pie X déjà citée, ne résiste pas à l'examen. Maurras voit dans le catholicisme la composante principale de l'identité morale, esthétique et spirituelle de la nation française et, au-delà de la France, il identifie catholicisme et civilisation parce que l'Église a opéré dans l'expression de ses dogmes comme dans sa structure hiérarchique et ses rites, la synthèse de l'héritage helléno-latin et du christianisme. On est loin de la conception voltairienne d'une Église-gendarme, tout juste bonne pour le petit peuple !
L'accusation la plus fréquente portée contre l'AF en cette matière serait d'avoir "instrumentalisé" l'Église. Cette idée, contredite par la formule de saint Pie X déjà citée, ne résiste pas à l'examen. Maurras voit dans le catholicisme la composante principale de l'identité morale, esthétique et spirituelle de la nation française et, au-delà de la France, il identifie catholicisme et civilisation parce que l'Église a opéré dans l'expression de ses dogmes comme dans sa structure hiérarchique et ses rites, la synthèse de l'héritage helléno-latin et du christianisme. On est loin de la conception voltairienne d'une Église-gendarme, tout juste bonne pour le petit peuple !
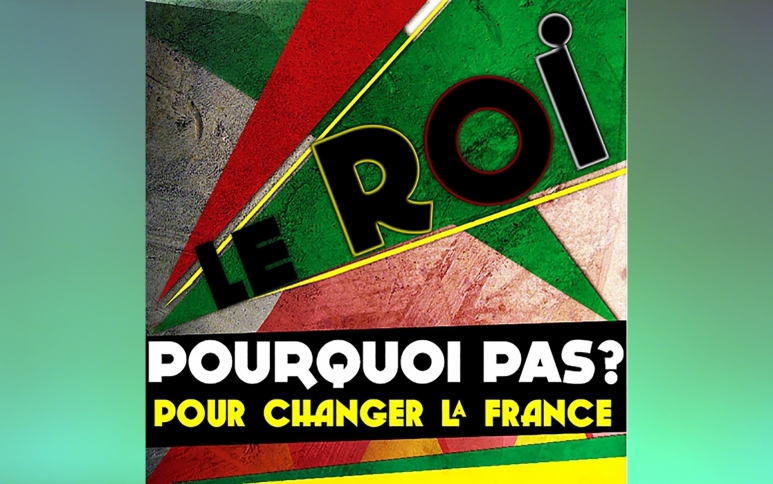
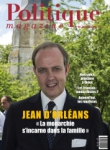



 Etrange, étrange. Les Français sont républicains, et le proclament sur tous les tons. Leurs pensées sont républicaines, leurs institutions sont républicaines, tout comme leur devise nationale. Dans ce pays, tout doit être républicain pour bénéficier d'une vraie légitimité politique, intellectuelle et morale. Le seul ordre valable est l'ordre républicain, la seule bonne école est l'école républicaine, les seuls partis autorisés à gouverner sont les partis républicains. C'est le triomphe, et même l'apothéose, de la République.
Etrange, étrange. Les Français sont républicains, et le proclament sur tous les tons. Leurs pensées sont républicaines, leurs institutions sont républicaines, tout comme leur devise nationale. Dans ce pays, tout doit être républicain pour bénéficier d'une vraie légitimité politique, intellectuelle et morale. Le seul ordre valable est l'ordre républicain, la seule bonne école est l'école républicaine, les seuls partis autorisés à gouverner sont les partis républicains. C'est le triomphe, et même l'apothéose, de la République.
 On les avait accusés de démagogie, de surfer sur les peurs. On les avait accusés d'avoir menti pendant la campagne pour le «leave». On avait même laissé entendre qu'ils avaient armé le bras du meurtrier de Jo Cox.
On les avait accusés de démagogie, de surfer sur les peurs. On les avait accusés d'avoir menti pendant la campagne pour le «leave». On avait même laissé entendre qu'ils avaient armé le bras du meurtrier de Jo Cox.
 Ce drapeau a été créé il y a 2 ans par le blog de La Couronne qui avait lancé auprès de ses lecteurs une souscription afin de faire réaliser par la Maison des Drapeaux, un nouveau drapeau royal de France : Bleu , Blanc, Rouge, avec, en son sein, le blason royal de France. Fort du très grand succès de ces deux souscriptions, La Maison des Drapeaux a alors décidé l’année dernière de le commercialiser à son tour sur son site internet.
Ce drapeau a été créé il y a 2 ans par le blog de La Couronne qui avait lancé auprès de ses lecteurs une souscription afin de faire réaliser par la Maison des Drapeaux, un nouveau drapeau royal de France : Bleu , Blanc, Rouge, avec, en son sein, le blason royal de France. Fort du très grand succès de ces deux souscriptions, La Maison des Drapeaux a alors décidé l’année dernière de le commercialiser à son tour sur son site internet.
 « Quelle haine, quelle rage de la part des européistes. Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Au lendemain du Brexit, j’avais fait une conférence de presse en disant aux Français : écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent et vous verrez, alors, le vrai visage de l’Union européenne et de ses défenseurs. » C’est par ces paroles que Marine Le Pen s’adressait à ses collègues du Parlement européen mardi 5 juillet.
« Quelle haine, quelle rage de la part des européistes. Merci, mes chers amis, de montrer votre vrai visage. Au lendemain du Brexit, j’avais fait une conférence de presse en disant aux Français : écoutez-les bien, regardez-les bien dans les jours qui viennent et vous verrez, alors, le vrai visage de l’Union européenne et de ses défenseurs. » C’est par ces paroles que Marine Le Pen s’adressait à ses collègues du Parlement européen mardi 5 juillet. Tout comme Rivarol (le style en moins), Cohn-Bendit n’a jamais fait dans la nuance, et enchaîner sur la faute du peuple britannique, après cette évocation du nazisme, il fallait quand même oser : « Et quand les Anglais savent qu’ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 52 % pour le Brexit, maintenant 10 à 20 % des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments d’un Montebourg complètement crétin contre les peuples… »
Tout comme Rivarol (le style en moins), Cohn-Bendit n’a jamais fait dans la nuance, et enchaîner sur la faute du peuple britannique, après cette évocation du nazisme, il fallait quand même oser : « Et quand les Anglais savent qu’ils se sont trompés, le peuple anglais a voté à 52 % pour le Brexit, maintenant 10 à 20 % des Brexitiens, ils le regrettent. Donc, faisons attention avec ces arguments d’un Montebourg complètement crétin contre les peuples… »