On conviendra que le sujet est suffisamment important pour que l'on s'y arrête quelques instants : voici donc une sorte de « page Education », aujourd'hui, sur Lafautearousseau, avec une étude fouillée des causes du désastre, pour commencer, suivie d'un sourire - mais bien vu, et profond, lui aussi - pour ne pas trop perdre le moral.
Nos lecteurs connaissent bien SOS Education, que nous citons régulièrement ici, pour la pertinence et la justesse de ses analyses, ainsi que pour le courageux combat mené contre les démolisseurs de l'Ecole. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore l'Association, ou qui souhaiteraient l'aider, trouveront tout ce qu'il faut en cliquant sur le lien hypertexte ci dessus.
Voici l'un des derniers textes publiés par SOS Education (le 12 décembre), sur L'Eglise du pédagogisme, et les ravages de cette secte des pédagogistes. LFAR
Elle a son Pape émérite : Philippe Meirieu,
Elle a sa Théologie : les « sciences de l’éducation »,
Elle a ses Séminaires : les ESPÉ (ex-IUFM) ,
Elle a son Saint-Office : les Inspecteurs généraux, relayés par une piétaille d'inquisiteurs subalternes dans les académies,
Son dogmatisme et son intolérance ont déjà fait des millions de victimes parmi nos enfants...
... mais elle ne cesse d'étendre son emprise sur un nombre croissant de professeurs :
l’Église du pédagogisme, la religion qui ruine depuis 40 ans l’Éducation nationale… et menace désormais l’avenir même de notre pays.
Une secte coupée de la réalité
Si l'enfant de vos voisins rencontre des difficultés à l'école, et si vous proposez de lui donner quelques cours de soutien, vous trouverez normal que ses parents souhaitent avoir une discussion avec vous sur votre programme et vos méthodes.
Après quelques mois, si vos voisins s’aperçoivent que leur enfant ne s'améliore pas, mais rencontre au contraire encore plus de problèmes, qu’il éprouve des difficultés à faire des exercices simples, vous vous attendrez à ce qu’ils vous demandent de remettre en question vos pratiques.
Vous-même, soucieux du bien-être de votre petit élève, et de conserver la confiance de ses parents, vous chercherez à ne pas les décevoir. Vous essaierez de leur expliquer le plus simplement possible vos choix d'enseignement. Vous les tiendrez informés de ce que vous faites, pour qu’ils comprennent votre façon de travailler et qu’ils soient au plus vite rassurés par les progrès de leur enfant.
Ce n’est pas du tout comme ça que les membres de l’Église du pédagogisme voient l’éducation.
L’Église du pédagogisme rassemble des personnes qui se croient investies d’une mission :« changer l’école pour faire changer la société » [1]. Enseignants, inspecteurs, formateurs, ils sont quelques milliers, mais ils tiennent toutes les clés de l’Éducation nationale.
Les enfants sont le matériau brut sur lequel ils travaillent pour réaliser ce projet. Ils considèrent les familles comme leur principal obstacle, et les professeurs qui dispensent un enseignement en harmonie avec ce que désirent les parents comme des traîtres ou des hérétiques. Ils ont inventé un vocabulaire qui n’est compréhensible que par les initiés, pour mieux couper l'école du reste de la société.
Tous les futurs enseignants passent par leurs séminaires, les ESPÉ. Là, ils apprennent le langage du pédagogisme. Ils intègrent les dogmes de l’Église du pédagogisme. Ces dogmes, qui ne sont fondés sur aucune démarche rationnelle, leur sont présentés sous la forme de paraboles. Par exemple : « Quand on va chez le boulanger, on ne lui explique pas comment faire le pain. De même, quand des parents mettent leur enfant à l’école, ils n’ont pas à savoir comment le professeur enseigne. »
Avec ses quelques milliers d'adeptes militants, l’Église du pédagogisme est plus petite que les Témoins de Jéhovah en France, par exemple. Mais son influence sur la société est beaucoup plus puissante et dangereuse puisqu’ils occupent les postes de pouvoir de l’Éducation nationale, qu’ils ont carte blanche pour y faire à peu près ce qu’ils veulent, et qu’ils n’ont de comptes à rendre à personne.
Ce sont eux qui rédigent les programmes scolaires et prescrivent discrètement les livres de classe de nos enfants. Ce sont encore eux qui mènent les expérimentations, les évaluent et qui inventent les nouvelles méthodes. Plus grave encore, ce sont eux qui inspectent les professeurs, et qui leur imposent leur manière de penser et d’enseigner, une manière dont les conséquences sont souvent, on le verra, désastreuses.
Car en effet, grâce à ses réseaux dans certains grands syndicats de l’Éducation nationale, l’Église du pédagogisme a organisé un système redoutable pour filtrer l’accès aux postes influents. Plus on monte dans la hiérarchie de l’Éducation nationale, plus la foi dans les dogmes du pédagogisme est répandue et enracinée. Quand on arrive au niveau des inspecteurs et des formateurs en ESPÉ, on se trouve parfois face à de véritables ayatollahs.
Instituer une nouvelle religion
Les membres de l’Église du pédagogisme sont, comme tous les fanatiques, complètement indifférents à la réalité et aveuglés par leur foi. Si depuis les années 1970, date à laquelle ils ont commencé à se rassembler, ils ont promu d’innombrables réformes pédagogiques qui ont invariablement tourné au désastre, ils sont sincèrement convaincus que l’Éducation nationale marche de mieux en mieux. Et pour cause : apprendre à lire, écrire, compter et réfléchir aux enfants n'est pas du tout la mission qu'ils assignent à l'école.
Citons l’expérience des « maths modernes » de 1973, celle du « collège unique » de 1975, les méthodes de lecture globales tout au long des années 70 puis « idéovisuelles »[2] dans les années 80, l’histoire « thématique », la Loi Jospin de 1989 mettant « l’enfant au centre du système éducatif »[3], la création des IUFM en 1990, le nouveau Bac en 1995, le remplacement du corps des instituteurs par celui des « professeurs des écoles », et surtout, les réformes successives des programmes tout au long de cette période, jusqu'à la création du Conseil Supérieur en 2013 par Vincent Peillon, qui prétendait instituer une « Refondation de l'école » afin d'« arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel » [4] : si on prend ce projet au sérieux, cela suppose finalement de désapprendre aux enfants leur propre langue, ce que l'Éducation nationale s'emploie à réaliser par tous les moyens depuis 40 ans.
Il est vrai que Vincent Peillon représente la frange la plus illuminée de l’Église du pédagogisme, n'hésitant pas à déclarer : « Toute l’opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion » [5]. La ministre actuelle, Najat Vallaud-Belkacem, est incapable d'un tel degré d'élaboration théologique, mais elle est redoutablement douée pour la propagation du dogme, et aussi pour prononcer les excommunications.
Quoiqu'il en soit, ces bouleversements ont bien sûr débouché sur un recul prodigieux des connaissances maîtrisées par les élèves à la fin de leur scolarité, malgré l’allongement du nombre d’années d’études et l’explosion des dépenses du système éducatif.
En 2015, on a fait refaire à des élèves de CM2 une dictée de 5 ou 6 lignes qui avait été donnée en 1987. Il s’agissait d’un petit texte qui ne comptait aucune difficulté particulière. Déjà en 1987, le travail de sape avait considérablement affaibli le niveau des enfants, qui faisaient à cette dictée une dizaine d'erreurs. Mais en appliquant le même barème de notation en 2015, on a constaté que le nombre moyen de fautes était passé à 17,8 : soit une explosion de + 70% !
Dans les années 90, les élèves français figuraient encore dans le groupe de tête des pays du monde en mathématiques. En novembre dernier, le comparatif international TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) a attribué à la France, à partir de tests réalisés sur des élèves de CM1 et de Terminale S la dernière position en Europe, et de très loin.
L'enquête internationale PISA, qui compare les systèmes éducatifs de nombreux pays du monde, vient par ailleurs de montrer que la France, qui ne cesse de sombrer dans les fonds du classement, est le seul pays développé où l'école amplifie les inégalités sociales et migratoires !
Malgré ces faits accablants, les prélats de l’Église du pédagogisme expriment la plus grande satisfaction chaque fois qu’ils font le bilan de quarante années de réformes.
Pour justifier les problèmes que tout le monde constate et qu’ils ne peuvent pas nier, sous peine de se ridiculiser – indiscipline, violence à l’école, illettrisme, chômage de masse des jeunes diplômés, pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans de nombreux secteurs – ils ont une réponse automatique : c’est parce qu’on n’est pas allé assez loin. Et si on n’est pas allé assez loin, c’est parce qu’on ne leur a pas donné les moyens.
Les moyens, comprenez « des budgets et des postes supplémentaires ». En effet, l’Église du pédagogisme doit notamment son influence au soutien de certains syndicats d’enseignants, et cela fait partie du contrat qu’elle appuie leurs revendications. Une clause facile à observer d’ailleurs, puisque tous ses membres sont directement intéressés par les succès des syndicats pour augmenter le nombre de postes dans l’Éducation nationale. Chaque nouvelle hausse d’effectifs venant automatiquement remplir ses séminaires, les ESPÉ !
Si les méthodes des pédagogistes sont, selon eux, mieux adaptées aux enfants, elles sont nettement plus coûteuses. De combien ? Ils ne nous ont jamais donné de chiffre. Tout ce qu’on sait aujourd’hui, c’est que nous sommes encore très loin d’avoir mis assez d’argent sur la table. La bonne volonté des Français n’est pourtant pas en cause. Depuis trente ans, ils acceptent chaque année de financer l’augmentation du coût de leur système scolaire. Le budget de l’Éducation nationale a plus que doublé, en euros constants, depuis les années 80. On pourrait demander à quoi sert tout cet argent, premier poste de la dépense publique ?
Mais l'Église du pédagogisme a peu à peu réussi à imposer ses vaches à lait comme des vaches sacrées : par exemple les ZEP (ou REP). Les ZEP démontrent depuis des décennies par l’absurde que, si les méthodes d’enseignement sont mauvaises, dépenser plus ne sert à rien. Pourtant, des milliards y sont engloutis dedans chaque année, et pas un ministre n'osera y toucher, même si on n’y observe pas la moindre « réduction des inégalités », bien au contraire. Les ZEP n’ont jamais été aussi redoutées par les parents : n’y laissent leurs enfants que les familles qui n’ont strictement aucune autre possibilité, pendant que les membres de l'Église du pédagogisme regroupent leurs rejetons dans des écoles privées où l'on n'entre que sur recommandation. Qu'importe : à la moindre tentative de mettre un terme à ce gaspillage scandaleux, l’Église du pédagogisme lancera ses mots d’ordre, et ses adeptes emboîteront une nouvelle fois le pas de son clergé dans leur traditionnel pèlerinage de République à la Nation, avec chants, bannières, et grande ferveur apostolique.
« Apprendre à apprendre »
L’Église du pédagogisme se compose de toutes les personnes qui croient qu’éduquer un enfant ne consiste pas à lui apprendre des choses, mais à lui « apprendre à apprendre » pour lui permettre de « construire lui-même son savoir ». Elle vise donc à interrompre la chaîne de la transmission des connaissances, par laquelle la culture se transmet d’une génération à l’autre.
Laissant les enfants « construire eux-mêmes leurs savoirs », elle espère ainsi qu’ils construiront un monde nouveau, radicalement différent de celui de leurs parents. C’est le sens de son slogan « Changer l’école pour changer la société ».
Évidemment, cette démarche est parfaitement hypocrite car, derrière ce discours officiel neutre, il y a un projet précis. Il n’est absolument pas question de laisser les enfants construire le monde qu’ils veulent.
S’ils se refusent à transmettre la culture classique aux enfants, ils ne se privent pas en revanche, de leur transmettre les « valeurs » qui, selon eux, devront façonner la nouvelle société. La tradition républicaine d’enseignement fondée par Jules Ferry voulait que les maîtres s’interdisent toute considération politique devant leurs élèves. Tous leurs efforts consistaient à leur transmettre un contenu factuel. Les pédagogistes au contraire ne veulent plus du contenu factuel. Et ils ont vigoureusement promu dans les écoles les matières et activités qui permettent d’influencer les valeurs des enfants. Ainsi, dès la grande section de maternelle, ils demandent aux enseignants d’organiser chaque semaine une demi-heure de débat sur des sujets de société. Officiellement, le but de ces débats est d’entraîner les enfants à l’exercice de leur liberté d’expression, pour faire « vivre la démocratie ». Dans les faits, les enfants étant incapables de prendre position, et encore plus d’argumenter, l’enseignant dirige lui-même le débat. Il énonce les arguments et récite, parfois inconsciemment, le catéchisme pédagogiste appris pendant son séminaire dans les ESPÉ. Les enfants manipulés s’approprient le raisonnement d’autant plus facilement qu’on leur fait croire qu’ils y sont arrivés tout seuls. Ces débats ont lieu tout au long de l’école primaire, l’Église du pédagogisme a inventé pour justifier ce genre d'activité destinée à remplacer l'instruction traditionnelle le concept de « vivre-ensemble ».
L’éducation civique est une matière fortement exploitée par les pédagogistes pour influencer politiquement les élèves. Beaucoup de parents croient, à tort, que les cours d’éducation civique s’apparentent à « l’enseignement du civisme » : encourager les enfants à faire preuve de courage, de patience, de prudence, de générosité, de respect, de justice, etc. En fait, « l’ éducation civique » enseigne aux enfants leurs droits, et pas n’importe lesquels : la liberté d’expression dans les limites de la bien-pensance, le droit de contester une décision qu'ils trouvent injuste, le droit de se syndiquer, le droit de grève, les « droits sociaux » (RSA, logements sociaux, CMU, etc.) On y trouve désormais aussi de la propagande à caractère sexuel. Mais nulle part il n’est question d’enseigner aux enfants les vertus civiques.
Les autres matières, comme la littérature, l’histoire et la géographie sont aussi fortement contaminées. Les enfants doivent « construire leurs propres savoirs » dans ces matières à partir de documents. C’est documents sont distribués en classe ou figurent dans leurs manuels. Ils doivent les observer et en tirer des conclusions. Ici, le prétexte est de leur enseigner la « méthode » littéraire, historique ou géographique, plutôt que de leur enseigner directement la littérature, l’histoire et la géographie. Ceci afin, soi-disant, qu’ils soient capables de continuer à étudier seuls ces matières une fois qu’ils auront quitté l’école. En réalité, le piège est le même que dans les « débats » pipés qu’on fait faire aux enfants de maternelle : le choix des documents donnés à l’élève permet de dicter d’avance les conclusions auxquelles il va aboutir, tout en lui donnant l’impression d’y être arrivé tout seul. Cela permet de faire des cours, et des manuels, d’où la rigueur la plus élémentaire est absente. Et personne ne peut s’en offusquer puisque les erreurs, simplifications et omissions n’apparaissent nulle part de façon trop évidente.
Jusqu’aux années soixante, les élèves apprenaient l’histoire dans des manuels qui racontaient l’enchaînement des événements historiques. Selon la classe, l’histoire était racontée avec plus ou moins de précision. Mais dès le cours moyen (les CM1 et CM2 actuels), les manuels détaillaient assez les événements pour que les élèves puissent les comprendre avec une certaine finesse. Et, si le manuel contenait des erreurs, elles étaient évidentes et remarquées. L’éditeur avait intérêt à les corriger s’il ne voulait pas perdre sa réputation et sa clientèle.
Sous la pression des pédagogistes, les manuels sont devenus des recueils de documents, où le cours n’occupe plus, même dans les matières littéraires, que 10 à 15 % de l’espace. De nombreuses leçons se résument donc à l’observation de documents, d’où les élèves doivent tirer leurs propres conclusions. C’est bien sûr la porte ouverte à d’innombrables manipulations, afin de faire rentrer dans l'esprit des élèves une idéologie de repentance et de défiance par rapport à leur héritage culturel.
Les enfants d'immigrés premières victimes
La volonté des pédagogistes de couper la chaîne de la transmission du savoir explique leurs ambitions malsaines concernant les enfants d’immigrés. Jusqu'à la création de leur Église, la conception dominante en France était que tous les enfants se trouvaient dans une filiation intellectuelle et spirituelle qui faisaient d’eux, qu’ils soient blancs, jaunes ou noirs, des héritiers de la culture gréco-latine, fécondée par le christianisme et l’esprit des Lumières. Cette idée était résumée par la fameuse phrase que tous apprenaient : « Nos ancêtres les Gaulois ». On a beaucoup ironisé sur le fait que les petits africains aient appris cette contrevérité historique évidente. Mais on aurait pu dire la même chose de presque tous les Français du début du XXe siècle, qui descendaient bien plus des Germains, des Latins et des Normands que des Gaulois. En réalité, cette phrase « Nos ancêtres les Gaulois » exprimait l’ouverture et la générosité d’une école qui avait l’ambition d’amener tous les enfants à la connaissance la plus approfondie possible de l’héritage culturel humaniste. Personne ne pensait qu’il fallait priver certains enfants de cet héritage, sous prétexte que leur ascendance « biologique » remontait ailleurs que vers Platon, Aristote, Descartes et Kant.
Mais les pédagogistes, eux, ont vu dans les petits immigrés l’alibi idéal pour qu’on arrête de transmettre la culture humaniste aux enfants. Présentant la pensée occidentale comme la culture exclusive des petits blancs, ils ont fait pression pour que les programmes scolaires soient réécrits en tenant compte des apports de toutes les autres cultures, avec comme argument massue que des héritiers de ces autres cultures étaient maintenant présents dans presque toutes les classes.
Ce fut le début du plus grand hold-up culturel jamais subi par une génération. Sous prétexte d’ouverture, les programme scolaires, qui étaient des modèles de cohérence et de progression logique, se sont fermés à la culture classique. Il sont devenus des fourre-tout dans lesquels sont sans cesse introduites des nouveautés, au fur et à mesure qu’apparaissent de nouvelles modes[7]. Les élèves sont donc privés de l’héritage que leurs parents, et bien sûr les pédagogistes eux-mêmes, ont reçu à pleines mains de leurs professeurs. Mal formés, ou pas formés du tout, incapables de pensée critique, ils en deviennent extrêmement perméables aux idéologies. C’est peut-être une explication de la radicalisation de la jeunesse sur certains sujets religieux ou politiques, alors que leurs aînés sont beaucoup plus mesurés. Mais évidemment, cette défaite de la pensée est vue comme une immense victoire par l’Église du pédagogisme. Elle ne pouvait pas rêver, il y a trente ans, d’un si complet triomphe de son nihilisme.
On comprend dès lors les causes de l’intolérance des pédagogistes vis-à-vis des parents et des professeurs attachés aux méthodes classiques d’éducation. Ce qu’ils mettent en cause, ce n’est pas l’efficacité de ces méthodes pour enseigner des choses aux enfants. C’est l’objectif lui-même qu’ils contestent. Car transmettre aux enfants la culture, c’est mettre en péril leur projet de construire l’homme nouveau qui fera la société nouvelle.
Leur opposition aux méthodes d’enseignement classiques est politique. C’est ce qui explique la violence avec laquelle ils luttent contre leurs adversaires.
De leur côté, les « adversaires » en question, parents ou professeurs, ne comprennent pas. Pour eux, la question des méthodes n’est pas idéologique. Leur but n’est pas de changer la société. Ils veulent juste que leurs enfants apprennent des choses intéressantes, sans trop les forcer si possible. Ils cherchent donc à savoir quelle est la méthode la plus efficace. Ils interprètent simplement l’agressivité des pédagogistes comme un signe du fait qu’ils croient vraiment en l’efficacité de leurs méthodes. Et face à une telle détermination, ils se laissent parfois convaincre, même s’ils n’ont aucune bonne raison de les croire.
Tant qu’ils ne s’aperçoivent pas que les pédagogistes s’opposent à leurs méthodes pour des raisons politiques, ils ne luttent ni avec les mêmes armes, ni avec la même détermination. Et ils perdent bataille après bataille.
C'est pour les rassembler et les mobiliser qu'existe SOS Education. •
[1] Voir les "Cahiers pédagogiques", un des principaux organes de l’Église du pédagogisme. Sur la page d’accueil, on peut lire « Changer l’école pour changer la société ».
[2] Cette méthode part du principe que le lecteur reconnaît les mots comme les Chinois reconnaissent des idéogrammes, et apprend donc aux enfants à « photographier » les mots dans leur mémoire, plutôt que de leur apprendre les lettres.
[3] Par opposition à la transmission des savoirs. Le but de l’école, selon cette nouvelle loi d’orientation, ne devait plus être de transmettre des savoirs aux enfants, mais de leur permettre de s’épanouir en les encourageant à exprimer leurs besoins.
[4] Voir lexpress.fr, du 02/09/2012, Vincent Peillon pour l'enseignement de la "morale laïque".
[5] Une religion pour la République : la foi laïque de Ferdinand Buisson, Le Seuil, 2010.
[6] Il s’agit d’une technique psychologique bien connue, et très utilisée aussi dans les ESPÉ : pour obtenir l’adhésion d’une personne à une opinion donnée, il est beaucoup plus efficace de lui faire faire des activités ciblées pour la faire arriver sans qu’elle s’en rende compte à cette opinion, plutôt que de la lui imposer au moyen d’une argumentation rationnelle, même si celle-ci est convaincante.
[7] Voir en particulier, Le Chaos pédagogique, Philippe Nemo, Albin Michel, 1992. En 2016, ce livre n’a pas pris une ride.





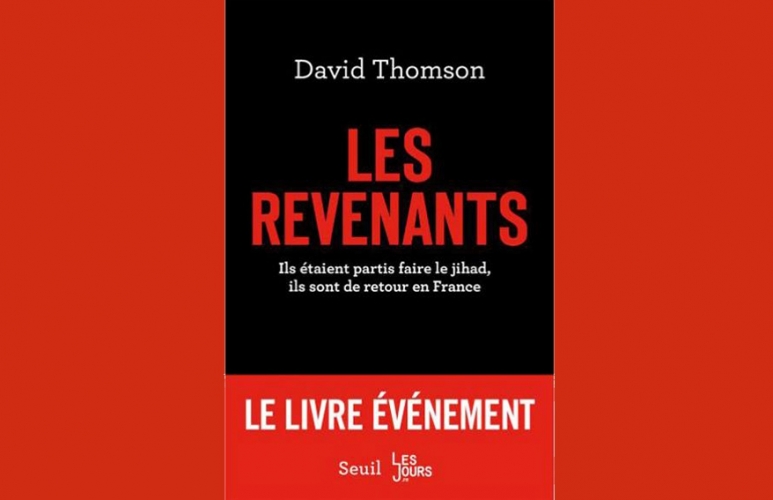



 Nous critiquons souvent, ici, la cléricature médiatique :
Nous critiquons souvent, ici, la cléricature médiatique :




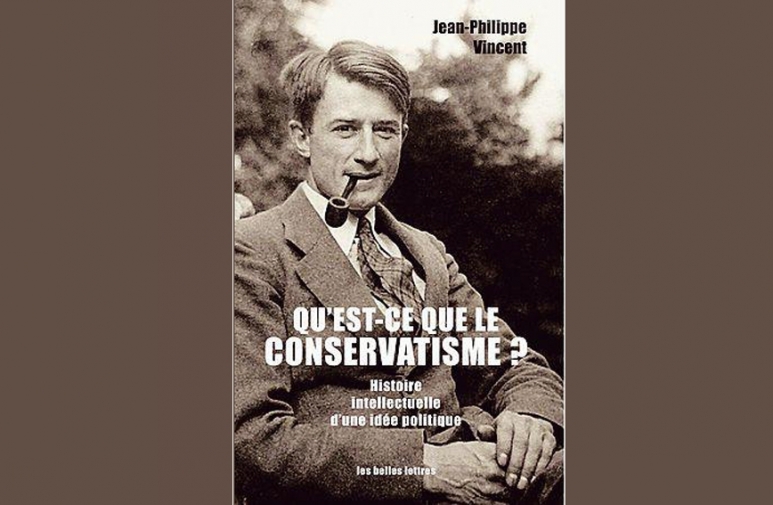
 Zemmour commente ici « une histoire didactique et passionnante du conservatisme, qui s'achèverait en supplément d'âme du libéralisme ». Une occasion pour lui de faire ressortir avec clarté et pertinence les « tensions » - c'est à dire, au fond, les contradictions - existant entre ces concepts, qui se voudraient alliés. Et les réalités politiques et sociales qu'elles engendrent. Encore faudrait-il s'entendre sur les mots. « Conservateur », pour commencer. Un mot qui n'a de sens ou de valeur que par son objet. Il avait un sens lorsque Comte lançait son « Appel aux conservateurs» [1855 !], un sens tout autre - ridicule et négatif - pour les nationalistes et monarchistes autour des années 1900. Vers 1980, Boutang pensait qu'il n'y avait déjà plus rien à conserver de notre société proprement dite - « qui n'a que des banques pour cathédrales ». Que voulons-nous conserver ? La modernité et ses avatars postmodernes ou la France profonde, la France historique, sa civilisation ? A travers son analyse des tensions entre capitalisme et libéralisme sous leurs traits d'aujourd'hui, Zemmour - comme Buisson - n'hésite pas à remonter au vrai clivage - sous quelque vocable qu'on les désigne - entre la France historique multiséculaire et celle opposée qui naît des Lumières et de la Révolution. Dans quel camp se situera de fait le courant qui se réclame aujourd'hui du conservatisme ? C'est bien là, à notre avis, la question de fond. Lafautearousseau
Zemmour commente ici « une histoire didactique et passionnante du conservatisme, qui s'achèverait en supplément d'âme du libéralisme ». Une occasion pour lui de faire ressortir avec clarté et pertinence les « tensions » - c'est à dire, au fond, les contradictions - existant entre ces concepts, qui se voudraient alliés. Et les réalités politiques et sociales qu'elles engendrent. Encore faudrait-il s'entendre sur les mots. « Conservateur », pour commencer. Un mot qui n'a de sens ou de valeur que par son objet. Il avait un sens lorsque Comte lançait son « Appel aux conservateurs» [1855 !], un sens tout autre - ridicule et négatif - pour les nationalistes et monarchistes autour des années 1900. Vers 1980, Boutang pensait qu'il n'y avait déjà plus rien à conserver de notre société proprement dite - « qui n'a que des banques pour cathédrales ». Que voulons-nous conserver ? La modernité et ses avatars postmodernes ou la France profonde, la France historique, sa civilisation ? A travers son analyse des tensions entre capitalisme et libéralisme sous leurs traits d'aujourd'hui, Zemmour - comme Buisson - n'hésite pas à remonter au vrai clivage - sous quelque vocable qu'on les désigne - entre la France historique multiséculaire et celle opposée qui naît des Lumières et de la Révolution. Dans quel camp se situera de fait le courant qui se réclame aujourd'hui du conservatisme ? C'est bien là, à notre avis, la question de fond. Lafautearousseau  Si la victoire de François Fillon en a étonné plus d'un, ce n'est pas seulement parce que peu de gens pouvaient imaginer que « Mister Nobody » s'immiscerait dans le combat de coqs entre Sarkozy et Juppé, mais aussi, et surtout, parce que son programme était à la fois le plus libéral (en économie) et le plus conservateur (sur les mœurs), ce qui paraissait doublement incompatible avec la France. L'affaire semblait entendue depuis belle lurette : notre pays aimait trop l'État pour être libéral, aimait trop l'égalité pour tolérer la liberté, aimait trop la Révolution pour avoir le respect des traditions, et tenait le travail, la famille et la patrie pour des valeurs maudites depuis Vichy. Les augures ont eu tort. Un conservatisme libéral semble renaître en France dans le sillon de Fillon, qui paraissait embaumé sous le masque poussiéreux et oublié de Guizot ou de Renan.
Si la victoire de François Fillon en a étonné plus d'un, ce n'est pas seulement parce que peu de gens pouvaient imaginer que « Mister Nobody » s'immiscerait dans le combat de coqs entre Sarkozy et Juppé, mais aussi, et surtout, parce que son programme était à la fois le plus libéral (en économie) et le plus conservateur (sur les mœurs), ce qui paraissait doublement incompatible avec la France. L'affaire semblait entendue depuis belle lurette : notre pays aimait trop l'État pour être libéral, aimait trop l'égalité pour tolérer la liberté, aimait trop la Révolution pour avoir le respect des traditions, et tenait le travail, la famille et la patrie pour des valeurs maudites depuis Vichy. Les augures ont eu tort. Un conservatisme libéral semble renaître en France dans le sillon de Fillon, qui paraissait embaumé sous le masque poussiéreux et oublié de Guizot ou de Renan.
 Dimanche soir, France 2 a diffusé le film de Quentin Tarantino « Le commando des bâtards » (en étatsunien : « Inglourious basterds »). On ne fera pas ici une critique cinématographique de l'œuvre, on se bornera seulement à s'arrêter sur un point bien précis.
Dimanche soir, France 2 a diffusé le film de Quentin Tarantino « Le commando des bâtards » (en étatsunien : « Inglourious basterds »). On ne fera pas ici une critique cinématographique de l'œuvre, on se bornera seulement à s'arrêter sur un point bien précis.
 François Hollande s'est moqué du monde : il n'a pas « pris la décision » de ne pas se représenter, il y a été contraint. Par son impopularité extrême et par les ambitions croisées, pressantes, assassines, des hommes de son clan, jusques et y compris parmi ses ministres et notamment le premier d'entre eux.
François Hollande s'est moqué du monde : il n'a pas « pris la décision » de ne pas se représenter, il y a été contraint. Par son impopularité extrême et par les ambitions croisées, pressantes, assassines, des hommes de son clan, jusques et y compris parmi ses ministres et notamment le premier d'entre eux.
 La construction, au pied de la Tour-Eiffel, de la cathédrale de la Sainte Trinité de Paris, avait été décidée en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine. C'était la fin d'un assez mauvais feuilleton sur l'utilisation qui serait faite de ce terrain : certains avaient même proposé d'y édifier une mosquée ! En ce lieu hautement symbolique de notre ville capitale, on nous permettra de nous réjouir de voir surgir de terre plutôt la croix des racines chrétiennes de l'Europe que le croissant d'une religion qui a agressé et envahi par deux fois cette même Europe, en 711 par l'Espagne, et en 1492 par Constantinople. Et qui lui fait la guerre aujourd'hui de la façon que l'on sait...
La construction, au pied de la Tour-Eiffel, de la cathédrale de la Sainte Trinité de Paris, avait été décidée en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine. C'était la fin d'un assez mauvais feuilleton sur l'utilisation qui serait faite de ce terrain : certains avaient même proposé d'y édifier une mosquée ! En ce lieu hautement symbolique de notre ville capitale, on nous permettra de nous réjouir de voir surgir de terre plutôt la croix des racines chrétiennes de l'Europe que le croissant d'une religion qui a agressé et envahi par deux fois cette même Europe, en 711 par l'Espagne, et en 1492 par Constantinople. Et qui lui fait la guerre aujourd'hui de la façon que l'on sait...


 Il a plus de quarante condamnations à son actif, ce voyou délinquant archi-multi récidiviste dont on n'a donné ni le nom ni le prénom (mais, après tout, c'est inutile, car on a très bien compris, par cette omission volontaire, de quel genre d'individu il s'agissait !) : viol sur mineur, incendies, cambriolages, rebellions, conduite sans permis... mais il était libre comme l'air ! Le dernier juge à l'avoir eu en face de lui a décidé, en effet, qu'il devait avoir sa chance. Et il l'a eue, sa chance. Résultat : le « véhicule a délibérément foncé sur les gendarmes, percutant violemment le major Rusig qui est tombé à terre », a déclaré à l'AFP le général Bernard Clouzot, commandant de la région de gendarmerie. Le major devait décéder quelques heures plus tard...
Il a plus de quarante condamnations à son actif, ce voyou délinquant archi-multi récidiviste dont on n'a donné ni le nom ni le prénom (mais, après tout, c'est inutile, car on a très bien compris, par cette omission volontaire, de quel genre d'individu il s'agissait !) : viol sur mineur, incendies, cambriolages, rebellions, conduite sans permis... mais il était libre comme l'air ! Le dernier juge à l'avoir eu en face de lui a décidé, en effet, qu'il devait avoir sa chance. Et il l'a eue, sa chance. Résultat : le « véhicule a délibérément foncé sur les gendarmes, percutant violemment le major Rusig qui est tombé à terre », a déclaré à l'AFP le général Bernard Clouzot, commandant de la région de gendarmerie. Le major devait décéder quelques heures plus tard...