A partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin du mois d'août, nous vous proposerons de découvrir, ou de mieux connaître, mais aussi de faire découvrir à d'autres (par le jeu des partages) l'immense Jacques Bainville, par le biais d'une photo quotidienne tirée de notre "Album Jacques Bainville" (lafautearousseau vous propose également un "Album Léon Daudet" et un "Album Charles Maurras").
Aujourd'hui : 2. L'Homme sans prénom
Surtout ne rien imposer; laissez-le libre; il choisira "librement" (!) quand il sera grand; l'enfant ne doit être en rien conditionné par ce - et ceux... - qui l'ont précédé....
Ces vieilleries des pédagogistes modernes (?) d'aujourd'hui, dont Philippe Meirieu est le pape, traînent en réalité depuis des décennies...
Avec sa "douce et paisible ironie" - pour reprendre sa propre expression, c'est cette "folie" que dénonce Jacques Bainville dans cette histoire de Tift....
"Quoiqu'elle vienne d'Amérique, cette histoire n'est pas d'Edgar Poe ni de Mark Twain. C'est une histoire tout à fait vraie.
Il y a, dans le commerce de New York, un représentant qui ne porte aucune espèce de prénom. Ce personnage s'appelle Tift, et il ne s'appelle que Tift. Ni les apôtres, ni les saints, ni les héros, ni les prophètes ne veillèrent à son baptême. Tift ne dépend ni de l'Ancien ni du Nouveau Testament., ni de l'antiquité grecque ni de l'antiquité romaine. Il ne se nomme même pas Sadi, comme feu le président Carnot. Tift reste Tift tout court, et c'est par là qu'il se distingue du commun des mortels et des très nombreux Tift qui foulent le sol de l'Amérique.
Chaque fois, cependant, que cette dérogation à un usage universel cause un désagrément, Tift raconte volontiers son aventure. Il a du la redire récemment à propos d'un conflit avec l'administration de son pays. Tift avait donc des parents qui professaient le plus profond respect pour la liberté humaine. Ayant engendré un fils, ils ne se reconnurent pas le droit de peser sur sa conscience. Tift devait n'avoir ni religion, ni préjugés. Il devait marcher vers l'avenir affranchi de toute entrave. C'est pourquoi les parents de Tift, après réflexion mûre, décidèrent de ne pas donner de prénom à leur fils. Ainsi évitaient-ils une responsabilité redoutable. Tift, quand il le voudrait, pourrait choisir les syllabes les plus harmonieuses à son gré.... Et son père et sa mère se réjouirent dans leur âme de leur prudente résolution.
Tift connut bientôt ce qu'il en coûte de ne s'appeler ni jean, ni Jacques, ni Edouard, ni Émile. Ses débuts dans le monde furent tumultueux. A l'école, son absence de pérnoms lui valut railleries et brimades, auxquels il répondait d'ailleurs par de solides horions. A sa majorité, lorqu'il s'agit pour Tift de s'inscrire sur les listes électorales et d'exercer ses droits de citoyen, le bureau lui refusa la délivrance de sa carte. Tift dut la revendiquer devant les tribunaux. Après de longues audiences, plaidoiries et consultations de droit, les juges reconnurent que rien dans la constitution ni dans les lois n'obligeait un citoyen à porter un prénom, pas même un nom. Tift majeur restait libre devant les hommes de s'appeler Tift comme devant ou d'ajouter à Tift l'ornement qui lui conviendrait.
Cependant, en présence du calendrier, pris d'hésitations et de doutes, Tift ne se pressait pas et ne décidait rien. Il lui vint alors une pensée délicate et ingénieuse. "Je contracterai mariage quelque jour, se dit-il, ma femme m'appliquera elle-même son prénom préféré."
Tift prit femme en effet, mais il se trouva que Mrs Tift n'avait jamais songé à l'esthétique des prénoms masculins. Elle n'aimait pas mieux Ernest que Guillaume. Et - telle est la vanité des femmes - trouvant original d'avoir pour mari le seul homme d'Amérique qui portât sec et nu le nom de son père, elle persuada Tift de rester, pour l'amour d'elle, un Tift unique entre tous les Tift de l'Union.
Ainsi, Tift mourra comme il a vécu, sans prénom ni grec, ni latin, ni hébreu, ni germanique. Et le principe d'où étaient partis les parents de Tift aura porté une conséquence imprévue. Se faisant scrupule d'attenter à la liberté de leur fils, ils ont pourtant, bon gré mal gré, disposé de ses destinées. On frémit quand on pense à ce qui serait arrivé si ces scrupules étaient nés quelques mois plus tôt dans l'esprit de ce père et de cette mère admirables : Tift n'aurait certainement pas vu la lumière. Car, pour respecter intégralement la liberté humaine, il importe de ne pas engendrer des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Témoin Chateaubriand qui maudissait le jour où sa mère lui avait "infligé la vie".
Il est d'ailleurs certain que les hommes ne seront vraiment libres et que la République ne sera vraiment fondée sur la terre qu'à partir du moment où chacun aura le droit de choisir ses parents. C'est la morale de l'histoire de Tift.
L'Action française, 22 janvier 1911

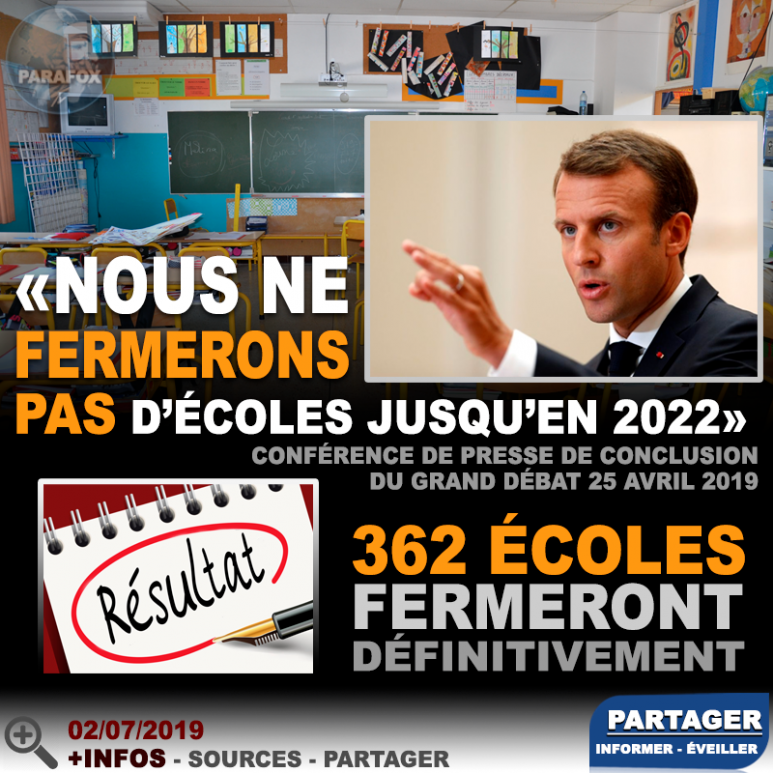




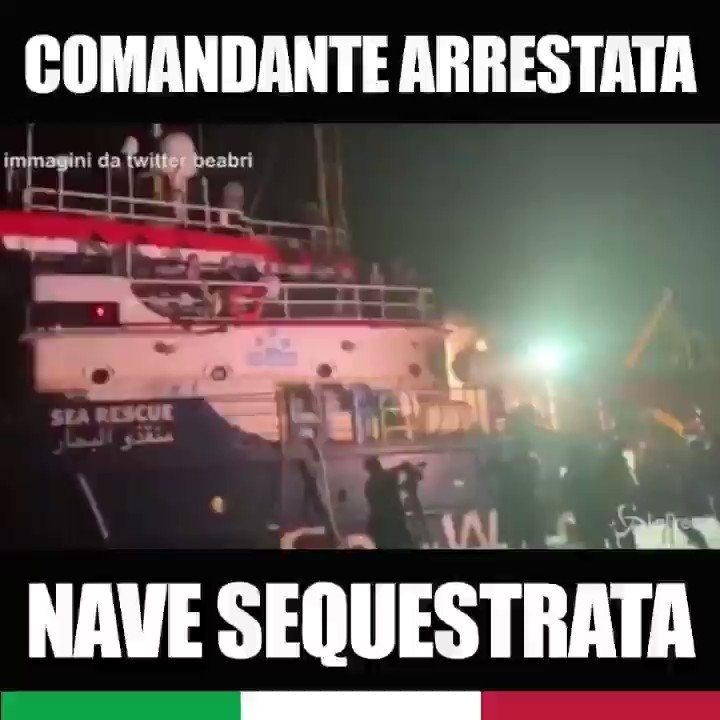

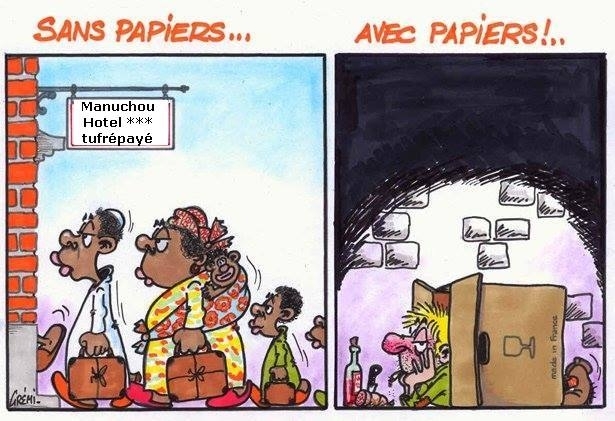





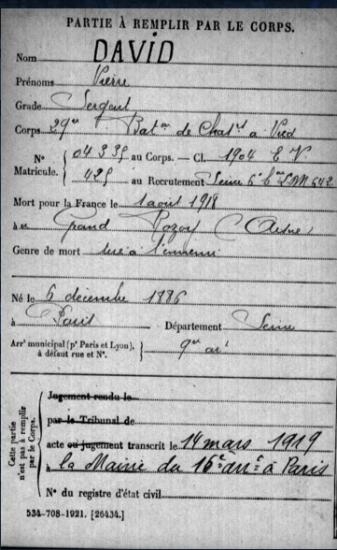
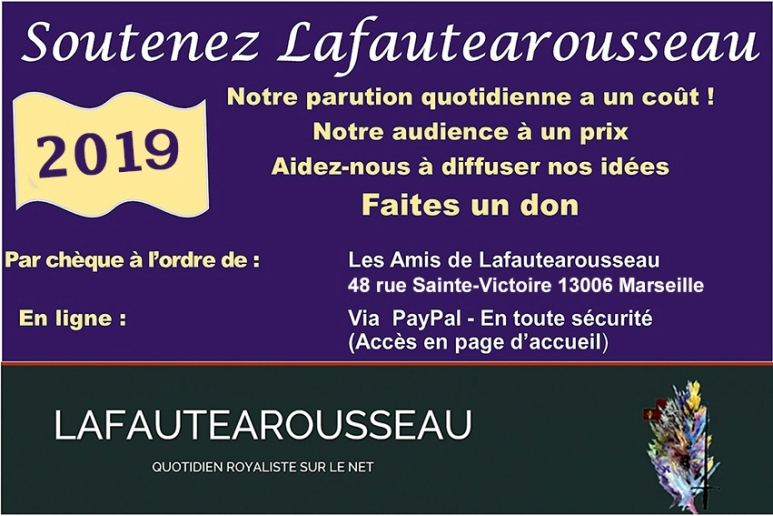



 On ne peut pas accepter que des documents estampillés « confidentiel défense » fuitent dans la presse (en l’occurrence des documents concernant les ventes d’armes à l’Arabie séoudite et aux Emirats Arabes Unis) ou que soit divulguée l’identité d’un membre des unités des forces spéciales (en l’occurrence un sous-officier de l'armée de l’air, nommé dans l’affaire Bennala). Mme Ndiaye, porte-parole du gouvernement a donc eu raison de rappeler (Europe 1, jeudi 23) qu’il est normal et « qu’un État protège un certain nombre de données nécessaires à des activité
On ne peut pas accepter que des documents estampillés « confidentiel défense » fuitent dans la presse (en l’occurrence des documents concernant les ventes d’armes à l’Arabie séoudite et aux Emirats Arabes Unis) ou que soit divulguée l’identité d’un membre des unités des forces spéciales (en l’occurrence un sous-officier de l'armée de l’air, nommé dans l’affaire Bennala). Mme Ndiaye, porte-parole du gouvernement a donc eu raison de rappeler (Europe 1, jeudi 23) qu’il est normal et « qu’un État protège un certain nombre de données nécessaires à des activité

