par Pascual Albert *
Publié le 13 novembre 2012 - Actualisé le 20 octobre 2017
 En moins de deux mois, des élections régionales se seront tenues en Galice, au Pays Basque et en Catalogne, les trois Communautés qui, les premières, ont obtenu l’autonomie et qui ont le plus de compétences, dans leurs Statuts d’Autonomie.
En moins de deux mois, des élections régionales se seront tenues en Galice, au Pays Basque et en Catalogne, les trois Communautés qui, les premières, ont obtenu l’autonomie et qui ont le plus de compétences, dans leurs Statuts d’Autonomie.
Si les élections au Pays Basque et en Galice étaient prévues et ont eu lieu parce que c’était le moment qu’elles se tiennent, les élections catalanes seront anticipées, le président Mas (1) ayant dissous le parlement, par une manœuvre opportuniste, résultat de la manifestation indépendantiste massive du 11 septembre, à Barcelone. Il prétend élargir sa majorité – jusqu’à la rendre absolue, si c’est possible – pour ne pas dépendre de l’appui parlementaire du Parti Populaire.
Dans les trois Communautés Autonomes (2), les partis d’implantation nationale sont présents : Parti Populaire ; socialistes et communistes ; ainsi que, bien sûr, tous les groupes nationalistes anti-espagnols de tous poils : Bloc Nationaliste de Galice, Parti Nationaliste Basque, Convergencia i Unio, Bildu, ERC, etc.
Les positions politiques des uns et des autres, quant au sens de la nation et quant aux structures de l’Etat, sont clairement différentes.
Le Parti Populaire (Droite « homologuée »), actuellement au pouvoir, en charge du gouvernement national, comme dans la plus grande partie des Communautés Autonomes et des Municipalités, défend catégoriquement la structure et les institutions actuelles, se refusant, dans les circonstances présentes, à faire des réformes qui, nécessairement, incluraient celle de la Loi Fondamentale : la Constitution. La priorité absolue du Parti Populaire est de tenter de surmonter la crise économique, en suivant les recommandations des institutions européennes et mondialistes. Malgré ses efforts, et la rigueur des mesures prises, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Le Parti Socialiste apparaît beaucoup plus ambigu et confus ; l’un de ses courants aurait une position assez proche du Parti Populaire, l’autre a commencé à demander la transformation de l’Espagne en un Etat fédéral. Cette ambiguïté fait qu’il lui est difficile de pouvoir profiter de l’importante usure gouvernementale dont la situation (crise, mesures sociales, corruption) fait supporter la conséquence à ses rivaux du Parti Populaire.
L’extrême-gauche communiste, qui est, par surcroît, écolo-pacifiste et « genderiste », recueille, en général, les désenchantés du socialisme et correspond, et même davantage, à la devise qu’elle porte, dans son âme, écrite en lettres de feu : « tout ce qui est anti-espagnol est nôtre ».
Les nationalistes de différentes tendances : bourgeois, prolétaires, modérés, radicaux, etc. ont fini par donner du lustre à leurs positionnements maximalistes et demandent des référendums d’autodétermination et autres processus qui puissent les conduire vers leur eldorado indépendantiste.
Les résultats électoraux sont conformes aux prévisions des enquêtes : en Galice, où, heureusement, le nationalisme ne parvient pas à se développer, le Parti Populaire, comme il était très probable, a validé sa majorité absolue, bien qu’il ait perdu un certain nombre de voix. Le Parti Socialiste a subi, comme prévu, une déroute complète.
Le Pays Basque, c’est une autre histoire et - quoique l’information distillée par les médias, tant nationaux qu’internationaux, se soit surtout concentrée sur la Catalogne, comme conséquence des derniers événements : le virage stratégique brutal de ce que l’on appelle le « nationalisme catalan modéré », et sa suite, la manifestation « indépendantiste » de Barcelone - il est certain que le plus grand problème institutionnel et politique que l’Espagne a connu ces dernières années a été le terrorisme de l’E.T.A. avec son sanglant cortège de morts, de blessés et de souffrances.
BILDU, parti ou coalition clairement inspirée et certainement dirigée par l’E.T.A., s’est présenté aux élections régionales dans le nouveau contexte quasi pacifique, l’E.T.A ayant annoncé, il y a déjà quelque temps, qu’elle renonçait à la « lutte armée », sans, pour autant, qu’elle se soit dissoute.
Lors des élections précédentes – sous différents noms – les radicaux se présentaient aux élections au milieu des bombes et des coups de feu. Déjà, lors des dernières élections municipales et « forales » – tenues dans ce contexte d’armistice ( ?) – ils avaient obtenu des résultats très inquiétants, remportant, entre autres, la mairie de Saint-Sébastien et la présidence forale du Guipúzcoa – avec la complicité du Parti Nationaliste Basque qui n’avait pas accepté l’offre, des partis constitutionnalistes, d’un pacte pour l’empêcher.
Quant aux dernières élections, les sondages prévoyaient ce qui s’est réalisé : une consolidation de l’espace nationaliste – modéré et radical – et une chute des partis espagnols (nationaux) ; le Parti Socialiste, qui gouvernait la Communauté Autonome Basque, avec l’appui parlementaire du Parti Populaire, a subi, ainsi que ce dernier, de fortes pertes en voix et en sièges.
Enfin, en Catalogne, le processus étant très en retard – en raison de son caractère imprévu et soudain – il n’y a pas encore une perception très nette du contexte électoral à venir. Ce qui, toutefois, est certain, c’est que si le président nationaliste Arturo Mas a franchi le pas qu’il a franchi (convocation d’élections anticipées), c’est parce qu’il espère renouveler et conforter sa majorité ; l’ampleur indéniable de la manifestation indépendantiste de Barcelone rend assez prévisible que la situation électorale soit plus ou moins similaire à celle du Pays Basque.
Que s’est-il passé pour qu’en un si court espace de temps, moins de dix ans, le label de l’Espagne, laquelle apparaissait tellement consolidée, avec ses réussites économiques, politiques, sociales, sportives, etc., au point d’être montrée comme un exemple à suivre, dans le même temps qu’ apparaissaient dans le monde des situations nouvelles « compliquées » : par exemple, la chute de l’empire soviétique, les Balkans, etc.
Naturellement, de nombreux éléments se sont conjugués, parmi lesquels, sans aucun doute, les facteurs de crise économique brutale et la perte de prestige accélérée de la caste politique ne sont pas les moins importants. Mais se conjuguent, aussi, d’autres causes, de différents ordres, qui rendaient prévisible que cette situation se produise, un jour ou l’autre.
Je vais tenter de les expliquer le plus brièvement possible :
I. Des raisons qui sont profondément liées au processus historique de formation de la nation Espagne
Le processus de formation de l’Espagne est très différent de celui de la France (où, à partir de la « centralité » d’une dynastie, les Capétiens, se construit, peu à peu, empiriquement, une nation, à travers des conquêtes et/ou des alliances, à la recherche des frontières du « pré-carré »).
 L’invasion arabe et le processus de reconquête chrétienne qui l’a suivie, font naître et se développer une série de royaumes et principautés, qui confluent, finalement, vers deux grandes couronnes : la Castille et l’Aragon, accompagnées d’un Portugal qui, progressivement, s’auto-affirmera et fera son chemin séparément, et d’un royaume de Navarre qui, quoique avec une beaucoup plus grande assise territoriale et incidence historique initiale dans la péninsule ibérique, sera porté, par les avatars de l’Histoire, à n’être qu’un appendice de la France. La Castille et l’Aragon s’unissent, en la personne de leurs rois, Ferdinand et Isabelle. Les Rois Catholiques conquièrent Grenade – le dernier bastion musulman ; avec eux commence la découverte et la colonisation de l’Amérique et, en s’immisçant dans les querelles internes de la Navarre, ils annexent la partie ibérique de ce royaume, et, en quelque manière, ils atteignent leurs frontières naturelles. Mais cette union se réalise à travers la personne des Rois Catholiques et chacun de ces peuples conserve ses lois, usages, coutumes et sa langue : en conclusion, ses « Fueros » (3). Les langues parlées sont : le galicien portugais, le catalan et le castillan, d’origine latine et la langue basque préromane.
L’invasion arabe et le processus de reconquête chrétienne qui l’a suivie, font naître et se développer une série de royaumes et principautés, qui confluent, finalement, vers deux grandes couronnes : la Castille et l’Aragon, accompagnées d’un Portugal qui, progressivement, s’auto-affirmera et fera son chemin séparément, et d’un royaume de Navarre qui, quoique avec une beaucoup plus grande assise territoriale et incidence historique initiale dans la péninsule ibérique, sera porté, par les avatars de l’Histoire, à n’être qu’un appendice de la France. La Castille et l’Aragon s’unissent, en la personne de leurs rois, Ferdinand et Isabelle. Les Rois Catholiques conquièrent Grenade – le dernier bastion musulman ; avec eux commence la découverte et la colonisation de l’Amérique et, en s’immisçant dans les querelles internes de la Navarre, ils annexent la partie ibérique de ce royaume, et, en quelque manière, ils atteignent leurs frontières naturelles. Mais cette union se réalise à travers la personne des Rois Catholiques et chacun de ces peuples conserve ses lois, usages, coutumes et sa langue : en conclusion, ses « Fueros » (3). Les langues parlées sont : le galicien portugais, le catalan et le castillan, d’origine latine et la langue basque préromane.
La modernité a rogné progressivement ces « Fueros » et libertés : la vision « régalienne » de Charles premier d’Autriche en a presque fini avec les libertés castillanes et le « centralisme » du premier Bourbon, Philippe V, abroge les fueros d’Aragon, de Catalogne, de Valence et des Iles Baléares (couronne d’Aragon). Par parenthèse, il serait peut-être intéressant d’approfondir, un jour, le thème de la guerre de succession d’Espagne, origine des mythes les plus enracinés du nationalisme catalan et du pan-catalanisme.
Mais tout cela – quoique grave – est sans aucune comparaison avec l’authentique agression centraliste et, plus encore, uniformisatrice (dont, vous, les Français, êtes paradoxalement, à la fois, les « coupables », les victimes et le modèle paradigmatique) que les « fils des Lumières » et leurs héritiers, les Jacobins enragés, ont impulsé avec le libéralisme. Mais, en Espagne, cela ne leur fut pas facile et, en l’espace de cinquante ans (1830-1880), ils se sont retrouvés face à un peuple en armes, pour défendre jusqu’à la mort ses traditions.
On a appelé cela les guerres carlistes et – quoique perdues – celles-ci ont rendu possible qu’au moins les Basques et les Navarrais conservent de nombreuses particularités « forales » dans leurs Statuts, parmi lesquelles la « Concertation Economique » qui consiste en ce qu’ils perçoivent l’impôt et, ensuite, payent à l’Etat le montant « pacté » (qui, naturellement, est toujours inférieur en pourcentage à la contribution directe des autres régions).
En conclusion, nous pourrions dire qu’en Espagne le changement de l’ « Ancien Régime » au nouveau n’a pas été bien achevé. De fait, l’actuelle fièvre catalane a pour excuse le refus du gouvernement central de négocier une « Concertation Economique ». D’un autre côté, il faut dire que le gouvernement ne peut faire autre chose, parce que la Constitution ne le permet pas. Auparavant, il faut la réformer.
2. Des raisons qui sont liées à la structuration de l’Espagne actuelle et à sa Constitution
Ici, nous pourrions commencer par la fin. Ce qui a été la première tentative de résoudre les problèmes signalés au point précédent, à partir de positions pacifiques et en recherchant des accords entre les forces politiques, n’a pas donné de résultat ; le modèle semble épuisé. Les causes sont nombreuses ; on va le voir ci-après.
Dans les années dites de la Transition (1970-1990), il y avait un sentiment de « différence » et une mobilisation pour cette différence, en Catalogne, à Valence, aux Baléares, au Pays Basque et en Navarre, et, dans une bien moindre mesure, en Galice.
Ce sentiment que j’appellerai « différentialiste » se centrait fondamentalement sur les questions culturelles et linguistiques, sans que l’on méconnaisse d’autres aspects de la revendication : politiques, économiques, administratifs.
Il est logique que ce soient les territoires signalés qui aient été les plus motivés, parce qu’y survivaient, avec une plus ou moins grande intensité, une langue et une culture propres, partageant l’espace, de manière inégale avec le castillan, langue de la culture officielle ; elles étaient généralement maltraitées. Mais ces langues étaient très vivantes (rien à voir avec la situation des langues régionales en France) et utilisées habituellement par des millions de personnes.
Il faut dire que, dans ces années-là, l’immense majorité des gens mobilisés le faisaient par AMOUR de ce qui était leur ; il y en avait très peu qui le faisait en HAINE de l’Espagne et de ce qui est espagnol. Cette situation a changé ; maintenant, énormément de jeunes de ces régions – surtout basques et catalans – s’activent par HAINE de l’Espagne. Ils l’ont apprise par une gigantesque opération de lavage de cerveau qui a duré trente ans, dans les écoles, instituts, universités et moyens de communication.
Dans un premier temps, on aurait pu donner une suite à ces véritables aspirations d’autonomie, d’une part en les centrant sur ce qui est fondamental, en ne livrant pas, avec armes et bagages, tout le pouvoir médiatique, culturel et éducatif, aux partis nationalistes, ou en maintenant des programmes éducatifs et d’enseignement cohérents et unitaires – bien qu’à Barcelone on les enseigne en catalan et à Séville en castillan – d’autre part en faisant appliquer les lois - aussi bien nationales que régionales - relatives à l’enseignement et à l’usage des langues co-officielles, et en n’acceptant pas les injustices, comme les difficultés de beaucoup de familles en Catalogne et au Pays Basque – aussi bien qu’en Galice – pour pouvoir faire donner à leurs enfants un enseignement en castillan, ou les amendes infligées aux entreprises et commerces qui ne rédigent pas en catalan, etc.
Cependant, les politiciens de bonne foi, peut-être pour banaliser la chose, ont décidé d’étendre l’état d’autonomie à toutes les régions, y compris lorsque certaines d’entre elles n’en avaient pas besoin et ne le demandaient même pas. Depuis lors, ce qui a fait fureur, c’est la surenchère comparative, le « Moi je veux plus », etc., des partis nationalistes au Pays Basque et en Catalogne, parce que eux « ne peuvent pas être » égaux au reste des Espagnols. Ce qui a commencé par être une revendication de leur légitime « différence », est, maintenant, une exigence d’être « PLUS », c'est-à-dire d’être indépendants.
Dans ce contexte, il est difficile que le nouveau positionnement du Parti Socialiste - avancer vers un Etat véritablement fédéraliste - puisse être une solution. Un Etat fédéral serait nécessairement égalitaire, s’agissant des compétences de toutes ses composantes, et, cela, c’est justement ce que les séparatistes ne peuvent supporter.
A cet ensemble de causes s’en ajoutent d’autres, peut-être plus futiles, mais qui deviennent de plus en plus significatives.
Parmi celles-ci, il y a le brusque virage stratégique de Convergencia i Unio, représentante théorique du nationalisme « modéré » : ainsi, Convergencia i Unio, que ne tardera pas à suivre le Parti Nationaliste Basque. Et, bien que quelques analystes croient qu’il ne s’agit que d’une question d’argent, d’autres – dont nous - ne le voient pas ainsi.
Il est certain que la Catalogne est littéralement en faillite, comme, d’ailleurs, toutes les Communautés Autonomes, à l’exception du Pays Basque et de la Navarre, et que ses gouvernants (« Tripartito » (4) et nationalistes) ont fait des ravages par leurs gaspillages et actes de corruption – comme les autres.
Mais, même si le Gouvernement Central leur avait concédé des finances propres – ce qu’il a refusé, refus qui a été le détonateur de la crise catalane, parce qu’il n’y a pas d’argent et parce que cela ne peut pas se faire sans préalablement réformer la Constitution - cela aurait signifié seulement retarder la crise.
Le cas des Basques est très clair, puisque, alors qu’ils disposent de leurs finances propres et des compétences en matières éducative, culturelle et linguistique, leur nationalisme « modéré » pousse toujours plus vers l’indépendance.
Que penser ? Que faire ?
Dans ce contexte et, sans aucun doute, à moyen ou long terme, que reste-t-il à l’Espagne ?
• Premièrement, réaffirmons bien haut et bien fort que l’Espagne n’est ni la Tchécoslovaquie, ni la Yougoslavie ; plus de cinq cents ans d’une conscience et d’une vie communes laissent des traces.
• En second lieu, malgré trop d’années de manipulation par les médias, d’intoxication par l’éducation et d’immersion linguistique, nous avons ici les sondages : aussi bien en Catalogne qu’au Pays Basque, la somme de ceux qui se sentent Espagnols ET Basques ou Catalans, ou seulement Espagnols, dépasse clairement le nombre de ceux qui ne se sentent que Basques ou Catalans ; et si, au Pays Basque, plus de 70% utilisent, comme langue habituelle, le castillan, en Catalogne 50% en font autant. Même s’il est sûr que, pour diverses raisons, ces populations apparaissent comme peu mobilisées, il est très possible que cela commence à changer.
• Il ne faut pas oublier, non plus, s’agissant de ces deux Communautés Autonomes, si intimement reliées au reste de l’Espagne, que plus de 70% de leur économie dépend d’elle et qu’elles souffriraient énormément d’une rupture.
• Rappelons aussi que les lois espagnoles elles-mêmes font qu’il appartiendrait au peuple espagnol, pris dans son ensemble, d’accepter, par référendum, cette rupture.
• Quant aux institutions européennes, que les séparatistes invoquent, argumentant qu’il n’y aura pas de problème, qu’ils vont rester dans l’Europe et dans la zone euro, cela est-il bien ainsi ? Que vont dire la France, avec l’irrédentisme basque et catalan, à ses frontières ? l’Italie, avec les Ligues du Nord et du Sud ? la Belgique, avec les Flamands et les Wallons ? etc. Il me semble que seule l’Allemagne serait favorable, parce qu’il est clair qu’elle préfère de petites nationalités, plus ou moins ethnolinguistiques, aux grandes nations historiques.
• Alors que la logique et le sens commun le plus élémentaire nous font conclure que la priorité, aujourd’hui, est d’arriver à sortir du chaos économique dans lequel nous sommes immergés – en cela le gouvernement central a raison, pour autant qu’il en coûte aux démagogues séparatistes qui, dans ces circonstances, ont déclenché cet orage, démontrant ce qu’ils sont, c'est-à-dire égoïstes, non-solidaires et opportunistes - c’est maintenant le moment de prendre le taureau par les cornes et de fermer – bien et pour toujours – ce débat.
Bien que les circonstances actuelles ne semblent pas être les meilleures pour la Monarchie (affaires de la chasse à l’éléphant du Roi et le reste… ; incroyable histoire du duc de Palma inculpé dans une vilaine affaire de trafic d’influences et d’évasion de capitaux), encore qu’heureusement il semble que ces affaires soient en train de s’éloigner, la Couronne devrait jouer dans cette situation un rôle important.
Il n’y a pas de doute que la Couronne doit user de tous les pouvoirs que la Constitution lui donne pour exercer sa médiation et redresser la situation.
Mais, en même temps, il faut être capable de procéder aux réformes nécessaires pour rendre possible l’Espagne réelle.
Du plus profond de la tradition espagnole, il faudrait reprendre l’esprit des « Fueros », pour être en adéquation avec notre réalité politique, en donnant à chaque région ce dont elle a besoin, mais dans les limites d’un authentique sentiment de loyauté envers les Espagnes, c’est-à-dire l’Espagne de tous.
La dynastie régnante, à qui personne ne peut contester la légitimité de son origine, par rapport à la dynastie carliste qui a soutenu ces principes, a devant elle un grand défi. Un défi comparable à la tentative de coup d’Etat du 23 février 1981. Dieu veuille qu’elle soit à la hauteur de l’Histoire. L’Espagne en a besoin. •
* Ami de longue date et grand connaisseur de notre cause, habitant Valence, en Espagne, d'où cet article nous est parvenu.
1. Arturo Mas : président de Catalogne (2010); a lancé le processus indépendantiste.
2. l'Espagne est aujourd'hui divisée en 17 communautés autonomes.
3. Fueros : privilèges et libertés des grandes régions historiques d'Espagne.
4. Tripartito: coalition de gauche catalane (PSC, Gauche Républicaine, communistes..).

 Ada Colau demande des « explications » au gouvernement de la région.
Ada Colau demande des « explications » au gouvernement de la région.




 L’organisation d’élections régionales en Catalogne répond sans doute à une logique institutionnelle (la tutelle de Madrid n’ayant pas vocation à s’éterniser) mais en les convoquant pour le 21 décembre, et en se plaçant ainsi dans le rôle de celui qui identifie la défense de l’intégrité espagnole à l’application sourcilleuse de mesures dictées par la loi, le chef du gouvernement rabaisse le débat de fond sur la nature même de l’Espagne au niveau purement comptable d’une consultation électorale. Il prend ainsi le risque - qui existe, au vu du rapport de forces actuel - d’être désavoué. Rien ne serait pire qu’un score avoisinant, voire dépassant, les 50% pour les indépendantistes qui, rappelons-le, disposaient de 72 sièges (majorité absolue) dans l’assemblée sortante pour 47,8% des voix. L’Espagne a certes une constitution qui ne reconnaît pas à une de ses communautés autonomes le droit au séparatisme, elle se vit malheureusement aussi comme une démocratie exemplaire, même couronnée. M. Guetta (France Inter, mercredi 1) peut dire : « Indépendance ou pas, ce sont ainsi les électeurs qui auront à
L’organisation d’élections régionales en Catalogne répond sans doute à une logique institutionnelle (la tutelle de Madrid n’ayant pas vocation à s’éterniser) mais en les convoquant pour le 21 décembre, et en se plaçant ainsi dans le rôle de celui qui identifie la défense de l’intégrité espagnole à l’application sourcilleuse de mesures dictées par la loi, le chef du gouvernement rabaisse le débat de fond sur la nature même de l’Espagne au niveau purement comptable d’une consultation électorale. Il prend ainsi le risque - qui existe, au vu du rapport de forces actuel - d’être désavoué. Rien ne serait pire qu’un score avoisinant, voire dépassant, les 50% pour les indépendantistes qui, rappelons-le, disposaient de 72 sièges (majorité absolue) dans l’assemblée sortante pour 47,8% des voix. L’Espagne a certes une constitution qui ne reconnaît pas à une de ses communautés autonomes le droit au séparatisme, elle se vit malheureusement aussi comme une démocratie exemplaire, même couronnée. M. Guetta (France Inter, mercredi 1) peut dire : « Indépendance ou pas, ce sont ainsi les électeurs qui auront à 
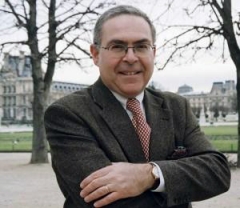 Un peu éclipsé, dimanche soir*, par l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, le résultat des élections législatives autrichiennes a provoqué des commentaires prouvant la méconnaissance ou l'incompréhension du système politique de ce pays.
Un peu éclipsé, dimanche soir*, par l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, le résultat des élections législatives autrichiennes a provoqué des commentaires prouvant la méconnaissance ou l'incompréhension du système politique de ce pays.

 Manifestation monstre hier dimanche à Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne, pour son appartenance à l'Espagne et pour l'unité du pays. C'est ce dont Le Monde prenait acte
Manifestation monstre hier dimanche à Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne, pour son appartenance à l'Espagne et pour l'unité du pays. C'est ce dont Le Monde prenait acte 

 De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.
De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.
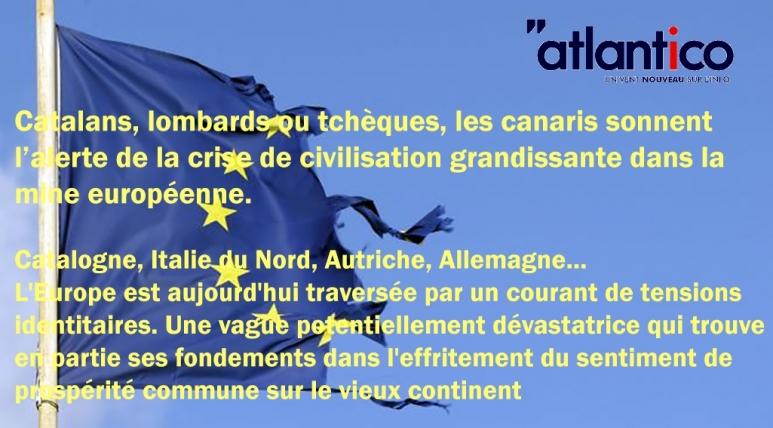

 Ce n'est pas seulement l'Histoire qu'il faut connaître, c'est aussi la géographie. A ceux qui veulent comprendre le présent, l’actualité, nous conseillerons en vérité de s'intéresser à l'une et à l'autre. Combien sont ceux qui débattent de sujets géopolitiques, d'événements en train de se dérouler, parfois tragiques, sans avoir seulement regardé les cartes, ignorant l'environnement, les réalités locales et sans rien connaître des antécédents des pays, peuples, régions du monde dont il est question ! Certes, ce qui nous préoccupe ce doit être le présent, l'actuel, et si possible l'avenir. Mais nous n'analyserons pas correctement le présent, nous prévoirons malaisément ses développements, si nous n'avons pas une connaissance minimale du passé comme des réalités physiques et humaines des régions dont nous avons à traiter.
Ce n'est pas seulement l'Histoire qu'il faut connaître, c'est aussi la géographie. A ceux qui veulent comprendre le présent, l’actualité, nous conseillerons en vérité de s'intéresser à l'une et à l'autre. Combien sont ceux qui débattent de sujets géopolitiques, d'événements en train de se dérouler, parfois tragiques, sans avoir seulement regardé les cartes, ignorant l'environnement, les réalités locales et sans rien connaître des antécédents des pays, peuples, régions du monde dont il est question ! Certes, ce qui nous préoccupe ce doit être le présent, l'actuel, et si possible l'avenir. Mais nous n'analyserons pas correctement le présent, nous prévoirons malaisément ses développements, si nous n'avons pas une connaissance minimale du passé comme des réalités physiques et humaines des régions dont nous avons à traiter.
 Emmanuel Macron l'a montré lors des premiers mois de sa présidence : il aime les symboles. Il sait qu'ils n'ont rien d'anecdotique.
Emmanuel Macron l'a montré lors des premiers mois de sa présidence : il aime les symboles. Il sait qu'ils n'ont rien d'anecdotique. Nous avons voulu consacrer nos articles de ce jour à l'actualité espagnole, brûlante s'il en est. Ils composent, sans épuiser le sujet, comme un mini-dossier.
Nous avons voulu consacrer nos articles de ce jour à l'actualité espagnole, brûlante s'il en est. Ils composent, sans épuiser le sujet, comme un mini-dossier.
 En moins de deux mois, des élections régionales se seront tenues en Galice, au Pays Basque et en Catalogne, les trois Communautés qui, les premières, ont obtenu l’autonomie et qui ont le plus de compétences, dans leurs Statuts d’Autonomie.
En moins de deux mois, des élections régionales se seront tenues en Galice, au Pays Basque et en Catalogne, les trois Communautés qui, les premières, ont obtenu l’autonomie et qui ont le plus de compétences, dans leurs Statuts d’Autonomie. L’invasion arabe et le processus de reconquête chrétienne qui l’a suivie, font naître et se développer une série de royaumes et principautés, qui confluent, finalement, vers deux grandes couronnes : la Castille et l’Aragon, accompagnées d’un Portugal qui, progressivement, s’auto-affirmera et fera son chemin séparément, et d’un royaume de Navarre qui, quoique avec une beaucoup plus grande assise territoriale et incidence historique initiale dans la péninsule ibérique, sera porté, par les avatars de l’Histoire, à n’être qu’un appendice de la France. La Castille et l’Aragon s’unissent, en la personne de leurs rois, Ferdinand et Isabelle. Les Rois Catholiques conquièrent Grenade – le dernier bastion musulman ; avec eux commence la découverte et la colonisation de l’Amérique et, en s’immisçant dans les querelles internes de la Navarre, ils annexent la partie ibérique de ce royaume, et, en quelque manière, ils atteignent leurs frontières naturelles. Mais cette union se réalise à travers la personne des Rois Catholiques et chacun de ces peuples conserve ses lois, usages, coutumes et sa langue : en conclusion, ses
L’invasion arabe et le processus de reconquête chrétienne qui l’a suivie, font naître et se développer une série de royaumes et principautés, qui confluent, finalement, vers deux grandes couronnes : la Castille et l’Aragon, accompagnées d’un Portugal qui, progressivement, s’auto-affirmera et fera son chemin séparément, et d’un royaume de Navarre qui, quoique avec une beaucoup plus grande assise territoriale et incidence historique initiale dans la péninsule ibérique, sera porté, par les avatars de l’Histoire, à n’être qu’un appendice de la France. La Castille et l’Aragon s’unissent, en la personne de leurs rois, Ferdinand et Isabelle. Les Rois Catholiques conquièrent Grenade – le dernier bastion musulman ; avec eux commence la découverte et la colonisation de l’Amérique et, en s’immisçant dans les querelles internes de la Navarre, ils annexent la partie ibérique de ce royaume, et, en quelque manière, ils atteignent leurs frontières naturelles. Mais cette union se réalise à travers la personne des Rois Catholiques et chacun de ces peuples conserve ses lois, usages, coutumes et sa langue : en conclusion, ses

 Le vrai changement réside dans le nouvel équilibre à l’intérieur de la mouvance « souverainiste », nouvel équilibre dans lequel M. Artur Mas apparaît politiquement affaibli et donc davantage susceptible de céder aux surenchères des « enragés » de l’indépendance (ERC et CUP). Ainsi, dès dimanche, le directeur de campagne de CiU, M. Lluis María Corominas. a assuré que «le bloc des partis souverainistes est majoritaire, [et qu’] une consultation sera donc organisée». C’est-à-dire que M. Artur Mas et CiU poursuivent leur fuite en avant et, après le bras de fer sur le « pacte fiscal » perdu contre Madrid, agitent désormais le chiffon rouge d’un référendum sur l’indépendance.
Le vrai changement réside dans le nouvel équilibre à l’intérieur de la mouvance « souverainiste », nouvel équilibre dans lequel M. Artur Mas apparaît politiquement affaibli et donc davantage susceptible de céder aux surenchères des « enragés » de l’indépendance (ERC et CUP). Ainsi, dès dimanche, le directeur de campagne de CiU, M. Lluis María Corominas. a assuré que «le bloc des partis souverainistes est majoritaire, [et qu’] une consultation sera donc organisée». C’est-à-dire que M. Artur Mas et CiU poursuivent leur fuite en avant et, après le bras de fer sur le « pacte fiscal » perdu contre Madrid, agitent désormais le chiffon rouge d’un référendum sur l’indépendance.