En Autriche, le FPÖ, classé à l'extrême droite par les observateurs français, gouvernera avec les conservateurs de Sebastian Kurz. Pour Jean Sévillia, ce type de coalition est banal en Autriche. Jean Sévillia précise toutefois : « Critique sur la politique migratoire de l'Union européenne, et de l'Allemagne d'Angela Merkel en particulier, le nouveau chancelier d'Autriche partage la volonté des pays du groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie) de contrôler strictement leurs frontières au nom de leur souveraineté nationale. Au centre de l'Europe, c'est une inflexion majeure. » L'affaire est importante. [Figarovox, 19.12]. LFAR
 Sebastian Kurz, 31 ans, a prêté serment lundi à Vienne, signant l'arrivée au pouvoir d'une coalition formée par la droite et le FPÖ, le Parti de la liberté d'Autriche, classé par beaucoup à l'extrême droite. Ce cas de figure n'est pas inédit. Au début des années 2000, les conservateurs et le FPÖ avaient déjà été partenaires. Que faut-il retenir de cette première expérience ?
Sebastian Kurz, 31 ans, a prêté serment lundi à Vienne, signant l'arrivée au pouvoir d'une coalition formée par la droite et le FPÖ, le Parti de la liberté d'Autriche, classé par beaucoup à l'extrême droite. Ce cas de figure n'est pas inédit. Au début des années 2000, les conservateurs et le FPÖ avaient déjà été partenaires. Que faut-il retenir de cette première expérience ?
Aux élections législatives d'octobre 1999, en effet, le FPÖ avait obtenu 27 % des suffrages, arrivant juste derrière les sociaux-démocrates et devançant de 400 voix seulement les conservateurs de l'ÖVP que menait alors le ministre des Affaires étrangères, Wolfgang Schüssel. Ce dernier, écartant l'idée de reconduire la grande coalition de son parti avec les sociaux-démocrates, coalition qui gouvernait l'Autriche depuis 1987, avait fait le choix, au terme de longues tractations, d'une coalition avec le FPÖ, ce parti qu'on qualifie de populiste, faute de terme plus approprié, mais que les Autrichiens ne classent pas à l'extrême droite. En février 2000, la formation du gouvernement de coalition entre les conservateurs de l'ÖVP et les populistes du FPÖ, sous la direction de Wolfgang Schüssel, devenu chancelier, allait décider les quatorze autres États membres de l'Union européenne à cesser toute rencontre bilatérale avec le gouvernement autrichien, à imposer des limitations à ses ambassadeurs et à retirer tout soutien européen aux candidats autrichiens à des postes au sein des organisations internationales. Cette politique de sanctions européennes, fortement encouragée par Jacques Chirac à l'Elysée, avait débouché sur un échec piteux. Elle avait dû être levée au bout de sept mois quand il avait bien fallu s'apercevoir que rien n'avait changé en Autriche, qui était restée un libre Etat démocratique, respectueux des droits de l'homme.
A l'intérieur du pays, le résultat sera l'inverse de ce qui était escompté par l'Union européenne car même les Autrichiens de gauche, électeurs sociaux-démocrates, seront blessés dans leur fierté patriotique de voir traiter leur pays comme un paria. Pour le FPÖ, cette participation au pouvoir sera l'épreuve de vérité puisque des dissensions internes quant aux choix gouvernementaux provoqueront un effondrement du parti aux législatives anticipées de 2002, le FPÖ descendant à 10 % des voix, puis une scission, Jörg Haider, leader du FPÖ et partisan du maintien de la coalition avec l'ÖVP, formant au printemps 2005 un nouveau parti qui emmènera les ministres du FPÖ, mais pour quelques mois seulement puisque la coalition conservateurs-populistes éclatera tout début 2007.
Pour répondre à votre question initiale, ce qu'il faut retenir de la première expérience de coalition entre les conservateurs et les populistes, qui a duré six années pleines, est que la mécanique institutionnelle autrichienne laisse le premier rôle au chancelier, qui a l'initiative et la vraie responsabilité du pouvoir. Ce fut le cas, de 2000 à 2006, avec le conservateur Wolfgang Schüssel qui imposait sa stratégie et son tempo à ses partenaires du FPÖ. Il n'en sera pas autrement avec Sebastian Kurz. L'autre réalité est que, dans l'exercice du pouvoir, les ministres populistes ont acquis une culture de gouvernement, ce qui les a parfois mis en contradiction avec leurs idées antérieures ou leur propre base électorale ou militante. Avant de poursuivre l'analogie pour aujourd'hui, observons ce qui va se passer maintenant.
Non loin du palais présidentiel où se déroulait l'investiture du nouvel exécutif, plusieurs milliers de personnes manifestaient contre la participation du FPÖ au gouvernement, rassemblées derrière des banderoles proclamant « Les nazis dehors » ou « Mort au fascisme ». Ce type d'analogie historique a-t-elle un sens ?
Rassembler 5500 personnes au centre de Vienne, capitale d'1,8 million d'habitants, derrière des drapeaux rouges et des banderoles d'antifas proclamant « No pasaran » ne signifie pas, en dépit de la complaisance des caméras de télévision, que les Autrichiens s'insurgent contre leur nouveau gouvernement. En démocratie, la légitimité provient des élections et du jeu constitutionnel. Je rappelle simplement que les conservateurs de l'ÖVP ont obtenu 31 % des voix aux élections législatives du 15 octobre dernier, et le FPÖ presque 26 % des voix. Après que Sebastian Kurz a été chargé de former le gouvernement par le président de la République, Alexander van der Bellen, un homme issu des Verts, les négociations en vue de la formation d'un cabinet se sont déroulées sur des enjeux publiquement affichés, de manière paritaire, selon les formes habituelles en Autriche. C'est donc dans le parfait respect des lois et de la Constitution autrichiennes que le gouvernement de Sebastian Kurz a été investi. Je rappelle encore que les sociaux-démocrates du SPÖ ont gouverné avec le FPÖ de 1983 à 1986, et gouvernent encore aujourd'hui avec lui dans deux diètes régionales, en Haute-Autriche et dans le Burgenland. En Autriche, encore une fois, le FPÖ n'est nullement classé à l'extrême droite, quoi qu'en pensent les médias français. La réalité politique est là, et non dans l'antifascisme d'opérette de quelques centaines d'étudiants et de bobos viennois.
Heinz-Christian Strache, le leader du FPÖ et désormais vice-chancelier, aurait tout de même été proche des néonazis dans sa jeunesse ?
Le néonazisme est interdit en Autriche, pays qui possède une des législations les plus sévères d'Europe en matière de répression du néonazisme et du négationnisme. Donc Strache n'a pas été proche des néonazis. Adolescent, il a peut-être été d'extrême droite, mais juge-t-on un homme de 48 ans sur les positions qu'il défendait à 18 ans ? En France, nous avons eu au cours des dernières décennies un certain nombre de hauts responsables politiques et de ministres qui, dans leur jeunesse, ont été membres d'Occident ou à l'inverse de mouvements trotskistes : fallait-il les enfermer dans cette étiquette ? Depuis qu'il a pris la tête du FPÖ, en 2005, et réunifié les deux partis populistes après la mort de Haider, en 2008, Heinz-Christian Strache a plutôt fait un sans-faute, rejetant les ambiguïtés dont aimait jouer Haider quant au national-socialisme, condamnant l'antisémitisme, se rapprochant d'Israël. En Autriche, même ses adversaires peinent à pointer ses « dérapages », sauf à considérer que la critique du fondamentalisme islamique soit un dérapage. Cela dit, Strache est à son tour au pied du mur. A part son mandat de député et la direction de son parti, il n'a jamais exercé de responsabilité politique effective autre que le ministère de la parole. Lui aussi va devoir prouver qu'il est capable de passer du discours à l'acte.
Deux ministres du FPÖ ont été nommés à des postes régaliens à l'Intérieur et la Défense. Sebastian Kurz ne semblait pas y être contraint ?
Un troisième ministère régalien très important, celui des Affaires étrangères, a été attribué à Karin Kneissl, qui n'est pas membre du FPÖ, mais a été choisie par lui. Cette femme de 52 ans, diplômée de l'université américaine de Georgetown et de l'ENA à Paris, spécialiste du Proche-Orient, parle l'arabe et l'hébreu. Il sera difficile de la faire passer pour une nationaliste au front bas… Pourquoi Kurz a-t-il consenti à donner des ministères régaliens au FPÖ ? Mais Schüssel en avait fait autant. Les Autrichiens ont une vision pragmatique de la politique, c'est tout. Dès lors qu'il y a coalition, il y a partage des fonctions et des compétences. Mais encore une fois, le maître du jeu, au sein du gouvernement, restera le chancelier.
Le rapprochement entre les conservateurs et le FPÖ en Autriche est-il symptomatique d'une droitisation en Europe ?
Je ne sais pas si le terme de « droitisation » est le bon, mais il est certain que, face à un certain nombre de défis qui sont posés à l'Europe, à toute l'Europe, la nouvelle coalition gouvernementale autrichienne veut répondre à des attentes de l'opinion en matière de sécurité nationale et de contrôle des flux migratoires.
Kurz fait profession de foi européenne, et prendra personnellement en charge les questions européennes, enlevées au ministère des Affaires étrangères. Critique sur la politique migratoire de l'Union européenne, et de l'Allemagne d'Angela Merkel en particulier, le nouveau chancelier d'Autriche partage la volonté des pays du groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie) de contrôler strictement leurs frontières au nom de leur souveraineté nationale. Au centre de l'Europe, c'est une inflexion majeure.
L'Autriche peut-elle être un laboratoire politique pour d'autres pays, notamment la France ?
Il y faudrait une révolution culturelle et un long chemin… Les Autrichiens, encore une fois, ont une conception beaucoup plus pragmatique de la politique, et sont habitués aux coalitions de gouvernement nationales ou régionales - conservateurs avec sociaux-démocrates, sociaux-démocrates avec populistes, conservateurs avec populistes - qui ne sont pas dans la pratique constitutionnelle de la Ve République. En France, malheureusement, il y a toujours un arrière-plan idéologique en politique, même quand on s'en défend. Notre histoire politique reste marquée en profondeur par l'expérience de la Révolution de 1789. •
Journaliste, essayiste et historien, chroniqueur au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire, Jean Sévillia est un spécialiste de l'Autriche.
Entretien par Alexandre Devecchio
Auteur - Sa biographie
Lire aussi dans Lafautearousseau ...
Europe : La France n'a-t-elle le choix qu'entre le statu quo et le Frexit ?
Pourquoi le nouveau gouvernement autrichien peut changer la donne en Europe
Sommes-nous donc contre l'Europe ?





 Sebastian Kurz, 31 ans, a prêté serment lundi à Vienne, signant l'arrivée au pouvoir d'une coalition formée par la droite et le FPÖ, le Parti de la liberté d'Autriche, classé par beaucoup à l'extrême droite. Ce cas de figure n'est pas inédit. Au début des années 2000, les conservateurs et le FPÖ avaient déjà été partenaires. Que faut-il retenir de cette première expérience ?
Sebastian Kurz, 31 ans, a prêté serment lundi à Vienne, signant l'arrivée au pouvoir d'une coalition formée par la droite et le FPÖ, le Parti de la liberté d'Autriche, classé par beaucoup à l'extrême droite. Ce cas de figure n'est pas inédit. Au début des années 2000, les conservateurs et le FPÖ avaient déjà été partenaires. Que faut-il retenir de cette première expérience ?
 Dans une Europe où les peuples sentent de plus en plus le sol se dérober sous leur pied, où monte partout une vague « populiste » surtout inquiète de perdre son identité, une autre politique européenne de la France pourrait bien s'imposer à court ou moyen terme comme une option nouvelle et salvifique. Il n'est pas sûr en effet que la France n'ait d'autre choix qu'entre le statu quo (berlino-bruxellois) et le Frexit ...
Dans une Europe où les peuples sentent de plus en plus le sol se dérober sous leur pied, où monte partout une vague « populiste » surtout inquiète de perdre son identité, une autre politique européenne de la France pourrait bien s'imposer à court ou moyen terme comme une option nouvelle et salvifique. Il n'est pas sûr en effet que la France n'ait d'autre choix qu'entre le statu quo (berlino-bruxellois) et le Frexit ... Pourquoi pas, en effet, une initiative de la France envers les pays de
Pourquoi pas, en effet, une initiative de la France envers les pays de 
 Cet intéressant article - écrit, pourrait-on dire, presque à chaud - est repris de Boulevard Voltaire où il est paru hier. Certes, il ne nous apprend que peu de choses sur la formation du nouveau gouvernement autrichien. Son véritable mérite - qui est important - nous paraît être de signaler - se référant au groupe de Visegrad - que l'événement est de nature à changer la donne en Europe. Comme la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie, l'Autriche devrait être désormais pour une Europe des Etats, des identités et des peuples. Notamment face à l'immigration et à l'Islam. Mais pas seulement : elle montre aussi l'exemple d'un pays qui se dote du gouvernement et, le cas échéant, des institutions de son choix, sans égard pour les leçons qui peuvent lui venir de Bruxelles et d'ailleurs. Si la France avait une politique étrangère, elle ne tarderait pas à se rapprocher de ce groupe de pays libres, plutôt que de poursuivre le rêve fédéraliste. Il n'est d'ailleurs pas impossible que l'évolution des réalités géopolitiques en cours et la vague populiste qui monte dans toute l'Europe, l'y conduisent volens nolens à plus ou moins court terme. Lafautearousseau
Cet intéressant article - écrit, pourrait-on dire, presque à chaud - est repris de Boulevard Voltaire où il est paru hier. Certes, il ne nous apprend que peu de choses sur la formation du nouveau gouvernement autrichien. Son véritable mérite - qui est important - nous paraît être de signaler - se référant au groupe de Visegrad - que l'événement est de nature à changer la donne en Europe. Comme la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie, l'Autriche devrait être désormais pour une Europe des Etats, des identités et des peuples. Notamment face à l'immigration et à l'Islam. Mais pas seulement : elle montre aussi l'exemple d'un pays qui se dote du gouvernement et, le cas échéant, des institutions de son choix, sans égard pour les leçons qui peuvent lui venir de Bruxelles et d'ailleurs. Si la France avait une politique étrangère, elle ne tarderait pas à se rapprocher de ce groupe de pays libres, plutôt que de poursuivre le rêve fédéraliste. Il n'est d'ailleurs pas impossible que l'évolution des réalités géopolitiques en cours et la vague populiste qui monte dans toute l'Europe, l'y conduisent volens nolens à plus ou moins court terme. Lafautearousseau  Conséquence rapide et directe de la calamiteuse gestion germanique de la crise des migrants de 2015, l’Allemagne et l’Autriche sont dans une phase très difficile de flottement politique. Mais vendredi, l’Autriche a mis un terme à son calvaire, qui s’est avéré être une mutation. L’Autriche a désormais – comme ça y est d’usage – un gouvernement de coalition, réunissant les conservateurs du ÖVP avec, cette fois, les nationaux-libéraux du FPÖ. Une coalition qui pourrait bien bouleverser la politique européenne.
Conséquence rapide et directe de la calamiteuse gestion germanique de la crise des migrants de 2015, l’Allemagne et l’Autriche sont dans une phase très difficile de flottement politique. Mais vendredi, l’Autriche a mis un terme à son calvaire, qui s’est avéré être une mutation. L’Autriche a désormais – comme ça y est d’usage – un gouvernement de coalition, réunissant les conservateurs du ÖVP avec, cette fois, les nationaux-libéraux du FPÖ. Une coalition qui pourrait bien bouleverser la politique européenne. Malgré la pression morale constante et immense de la part de la presse dominante, la digue a cédé. Il faut dire que cette même presse avait été en faveur de l’afflux massif et incontrôlé d’étrangers dès le début de la crise de l’été 2015. Si le FPÖ n’est pas arrivé premier, il intègre pour autant le gouvernement – en récupérant notamment l’Intérieur, la Défense et les Affaires étrangères ! – et impose certaines de ses lignes directrices, notamment sur les questions de l’islam, du rapport à la Russie – le FPÖ est un partenaire du parti de Poutine – ou encore concernant les aides sociales aux étrangers.
Malgré la pression morale constante et immense de la part de la presse dominante, la digue a cédé. Il faut dire que cette même presse avait été en faveur de l’afflux massif et incontrôlé d’étrangers dès le début de la crise de l’été 2015. Si le FPÖ n’est pas arrivé premier, il intègre pour autant le gouvernement – en récupérant notamment l’Intérieur, la Défense et les Affaires étrangères ! – et impose certaines de ses lignes directrices, notamment sur les questions de l’islam, du rapport à la Russie – le FPÖ est un partenaire du parti de Poutine – ou encore concernant les aides sociales aux étrangers. 


 Sommes-nous, comme nous pourrions parfois le donner à croire par maladresse, antieuropéens ? Sommes-nous contre l'Europe ?
Sommes-nous, comme nous pourrions parfois le donner à croire par maladresse, antieuropéens ? Sommes-nous contre l'Europe ? 
 Je suis toujours surpris de constater comment certaines informations, pas forcément négligeables, sont littéralement occultées dans notre pays, comme si elles dérangeaient l'ordre bien établi des idées reçues et de l'idéologie dominante. Ainsi, la décision de la Pologne de « supprimer le travail dominical » comme le titre, pour un court article, Le Figaro en pages économie, information qui ne peut laisser indifférent les royalistes sociaux, héritiers d'Albert de Mun, grand défenseur des ouvriers et promoteur infatigable du repos dominical combattu par les républicains libéraux et anticléricaux.
Je suis toujours surpris de constater comment certaines informations, pas forcément négligeables, sont littéralement occultées dans notre pays, comme si elles dérangeaient l'ordre bien établi des idées reçues et de l'idéologie dominante. Ainsi, la décision de la Pologne de « supprimer le travail dominical » comme le titre, pour un court article, Le Figaro en pages économie, information qui ne peut laisser indifférent les royalistes sociaux, héritiers d'Albert de Mun, grand défenseur des ouvriers et promoteur infatigable du repos dominical combattu par les républicains libéraux et anticléricaux. Internet. » Sans doute faudrait-il ôter de cette liste le dernier élément qui ne me semble pas non plus indispensable mais l'idée générale est bonne et la décision prise par les députés polonais juste et éminemment sociale, même si elle ne sera sans doute pas immédiatement comprise d'une part de la jeunesse désormais habituée à une « immédiateté consommatrice » peu soucieuse du « partage familial ». Cette mesure s'inscrit néanmoins dans la nécessaire « dé-marchandisation » du temps qu'il me paraît utile de promouvoir, en rupture avec la logique de Benjamin Franklin, celle résumée par la célèbre et maudite formule « Le temps c'est de l'argent ».
Internet. » Sans doute faudrait-il ôter de cette liste le dernier élément qui ne me semble pas non plus indispensable mais l'idée générale est bonne et la décision prise par les députés polonais juste et éminemment sociale, même si elle ne sera sans doute pas immédiatement comprise d'une part de la jeunesse désormais habituée à une « immédiateté consommatrice » peu soucieuse du « partage familial ». Cette mesure s'inscrit néanmoins dans la nécessaire « dé-marchandisation » du temps qu'il me paraît utile de promouvoir, en rupture avec la logique de Benjamin Franklin, celle résumée par la célèbre et maudite formule « Le temps c'est de l'argent ».

 Rien de ce qui se passe en Allemagne n'est sans conséquences pour la France et pour l'Europe. Ce fut le cas dans le passé et l'est toujours aujourd'hui.
Rien de ce qui se passe en Allemagne n'est sans conséquences pour la France et pour l'Europe. Ce fut le cas dans le passé et l'est toujours aujourd'hui.



 A vrai dire, réduite à des querelles de boutiquiers, et, pis, à l'univers statistique des technocrates en charge de son avenir, il devient de plus en plus clair que jamais sans-doute, dans l'histoire de notre continent il n'y eut aussi peu de conscience européenne qu'aujourd'hui.
A vrai dire, réduite à des querelles de boutiquiers, et, pis, à l'univers statistique des technocrates en charge de son avenir, il devient de plus en plus clair que jamais sans-doute, dans l'histoire de notre continent il n'y eut aussi peu de conscience européenne qu'aujourd'hui.
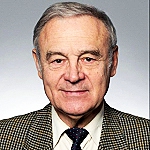


 S'il y a une leçon française de l'exemple catalan, c'est que le politique est hautement conditionné, limité, voire défié par des réalités sociales profondes, antérieures, venues de temps très anciens, qui activent les passions des hommes et suscitent leurs actions, bonnes ou mauvaises, traditionnelles ou subversives ; que les États, les gouvernements, les constitutions, les formules procédurales, ne sont pas tout-puissants ; que la pratique démocratique telle qu'elle est conçue de nos jours, peut même avoir des effets très pervers ; que tout cet attirail ne suffit pas en soi-même à donner à volonté forme et cohésion à une société, ou à la modifier à son gré.
S'il y a une leçon française de l'exemple catalan, c'est que le politique est hautement conditionné, limité, voire défié par des réalités sociales profondes, antérieures, venues de temps très anciens, qui activent les passions des hommes et suscitent leurs actions, bonnes ou mauvaises, traditionnelles ou subversives ; que les États, les gouvernements, les constitutions, les formules procédurales, ne sont pas tout-puissants ; que la pratique démocratique telle qu'elle est conçue de nos jours, peut même avoir des effets très pervers ; que tout cet attirail ne suffit pas en soi-même à donner à volonté forme et cohésion à une société, ou à la modifier à son gré.