Catalogne : Points d'Histoire et réalités d'aujourd'hui

Carles Puigdemont hier soir devant le Parlement catalan
Publié le 11 octobre 2012 - Actualisé le 20 octobre 2017
 S'il faut rechercher les sources et les responsabilités les plus déterminantes dans les graves événements d'Espagne, il serait léger de ne voir que les apparences. Peut-être un peu de recul n'est-t-il pas de trop et permettrait de les mieux comprendre.
S'il faut rechercher les sources et les responsabilités les plus déterminantes dans les graves événements d'Espagne, il serait léger de ne voir que les apparences. Peut-être un peu de recul n'est-t-il pas de trop et permettrait de les mieux comprendre.
Ce qui se produit en Catalogne est grave parce qu'une Espagne en ébullition, en convulsion, rejouant les scénarios des années 30 mais dans le contexte postmoderne, n'empoisonnerait pas que sa propre existence. De sérieuses conséquences en résulteraient en France et en Europe. De nombreux et d'importants équilibres nationaux et transnationaux s'en trouveraient rompus. On ne sait jamais jusqu'où, ni jusqu'à quelles situations, sans-doute troublées pour la longtemps.
L'unité de l'Espagne, on le sait, ne date pas d'hier. Elle est constante au fil des cinq derniers siècles, à compter du mariage d'isabelle la Catholique, reine de Castille, et de Ferdinand d'Aragon, les rois sous le règne desquels l'Espagne acheva de se libérer de l'occupation arabe en prenant Grenade, dernier royaume maure de la Péninsule [1492| ; et où Colomb, cherchant à atteindre les Indes par l'Ouest, découvrit l'Amérique. S'ouvrait ainsi, après le règne de Jeanne la folle, unique et malheureuse héritière des Rois Catholiques mariée à un prince flamand, le règne de Charles Quint, lui-même prince Habsbourg de naissance flamande, sur les terres duquel, après la découverte de Colomb, le soleil ne se couchait pas. Le règne suivant, celui de Philippe II, marque l'apogée de la puissance de l'Espagne et de la dynastie Habsbourg qui y règnera jusqu'au tout début du XVIIIe siècle. Ces règnes couvrent deux premiers siècles d'unité espagnole, et, malgré de multiples conflits et convulsions, deux brèves républiques, dont la seconde sera sanglante et conduira à la Guerre Civile puis au long épisode franquiste, l'unité de l'Espagne, sous le règne rarement glorieux des Bourbons, ne fut jamais vraiment brisée les trois siècles suivants, jusqu'à l'actuel roi Philippe VI.
Mais si elle fut sans conteste toujours maintenue au cours de cette longue période de cinq ou six siècles, l'unité de l'Espagne, surtout pour un regard français, ne fut non plus jamais tout à fait acquise, tout à fait accomplie. Et si la monarchie a toujours incarné l'unité, la république, effective ou fantasmée, a toujours signifié la division de l'Espagne. Ainsi aussitôt qu'en avril 1931, la seconde république fut instaurée à Madrid, l'Espagne, de fait, en connut deux, l'une à Madrid et l'autre à Barcelone. Ce que vit l'Espagne d'aujourd'hui, l'Espagne d'hier l'a déjà connu.
L'Histoire - le passé - mais aussi la géographie, liées l'une à l'autre, y ont conservé un poids, une présence, inconnus chez nous. L'Espagne n'a pas vraiment vécu d'épisode jacobin ...
Bainville a raison, hier comme aujourd’hui, lorsqu’il observe que la péninsule ibérique se divise d'Est en Ouest en trois bandes verticales, définissant trois « nationalités » qui sont aussi zones linguistiques : la catalane, la castillane et la portugaise. Curieusement, le Portugal accroché au flanc Ouest de l'Espagne n'a jamais pu lui être durablement rattaché. Partout ailleurs, les particularismes sont restés vivants, jusqu'à, parfois, l'agressivité et la haine, comme on l'a vu au Pays Basque et comme on le voit encore en Catalogne.
De ces particularismes, la langue est le premier ciment ; Dans l’enclave basque, en Catalogne, et, même, dans la lointaine Galice, où l'on parle le galicien en qui se reconnaît l'influence du portugais. Ces langues ne sont pas de culture, ne ressortent pas d'un folklore déclinant à peu près partout, comme chez nous. Elles sont d'usage quotidien et universel, dans les conversations entre soi, au travail comme à l'école, à l'université, dans les actes officiels, la presse, les radios et télévisions, etc. Comme Mistral l'avait vu, ces langues fondent des libertés. Le basque et le catalan sont, mais au sens mistralien, des langues « nationales ». Le catalan, toutefois, est aussi langue des Baléares et, à quelques variantes près, de la région valencienne, jusqu'à Alicante ...
A cette liberté linguistique se combine un fort sentiment d'appartenance à des communautés vivantes, vécues comme historiques et populaires, chargées de sens, de mœurs et de traditions particulières très ancrées, parfaitement légitimes et toujours maintenues.
C'est donc non sans motifs que la monarchie post franquiste institua en Espagne 17 « communautés autonomes » ou « autonomies » qui vertèbrent le pays. On célébra partout ces libertés reconnues, transcription contemporaine des antiques « fueros » concept à peu près intraduisible en français, qui signifie à la fois des libertés et des droits reconnus, que les rois de jadis juraient de respecter, sous peine d'illégitimité.
Le mouvement donné instituait un équilibre, fragile comme tous les équilibres, et qu'il eût fallu - avec autorité et vigilance - faire scrupuleusement respecter.
C'est bien ce que Madrid n'a pas fait lorsque les équilibres commencèrent à être rompus en Catalogne. A y regarder de près, le système des partis, des alliances électorales et de gouvernement, n'a fait ici comme ailleurs que susciter et attiser les divisions latentes, tandis qu'à Madrid ce même système jouait en faveur du laisser-faire, autrement dit de l'inaction.
Les choses, contrairement au Pays Basque longtemps ravagé par le terrorisme, se sont passées en Catalogne sans violence mais, on le voit bien aujourd'hui, avec efficacité. Après un temps de renaissance catalane, libre, heureuse de vivre ou revivre, et satisfaite des nouvelles institutions, est venue l'heure des surenchères, de la conquête progressive des pouvoirs de fait par les catalanistes les plus sectaires. Un exemple suffit pour en juger et c'est, depuis bien longtemps déjà, l'interdiction de fait, quasi absolue, de l'espagnol à l'école et à l'université de Catalogne, privant d’ailleurs la jeunesse catalane du privilège du bilinguisme qui était jadis le sien dès la petite enfance. Madrid a laissé faire et plusieurs générations, toute une jeunesse, élèves et professeurs, ont été formées dans la haine de l'Espagne. Il eût certainement fallu interdire cette interdiction, rétablir partout l'espagnol dans ses droits de langue nationale ; c'est tout spécialement par la culture : école, université, médias, univers intellectuel, qu'un petit clan d’indépendantistes s'est progressivement emparé de quasiment tous les pouvoirs en Catalogne. Les anti-indépendantistes qualifient à juste titre leurs menées de coup d'Etat. Mais, ce coup ne s'est pas déroulé en un jour, il s'étale sur plusieurs décennies.
En somme, au long des dites dernières décennies, minée par le jeu délétère des partis, paralysée par sa faiblesse, Madrid a tout laissé faire, tout laissé passer, y compris l'inacceptable, y compris l’installation progressive d’une hostilité envers l’Espagne, qui a gagné une petite moitié des Catalans et coupé la société en deux parties adverses. Du beau travail ! Jusqu'à ce qu'à l'heure des échéances, ne reste plus à Madrid comme solution que l'usage de la force et de la violence. La responsabilité du gouvernement espagnol, ses atermoiements, nous semblent indéniables.
Du côté catalan, les partis révolutionnaires, d’implantation ancienne en Catalogne, ont fait leur travail habituel ; il n’est guère utile de s’en scandaliser. Mais sans-doute est-ce l'engagement indépendantiste des partis de centre-droit qui a rendu possible tout ce à quoi nous sommes en train d'assister.
Si les choses devaient tourner mal Outre-Pyrénées, et cela est bien possible, il ne faudrait pas oublier que - par-delà le légitime traditionalisme catalan - les présidents de centre-droit qui ont longtemps dirigé et président encore la région - Messieurs Jordi Pujol, Artur Mas et Carles Puigdemont, leurs partis et leurs soutiens - y auront une large part de responsabilité. Au détriment de la Catalogne et de l’Espagne, mais aussi de la France et de l’Europe. •
Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien ci-dessous


 L'interview d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et de longues heures d'antenne sur toutes les chaînes, les jours d'avant, d'après, et le dimanche soir fatidique où elle fut donnée, quoique, de l'aveu général, Macron n'y ait pas dit grand-chose, en tout cas rien de substantiel, et que cette interview n'ait été rien d'autre qu'un « exercice de style ».
L'interview d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et de longues heures d'antenne sur toutes les chaînes, les jours d'avant, d'après, et le dimanche soir fatidique où elle fut donnée, quoique, de l'aveu général, Macron n'y ait pas dit grand-chose, en tout cas rien de substantiel, et que cette interview n'ait été rien d'autre qu'un « exercice de style ». 




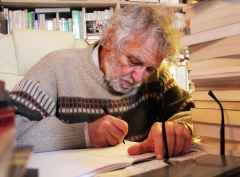

 L’Histoire en a décidé ainsi : mieux qu’espagnole, la Catalogne est l’Espagne elle-même, au même titre que sont l’Espagne toutes les provinces et communautés autonomes du royaume.
L’Histoire en a décidé ainsi : mieux qu’espagnole, la Catalogne est l’Espagne elle-même, au même titre que sont l’Espagne toutes les provinces et communautés autonomes du royaume. 
 Le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne est-il un discours historique ?
Le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne est-il un discours historique ?
 Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro, en charge du FigaroVox. Il vient de publier
Alexandre Devecchio est journaliste au Figaro, en charge du FigaroVox. Il vient de publier 



 «
« 

 Si l'on doutait que les journalistes - notamment de radio et de télévision - fussent attelés sans relâche et sans vergogne à une fonction de pure et classique propagande, l'affaire du Brexit, la façon très monolithique, très « formatée » dont elle n'a cessé d'être présentée, en donne une illustration tout à fait claire. Le bourrage de crâne parle chez nous un langage moins brutal, plus doucereux, que celui des régimes totalitaires d'autrefois ou même d'aujourd'hui, mais le résultat est le même. Sans qu'on soit sûr qu'il ne soit pis.
Si l'on doutait que les journalistes - notamment de radio et de télévision - fussent attelés sans relâche et sans vergogne à une fonction de pure et classique propagande, l'affaire du Brexit, la façon très monolithique, très « formatée » dont elle n'a cessé d'être présentée, en donne une illustration tout à fait claire. Le bourrage de crâne parle chez nous un langage moins brutal, plus doucereux, que celui des régimes totalitaires d'autrefois ou même d'aujourd'hui, mais le résultat est le même. Sans qu'on soit sûr qu'il ne soit pis. L'actuel ministre des Affaires Etrangères de Grande Bretagne, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, a écrit sur Winston Churchill un gros livre foisonnant, écrit à la va comme je te pousse, construit le plus anarchiquement du monde, mais bourré de faits, d'anecdotes, de mots d'esprit et surtout rempli d'admiration pour le courage, l'héroïsme même, le patriotisme et le profond loyalisme monarchique de son grand homme, dont il est patent qu'il est son modèle et son exemple. Son livre enseigne ces vertus.
L'actuel ministre des Affaires Etrangères de Grande Bretagne, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, a écrit sur Winston Churchill un gros livre foisonnant, écrit à la va comme je te pousse, construit le plus anarchiquement du monde, mais bourré de faits, d'anecdotes, de mots d'esprit et surtout rempli d'admiration pour le courage, l'héroïsme même, le patriotisme et le profond loyalisme monarchique de son grand homme, dont il est patent qu'il est son modèle et son exemple. Son livre enseigne ces vertus.

 « Un seul interlocuteur, en la personne de Mariano Rajoy »
« Un seul interlocuteur, en la personne de Mariano Rajoy »
 L’élection cette année à la présidence française d’Emmanuel Macron (39 ans, né en 1977), le plus jeune chef d’Etat français depuis Napoléon Bonaparte (Premier consul à 30 ans, en 1799) a suscité l’attention de chercheurs catholiques nord-américains, dont le journaliste Phil Lawler, connus pour investiguer dans les affaires intimes de leurs contemporains. Ils en ont déduit, par exemple, que si le président Macron reste marié à son épouse actuelle, Brigitte Trogneux (née en 1953, 64 ans, mère de trois enfants par son mariage précédent avec un certain M. Auzière qu’on donne pour « financier »), il n'aura pas de postérité.
L’élection cette année à la présidence française d’Emmanuel Macron (39 ans, né en 1977), le plus jeune chef d’Etat français depuis Napoléon Bonaparte (Premier consul à 30 ans, en 1799) a suscité l’attention de chercheurs catholiques nord-américains, dont le journaliste Phil Lawler, connus pour investiguer dans les affaires intimes de leurs contemporains. Ils en ont déduit, par exemple, que si le président Macron reste marié à son épouse actuelle, Brigitte Trogneux (née en 1953, 64 ans, mère de trois enfants par son mariage précédent avec un certain M. Auzière qu’on donne pour « financier »), il n'aura pas de postérité.