Jean-François Colosimo a accordé un entretien-fleuve à FigaroVox au sujet du rôle géopolitique de la Turquie au Proche-Orient. Il déplore le double-jeu d'Erdoğan et la passivité de l'Europe. Ses positions - largement explicitées et développées dans cet entretien - correspondent à celles que nous avons toujours défendues ici. LFAR
On a appris les bombardements d'un village chrétien de Sharanish au nord de l'Irak, dans le cadre des opérations anti-PKK. Juste après les attentats d'Istanbul, la Turquie avait lancé une campagne de frappes aériennes contre Da'ech en Irak et en Syrie. Quel est son ennemi prioritaire, Da'ech ou les minorités ?
Jean-François Colosimo: Une vague de bombes qui revêt valeur d'avertissement pour l'État islamique et de gage pour les États-Unis ne saurait épuiser la question du double jeu d'Ankara dans la nouvelle crise d'Orient. Le fait de se vouloir à la fois le champion de l'Otan et le passeur de Da'ech n'engage pas d'autre ennemi prioritaire que soi-même. La Turquie est en lutte contre la Turquie. Elle combat les spectres des massacres sur lesquels elle s'est édifiée. Que les minorités, chrétiennes ou autres, souffrent au passage, c'est leur sort. Car toute l'histoire moderne du pays se conjugue dans ce mouvement de balancier perpétuel entre adversité du dehors et adversité du dedans. Et au regard duquel les changements de régime ne comptent guère.
Comment s'est opéré le basculement d'une Turquie laïque vers l'intensification de l'emprise de l'islam sur toute la société? Quel est le sort des minorités ethniques et religieuses ?
Afin de comprendre la Turquie d'aujourd'hui, il faut, comme il est d'habitude en Orient, s'établir sur le temps long. Plusieurs illusions de perspective menacent en effet une claire vision: qu'il y aurait une permanence en quelque sorte éternelle de la Turquie, qu'il y aurait lieu d'opposer la Turquie laïciste de Mustafa Kemal et la Turquie islamiste de Recep Erdoğan, que l'avenir de la Turquie serait nécessairement assuré.
La Turquie contemporaine est incompréhensible sans l'Empire ottoman, lequel est lui-même incompréhensible sans l'Empire byzantin qui l'a précédé: comment passe-t-on, à l'âge moderne, d'une mosaïque multi-ethnique et pluri-religieuse à des ensembles nationaux et étatiques cohérents? Or, la décomposition de l'Empire ottoman, entamé dans les années 1820 avec l'indépendance de la Grèce, n'en finit pas de finir. Depuis la chute du communisme, de Sarajevo à Bagdad, les récents incendies des Balkans et les présents incendies du Levant attestent de sa reprise, de sa poursuite et de son caractère, pour l'heure, inachevé.
Ce processus historique, déjà long de deux siècles, explique à la fois la naissance et l'agonie de la Turquie moderne. Deux événements relevant de la logique de la Terreur encadrent son surgissement: le premier génocide de l'histoire, commis en 1915 par le mouvement progressiste des Jeunes-Turcs, soit 1 600 000 Arméniens d'Asie mineure anéantis ; la première purification ethnique de l'histoire, entérinée par la Société des Nations en 1923, consécutive à la guerre de révolution nationale menée par Mustafa Kemal et se soldant par l'échange des populations d'Asie mineure, soit 1 500 000 Grecs expulsés du terreau traditionnel de l'hellénisme depuis deux mille cinq cents ans. Une dépopulation qui a été aussi bien, il faut le noter, une déchristianisation.
La déconstruction impériale que se proposait d'acter le Traité de Sèvres en 1920, en prévoyant entre autres une Grande Arménie et un Grand Kurdistan, laisse la place à la construction de la Grande Turquie, acquise par les armes, qu'endosse le Traité de Versailles en 1923. La Turquie naît ainsi d'un réflexe survivaliste. Elle doit perpétuer sa matrice, continuer à chasser ses ennemis pour exister, sans quoi elle risque de retomber dans la fiction et l'inexistence. L'ennemi extérieur a été battu. Reste à vaincre l'ennemi intérieur. Ou, plutôt, les ennemis, tant ils sont nombreux et tant la fabrique nationaliste ne fonctionne qu'en produisant, à côté du citoyen-modèle, son double démonisé.
Qui ont été les victimes de cette politique ?
Dès l'instauration de la République par Kemal, la modernisation et l'occidentalisation se traduisent par l'exclusion. C'est vrai des minorités religieuses non-musulmanes, ce qu'il reste de Grecs, Arméniens, Syriaques, Antiochiens, Juifs, Domnehs (ou Judéo-musulmans), Yézidis, etc. C'est vrai des minorités musulmanes hétérodoxes, Soufis, Alévis, Bektâchîs, etc. C'est vrai des minorités ethniques, Kurdes, Lazes, Zazas, etc. Toute différence est assimilée à une dissidence potentielle. Toute dissidence est assimilée à un acte d'antipatriotisme. Tout antipatriotisme doit être supprimé à la racine. Tout signe distinct de culte, de culture ou de conviction doit être dissous dans une identité unique, un peuple idéal et un citoyen uniforme.
Cette guerre intérieure, que conduit l'État contre ces peuples réels au nom d'un peuple imaginaire, parcourt le petit siècle d'existence de la Turquie moderne. De 1925 à 1938, elle est dirigée contre les Kurdes à coups de bombes, de gaz et de raids militaires. En 1942, elle prend un tour légal avec la discrimination fiscale des communautés «étrangères», dont les Juifs, et la déportation dans des camps de dix mille réfractaires. De 1945 à 1974, elle s'appuie sur les pogroms populaires, à l'impunité garantie, pour liquider les derniers grands quartiers grecs d'Istanbul et leurs dizaines de milliers d'habitants tandis qu'à partir de 1989, les institutions religieuses arméniennes se trouvent plus que jamais otages d'un chantage à la surenchère négationniste. Avec les putschs de 1960, 1971, 1980, la guerre devient celle de l'armée contre la démocratie. Hors des périodes de juntes, elle est le produit du derin devlet, de «l'État profond», alliance des services secrets, des groupes fascisants et des mafias criminelles qui orchestre répressions sanglantes des manifestations, éliminations physiques des opposants et attentats terroristes frappant les mouvements contestataires: ce qui aboutit par exemple, entre les années 1980 - 2010, à décapiter l'intelligentsia de l'activisme alévi. Mais la guerre classique peut aussi reprendre à tout moment: dite « totale », puis « légale » contre le PKK d'Abdullah Öcalan avec la mise sous état de siège du Sud-Est, le pays kurde, elle présente un bilan de 42 000 morts et 100 000 déplacés à l'intérieur des frontières en vingt ans, de 1984 à 2002.
La prise de pouvoir d'Erdoğan et de l'AKP va permette un retour de l'islam au sein de l'identité turque. Elle acte en fait une convergence sociologique qui a force d'évidence démographique, accrue par la volonté de revanche des milieux traditionnels marginalisés par le kémalisme, des classes laborieuses délaissées par les partis sécularisés, de la paysannerie menacée par la modernisation mais aussi, dans un premier temps, des minorités tentées de rompre la chape de plomb étatique. La réalité va cependant vite reprendre ses droits: le fondamentalisme sunnite devient la religion constitutive de la « turquité » comme, hier, l'intégrisme laïciste. La couleur de l'idéologie change, mais ni la fabrique, ni la méthode, ni le modèle. Les minorités, abusées, trahies, redeviennent les cibles d'une construction artificielle et imposée. Mais entretemps, à l'intérieur, la société est divisée puisqu'elle compte une avant-garde artistique et intellectuelle constituée. Et à l'extérieur, la stabilité intermittente issue du Traité de Lausanne cède devant les réalités oubliées du Traité de Sèvres.
Quelles sont les ambitions géopolitiques de la Turquie dans la région proche-orientale et caucasienne ?
Parallèlement à son entreprise d'islamisation de la société, Erdoğan a voulu établir la Turquie comme puissance internationale conduisant une politique autonome d'influence. La Turquie laïciste et militaire de la Guerre froide, intégrée au bloc occidental, n'est plus qu'un fantôme, servant de leurre à une ambition néo-ottomane. La Turquie veut à nouveau dominer le monde musulman proche-oriental. Or les pays arabes du Levant ont précisément fondé leur indépendance sur le rejet du joug des Turcs-ottomans, considérés comme des intrus politiques et des usurpateurs religieux et les anciennes républiques musulmanes d'URSS restent dans l'orbe de Moscou. C'est la limite de l'exercice.
Erdoğan a néanmoins voulu jouer sur tous les tableaux: comme protecteur des entités ex-soviétiques turcophones en Asie centrale et sunnites au Caucase ; comme médiateur de la Palestine et de la Syrie au Machrek ; comme allié des populations islamisées d'Albanie, du Kosovo et de Bosnie en Europe ; et même comme défenseur des Ouïghours musulmans en Chine. Le signe le plus probant de sa rupture avec l'Occident étant de s'être posé en adversaire d'Israël, jusque-là l'allié d'Ankara, à l'occasion de ses sorties verbales à Davos ou des expéditions navales présentées comme humanitaires à destination de Gaza.
Le fil rouge? Que la Turquie, sortie de l'effondrement de l'Empire ottoman, déportée à l'Ouest par une laïcisation jugée contre-nature, redevienne la première puissance du monde musulman et sunnite.
Comment comprendre l'emprise d'Erdogan et de l'AKP, un parti islamo-conservateur, sur un pays qui semblait avoir réalisé une entreprise d'européanisation et de laïcisation depuis un siècle ?
La pointe fine de la société civile, souvent remarquable, issue des anciens milieux cosmopolites d'Istanbul-Constantinople ou d'Izmir-Smyrne, tournée vers l'Europe non pas comme modèle de technicité mais de culture, reste malheureusement inefficace dans l'ordre politique. De surcroît, maladie fréquente dans les pays musulmans de Méditerranée orientale, l'opposition démocratique est éclatée, les forces progressistes étant divisées, notamment à cause de la question des minorités. Enfin, Erdoğan a su mener une guerre souterraine visant à soumettre les pouvoirs qui pouvaient lui résister: militaire, parlementaire, judiciaire, médiatique, et même religieux. L'erreur et la honte de l'Europe sont d'avoir laissé se développer son emprise tyrannique.
Il faut rappeler l'affaire Ergenekon, du nom d'un réseau supposément composé de militants nationalistes sous la coupe d'officiers militaires et démantelé par le gouvernement islamiste. Entre 2008 et 2010, à la faveur d'une instruction et d'un procès fleuve, trois cents personnes ont été arrêtées, 194 inculpées, et les condamnations aussi nombreuses ont permis de mettre au pas l'armée et de discréditer l'idéologie républicaine. Il faut rappeler les dizaines et dizaines de journalistes virés sur ordre d'en-haut, emprisonnés pour offenses à la patrie, à l'islam, au chef de l'État. Il faut rappeler les poursuites judiciaires contre l'écrivain Orhan Pamuk qui avait osé évoquer le génocide des Arméniens, contre le pianiste Fazil Say qui avait osé se déclarer athée. Mais aussi la restauration du voile dans l'espace public sous prétexte de liberté de conscience, l'hypertaxation du raki et plus généralement de l'alcool sous prétexte de lutte contre l'alcoolisme, la multiplication des mosquées sous prétexte de la moralisation de la jeunesse, etc.
Dans le même temps, le mouvement protestataire né à Istanbul après qu'Erdogan a annoncé sa volonté de détruire le Parc Gezi de Taksim, ce bastion alévi, a récemment enflammé la Turquie. La résistance qui existe est ainsi populaire et parcourue par les survivances minoritaires.
Nous sommes face à un engrenage et une dérive autoritaire qui ne dit pas son nom. Au point que, alors qu'Erdoğan fustige «les nationalismes ethniques et religieux qui menacent la Turquie» (sic), bat le rappel de la pièce de théâtre qu'il avait écrite dans les années 1970 et dans laquelle il dénonçait le complot franc-maçon, juif et communiste, qu'il avance que les musulmans ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb ou que l'hitlérisme a été un facteur de modernisation, qu'il se fait construire un palais de mille pièces à Ankara, c'est son mentor spirituel, l'islamiste Fethullah Gülen, qui dénonce la mainmise et la corruption de l'AKP!
Or, signe des temps, les dernières élections ont vu pour la première fois des Turcs non- kurdes voter pour des candidats kurdes, en l'occurrence ceux du parti HDP mené par Selahattin Dermitaş. Cela montre que la société entend barrer la route à la révision constitutionnelle grâce à laquelle Erdoğan veut s'attribuer les pleins pouvoirs. C'est dans ce contexte qu'est survenue l'instrumentalisation des attentats attribués à Da'ech.
Quelle position la Turquie a-t-elle adopté à l'endroit de Da'ech ?
Le sommet de la politique d'islamisation d'Erdoğan est le soutien implicite de la Turquie à Da'ech, par hostilité au régime d'Assad, aux courants progressistes arabes, et par une alliance objective sur le sunnisme fondamentaliste. La Turquie s'élève enfin contre l'essor de l'identité kurde en Turquie et, de ce point de vue, son alliance avec Da'ech est objective.
C'est l'État turc qui a déverrouillé l'État islamique en lui offrant un hinterland propice au transport des combattants, à l'approvisionnement en armes, au transfert de devises, au commerce du pétrole. C'est la société turque qui souffre de ce rapprochement insensé. C'est l'Europe qui s'entête à demeurer aveugle à cette connivence mortifère.
Pour quelle raison cette ambiguïté turque n'est-elle pas dénoncée par les pays qui luttent contre l'État islamique ?
Parce que l'Europe impotente, sans diplomatie et sans armée a cédé au chantage d'Erdoğan sur l'endiguement supposé des réfugiés. Argent, reconnaissance, soutien, silence: Merkel et Hollande ont tout accordé à Erdoğan. Surtout, l'Union se plie au diktat de la politique ambivalente d'Obama qui privilégie l'axe sunnite, saoudien-qatari-turc, avec pour souci premier de ne pas sombrer l'Arabie saoudite dans le chaos.
Comment une Turquie entrée dans une phase d'islamisation à marche forcée peut-elle encore espérer intégrer une Union européenne laïque? Pour quelle raison l'UE, depuis 1986, continue-t-elle à fournir des fonds structurels à un État dont il est hautement improbable qu'il entre en son sein ?
La Turquie, en raison de son héritage byzantin, partagé entre l'Ouest et l'Est, a depuis toujours manifesté une volonté d'association avec l'Occident. Sa tentative d'entrer dans l'UE était liée au fait qu'une Turquie laïciste et moderne voulait être un exemple d'européanisation. Or aujourd'hui s'est opéré un renversement d'alliance vers l'Orient, et de l'occidentalisation à l'islamisation.
L'entrée de la Turquie dans l'UE semblait cependant peu probable et le paraît encore moins aujourd'hui pour plusieurs raisons: géographiquement, l'Europe s'arrête au Bosphore. Historiquement, l'Europe s'est affirmée à Lépante et à Vienne en arrêtant les Ottomans. Politiquement, la Turquie deviendrait le pays à la fois le plus peuplé et le moins avancé, le plus religieux et le moins démocratique de l'Union. Militairement, elle en porterait les frontières sur des zones de guerre. Mais, surtout, culturellement, philosophiquement, l'État turc, non pas les intellectuels turcs, refuse cette épreuve typiquement européenne du retour critique sur soi et sur l'acceptation d'une mémoire partagée quant au passé, à commencer par le génocide des Arméniens. Mais l'arrimage de la Turquie à l'Europe, sous la forme de partenariat privilégié, doit demeurer un objectif. Il ne passe pas par une amélioration des cadres politiques ou économiques, mais par une libération des mentalités. Ce que veut empêcher Erdoğan.
L'affrontement russo-turc est-il en passe de se durcir ?
Erdoğan a osé défier Poutine sans en avoir les moyens et pour complaire aux États-Unis. L'opposition là encore est ancienne, ancrée, pluriséculaire et constitue un invariant de la géopolitique des civilisations. Un des vieux rêves tsaristes était de conquérir l'Empire ottoman afin de restaurer Byzance dont la Russie est issue. En 1915, l'annexion de Constantinople-Istanbul et sa transformation en Tsargrad, nouvelle capitale d'un Empire chrétien d'Orient couvrant des mers froides aux mers chaudes était à l'ordre du jour. Ce conflit renaît aujourd'hui: on aura ainsi vu récemment les Turcs réclamer la Crimée, redevenue russe, comme «terre de leurs ancêtres». Ou le parlement turc débattre du retour de Sainte-Sophie, la plus grande basilique du monde jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, transformée en musée sous Atatürk, au statut de mosquée qui avait été le sien sous l'Empire ottoman, tandis que les députés de la Douma votaient une motion en faveur de sa réouverture au culte orthodoxe.
Moscou est déjà l'alliée d'Assad: il ne lui resterait qu'à appuyer les Kurdes, en profitant par exemple de leurs puissants relais communs en Israël, pour menacer profondément Ankara et embarrasser durablement Washington. Erdoğan a compris trop tardivement que, eu égard à la détermination de Poutine, il avait allumé un incendie.
Comment expliquer l'incohérence de la politique étrangère de la France au Proche-Orient? Le pouvoir a-t-il une compréhension des ressorts profonds qui animent les pays de cette région ?
Ces considérations historico-religieuses échappent totalement au gouvernement français et à l'Union européenne. La France fait preuve d'un manque de compréhension flagrant des ressorts profonds de ce qui se passe au Proche-Orient. Cette incompréhension n'est jamais qu'un signe de plus de l'erreur politique et morale qu'a été le choix d'abandonner le Liban qu'avait été celui de François Mitterrand. François Hollande, encore moins avisé, professe pour des raisons gribouilles de dépendance économique, une politique d'inféodation envers les pays théoriciens et fournisseurs de l'islamisme arabe qu'il était prêt à intituler pompeusement « la politique sunnite de la France » si quelques vieux pontes du Quai d'Orsay doués de mémoire ne l'en avaient pas dissuadé.
La France de François Hollande a substitué à sa traditionnelle politique d'équilibre en Orient une politique hostile à l'Iran et à la Syrie, ignorante des Chiites et indifférente aux chrétiens. Ce n'est pas qu'une faute de Realpolitik, c'est une faute de l'intelligence et du cœur. Ou si l'on préfère, du devoir et de l'honneur.
Quant à la Turquie proprement dite, au sein de cette «politique sunnite» que dirige Washington, c'est Berlin, liée de manière décisive à Ankara par la finance, l'industrie, l'immigration, qui décide pour Paris.
Mais cet aveuglement de la gauche au pouvoir est-il si surprenant? Ce furent les socialistes d'alors, leurs ancêtres en quelque sorte, qui entre 1920 et 1923 encouragèrent les Grecs à reconquérir les rivages du Bosphore et de l'Égée avant de les trahir au profit de Mustafa Kemal, arguant qu'il fallait l'armer car son progressisme avait l'avantage sur le terrain et représentait l'avenir absolu. Et quitte à faire retomber une nouvelle fois Byzance dans l'oubli! Quel aveuglement sur la force du théologique en politique… Rien de bien neuf sur le fond, donc. Mais les massacres qui se préparent en Orient creuseront de nouveaux charniers qui, pour l'histoire, changeront cette ignorance passive en cynisme délibéré. •
Jean-François Colosimo est écrivain et essayiste. Président du Centre national du livre de 2010 à 2013, il dirige désormais les éditions du Cerf. Son dernier livre, Les Hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, est paru en septembre 2014 aux éditions Fayard. Il a également publié chez Fayard Dieu est américain en 2006 et L'Apocalypse russe en 2008.
Entretien par Eléonore de Vulpillières

 Après tant et tant de voyages, de combats et d'épreuves, Boutros Boutros-Ghali eut l'ultime consolation de mourir au Caire, dans son pays, parmi les siens ; malgré les atteintes de l'âge, il était toujours, à 94 ans, débordant d'esprit, de cœur et d'un goût insatiable pour le travail, qui firent de ce grand scribe d'apparence frêle et d'une impeccable élégance, une personnalité connue et respectée dans le monde entier, en particulier dans l'univers francophone, en France et bien entendu en Egypte.
Après tant et tant de voyages, de combats et d'épreuves, Boutros Boutros-Ghali eut l'ultime consolation de mourir au Caire, dans son pays, parmi les siens ; malgré les atteintes de l'âge, il était toujours, à 94 ans, débordant d'esprit, de cœur et d'un goût insatiable pour le travail, qui firent de ce grand scribe d'apparence frêle et d'une impeccable élégance, une personnalité connue et respectée dans le monde entier, en particulier dans l'univers francophone, en France et bien entendu en Egypte.
 Dans son roman d'anticipation 2084, le grand écrivain algérien imaginait un monde dominé par l'islam radical. Il se montre tout aussi pessimiste pour l'avenir de l'Algérie.
Dans son roman d'anticipation 2084, le grand écrivain algérien imaginait un monde dominé par l'islam radical. Il se montre tout aussi pessimiste pour l'avenir de l'Algérie. Entretien par
Entretien par 

 Il est vrai, que dire du retour de Ayrault en remplacement du catastrophique Fabius promu à la présidence du Conseil constitutionnel, de l’arrivée de trois ministres écologistes, d’un retour au respect strict de la parité dans l’équipe ministérielle ou de la création de secrétariats d’Etat à l’intitulé démagogique — on croyait avoir tout vu, en 1981, avec le ministère du temps libre ? C’était sans compter des équipes de communicants pouvant vendre n’importe quoi à un François Hollande, voire à un Manuel Valls qu’on pensait plus lucide, totalement dépourvus du sens du ridicule. Croient-ils que les Français, confrontés, sur leur sol, au terrorisme islamiste, au déferlement migratoire et à l’aggravation de la crise économique, n’aient d’autre attente que la création d’un très stalinien secrétariat d’Etat à l’égalité réelle (sic), d’un autre, lacrymal, à l’aide aux victimes ou, d’un troisième, très politiquement correct, aux relations internationales sur le climat et à la biodiversité ? Alors qu’en temps de crise une équipe resserrée s’impose pour garantir la cohérence de l’action, Hollande, en homme de la IVe, a fait le choix inverse : satisfaire tous ceux qui pourront, pense-t-il, l’aider à gagner en 2017, des radicaux de gauche, avec le retour de leur président, Baylet, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, et présentement puissant homme de presse, qui jappait d’impatience depuis le début du quinquennat, aux deux tendances écologistes : EELV par la personne d’Emmanuelle Cosse, et la dissidence. Non sans que cette promotion d’arrivistes notoires n’achève une mouvance qui, depuis sa création, n’a jamais su donner que le pire des spectacles politiciens, ce qui est assez naturel pour un parti dépourvu de tout sens de la cité : il est alors condamné à n’être que sa propre caricature, l’ambition personnelle ne pouvant prendre le masque de la recherche du Bien commun.
Il est vrai, que dire du retour de Ayrault en remplacement du catastrophique Fabius promu à la présidence du Conseil constitutionnel, de l’arrivée de trois ministres écologistes, d’un retour au respect strict de la parité dans l’équipe ministérielle ou de la création de secrétariats d’Etat à l’intitulé démagogique — on croyait avoir tout vu, en 1981, avec le ministère du temps libre ? C’était sans compter des équipes de communicants pouvant vendre n’importe quoi à un François Hollande, voire à un Manuel Valls qu’on pensait plus lucide, totalement dépourvus du sens du ridicule. Croient-ils que les Français, confrontés, sur leur sol, au terrorisme islamiste, au déferlement migratoire et à l’aggravation de la crise économique, n’aient d’autre attente que la création d’un très stalinien secrétariat d’Etat à l’égalité réelle (sic), d’un autre, lacrymal, à l’aide aux victimes ou, d’un troisième, très politiquement correct, aux relations internationales sur le climat et à la biodiversité ? Alors qu’en temps de crise une équipe resserrée s’impose pour garantir la cohérence de l’action, Hollande, en homme de la IVe, a fait le choix inverse : satisfaire tous ceux qui pourront, pense-t-il, l’aider à gagner en 2017, des radicaux de gauche, avec le retour de leur président, Baylet, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, et présentement puissant homme de presse, qui jappait d’impatience depuis le début du quinquennat, aux deux tendances écologistes : EELV par la personne d’Emmanuelle Cosse, et la dissidence. Non sans que cette promotion d’arrivistes notoires n’achève une mouvance qui, depuis sa création, n’a jamais su donner que le pire des spectacles politiciens, ce qui est assez naturel pour un parti dépourvu de tout sens de la cité : il est alors condamné à n’être que sa propre caricature, l’ambition personnelle ne pouvant prendre le masque de la recherche du Bien commun.
 Joie, gastronomie et croissance ! La France accueille désormais sur les Champs-Élysées le plus grand « restaurant » McDonald's du monde. Un exemple de réussite puisque le géant du sandwich atteint en France la quintessence de son art, au moment même où ses résultats reculent aux États-Unis. Là-bas, c'est une blogueuse qui a sonné la révolte contre la nourriture grasse et sucrée, déclenchant un mouvement de défiance contre le modèle jusque-là triomphant. Heureusement pour McDonald's, il reste la France, ce paradis ! La direction américaine, jusque-là sceptique, est même venue en délégation au printemps 2015 prendre des cours auprès de son entité française.
Joie, gastronomie et croissance ! La France accueille désormais sur les Champs-Élysées le plus grand « restaurant » McDonald's du monde. Un exemple de réussite puisque le géant du sandwich atteint en France la quintessence de son art, au moment même où ses résultats reculent aux États-Unis. Là-bas, c'est une blogueuse qui a sonné la révolte contre la nourriture grasse et sucrée, déclenchant un mouvement de défiance contre le modèle jusque-là triomphant. Heureusement pour McDonald's, il reste la France, ce paradis ! La direction américaine, jusque-là sceptique, est même venue en délégation au printemps 2015 prendre des cours auprès de son entité française.
 Après mille ans d’anathèmes, Rome et Moscou se parlent de nouveau, pour le plus grand profit des chrétientés orientale et romaine.
Après mille ans d’anathèmes, Rome et Moscou se parlent de nouveau, pour le plus grand profit des chrétientés orientale et romaine.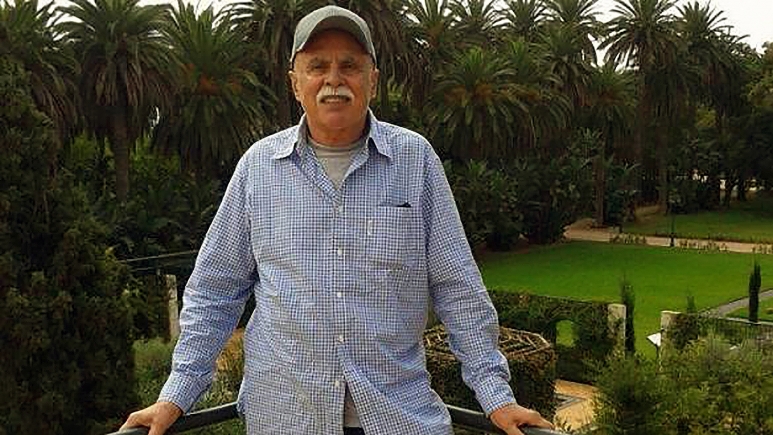

 Certes, les rapprochements n'ont pas valeur absolue car rien ne se répète à l'identique en Histoire. Ils ne sont pas non plus à ignorer car rien n'y est radicalement nouveau. A l'esprit d'analyse et de finesse, au devoir de réalisme et d'observation de faire leur travail ... Le moins que l'on puisse dire c'est que la diplomatie française a singulièrement manqué de ces qualités élémentaires ces dernières années.
Certes, les rapprochements n'ont pas valeur absolue car rien ne se répète à l'identique en Histoire. Ils ne sont pas non plus à ignorer car rien n'y est radicalement nouveau. A l'esprit d'analyse et de finesse, au devoir de réalisme et d'observation de faire leur travail ... Le moins que l'on puisse dire c'est que la diplomatie française a singulièrement manqué de ces qualités élémentaires ces dernières années. 

 Parmi mes manies figure l’ordre, y compris quand je ne suis que de passage dans une chambre d’hôtel. « L’air de rien, l’ordre et la méthode ont fait la force de la Vieille Europe », devait me dire un jour le président-poète sénégalais Léopold Senghor, sans doute pour me décomplexer.
Parmi mes manies figure l’ordre, y compris quand je ne suis que de passage dans une chambre d’hôtel. « L’air de rien, l’ordre et la méthode ont fait la force de la Vieille Europe », devait me dire un jour le président-poète sénégalais Léopold Senghor, sans doute pour me décomplexer.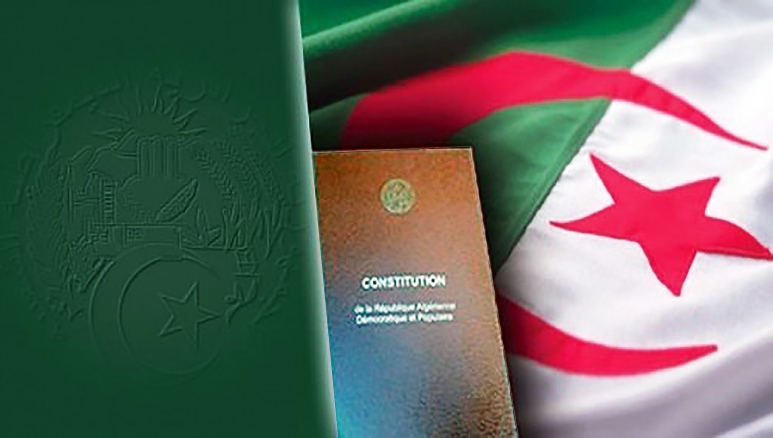
 Dimanche, l’Algérie votera sa nouvelle Constitution. Dernière œuvre politique majeure du président Abdelaziz Bouteflika, la révision de la Constitution a été approuvée le 11 janvier dernier en Conseil des ministres. Si certaines mesures ont été saluées par l’opinion publique, comme la reconnaissance officielle de la langue amazighe, d’autres agacent quelques opposants. C’est le cas de l’article 51 qui restreint fortement les droits des binationaux.
Dimanche, l’Algérie votera sa nouvelle Constitution. Dernière œuvre politique majeure du président Abdelaziz Bouteflika, la révision de la Constitution a été approuvée le 11 janvier dernier en Conseil des ministres. Si certaines mesures ont été saluées par l’opinion publique, comme la reconnaissance officielle de la langue amazighe, d’autres agacent quelques opposants. C’est le cas de l’article 51 qui restreint fortement les droits des binationaux.
 Je n'ai rien contre l'armée, au contraire, mais, en temps de paix je préfère quand même l'excursion champêtre à l’entraînement militaire et la fréquentation d'une bonne bibliothèque à la formation de jeunes recrues…
Je n'ai rien contre l'armée, au contraire, mais, en temps de paix je préfère quand même l'excursion champêtre à l’entraînement militaire et la fréquentation d'une bonne bibliothèque à la formation de jeunes recrues…
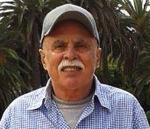 « De Libye vient toujours du nouveau ! » nous apprit le Grec Hérodote qui forgea le nom de ce vaste pays à partir des Lébous, antique tribu berbère des lieux. Ces nouveautés libyennes furent souvent positives comme l'empereur romain Septime-Sévère, venu de Leptis-Magna ou bien la dynastie nationale des Karamanlis (1711-1835) ; ou encore la confrérie islamo-nationaliste, d'origine algérienne, des Sénoussis, qui, avec le règne du pacifique roi Idriss 1er (1951-1969) donna au pays ce qui fait figure aujourd'hui, face au sanglant chaos général, de « belle époque ».
« De Libye vient toujours du nouveau ! » nous apprit le Grec Hérodote qui forgea le nom de ce vaste pays à partir des Lébous, antique tribu berbère des lieux. Ces nouveautés libyennes furent souvent positives comme l'empereur romain Septime-Sévère, venu de Leptis-Magna ou bien la dynastie nationale des Karamanlis (1711-1835) ; ou encore la confrérie islamo-nationaliste, d'origine algérienne, des Sénoussis, qui, avec le règne du pacifique roi Idriss 1er (1951-1969) donna au pays ce qui fait figure aujourd'hui, face au sanglant chaos général, de « belle époque ».
