Au lendemain de la rencontre de Vladimir Poutine avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, Hadrien Desuin* analyse pour le Figaro - avec pertinence selon nous - les enjeux de la guerre en Syrie. Un nouvel équilibre des forces au Moyen-Orient se met en place. Lequel, soit dit en passant, relativise et renvoie au passé, les violentes critiques portées par les Etats-Unis, l'Union Européenne, la diplomatie française et maints observateurs, à l'encontre de la Russie et de Vladimir Poutine. Les échecs qu'on lui prédisait, ainsi d'ailleurs que la chute d'Assad annoncée comme imminente il y a trois ou quatre ans, ne se sont pas produits. Et cette politique nous a fait perdre ces mêmes trois ou quatre années, au cours desquelles Daech s'est considérablement renforcé, où le chaos s'est répandu à travers le Moyen-Orient tout entier, avec, pour nous, Français et Européens, les conséquences que l'on sait. Cette politique, nous l'avons toujours dénoncée, ici. Et sans-doute avions-nous raison. LFAR
LE FIGARO - Le président russe Vladimir Poutine a rencontré lundi à Moscou le Premier ministre israélien Nétanyahou au sujet de la guerre en Syrie. Selon Haaretz, cette visite semble refléter « le manque de foi [de ce dernier] dans la capacité et la volonté des Etats-Unis à protéger les intérêts sécuritaires israéliens. » La Russie est-elle un nouvel acteur majeur dans la région ?
Hadrien DESUIN - Les derniers renforcements russes en Syrie frappent l'imaginaire collectif. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide et l'intervention soviétique en Afghanistan, l'armée russe s'apprête à intervenir au Moyen-Orient. Les Russes avaient conservé leur base de Tartous et fournissaient en armes l'armée syrienne mais Poutine a changé de braquet: désormais c'est l'armée russe qui frappe. Il s'agit d'un événement majeur qui va marquer l'histoire des relations internationales: un nouvel équilibre des forces au Moyen-Orient se met en place. Il faut se souvenir que les interventions américaines dans le Golfe ont été rendues possible par la chute de l'URSS. Mais progressivement la Russie poutinienne restaure les positions soviétiques au Moyen-Orient, ce que n'aurait pas déplu à Evgueni Primakov qui vient de disparaître.
Il faut toutefois nuancer. La stratégie russe n'est pas une logique de guerre froide et d'opposition aux armées occidentales mais plutôt d'aiguillon. L'idée est de participer à la coalition anti-Daech en s'appuyant sur l'armée syrienne et non les «rebelles». Rebelles qu'à l'exception de quelques idéologues, on peine à distinguer des groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda. La Russie ne veut pas apparaître comme un trublion mondial. Au contraire, elle souhaite jouer un rôle dans le nouveau monde multipolaire qui s'ouvre après la fin de l'hégémonie américaine post-URSS.
Côté israélien, il y a une vraie déception vis-à-vis des Etats-Unis et un certain pragmatisme. Marqué par le conflit contre le Hezbollah au Liban-sud, le chef du Likoud a d'abord misé sur la chute de Bachar Al-Assad. Le premier ministre israélien a dès lors voulu jouer le Capitole contre la Maison-Blanche ; mal lui en a pris. Ses réseaux dans le parti républicain n'ont pas suffit. Même les électeurs juifs démocrates n'ont pas suivi son obsession anti-iranienne. Peut-être aussi que la droite nationaliste israélienne voit d'un bon oeil l'émergence de Daech, qui peut cyniquement diviser le camp djihadiste, notamment le Hamas.
Par dépit, Netanyahou se tourne vers Moscou qui pourtant applique une politique pro-iranienne dans la région. Il s'agit sans doute d'une simple coordination technique entre les états-majors aériens. Netanyahou en profite aussi pour marquer sa désapprobation vis-à vis de l'administration Obama. Avec l'idée que le grand retour de la Russie au Moyen-Orient ne manquera pas d'être exploité par les républicains qui pointent la prudence excessive de Barack Obama.
Comment expliquer ce basculement alors que la Russie était la cible de violentes critiques de la part des EU et de l'UE ?
Le principe de réalité finit toujours par prendre le dessus sur les émotions morales. La stratégie occidentale est en échec en Syrie depuis quatre ans. Le groupe des amis de la Syrie qui avait exclu les positions iranienne et russe n'a jamais pu apporter la preuve de la crédibilité de l'armée syrienne libre (ASL) et sa branche politique, le conseil national syrien. La Russie, de son côté, a toujours proposé ses bons offices diplomatiques pour dénouer le nœud syrien et trouver une solution interne au régime des Assad.
Pour l'opinion occidentale, les crimes de Daech sont désormais nettement plus insupportables que les tentatives de Bachar Al-Assad de rester au pouvoir. C'est donc la position russe qui apparaît la plus juste mais aussi la plus réaliste. On joue sur les mots mais plus personne en haut lieu n'appelle à un changement de régime à Damas. Mutatis mutandis, les occidentaux s'alignent sur la position russe. C'est-à-dire la priorité donnée à la lutte contre le terrorisme islamiste.
La Russie semble être le pays le plus déterminé à attaquer Daech . Comment expliquer la lenteur des pays européens et des Etats-Unis à s'allier avec Moscou ?
On disait l'économie russe à genoux, le pouvoir politique de Poutine vacillant, isolé sur la scène internationale. Il n'en n'est rien. Comme disait Bismarck, «la Russie n'est jamais aussi forte ni aussi faible qu'il n'y paraît.» Largement surestimée au cours de la guerre froide, la Russie a, depuis 25 ans, été négligée au Moyen-Orient. Mais l'image d'une armée russe en déliquescence dans les années 90 n'est plus d'actualité. Poutine et ses généraux se sentent suffisamment forts désormais pour se projeter au Moyen-Orient et déployer le meilleur de leur technologie.
Comme à son habitude, Vladimir Poutine a manœuvré en discrétion pendant tout le mois de septembre jusqu'à ce que son appui à l'armée syrienne ne puisse plus être contesté. Comme en Crimée et en Géorgie, Poutine ne veut pas provoquer mais les Occidentaux sont mis en douceur devant le fait accompli, sans déclaration tonitruante ni fanfaronnade. Les rôles s'inversent puisque jusqu'à présent ce sont les Occidentaux qui mettaient bruyamment la Russie devant le fait accompli.
Pour autant, les puissances occidentales, échaudées par leurs échecs successifs dans la région réalisent au fur et à mesure que Poutine et Lavrov peuvent poursuivre le rôle positif qu'ils ont joué dans les négociations avec l'Iran.
Laurent Fabius s'est montré hostile à la visite de parlementaires français en Crimée, et opposé à la vente des Mistral à Moscou. La France est sous embargo alimentaire russe depuis 2014 après les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie… Comment analysez-vous l'attitude de la diplomatie française envers la Russie? La France est-elle en train de manquer une rapprochement de poids avec Moscou ?
La position de Laurent Fabius reste arc-boutée sur le départ de Bachar Al-Assad comme s'il vivait encore dans le mirage des printemps arabes. Mais Daech a pris de plus en plus d'importance jusqu'à la prise de Mossoul. Les Occidentaux ont alors été contraints de prendre la défense de Bagdad et les militaires ont fait pression pour élargir les opérations à la Syrie. Jean-Yves Le Drian en France, John Kerry et Ashton Carter [actuel secrétaire d'Etat américain à la Défense, ndlr] aux Etats-Unis ont été les premiers à pousser à reprendre le dialogue avec Damas. C'est eux qui tirent François Hollande et Barack Obama à se rapprocher de la position russe.
Laurent Fabius, toujours en retard d'une guerre, semble encore penser le monde des années 90. Depuis trois ans, il réclame le départ préalable de Bachar Al-Assad sans tenir compte de la position russe. Dans un entretien paru aujourd'hui dans Le Figaro, il trouve pour la première fois absurde de demander des excuses à Assad avant toute discussion. Mais si on négocie avec un chef d'État, c'est reconnaître sa légitimité et sa capacité dans l'avenir à mettre en place l'accord. Ce qui n'est pas compatible avec une exigence de départ à court ou moyen terme.
Sur les questions de sécurité, Laurent Fabius qui se comporte en Vice-président, accumule les revers. Ses rapports avec la Russie ont semblé en opposition avec le ministère de la Défense dont l'approche est nettement plus réaliste. Engoncé dans un discours moralisateur, Laurent Fabius est en décalage avec les événements et semble avoir perdu tout crédit pour diriger la diplomatie française. Son départ en décembre, à la faveur du remaniement post-élections régionales pourrait permettre de renouer les liens traditionnels avec la Russie et redonner des marges de manœuvre à François Hollande. •
* Ancien élève de l'École spéciale militaire de St-Cyr puis de l'École des officiers de la Gendarmerie nationale, Hadrien Desuin est titulaire d'un master II en relations internationales et stratégie sur la question des Chrétiens d'Orient, de leurs diasporas et la géopolitique de l'Égypte, réalisé au Centre d'Études et de Documentation Économique Juridique et social (CNRS/MAE) au Caire en 2005. Il a dirigé le site Les Conversations françaises de 2010 à 2012. Aujourd'hui il collabore à Causeur et Conflits où il suit l'actualité de la diplomatie française dans le monde.
Entretien réalisé par Eléonore de Vulpillières

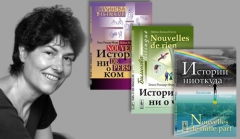 Le Nobel de littérature a été attribué.
Le Nobel de littérature a été attribué.

 La cruauté des gros plans télévisés sur les traits des politiciens en difficultés a parfois quelque chose d’insoutenable: il fallait voir en cette fin septembre la terrible mine plus que grise, funèbre même de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, pendant que le président Hollande annonçait à la Terre entière que l’armée de l’air française avait commencé ses «frappes» (on ne dit plus « bombardements», mot qui effraie les opinions publiques occidentales, pauvres chéries trop sensibles…) sur Daech en Syrie.
La cruauté des gros plans télévisés sur les traits des politiciens en difficultés a parfois quelque chose d’insoutenable: il fallait voir en cette fin septembre la terrible mine plus que grise, funèbre même de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, pendant que le président Hollande annonçait à la Terre entière que l’armée de l’air française avait commencé ses «frappes» (on ne dit plus « bombardements», mot qui effraie les opinions publiques occidentales, pauvres chéries trop sensibles…) sur Daech en Syrie. 

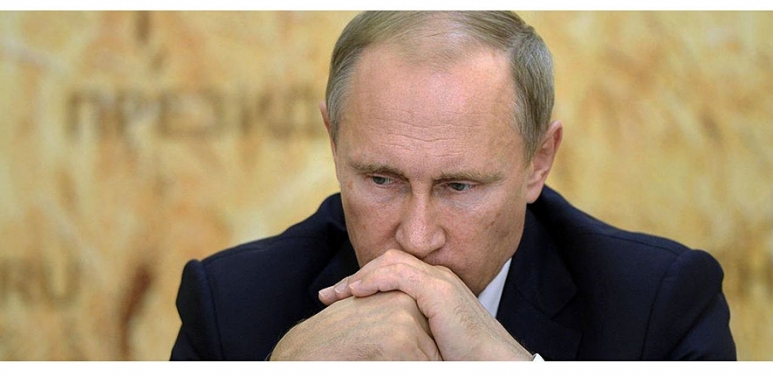
 De Gaulle en ses Mémoires : « Vers l'Orient compliqué, je m'envolai avec des idées simples.» Mieux valent des idées simples que pas d'idées du tout. C'est ce vide quasiment abyssal qui semble régner sur la politique étrangère de la France, et ce, depuis quelques années. Sarkozy voulut se débarrasser de Kadhafi au nom de la liberté et des droits de l'homme, ce qui était tout à fait légitime, mais ce faisant, il a complètement ignoré le fait qu'une dictature peut en cacher une autre, pire encore. Kadhafi était une brute sanguinaire que gouvernements de gauche et de droite reçurent en grande pompe, puisque le pétrole reste l'horizon indépassable de notre temps européen. L'on se rappelle les vivats médiatiques, les poèmes lyriques et les autocongratulations euphoriques qui accueillirent la chute du tyran. Résultat des courses : la voie des grandes migrations fut ouverte avec fracas et, dans leur candeur naïve, nos protagonistes ne songeaient même pas, les choses méditerranéennes étant ce qu'elles sont, qu'aux serments de Tobrouk allaient succéder les décapitations de Syrte.
De Gaulle en ses Mémoires : « Vers l'Orient compliqué, je m'envolai avec des idées simples.» Mieux valent des idées simples que pas d'idées du tout. C'est ce vide quasiment abyssal qui semble régner sur la politique étrangère de la France, et ce, depuis quelques années. Sarkozy voulut se débarrasser de Kadhafi au nom de la liberté et des droits de l'homme, ce qui était tout à fait légitime, mais ce faisant, il a complètement ignoré le fait qu'une dictature peut en cacher une autre, pire encore. Kadhafi était une brute sanguinaire que gouvernements de gauche et de droite reçurent en grande pompe, puisque le pétrole reste l'horizon indépassable de notre temps européen. L'on se rappelle les vivats médiatiques, les poèmes lyriques et les autocongratulations euphoriques qui accueillirent la chute du tyran. Résultat des courses : la voie des grandes migrations fut ouverte avec fracas et, dans leur candeur naïve, nos protagonistes ne songeaient même pas, les choses méditerranéennes étant ce qu'elles sont, qu'aux serments de Tobrouk allaient succéder les décapitations de Syrte. 
 Le 14 septembre 2015, un coup de tonnerre a retenti dans le ciel serein des certitudes démocratiques européo centrées quand le Conseil suprême des tribus de Libye désigna Seif al-Islam Kadhafi comme son représentant légal. Désormais, voilà donc un fils du défunt colonel seul habilité à parler au nom des vraies forces vives de Libye...
Le 14 septembre 2015, un coup de tonnerre a retenti dans le ciel serein des certitudes démocratiques européo centrées quand le Conseil suprême des tribus de Libye désigna Seif al-Islam Kadhafi comme son représentant légal. Désormais, voilà donc un fils du défunt colonel seul habilité à parler au nom des vraies forces vives de Libye... 
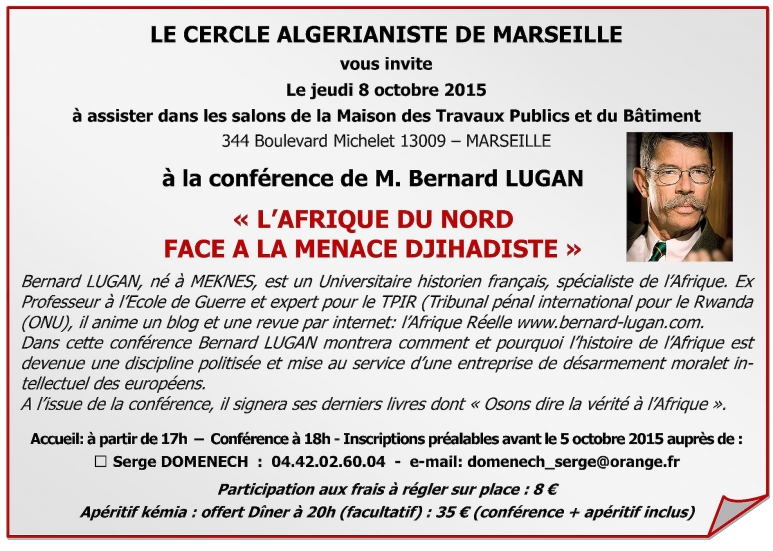




 Il n’y a pas une semaine durant laquelle la presse n’évoque un nouveau drame environnemental, mais sans que cela ne suscite autre chose qu’une sorte de fatalisme bien-pensant ou moult déclarations désolées et lénifiantes, malgré quelques tentatives de réaction, vite étouffées par l’oligarchie médiatique ou, simplement, par l’oubli des informations de la veille. Ainsi, la sixième extinction animale et végétale, puis la vidange accélérée des océans, n’ont occupé quelques colonnes de journaux et quelques minutes d’écran que le temps d’une journée vite achevée, et ces informations reviendront l’année prochaine, entre une déploration sur le réchauffement climatique et une lamentation sur la bétonisation des campagnes, désormais véritables marronniers télévisuels et imprimés…
Il n’y a pas une semaine durant laquelle la presse n’évoque un nouveau drame environnemental, mais sans que cela ne suscite autre chose qu’une sorte de fatalisme bien-pensant ou moult déclarations désolées et lénifiantes, malgré quelques tentatives de réaction, vite étouffées par l’oligarchie médiatique ou, simplement, par l’oubli des informations de la veille. Ainsi, la sixième extinction animale et végétale, puis la vidange accélérée des océans, n’ont occupé quelques colonnes de journaux et quelques minutes d’écran que le temps d’une journée vite achevée, et ces informations reviendront l’année prochaine, entre une déploration sur le réchauffement climatique et une lamentation sur la bétonisation des campagnes, désormais véritables marronniers télévisuels et imprimés…
 En Algérie, les récents limogeages opérés à la tête de l'armée et des services spéciaux ont une explication: le pays n'est plus gouverné par le président Abdelaziz Bouteflika, mais par Saïd, son frère.
En Algérie, les récents limogeages opérés à la tête de l'armée et des services spéciaux ont une explication: le pays n'est plus gouverné par le président Abdelaziz Bouteflika, mais par Saïd, son frère. 
