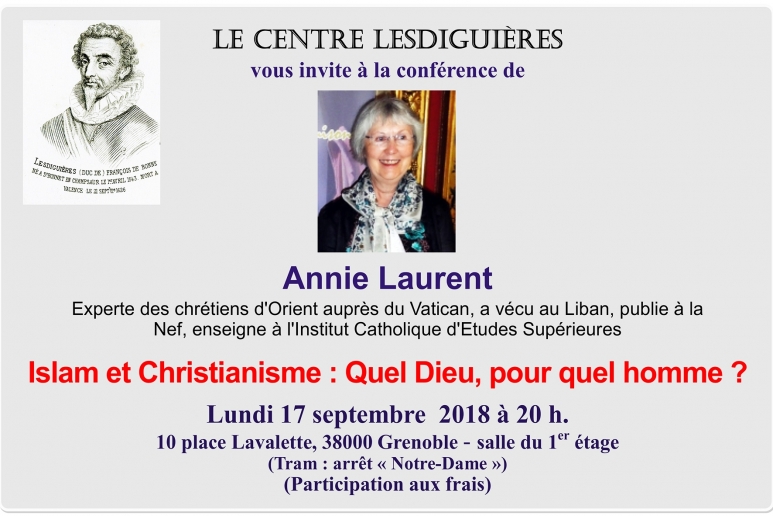Édouard Philippe a annoncé le gel de la revalorisation des pensions de retraite en 2019. Celles-ci ne seront plus indexées sur l’inflation ; les retraités verront leur pension augmenter de 0,3% seulement, alors que la hausse des prix atteint déjà 2,3%. Leur revenu, déjà rogné par la hausse de la CSG, va donc encore diminuer. Or, on sait que, dans l’immense majorité des cas, il frôle la pauvreté, quand il n’est pas carrément dedans.
Une réforme des retraites entreprise au détriment des retraités
Par ailleurs, la réforme des retraites va être mise en chantier. Elle va constituer en l’institution d’une retraite par points de type unique, qui se substituera à tous les systèmes existants et qui fera que chaque euro cotisé « donnera droit » à un point de retraite. Fini, donc le calcul de la retraite sur les six derniers mois de carrière (pour les fonctionnaires) ou les vingt-cinq meilleures années de travail (pour les salariés du privé). Résultat prévisible, selon de nombreux économistes : 90% des salariés atteindront l’âge de la retraite sans pouvoir prétendre à un niveau décent de pension. Un recul social sans précédent. On estime qu’un retraité touchant une pension de 1300 euros va perdre 578 euros annuels, du fait de l’augmentation de la CSG (qui est certainement appelée à se poursuivre) et de la non-indexation des pensions sur la hausse des prix. A cela, il convient d’ajouter les amputations découlant de la suppression de l’abattement fiscal de 10% sur le calcul des revenus imposables, et la suppression de l’avantage accordé à ceux qui ont élevé trois enfants ou plus. Enfin, les pensions complémentaires de retraite risquent bien de diminuer, elles aussi, puisque le système fusionné AGIRC-ARRCO aura la faculté de moduler le niveau des pensions en fonction de la conjoncture.
Décidément, les retraités ne vont pas connaître des lendemains qui chantent.
Le choix des forts contre les faibles
Mais Macron et Philippe assument résolument leur choix, celui – à les en croire – des actifs contre les inactifs (même si les retraités ont travaillé dur pendant plus de quarante ans), du travail productif, de l’investissement « créateur de richesses ». Philippe a déclaré au JDD :
« Nous assumons une politique de transformation et de maîtrise des dépenses qui privilégie, je le redis, la rémunération de l’activité et qui rompt avec l’augmentation indifférenciée des allocations. C’est par le retour à l’activité et une meilleure rémunération du travail que notre pays sera plus prospère». Donc, tout pour le business, dans le respect de l’orthodoxie budgétaire de Bruxelles. Encourageons les forts et les nantis, pour aller de l’avant, et laissons tomber les passifs, les poussifs, ceux qui se contentent de faire honnêtement leur travail, ceux qui ont le malheur de le perdre (chômeurs) et ceux qui ne peuvent plus travailler (retraités). Vive les winners, à bas les loosers ! »
Macron est le président des forts, des malins, des délurés, des débrouillards, des futés, des combinards et des bobos, et l’ennemi des inhabiles, des faibles, des fragiles, des distraits, des rêveurs, de ceux qui n’ont pas d’autre ambition que de mener une vie honnête de travail régulier, qui n’ont pas un tempérament d’entrepreneur, qui ne savent pas nager dans le marigot social, qui ne savent pas « s’y prendre », ni « y faire », et qui ont donc besoin d’un filet de sécurité pour ne pas se perdre et connaître la déchéance.
L’aboutissement social logique d’un monde déshumanisé et individualiste
Voilà où mène un monde individualiste, déchristianisé, déshumanisé, sans charité, où chacun est seul face aux autres, dans une société qui n’est plus une  communauté, mais une jungle, dont la seule valeur est l’argent et dont les bourses et les banques sont les temples. Voilà l’aboutissement du grand vent libérateur des sixties et de ce mai 1968, dont Macron s’est fait le laudateur. Il est d’ailleurs révélateur que Daniel Cohn-Bendit, le vieux leader de mai 1968 se sente comme un poisson dans l’eau dans le monde néolibéral d’aujourd’hui, et soit un partisan convaincu de Macron.
communauté, mais une jungle, dont la seule valeur est l’argent et dont les bourses et les banques sont les temples. Voilà l’aboutissement du grand vent libérateur des sixties et de ce mai 1968, dont Macron s’est fait le laudateur. Il est d’ailleurs révélateur que Daniel Cohn-Bendit, le vieux leader de mai 1968 se sente comme un poisson dans l’eau dans le monde néolibéral d’aujourd’hui, et soit un partisan convaincu de Macron.
Bientôt, les retraités devront chercher un emploi pour compléter leur maigre pension. Puis, on expliquera qu’il appartient à tout un chacun de se créer lui-même sa propre protection sociale.
Il y a peu, Macron exprimait son dédain à l’égard d’ « un modèle social qui ne sale plus… et où le summum de la lutte des classes était l’obtention d’une somme modique d’APL ». Son modèle social, à lui, se résume de la façon suivante. On dit aux chômeurs : « créez votre start up ». Vous n’avez pas d’argent : persuadez un banquier de vous accorder un prêt. Vous n’avez pas la fibre d’un chef d’entreprise, ou votre conseiller financier vous refuse un prêt ? Tant pis pour vous. Votre pension de retraite est insuffisante ? Remettez-vous au travail. Laissons tomber ceux qui, n’ayant pas une mentalité d’entrepreneur, se contentent de vouloir un travail et une situation sociale stable. Et préférons les actifs et les « créateurs de richesses » aux retraités.
L’erreur révolutionnaire et jacobine
Certes, il convient, ici, d’incriminer le néolibéralisme mondialiste actuel, ce que nous faisons présentement, mais également notre modèle républicain.
Sous l’Ancien Régime, des corps intermédiaires politiques (municipalités), judiciaires (parlements) et professionnels (corporations) donnaient consistance, souplesse et capacité d’adaptation aux communautés naturelles du royaume, créaient une symbiose entre le pouvoir et la société, et permettait à l’État de remplir ses fonctions régaliennes sans se charger de la responsabilité écrasante de toutes les composantes de la nation. Garant du droit, l’État faisait respecter (définissait, au besoin) les règles de la vie économique et sociale sans se substituer aux agents de celle-ci dans la conduite de leurs affaires. Il existait ainsi un espace social autonome régi par un droit plus coutumier que positif.
 Or, cet espace disparut sous la Révolution. L’application dogmatique des principes de la souveraineté nationale et de l’égalité de tous devant la loi conduisit à la suppression de ces corps, et institua un face-à-face de l’individu et de l’État. La loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) prohiba toutes les formes d’associations que les travailleurs et les employeurs eussent pu créer en vue de défendre « leurs prétendus intérêts communs ». D’une manière générale, la loi ne reconnut que des individus égaux contractant en toute indépendance et seuls responsables de leurs intérêts propres. A ses yeux, les intérêts économiques et professionnels ne pouvaient être que des intérêts individuels. Le champ social se dissolvait dans les deux pôles de l’individu et de l’État. Certes, la situation a bien évolué depuis ce temps. Mais il en est resté quelque chose, une tradition rédhibitoire qui accorde à l’État un rôle essentiel dans le règlement des rapports entre employeurs et salariés, et qui légitime à l’avance son intervention constante et les sollicitations innombrables qui lui sont adressées. Dans son Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux coalitions (1864), Emile Ollivier déclare, à propos de la conception que Le Chapelier fit prévaloir 73 ans plus tôt : « Nous saisissons à son origine, dans cette théorie exposée par Le Chapelier, l’erreur fondamentale de la Révolution française. De là sont sortis tous les excès de la centralisation, l’extension démesurée des droits sociaux, les exagérations des réformateurs socialistes ; de là procèdent Babeuf, la conception de l’État-providence, le despotisme révolutionnaire sous toutes ses formes ».
Or, cet espace disparut sous la Révolution. L’application dogmatique des principes de la souveraineté nationale et de l’égalité de tous devant la loi conduisit à la suppression de ces corps, et institua un face-à-face de l’individu et de l’État. La loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) prohiba toutes les formes d’associations que les travailleurs et les employeurs eussent pu créer en vue de défendre « leurs prétendus intérêts communs ». D’une manière générale, la loi ne reconnut que des individus égaux contractant en toute indépendance et seuls responsables de leurs intérêts propres. A ses yeux, les intérêts économiques et professionnels ne pouvaient être que des intérêts individuels. Le champ social se dissolvait dans les deux pôles de l’individu et de l’État. Certes, la situation a bien évolué depuis ce temps. Mais il en est resté quelque chose, une tradition rédhibitoire qui accorde à l’État un rôle essentiel dans le règlement des rapports entre employeurs et salariés, et qui légitime à l’avance son intervention constante et les sollicitations innombrables qui lui sont adressées. Dans son Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux coalitions (1864), Emile Ollivier déclare, à propos de la conception que Le Chapelier fit prévaloir 73 ans plus tôt : « Nous saisissons à son origine, dans cette théorie exposée par Le Chapelier, l’erreur fondamentale de la Révolution française. De là sont sortis tous les excès de la centralisation, l’extension démesurée des droits sociaux, les exagérations des réformateurs socialistes ; de là procèdent Babeuf, la conception de l’État-providence, le despotisme révolutionnaire sous toutes ses formes ».
En vain, certains républicains, tels Ferry, puis Gambetta, préconisèrent le règlement ponctuel et pragmatique des problèmes professionnels et sociaux par la libre activité associative et syndicale plutôt que par l’intervention systématique de l’État. Leur conception ne prévalut pas. Les radicaux (Clemenceau) firent ressortir au domaine de compétence des pouvoirs publics le règlement des problèmes sociaux. Grâce à l’adoption, par voie parlementaire, de réformes faisant l’objet d’un programme soumis aux électeurs, les hommes politiques devaient élever la condition matérielle et morale du peuple et engendrer une société égalitaire tenant les promesses de l’idéal de la Révolution. Il est à noter que, dans le camp socialiste, Jaurès fit prévaloir des vues analogues à partir de 1906. Et ce sont elles qui finirent par prévaloir à gauche et chez une majorité de Français.
Ainsi naquit ce terrible mal français qu’est l’idéologisation et la politisation des questions sociales, et, par voie de conséquence, l’institution d’un pseudo État-providence jacobin, aujourd’hui incapable de remplir sa mission. Et, du coup, toute réforme de notre législation sociale se présente comme un démantèlement de ce dernier et une entreprise de destruction de toute protection des travailleurs, en l’absence de l’existence d’une longue habitude de la pratique de la négociation sociale entre organisations syndicales et patronales dans un esprit dénué d’idées de lutte de classes ou de revanche sociale, et permettant à chacun des partenaires de faire des concessions à l’autre en un souci de défense de l’intérêt commun (celui de l’entreprise et celui de la nation). C’est pourquoi la France échoue, en la matière, là où réussissent (certes difficilement et imparfaitement) des pays où un tel esprit existe, comme les pays scandinaves ou l’Allemagne. Elle échoue parce qu’en 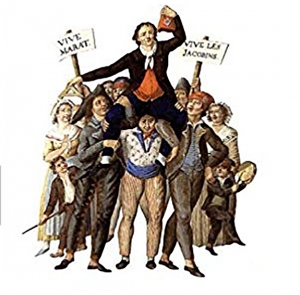 France, la société, c’est l’État, et l’État, c’est la République jacobine avec sa vieille promesse révolutionnaire d’égalité sociale. Cette conception maléfique de l’ordre politique et de la société et de la fusion de l’un et de l’autre a pour conséquence que l’État républicain doit continuer à gérer un système de protection social qui n’en peut plus, qu’il ne peut le réformer qu’en le mutilant ou en le détruisant, et que s’il le fait, il devient, par là même, un pouvoir instaurant délibérément une société inégalitaire, et privilégiant les uns au détriment des autres. Il ne peut se réformer qu’en se niant, en faisant seppuku.
France, la société, c’est l’État, et l’État, c’est la République jacobine avec sa vieille promesse révolutionnaire d’égalité sociale. Cette conception maléfique de l’ordre politique et de la société et de la fusion de l’un et de l’autre a pour conséquence que l’État républicain doit continuer à gérer un système de protection social qui n’en peut plus, qu’il ne peut le réformer qu’en le mutilant ou en le détruisant, et que s’il le fait, il devient, par là même, un pouvoir instaurant délibérément une société inégalitaire, et privilégiant les uns au détriment des autres. Il ne peut se réformer qu’en se niant, en faisant seppuku.
Voilà à quelle impasse politique et éthique nous a amené notre République, étayée sur le souvenir et les principes de notre grande Révolution, dont nous nous montrons si fiers encore.
La nécessité de renouer avec l’humain
La réalisation de la justice sociale dans un esprit communautaire et fraternel compatible avec l’intérêt national ne résidait ni dans un Etat providence jacobin appelé à être condamné par l’ouverture des frontières et la crise économique, ni dans les prétendus effets bénéfiques à long terme d’une politique néolibérale et mondialiste qui favorise les forts et écrase tous les autres (dans le soi-disant intérêt des générations futures, censées tirer parti de ce sacrifice). Elle siégeait dans les corps de métier, les corporations, les associations d’aide et d’entraide, et la pratique d’une négociation inspirée par la solidarité nationale et chrétienne. Cela, nous l’avions sous l’Ancien Régime, et nous l’avons bêtement détruit en 1791. Si nous avions l’intelligence de le retrouver, nous pourrions édifier enfin une politique sociale juste et humaine. ■
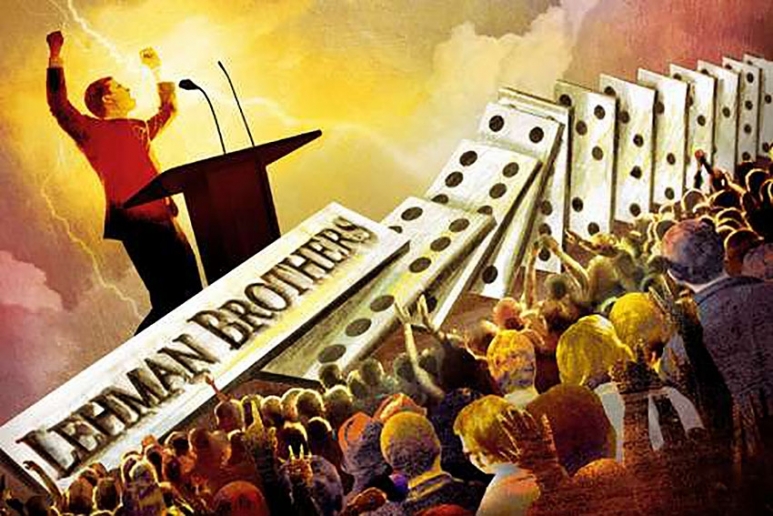
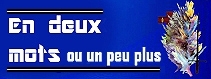
 mauvais. Elles les nourrissent à proportion de leur gravité. Le Monde a sûrement en tête ce que la crise de 1929 a produit ou du moins contribué à produire en Europe et ailleurs. La seconde guerre mondiale. C'est bien les souvenirs de cette dernière que le titre du Monde entend raviver.
mauvais. Elles les nourrissent à proportion de leur gravité. Le Monde a sûrement en tête ce que la crise de 1929 a produit ou du moins contribué à produire en Europe et ailleurs. La seconde guerre mondiale. C'est bien les souvenirs de cette dernière que le titre du Monde entend raviver. 
 Ainsi donc, sur les trois protagonistes de ce triste fait-divers, deux ont été condamnés l’un à 7 ans de réclusion criminelle, l’autre à 11 ans.
Ainsi donc, sur les trois protagonistes de ce triste fait-divers, deux ont été condamnés l’un à 7 ans de réclusion criminelle, l’autre à 11 ans.  D’autre part, le procès a laissé les avocats et l’avocat général glorifier les agresseurs, refusant de reconnaître que ces groupes prétendument antifascistes (photo) ne cachent pas leur objectif qui est d’interdire toute expression publique à ceux qui s’opposent à eux en dehors du Système. Nous sommes en face d’une grave atteinte aux libertés, qui frappe des déclassés sans défense, mais qui nous écrasera sans merci demain si nous n’y prêtons garde.
D’autre part, le procès a laissé les avocats et l’avocat général glorifier les agresseurs, refusant de reconnaître que ces groupes prétendument antifascistes (photo) ne cachent pas leur objectif qui est d’interdire toute expression publique à ceux qui s’opposent à eux en dehors du Système. Nous sommes en face d’une grave atteinte aux libertés, qui frappe des déclassés sans défense, mais qui nous écrasera sans merci demain si nous n’y prêtons garde. 

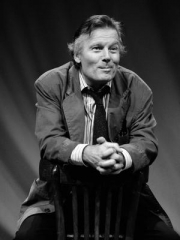 Comédien charismatique dans un répertoire riche de vingt-cinq ans de Comédie-Française, Jean Piat s'est éteint hier soir à l'âge de 93 ans.
Comédien charismatique dans un répertoire riche de vingt-cinq ans de Comédie-Française, Jean Piat s'est éteint hier soir à l'âge de 93 ans.
 Les leçons de la réforme des retraites par Macron
Les leçons de la réforme des retraites par Macron communauté, mais une jungle, dont la seule valeur est l’argent et dont les bourses et les banques sont les temples. Voilà l’aboutissement du grand vent libérateur des sixties et de ce mai 1968, dont Macron s’est fait le laudateur. Il est d’ailleurs révélateur que Daniel Cohn-Bendit, le vieux leader de mai 1968 se sente comme un poisson dans l’eau dans le monde néolibéral d’aujourd’hui, et soit un partisan convaincu de Macron.
communauté, mais une jungle, dont la seule valeur est l’argent et dont les bourses et les banques sont les temples. Voilà l’aboutissement du grand vent libérateur des sixties et de ce mai 1968, dont Macron s’est fait le laudateur. Il est d’ailleurs révélateur que Daniel Cohn-Bendit, le vieux leader de mai 1968 se sente comme un poisson dans l’eau dans le monde néolibéral d’aujourd’hui, et soit un partisan convaincu de Macron. Or, cet espace disparut sous la Révolution. L’application dogmatique des principes de la souveraineté nationale et de l’égalité de tous devant la loi conduisit à la suppression de ces corps, et institua un face-à-face de l’individu et de l’État. La loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) prohiba toutes les formes d’associations que les travailleurs et les employeurs eussent pu créer en vue de défendre « leurs prétendus intérêts communs ». D’une manière générale, la loi ne reconnut que des individus égaux contractant en toute indépendance et seuls responsables de leurs intérêts propres. A ses yeux, les intérêts économiques et professionnels ne pouvaient être que des intérêts individuels. Le champ social se dissolvait dans les deux pôles de l’individu et de l’État. Certes, la situation a bien évolué depuis ce temps. Mais il en est resté quelque chose, une tradition rédhibitoire qui accorde à l’État un rôle essentiel dans le règlement des rapports entre employeurs et salariés, et qui légitime à l’avance son intervention constante et les sollicitations innombrables qui lui sont adressées. Dans son Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux coalitions (1864), Emile Ollivier déclare, à propos de la conception que Le Chapelier fit prévaloir 73 ans plus tôt : « Nous saisissons à son origine, dans cette théorie exposée par Le Chapelier, l’erreur fondamentale de la Révolution française. De là sont sortis tous les excès de la centralisation, l’extension démesurée des droits sociaux, les exagérations des réformateurs socialistes ; de là procèdent Babeuf, la conception de l’État-providence, le despotisme révolutionnaire sous toutes ses formes ».
Or, cet espace disparut sous la Révolution. L’application dogmatique des principes de la souveraineté nationale et de l’égalité de tous devant la loi conduisit à la suppression de ces corps, et institua un face-à-face de l’individu et de l’État. La loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) prohiba toutes les formes d’associations que les travailleurs et les employeurs eussent pu créer en vue de défendre « leurs prétendus intérêts communs ». D’une manière générale, la loi ne reconnut que des individus égaux contractant en toute indépendance et seuls responsables de leurs intérêts propres. A ses yeux, les intérêts économiques et professionnels ne pouvaient être que des intérêts individuels. Le champ social se dissolvait dans les deux pôles de l’individu et de l’État. Certes, la situation a bien évolué depuis ce temps. Mais il en est resté quelque chose, une tradition rédhibitoire qui accorde à l’État un rôle essentiel dans le règlement des rapports entre employeurs et salariés, et qui légitime à l’avance son intervention constante et les sollicitations innombrables qui lui sont adressées. Dans son Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif aux coalitions (1864), Emile Ollivier déclare, à propos de la conception que Le Chapelier fit prévaloir 73 ans plus tôt : « Nous saisissons à son origine, dans cette théorie exposée par Le Chapelier, l’erreur fondamentale de la Révolution française. De là sont sortis tous les excès de la centralisation, l’extension démesurée des droits sociaux, les exagérations des réformateurs socialistes ; de là procèdent Babeuf, la conception de l’État-providence, le despotisme révolutionnaire sous toutes ses formes ».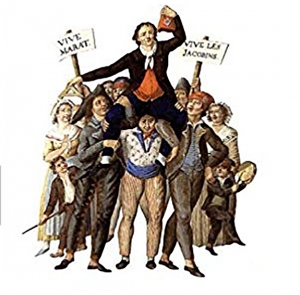 France, la société, c’est l’État, et l’État, c’est la République jacobine avec sa vieille promesse révolutionnaire d’égalité sociale. Cette conception maléfique de l’ordre politique et de la société et de la fusion de l’un et de l’autre a pour conséquence que l’État républicain doit continuer à gérer un système de protection social qui n’en peut plus, qu’il ne peut le réformer qu’en le mutilant ou en le détruisant, et que s’il le fait, il devient, par là même, un pouvoir instaurant délibérément une société inégalitaire, et privilégiant les uns au détriment des autres. Il ne peut se réformer qu’en se niant, en faisant seppuku.
France, la société, c’est l’État, et l’État, c’est la République jacobine avec sa vieille promesse révolutionnaire d’égalité sociale. Cette conception maléfique de l’ordre politique et de la société et de la fusion de l’un et de l’autre a pour conséquence que l’État républicain doit continuer à gérer un système de protection social qui n’en peut plus, qu’il ne peut le réformer qu’en le mutilant ou en le détruisant, et que s’il le fait, il devient, par là même, un pouvoir instaurant délibérément une société inégalitaire, et privilégiant les uns au détriment des autres. Il ne peut se réformer qu’en se niant, en faisant seppuku.

 Les FDS sont naturellement conseillés par des militaires américains, mais il semblerait que des Français soient également sur place. Une photo prise par un Américain montrant des soldats manoeuvrant un mortier laisse apparaître, en arrière-plan, un véhicule blindé. Selon un journaliste de France 24, Wassim Nasr, il serait de type Aravis et utilisé par deux seules armées au monde : les Français et les Saoudiens ; si ces derniers combattaient Daech cela se saurait et il est donc évident que ce sont bien des militaires français qui sont présents. La photo daterait du mois d’août, lors de la préparation de l’offensive.
Les FDS sont naturellement conseillés par des militaires américains, mais il semblerait que des Français soient également sur place. Une photo prise par un Américain montrant des soldats manoeuvrant un mortier laisse apparaître, en arrière-plan, un véhicule blindé. Selon un journaliste de France 24, Wassim Nasr, il serait de type Aravis et utilisé par deux seules armées au monde : les Français et les Saoudiens ; si ces derniers combattaient Daech cela se saurait et il est donc évident que ce sont bien des militaires français qui sont présents. La photo daterait du mois d’août, lors de la préparation de l’offensive. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise : des membres des forces spéciales françaises sont présents depuis longtemps en Syrie. Cela n’a jamais été officiellement confirmé mais les indices sont multiples et sont corroborés par les déclarations courageuses de la ministre Florence Parly qui affirmait : « Si ces djihadistes périssent dans les combats, je dirai que c’est mieux ».
Ce n’est d’ailleurs pas une surprise : des membres des forces spéciales françaises sont présents depuis longtemps en Syrie. Cela n’a jamais été officiellement confirmé mais les indices sont multiples et sont corroborés par les déclarations courageuses de la ministre Florence Parly qui affirmait : « Si ces djihadistes périssent dans les combats, je dirai que c’est mieux ».
 « Recevez-les, aidez-les, éduquez-les... Mais à terme, ils doivent développer leur propre pays », a déclaré le chef spirituel du bouddhisme tibétain qui a fui en 1959 le Tibet pour s’exiler en Inde, à la suite de la répression par les autorités communistes chinoises d’un soulèvement tibétain.
« Recevez-les, aidez-les, éduquez-les... Mais à terme, ils doivent développer leur propre pays », a déclaré le chef spirituel du bouddhisme tibétain qui a fui en 1959 le Tibet pour s’exiler en Inde, à la suite de la répression par les autorités communistes chinoises d’un soulèvement tibétain.
 Au Danemark, le plus sudiste des États scandinaves, le Chef de l'État est allé chercher, dit-on, un soutien à sa rêverie européiste qui n'en a quasiment plus.
Au Danemark, le plus sudiste des États scandinaves, le Chef de l'État est allé chercher, dit-on, un soutien à sa rêverie européiste qui n'en a quasiment plus. Le cas de l'Espagne est différent, plus complexe. Elle est royaume depuis la nuit des temps. Si l'on additionne les années qu'ont duré ses deux républiques, fût-ce en comptant les périodes de guerre civile qu’elles ont connues et perdues, on ne dépasse pas la dizaine. Mais l'Espagne n'a jamais atteint le niveau français d'unité politique. Elle est aujourd'hui affaiblie par le séparatisme catalan et, le cas échéant, basque. La société civile espagnole est presque aussi dissoute que la nôtre et que celles de
Le cas de l'Espagne est différent, plus complexe. Elle est royaume depuis la nuit des temps. Si l'on additionne les années qu'ont duré ses deux républiques, fût-ce en comptant les périodes de guerre civile qu’elles ont connues et perdues, on ne dépasse pas la dizaine. Mais l'Espagne n'a jamais atteint le niveau français d'unité politique. Elle est aujourd'hui affaiblie par le séparatisme catalan et, le cas échéant, basque. La société civile espagnole est presque aussi dissoute que la nôtre et que celles de  Quant au Maroc, il suffit de songer à ce qu'il en serait advenu si l'attentat de Skhirat fomenté par la Libye de Kadhafi contre le roi Hassan II et la famille royale (1971) avait réussi, ou celui ourdi par le général Oufkir l'année suivante (attaque du Boeing du roi au-dessus du détroit de Gibraltar) ou encore si l'actuel souverain y était renversé ou tué par un quelconque complot islamiste, ce qui n’est pas une hypothèse fantaisiste... Le bienfait qu'apporte à son pays le régime monarchique marocain malgré ses défauts, saute aux yeux.
Quant au Maroc, il suffit de songer à ce qu'il en serait advenu si l'attentat de Skhirat fomenté par la Libye de Kadhafi contre le roi Hassan II et la famille royale (1971) avait réussi, ou celui ourdi par le général Oufkir l'année suivante (attaque du Boeing du roi au-dessus du détroit de Gibraltar) ou encore si l'actuel souverain y était renversé ou tué par un quelconque complot islamiste, ce qui n’est pas une hypothèse fantaisiste... Le bienfait qu'apporte à son pays le régime monarchique marocain malgré ses défauts, saute aux yeux. amilles aristocratiques et populaires. L'Europe est l'œuvre des Habsbourg, des Hohenzollern,
amilles aristocratiques et populaires. L'Europe est l'œuvre des Habsbourg, des Hohenzollern, Dans cette dernière hypothèse, la plus favorable, celle où nous nous ressaisirions face au danger, l'on ne donnera pas cher des régimes politiques dérisoires et faillis du genre de celui aujourd’hui établi en France. Nonobstant les velléités de verticalité et de grandeur du président Macron.
Dans cette dernière hypothèse, la plus favorable, celle où nous nous ressaisirions face au danger, l'on ne donnera pas cher des régimes politiques dérisoires et faillis du genre de celui aujourd’hui établi en France. Nonobstant les velléités de verticalité et de grandeur du président Macron.





 On aurait aimé pouvoir créditer M. El Karoui (photo) d’avoir franchi, d’un rapport à l’autre, le pas lexical qui va d’islam à islamisme et attendre en conséquence de lui certaines vérités. M. El Karoui décrit certes fort bien les modalités de propagation de la lèpre salafiste qui gangrène les si mal nommées « cités » par un maillage très intelligent, lequel allie embrigadement intellectuel par internet et embrigadement physique dans les salles de sport. Les résultats sont épouvantables comme le montrent deux exemples fournis par le quotidien La Provence du 11 septembre : 20 à 25% des musulmans de Marseille seraient salafistes ; vingt-et-un mille personnes seraient inscrites en France au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractè
On aurait aimé pouvoir créditer M. El Karoui (photo) d’avoir franchi, d’un rapport à l’autre, le pas lexical qui va d’islam à islamisme et attendre en conséquence de lui certaines vérités. M. El Karoui décrit certes fort bien les modalités de propagation de la lèpre salafiste qui gangrène les si mal nommées « cités » par un maillage très intelligent, lequel allie embrigadement intellectuel par internet et embrigadement physique dans les salles de sport. Les résultats sont épouvantables comme le montrent deux exemples fournis par le quotidien La Provence du 11 septembre : 20 à 25% des musulmans de Marseille seraient salafistes ; vingt-et-un mille personnes seraient inscrites en France au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractè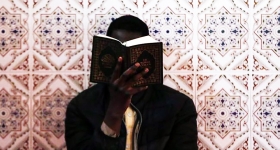 Rien d’étonnant, dès lors, si les principales propositions du rapport pèchent par hypocrisie et/ou par angélisme. Ainsi en est-il du renforcement de l’apprentissage de l’arabe dans les écoles, collèges et lycées sous prétexte qu’au cours des dernières années
Rien d’étonnant, dès lors, si les principales propositions du rapport pèchent par hypocrisie et/ou par angélisme. Ainsi en est-il du renforcement de l’apprentissage de l’arabe dans les écoles, collèges et lycées sous prétexte qu’au cours des dernières années  pas en effet, dans ce pays, de vouloir s’ingérer dans le modus vivendi de la communauté musulmane. Ainsi viennent de s’achever, ce samedi 15, les « assises territoriales de l'islam de France » : messieurs les préfets de la République étaient invités à « faire émerger des propositions inédites » pour permettre au pouvoir exécutif de donner au plus tôt « à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République » (propos de M. Macron devant le Congrès). Comment ne pas être sceptique ? On sait bien que n’ont été un succès ni le Conseil français du culte musulman fondé par M. Sarkozy ni la mission de M. Chevènement à la tête de
pas en effet, dans ce pays, de vouloir s’ingérer dans le modus vivendi de la communauté musulmane. Ainsi viennent de s’achever, ce samedi 15, les « assises territoriales de l'islam de France » : messieurs les préfets de la République étaient invités à « faire émerger des propositions inédites » pour permettre au pouvoir exécutif de donner au plus tôt « à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République » (propos de M. Macron devant le Congrès). Comment ne pas être sceptique ? On sait bien que n’ont été un succès ni le Conseil français du culte musulman fondé par M. Sarkozy ni la mission de M. Chevènement à la tête de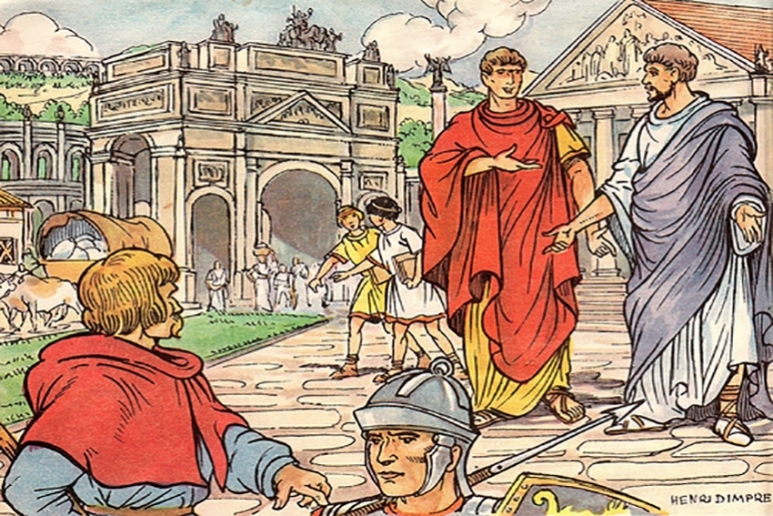
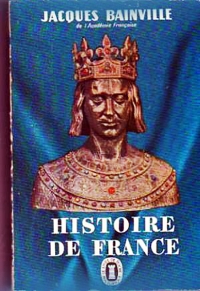 L'histoire de France coulait dans mes veines, emplissait l'air que je respirais, forgeait mes rêves d'enfant ; je n'imaginais pas être la dernière génération à grandir ainsi. J'ignorais que ma date de naissance serait décisive: je vivais au XXe siècle mais en paix, loin du fracas des deux guerres mondiales, et de la guerre d'Algérie ; je me réchauffais pourtant encore aux ultimes feux de l'école de la IIIe République. J'évoluais entre deux époques, entre deux mondes. Je grandissais dans l'abondance de la société de consommation et pourtant mon esprit vagabondait dans les plaines héroïques d'hier. J'étais abonné au Journal de Mickey, mon corps se gavait de fraises Tagada et de rochers Suchard, mais ma tête chargeait avec les cavaliers de Murat dans les plaines enneigées d'Eylau. Je vivais le meilleur des deux mondes. Je ne mesurais pas ma chance. Nous apprenions tous à lire et écrire selon la méthode syllabique ; mon orthographe était impeccable (à l'exception d'un désamour inexpliqué pour l'accent circonflexe), ma science de la grammaire intériorisée comme une seconde nature ; et l'Histoire attendrait respectueusement que j'entre au collège, à la rentrée 1969, pour cesser d'être une matière à part entière et se contenter du statut marginal d'«activité d'éveil». Notre programme avait été instauré par le grand Lavisse lui-même et ne devait rien à la pédagogie active des « sciences de l'éducation » qui commençaient tout juste à sévir. J'avais encore comme ancêtres les Gaulois, et mon père bénissait cette filiation en se précipitant à la librairie pour acquérir chaque nouvel épisode d'Astérix, qu'il s'empressait de lire avant de me l'offrir. Dans mon école publique de Drancy, banlieue parisienne où mes parents s'étaient installés, on rencontrait pourtant peu de Gaulois authentiques ; un Martin ou un Minot étaient mêlés à beaucoup de noms finissant en i. Je n'ai cependant jamais entendu ces descendants d'Italiens exciper fièrement de leur ascendance de vainqueurs romains pour mépriser ces minables vaincus gaulois…
L'histoire de France coulait dans mes veines, emplissait l'air que je respirais, forgeait mes rêves d'enfant ; je n'imaginais pas être la dernière génération à grandir ainsi. J'ignorais que ma date de naissance serait décisive: je vivais au XXe siècle mais en paix, loin du fracas des deux guerres mondiales, et de la guerre d'Algérie ; je me réchauffais pourtant encore aux ultimes feux de l'école de la IIIe République. J'évoluais entre deux époques, entre deux mondes. Je grandissais dans l'abondance de la société de consommation et pourtant mon esprit vagabondait dans les plaines héroïques d'hier. J'étais abonné au Journal de Mickey, mon corps se gavait de fraises Tagada et de rochers Suchard, mais ma tête chargeait avec les cavaliers de Murat dans les plaines enneigées d'Eylau. Je vivais le meilleur des deux mondes. Je ne mesurais pas ma chance. Nous apprenions tous à lire et écrire selon la méthode syllabique ; mon orthographe était impeccable (à l'exception d'un désamour inexpliqué pour l'accent circonflexe), ma science de la grammaire intériorisée comme une seconde nature ; et l'Histoire attendrait respectueusement que j'entre au collège, à la rentrée 1969, pour cesser d'être une matière à part entière et se contenter du statut marginal d'«activité d'éveil». Notre programme avait été instauré par le grand Lavisse lui-même et ne devait rien à la pédagogie active des « sciences de l'éducation » qui commençaient tout juste à sévir. J'avais encore comme ancêtres les Gaulois, et mon père bénissait cette filiation en se précipitant à la librairie pour acquérir chaque nouvel épisode d'Astérix, qu'il s'empressait de lire avant de me l'offrir. Dans mon école publique de Drancy, banlieue parisienne où mes parents s'étaient installés, on rencontrait pourtant peu de Gaulois authentiques ; un Martin ou un Minot étaient mêlés à beaucoup de noms finissant en i. Je n'ai cependant jamais entendu ces descendants d'Italiens exciper fièrement de leur ascendance de vainqueurs romains pour mépriser ces minables vaincus gaulois… Un jour, mon grand-père paternel me montra un des timbres qu'il collectionnait. Un combattant à la mine farouche, la tête surmontée d'un turban, brandissait un fusil. Un seul nom barrait l'image : Zemmour. C'était une tribu berbère célèbre, m'expliqua le vieil homme. Une des dernières à se soumettre à la France, bien après la prise de la smala d'Abd el-Kader, que j'avais étudiée à l'école. Mon sort se compliquait: j'avais été colonisé par la France, et j'avais même farouchement résisté à l'envahisseur. Comme Astérix face à Rome. Les Gaulois étaient devenus des Gallo-Romains, après avoir pris goût à la paix et à la civilisation romaine. Mes ancêtres à moi étaient devenus des Berbéro-Français,
Un jour, mon grand-père paternel me montra un des timbres qu'il collectionnait. Un combattant à la mine farouche, la tête surmontée d'un turban, brandissait un fusil. Un seul nom barrait l'image : Zemmour. C'était une tribu berbère célèbre, m'expliqua le vieil homme. Une des dernières à se soumettre à la France, bien après la prise de la smala d'Abd el-Kader, que j'avais étudiée à l'école. Mon sort se compliquait: j'avais été colonisé par la France, et j'avais même farouchement résisté à l'envahisseur. Comme Astérix face à Rome. Les Gaulois étaient devenus des Gallo-Romains, après avoir pris goût à la paix et à la civilisation romaine. Mes ancêtres à moi étaient devenus des Berbéro-Français, 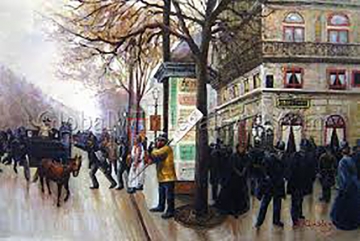 après avoir pris goût à la paix et à la civilisation française. Les Gallo-Romains avaient adopté les prénoms latins et endossé les toges romaines, appris à parler et à lire le latin ; ils disaient: « A Rome, on fait comme les Romains .» Mes aïeux avaient donné des prénoms français à leurs enfants, lu Victor Hugo et endossé les costumes et les robes de Paris, jusqu'à cette minijupe si « indécente » que ma mère arborait dans les rues de Paris, à la place des djellabas et burnous arabes que leurs grands-mères avaient pourtant portés.
après avoir pris goût à la paix et à la civilisation française. Les Gallo-Romains avaient adopté les prénoms latins et endossé les toges romaines, appris à parler et à lire le latin ; ils disaient: « A Rome, on fait comme les Romains .» Mes aïeux avaient donné des prénoms français à leurs enfants, lu Victor Hugo et endossé les costumes et les robes de Paris, jusqu'à cette minijupe si « indécente » que ma mère arborait dans les rues de Paris, à la place des djellabas et burnous arabes que leurs grands-mères avaient pourtant portés.