Mathieu Bock-Côté : « Défense du Brexit »

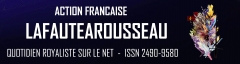 Les appels à un second référendum reviennent à considérer que les Britanniques ne voulaient pas sincèrement quitter l'Europe. Parce que leur choix ne va pas dans le sens du progressisme diversitaire, il ne peut être sérieux et doit donc être effacé des tablettes. Mathieu Bock-Côté fait ici l'analyse inverse et nous n'avons aucun scrupule - au contraire - à la reprendre pour les lecteurs de Lafautearousseau : c'est aussi la nôtre. Mathieu Bock-Côté la mène avec rigueur et avec talent. [Le Figaro, 26.10]. LFAR
Les appels à un second référendum reviennent à considérer que les Britanniques ne voulaient pas sincèrement quitter l'Europe. Parce que leur choix ne va pas dans le sens du progressisme diversitaire, il ne peut être sérieux et doit donc être effacé des tablettes. Mathieu Bock-Côté fait ici l'analyse inverse et nous n'avons aucun scrupule - au contraire - à la reprendre pour les lecteurs de Lafautearousseau : c'est aussi la nôtre. Mathieu Bock-Côté la mène avec rigueur et avec talent. [Le Figaro, 26.10]. LFAR

À mesure que mars 2019 s'approche, on comprend qu'une frange importante des élites européennes peine toujours à prendre au sérieux le vote des Britanniques en faveur du Brexit. L'appel récurrent à la tenue d'un nouveau référendum, censé corriger les résultats du premier, témoigne de cet état d'esprit : le 23 juin 2016, les Britanniques n'auraient pas eu toute leur tête. Ils auraient voté sous le coup de la passion en plus d'être manipulés par la propagande du camp eurosceptique, que ses adversaires accusent d'« europhobie ». Le vote en faveur du Leave était accidentel. On en comprend qu'il n'y avait qu'un seul choix possible et rationnel, et que celui-ci consistait à confirmer l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne.
Ce refus d'envisager que les Britanniques aient voté en connaissance de cause est révélateur de la mentalité qui domine les élites mondialisées, décrétant le cadre national désuet et, surtout, dépourvu de légitimité. On l'avait déjà constaté en 2005, après le référendum français sur la Constitution européenne. Plusieurs accusèrent Jacques Chirac d'avoir fait une immense bourde en le tenant, dans la mesure où il reconduirait la légitimité d'un cadre national qu'il faudrait justement dépasser. Le philosophe Jürgen Habermas soutiendra ainsi que le seul référendum légitime serait à l'échelle de l'Union européenne (UE), pour constituer par cet acte fondateur un peuple européen. Le peuple devient ici une pure construction juridique sans épaisseur identitaire.
La même chose a été reprochée au Brexit. Deux ans après le référendum, on constate à quel point il a révélé la nature ambivalente de la démocratie contemporaine. Quand la volonté populaire s'exprime en faveur du progressisme diversitaire, elle est louée. Mais quand elle embrasse une cause jugée en contradiction avec le « sens de l'histoire », on la désavoue et, surtout, on veut l'étouffer. La souveraineté populaire est vidée de sa substance. Il ne s'agit plus que d'un mécanisme vicié qui consacrerait la tyrannie de la majorité et l'hégémonie politique des catégories sociales retardataires. Elle ne devrait pas permettre les régressions historiques comme le Brexit. Cette interdiction s'applique aussi à toute volonté de renverser les innovations « sociétales » ou de redéfinir les « droits » qui ont été octroyés au fil des ans.
La dénonciation du Brexit fait ainsi écho à celle des « populisme s», un terme servant essentiellement à pathologiser la souveraineté populaire lorsqu'elle entre en dissidence avec le régime diversitaire. Dès lors que la question du régime resurgit, l'espace démocratique se resserre. Les partis et mouvements qui adhèrent à l'idéologie diversitaire et postnationale sont accueillis favorablement dans la conversation démocratique. Les autres sont assimilés à la lèpre, pour emprunter la formule désormais célèbre d'Emmanuel Macron. Qui entend arrimer la démocratie au cadre national bascule dans le camp de la réaction et sera à bon droit traité comme l'ennemi public, et peut-être même comme ennemi de l'humanité.
 Dans ce contexte, on pouvait s'attendre à ce que les élites britanniques fassent tout pour neutraliser le résultat du Brexit. Et pourtant, Theresa May a décidé de respecter la volonté populaire, en la considérant non pas sur un mode anecdotique mais historique. Si elle peine à conserver l'unité d'un Parti conservateur travaillé par des courants contradictoires sur la question européenne, elle garde le cap. Les modalités de la rupture restent à préciser: on ne détricote pas facilement des accords tissés au fil des décennies. L'UE s'est construite de telle manière que plus on s'y engage et plus il devient difficile de s'en désengager. Sans le moindre doute, le Brexit entraînera quelques turbulences, mais l'histoire s'écrit rarement en ayant pour trame sonore une musique d'ascenseur. La restauration de la souveraineté nationale d'un pays n'est pas une décision administrative ordinaire.
Dans ce contexte, on pouvait s'attendre à ce que les élites britanniques fassent tout pour neutraliser le résultat du Brexit. Et pourtant, Theresa May a décidé de respecter la volonté populaire, en la considérant non pas sur un mode anecdotique mais historique. Si elle peine à conserver l'unité d'un Parti conservateur travaillé par des courants contradictoires sur la question européenne, elle garde le cap. Les modalités de la rupture restent à préciser: on ne détricote pas facilement des accords tissés au fil des décennies. L'UE s'est construite de telle manière que plus on s'y engage et plus il devient difficile de s'en désengager. Sans le moindre doute, le Brexit entraînera quelques turbulences, mais l'histoire s'écrit rarement en ayant pour trame sonore une musique d'ascenseur. La restauration de la souveraineté nationale d'un pays n'est pas une décision administrative ordinaire.
Qui dit Brexit ne dit pas nécessairement Frexit. La Grande-Bretagne, depuis toujours emportée par le grand large, n'a pas le même rapport avec le continent que la France. Les deux histoires ne sont pas interchangeables. Toutefois, le référendum britannique a confirmé l'importance vitale de la nation, qu'on ne saurait tenir pour une simple construction artificielle facile à démonter, comme veut le croire une certaine sociologie. Les nations sont des réalités historiques aux racines très profondes et qu'on ne saurait déposséder de leur souveraineté sans provoquer chez elles une réaction vitale, surtout quand l'histoire redevient tumultueuse. On ne saurait non plus les humilier sans les pousser à la révolte. Le Brexit, de ce point de vue, peut servir de rappel: ou bien l'Europe sera gaullienne, et saura respecter la diversité des peuples qui la constituent, ou bien elle ne sera pas. Ou alors, elle ne sera plus l'Europe. ■
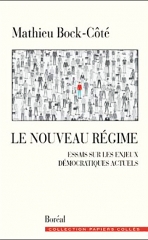 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur
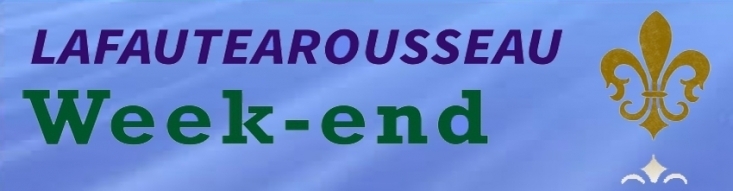
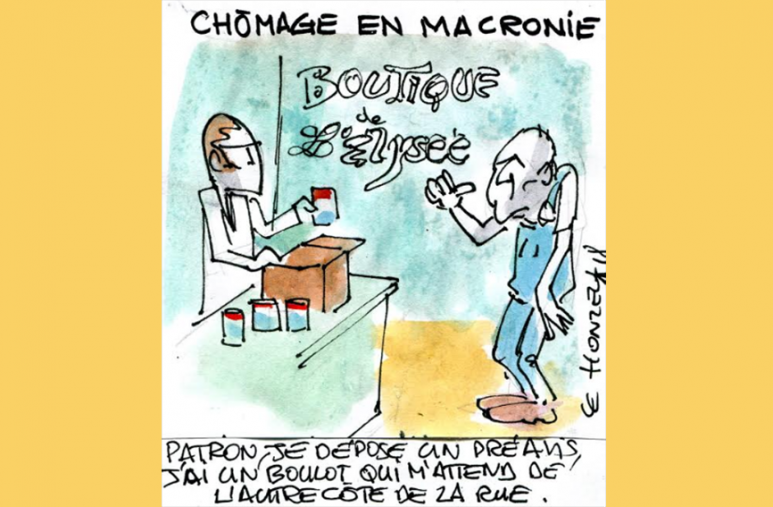


 Résumons un peu cela : la jeune luthérienne saxonne Sophie d'Anhalt (Marlene Dietrich) est choisie en 1744 pour devenir l'épouse du Grand duc Pierre (Simon Jaffe), neveu de l'Impératrice Élisabeth Ière (Louise Dresser), fille de Pierre le Grand, grande souveraine cultivée et francophile, qui n'a pas d'autre héritier que cet individu brutal et inculte et qui est lui-même adulateur de la Prusse. Sophie d'Anhalt se convertit à l'orthodoxie en 1744, prend le prénom de Catherine et se marie avec son triste époux en 1745. Elle n'a pas 16 ans.
Résumons un peu cela : la jeune luthérienne saxonne Sophie d'Anhalt (Marlene Dietrich) est choisie en 1744 pour devenir l'épouse du Grand duc Pierre (Simon Jaffe), neveu de l'Impératrice Élisabeth Ière (Louise Dresser), fille de Pierre le Grand, grande souveraine cultivée et francophile, qui n'a pas d'autre héritier que cet individu brutal et inculte et qui est lui-même adulateur de la Prusse. Sophie d'Anhalt se convertit à l'orthodoxie en 1744, prend le prénom de Catherine et se marie avec son triste époux en 1745. Elle n'a pas 16 ans. Alors que l'Impératrice régnante et toute la Russie attendent impatiemment un héritier mâle (depuis la mort de Pierre le Grand plusieurs femmes ont occupé le trône), Catherine donne jour à son fils Paul neuf ans après son mariage et il y a tout lieu de présumer que le père en est un officier noble de la Cour, Sergeï Saltikov. En 1761, Élisabeth tsarine meurt et Pierre lui succède sous le nom de Pierre III. Il y a longtemps que les époux se détestent et que Catherine, dotée, paraît-il d'un tempérament insatiable, multiplie les amants, notamment parmi les beaux militaires. C'est sur la caste des officiers qu'elle s'appuiera pour détrôner son mari, le faire assassiner et lui succéder sous le nom de Catherine II.
Alors que l'Impératrice régnante et toute la Russie attendent impatiemment un héritier mâle (depuis la mort de Pierre le Grand plusieurs femmes ont occupé le trône), Catherine donne jour à son fils Paul neuf ans après son mariage et il y a tout lieu de présumer que le père en est un officier noble de la Cour, Sergeï Saltikov. En 1761, Élisabeth tsarine meurt et Pierre lui succède sous le nom de Pierre III. Il y a longtemps que les époux se détestent et que Catherine, dotée, paraît-il d'un tempérament insatiable, multiplie les amants, notamment parmi les beaux militaires. C'est sur la caste des officiers qu'elle s'appuiera pour détrôner son mari, le faire assassiner et lui succéder sous le nom de Catherine II. C'est là-dessus que le film de Sternberg s'arrête, en 1762. Catherine régnera encore durant 34 ans. Tous les événements relatés ci-dessus figurent, il est vrai dans le film et Sternberg ne dissimule en rien, ce qui n'était pas vraiment commun dans le cinéma étasunien, les débordements sexuels de son héroïne (il est vrai que le film est sorti avant le vertueux Code Hayes). Mais le cinéaste les présente comme s'ils s'étaient déroulés en quelques mois alors qu'il y a un espace de 17 ans avant l'arrivée de Catherine en Russie et sa prise de pouvoir. Et puis, par exemple il n'y a pas un mot sur la guerre de 7 ans, conflit majeur du 18ème siècle, menée par la Russie aux côtés de la France, qui aurait permis un durable écrasement de la Prusse si, à peine couronné Pierre III ne s'était empressé de capituler alors que nos forces alliées étaient presque victorieuses.
C'est là-dessus que le film de Sternberg s'arrête, en 1762. Catherine régnera encore durant 34 ans. Tous les événements relatés ci-dessus figurent, il est vrai dans le film et Sternberg ne dissimule en rien, ce qui n'était pas vraiment commun dans le cinéma étasunien, les débordements sexuels de son héroïne (il est vrai que le film est sorti avant le vertueux Code Hayes). Mais le cinéaste les présente comme s'ils s'étaient déroulés en quelques mois alors qu'il y a un espace de 17 ans avant l'arrivée de Catherine en Russie et sa prise de pouvoir. Et puis, par exemple il n'y a pas un mot sur la guerre de 7 ans, conflit majeur du 18ème siècle, menée par la Russie aux côtés de la France, qui aurait permis un durable écrasement de la Prusse si, à peine couronné Pierre III ne s'était empressé de capituler alors que nos forces alliées étaient presque victorieuses. Aucune prétention historique dans le film, donc, mais un véritable enchantement de mise en scène, d'images et d'acteurs. Au début de ce message j'ai écrit que la Russie présentée paraissait être une image de l'Enfer ; c'est exactement la même chose dans la somptuosité baroque des palais, dans leur décoration grotesque, au sens originel du terme, surchargés de motifs étranges, d'icônes terrifiantes, de statues contrefaites menaçantes (j'ai d'ailleurs trouvé une certaine ressemblance avec la demeure des Chasses du comte Zaroff, pareillement hostile et inquiétante). Et tout autant la violence des comportements, la tension irrespirable lors de plusieurs scènes capitales (notamment celle, à la fin du film, où les deux époux s'affrontent avec une haine tangible), l'atmosphère perpétuellement sanglante et la folie qui rode. Au rebours des minimalismes, la qualité des décors, des costumes, des scènes de foule donne à ce récit une ampleur grandiose et maléfique. Et tout cela enluminé par les somptueuses liturgies orthodoxes.
Aucune prétention historique dans le film, donc, mais un véritable enchantement de mise en scène, d'images et d'acteurs. Au début de ce message j'ai écrit que la Russie présentée paraissait être une image de l'Enfer ; c'est exactement la même chose dans la somptuosité baroque des palais, dans leur décoration grotesque, au sens originel du terme, surchargés de motifs étranges, d'icônes terrifiantes, de statues contrefaites menaçantes (j'ai d'ailleurs trouvé une certaine ressemblance avec la demeure des Chasses du comte Zaroff, pareillement hostile et inquiétante). Et tout autant la violence des comportements, la tension irrespirable lors de plusieurs scènes capitales (notamment celle, à la fin du film, où les deux époux s'affrontent avec une haine tangible), l'atmosphère perpétuellement sanglante et la folie qui rode. Au rebours des minimalismes, la qualité des décors, des costumes, des scènes de foule donne à ce récit une ampleur grandiose et maléfique. Et tout cela enluminé par les somptueuses liturgies orthodoxes.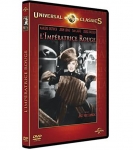
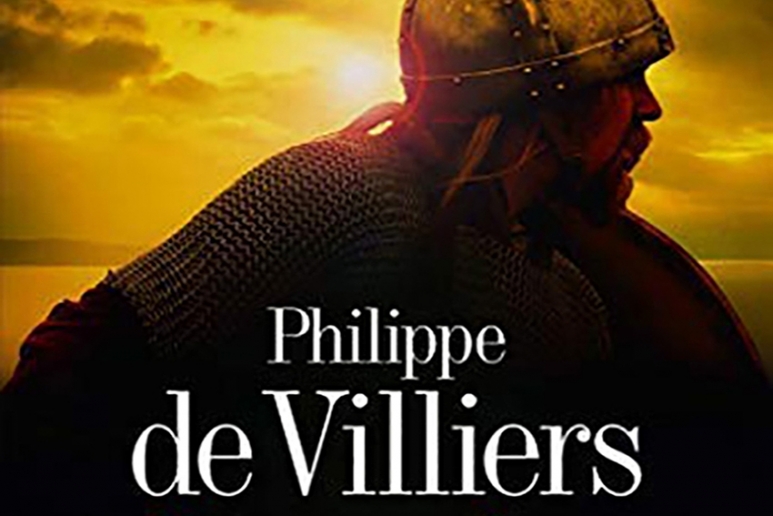
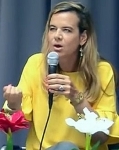

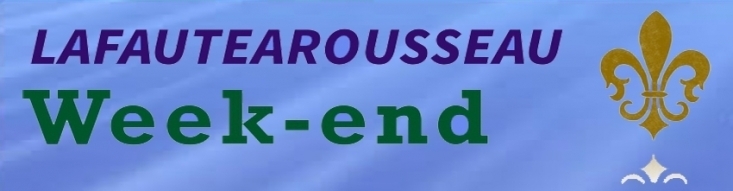
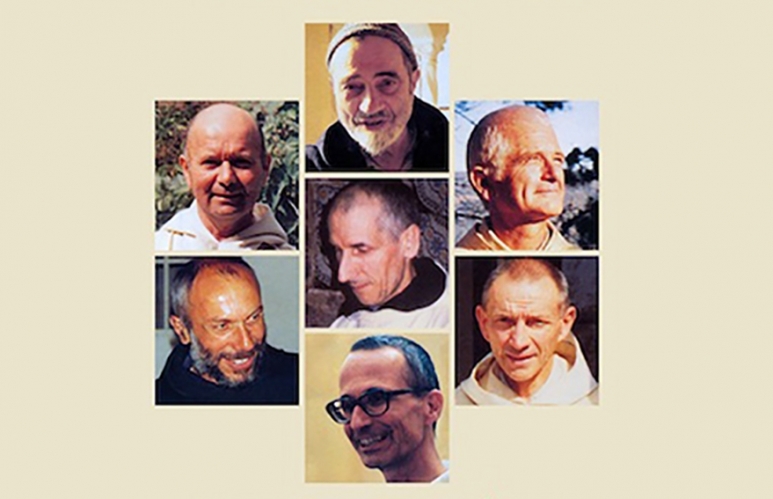
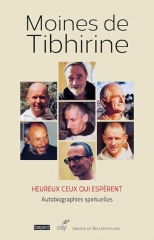


 Ce long-métrage entame brillamment les cérémonies du jubilé des « premiers pas sur la lune » qu’on ne manquera pas de célébrer dans 9 mois.
Ce long-métrage entame brillamment les cérémonies du jubilé des « premiers pas sur la lune » qu’on ne manquera pas de célébrer dans 9 mois. Curieux cet hommage justifié, que je recommande évidemment, mais sélectif.
Curieux cet hommage justifié, que je recommande évidemment, mais sélectif.
 Nous mettons en ligne aujourd'hui la seconde partie du débat dont nous avons publié la première partie hier. Cette dernière porte notamment sur l'immigration, l'Islam, la théorie du grand remplacement, la guerre de civilisation, des sujets absolument essentiels pour la survie de la France. En tous domaines, l'on mesurera combien la pensée d'Éric Zemmour est pétrie des thèses - parfois même d'expressions - maurrassiennes et bainvilliennes. Zemmour redresse ainsi avec un remarquable courage intellectuel des opinions reçues, manichéennes et simplistes par ignorance ou pure mauvaise foi. Quand on a lu La Cause du peuple de Patrick Buisson, quand on écoute ou qu'on lit Zemmour, on se rend un compte exact de l'influence que les idées d'Action française continuent d'exercer sur l'Intelligence française. En ce sens, l'on ne peut parler ni de leur échec, ni de leur malédiction. Et surtout, l'on constate quels signalés services elles ne cessent de rendre à la France d'aujourd'hui. Regardez, écoutez, donnez vos avis...
Nous mettons en ligne aujourd'hui la seconde partie du débat dont nous avons publié la première partie hier. Cette dernière porte notamment sur l'immigration, l'Islam, la théorie du grand remplacement, la guerre de civilisation, des sujets absolument essentiels pour la survie de la France. En tous domaines, l'on mesurera combien la pensée d'Éric Zemmour est pétrie des thèses - parfois même d'expressions - maurrassiennes et bainvilliennes. Zemmour redresse ainsi avec un remarquable courage intellectuel des opinions reçues, manichéennes et simplistes par ignorance ou pure mauvaise foi. Quand on a lu La Cause du peuple de Patrick Buisson, quand on écoute ou qu'on lit Zemmour, on se rend un compte exact de l'influence que les idées d'Action française continuent d'exercer sur l'Intelligence française. En ce sens, l'on ne peut parler ni de leur échec, ni de leur malédiction. Et surtout, l'on constate quels signalés services elles ne cessent de rendre à la France d'aujourd'hui. Regardez, écoutez, donnez vos avis... 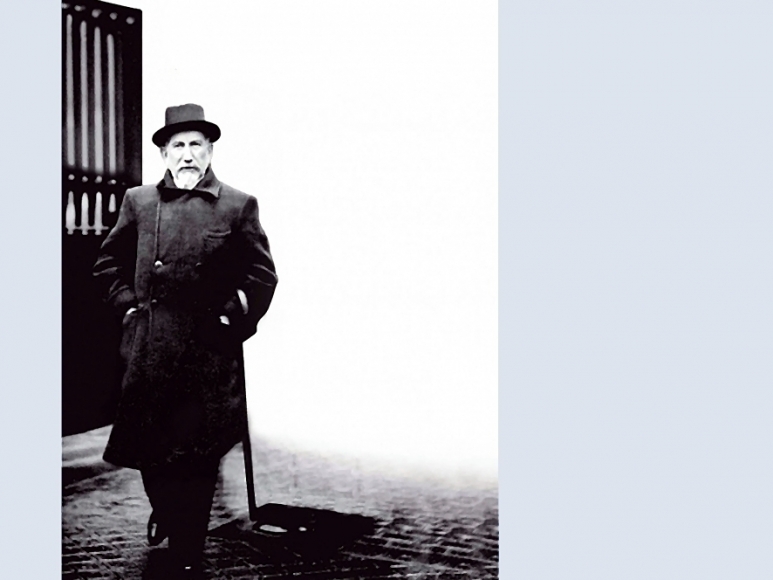
 Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers.
Il s'agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n'y sommes plus ; si notre sol nous appartient ou si nous allons perdre avec lui notre fer, notre houille et notre pain ; si, avec les champs et la mer, les canaux et les fleuves, nous allons aliéner les habitations de nos pères, depuis le monument où se glorifie la Cité jusqu'aux humbles maisons de nos particuliers. 

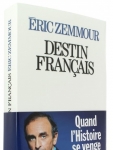


 Lire aussi dans Lafautearousseau ...
Lire aussi dans Lafautearousseau ...