Photo : Panos Kemmenos, leader des Grecs indépendants.
Par Yves Morel
L’accès au pouvoir d’Alexis Tsipras en Grèce n’a été possible qu’avec l’appoint des 13 députés des Grecs indépendants qui a permis à Syriza, la formation du nouveau Premier ministre, d’obtenir la majorité à la Boulè (fixée à 151 sièges, quand elle en disposait de 149). Un ralliement qui, quoique jugé prévisible par quelques politiques et observateurs, a surpris tout le monde. Les deux formations sont, en effet, aux antipodes l’une de l’autre. Coalition de la gauche radicale incluant des alternatifs de sensibilité écologiste, des socialistes anticapitalistes marxisants, proche à la fois, sur l’échiquier politique français, d’Attac, du NPA, du Front de Gauche, des Alternatifs et de l’aile gauche des Verts, Syriza n’a rien en commun avec les Grecs indépendants, nationalistes, conservateurs, favorables à l’entreprise privée, et très liés à l’armée et à l’Église orthodoxe.
Les deux partis se sont pourtant retrouvés sur leur plus petit dénominateur commun : leur hostilité à l’euro, le refus de la politique d’austérité imposée par Bruxelles et la renégociation du remboursement de la dette grecque. Et la capitulation de Tsipras à Bruxelles ne semble pas avoir entamé cette alliance limitée à ce seul point.
Un parti souverainiste dirigé par un grec francophile
Où situer les Grecs indépendants (Anexátítí Éllines, soit ANEL)? Leurs positions souverainistes les apparentent, à l’esprit de beaucoup, à Debout le France de Nicolas Dupont-Aignan. Et, de fait, les deux mouvements sont nés d’une rupture d’avec leur formation d’origine, qui se trouvait être le grand parti conservateur de leur pays : Debout la France (DLF) fut d’abord, et jusqu’en 2008, un courant de l’UMP, et Dupont-Aignan, un élu de cette formation avant de la quitter ; les Grecs indépendants, quant à eux, fondés en février 2012, sont une dissidence de Nouvelle Démocratie, dont Kammenos fut député. De plus, ce dernier affiche ouvertement ses affinités souverainistes avec Dupont-Aignan, lequel ne lui ménage pas son soutien public ; les deux hommes se sont rencontrés, s’apprécient, et Kammenos a pris publiquement la parole lors d’un meeting de DLF.
Leurs relations sont d’autant plus aisées que Kammenos parle couramment le français et connaît très bien notre pays, sa sensibilité et sa culture ; après avoir été élève d’un lycée français de Grèce, il a effectué ses études supérieures de sciences économiques, de gestion des entreprises et de psychologie à l’université Lyon II, puis à Lausanne, en Suisse romande. Les deux partis et leurs leaders respectifs combattent l’euro, la politique européenne commune pilotée par la Commission européenne, la tyrannie des critères de convergence et la limitation draconienne des déficits budgétaires, le culte monétariste de la devise forte, la mondialisation et le libéralisme sans frontières, la disparition des souverainetés nationales au profit du marché mondialisé, de la technocratie de bruxelloise et de la loi des bourses et des grandes banques.
Proche de DLF ou du MPF ?
Cependant la ressemblance s’arrête là. Car quant au reste, les différences et les oppositions apparaissent en nombre. En effet, Dupont-Aignan et DLF sont des républicains laïcs, relativement progressistes, dont le gaullisme orthodoxe se nuance assez fortement de mendésisme, les rapprochant en cela du Pôle républicain et de la gauche chevènementiste. A l’opposé, Kamennos et les Grecs indépendants s’ancrent résolument à droite, défendent la religion et la morale chrétiennes, entretiennent les meilleurs rapports avec l’Eglise orthodoxe, réprouvent les mesures laïques votées ces dernières années en Grèce (mariage civil, partenariat civil pour les couples homosexuels, laïcisation de l’enseignement) et combattent résolument le multiculturalisme et l’immigration. En fait, ils s’apparentent beaucoup plus au Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de Villiers qu’au DLF de Dupont-Aignan ; leurs vues coïncident en tous point avec ceux du Vendéen, la seule petite différence résidant en la différence confessionnelle, l’ANEL se réclamant de la religion orthodoxe quand le MPF fait fond sur le catholicisme ; ceci dit, tous deux promeuvent l’idéal d’une civilisation chrétienne. Mais ce n’est pas seulement sur les questions d’éthique et de société que se situent les affinités entre l’ANEL et le MPF : les deux formations se ressemblent également par leur nationalisme économique.
Toutes deux sont hostiles au grand marché européen sans frontières découlant de l’Acte unique européen et de l’institution de l’euro, des critères de convergences et contraintes budgétaires en découlant, de la Banque Centrale Européenne, se prononcent en faveur du protectionnisme patriotique et revendiquent le droit, pour leurs nations respectives, de mener une politique commerciale extérieure conforme à leurs intérêts propres et à leur parcours et traditions historiques. Ce patriotisme économique était ouvertement revendiqué en France par Philippe de Villiers et Jimmy Goldsmith en 1894-1897, et il l’est aujourd’hui en Grèce par l’ANEL. Kamennos préconise la conclusion d’alliances économiques fécondes de la Grèce avec la Russie et la Chine et considère avec un optimisme allègre la position géographique de son pays qui, selon lui, peut devenir la plaque tournante des exportations chinoises vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique septentrionale. C’est avec enthousiasme qu’il annonce « la résurrection de la route de la soie à la fois sur terre et sur mer ». Et, ministre délégué à la Marine marchande, dans le second gouvernement de Kostas Karamanlis (2007-2009), il a décidé la conclusion d’un accord avec le groupe chinois COSMO attribuant à ce dernier une concession de trente ans dans la station de conteneurs du port du Pirée (30 novembre 2008).
Un parti d’extrême droite ?
L’ANEL, parti des Grecs indépendants, est donc, assurément, un parti de droite, nationaliste, chrétien, hostile à l’Europe communautaire. Il est le jumeau intellectuel et moral du MPF français bien plus que l’équivalent approximatif du DLF de Dupont-Aignan, nonobstant les relations amicales entre les deux partis. Doit-on l’assimiler à l’extrême-droite, à l’instar de Daniel Cohn-Bendit, qui voit en Kamennos « un homophobe, un antisémite et un raciste » et considère l’alliance de Syriza avec l’ANEL comme un « scandale » ?
Il conviendrait d’abord de clarifier cette notion d’ « extrême droite », tout comme d’ailleurs celle d’ « extrême gauche ». Quel(s) critère(s) permet(tent) de qualifier un parti d’ «extrême » ou d’«extrémiste » ? De l’avis général des politologues et des historiens contemporainistes, un parti peut être qualifié ainsi lorsqu’il préconise – idéologiquement, éthiquement et institutionnellement – une rupture radicale avec le régime dont il combat le gouvernement, et l’édification d’un nouveau système politique et social fondé sur des valeurs et une vision de l’homme et du monde en opposition avec lui. Tel n’est pas le cas de l’ANEL qui ne préconise pas un changement de régime et critique les orientations des grands partis habituellement au pouvoir en Grèce sans contester pour autant la démocratie libérale et parlementaire instaurée par la constitution de 1974. Les Grecs indépendants réclament certes un contrôle sévère de l’immigration, l’exclusion des clandestins, défendent une morale chrétienne rigoureuse, plaident la cause de l’exemption d’impôts de l’Eglise orthodoxe, se prononcent contre la banalisation de l’homosexualité et le mariage gay et lesbien, critiquent la « culture » du rap, du tag, du reggae et des tam-tams, défendent la tradition culturelle hellénique, mais tout cela reste parfaitement compatible avec la démocratie libérale.
Et le fait que M. Kamennos soit décoré de l’Eglise orthodoxe tchèque et du Grand Patriarcat de Jérusalem ne fait pas de lui un champion de la théocratie. Quant à l’accusation d’antisémitisme, lancée à propos de la critique de l’exemption d’impôts des juifs, musulmans et bouddhistes (et, à ce sujet, pourquoi ne pas parler également de racisme anti-arabe ou anti-asiatique ?), elle est bancale : dénoncer le privilège indu d’une communauté (en l’occurrence de trois communautés différentes) au nom de la simple égalité devant la loi ne relève pas du racisme. Du reste, l’ANEL ne conclut guère d’alliances qu’avec des partis reconnus comme démocratiques. Aucun des partis du groupe parlementaire européen auquel elle appartient ne peut être sérieusement et de bonne foi taxé d’opposition à la démocratie et aux libertés publiques. Et nous avons vu quels liens cordiaux l’unissaient au DLF de Dupont-Aignan, indubitablement républicain et laïc. En fait, le seul parti d’extrême droite et antidémocratique de la Grèce actuelle est l’Aube dorée. Rappelons, pour clore ce point, qu’en France, l’ultra gauche elle-même n’a pas critiqué le choix de Syriza de s’allier à l’ANEL, qu’il s’agisse d’EELV (de par son porte-parole Julien Bayou, à Athènes au début de cette année et ardent soutien de Syriza), ou du parti communiste (de par les propos récents de Pierre Laurent), qui ont estimé qu’un tel accord pouvait offrir pour la Grèce des perspectives intéressantes.
La même relativisation de cette notion d’extrémisme vaut pour Syriza. Cette formation, née de l’alliance de divers partis et associations allant de la gauche marxiste aux représentants d’un idéal humaniste et social-démocrate modéré en passant par les altermondialistes et les écologistes, a été située à l’extrême gauche, alors que rien, dans son programme – au demeurant critiquable sur bien des points – n’indique l’ambition d’édifier une société collectiviste ou anarchiste et une volonté de rupture d’avec la « démocratie bourgeoise » libérale et parlementaire, le capitalisme, la libre entreprise. Le simple fait pour un parti de refuser la mondialisation néolibérale, la financiarisation de l’économie, la soumission aux lois du marché et aux fluctuations boursières, et la tyrannie de la Commission européenne, de la BCE et des « critères de convergence », ne suffit pas à le classer à l’ « extrême gauche » ; de même que l’adhésion à l’idée d’instituer la taxe Tobin sur les transactions financières (critiquable, elle aussi), n’est pas le fait des seuls gens de d’extrême gauche ou simplement de gauche (des centristes comme François Bayrou et des hommes de droite comme Jacques Chirac et Paul-Marie Coûteaux s’y sont ralliés).
Ni Syriza ni ANEL ne sont des partis extrémistes, ni Alexis Tsipras ni Panos Kamennos ne sont des extrémistes désireux d’instaurer, le premier une république populaire teintée d’écologisme et de libertarisme sociétal, le second une théocratie nationaliste. Ces deux mouvements et leurs meneurs respectifs ne sont que les expressions différentes, certes opposées mais complémentaires, du refus d’une Europe supranationale destructrice des peuples.
En réalité, l’ANEL et son alliance au pouvoir avec SYRIZA montrent surtout l’inanité de la traditionnelle classification des formations politiques en éventail allant de l’extrême gauche à l’extrême droite, et révèlent que la défense de la civilisation, de la tradition et de la nation excèdent les trop habituels et spécieux clivages politiques et sont parfaitement compatibles avec la défense des intérêts économiques et sociaux du peuple. •
Yves Morel
Docteur ès-lettres, écrivain, spécialiste de l'histoire de l'enseignement en France, collaborateur de la Nouvelle Revue universelle
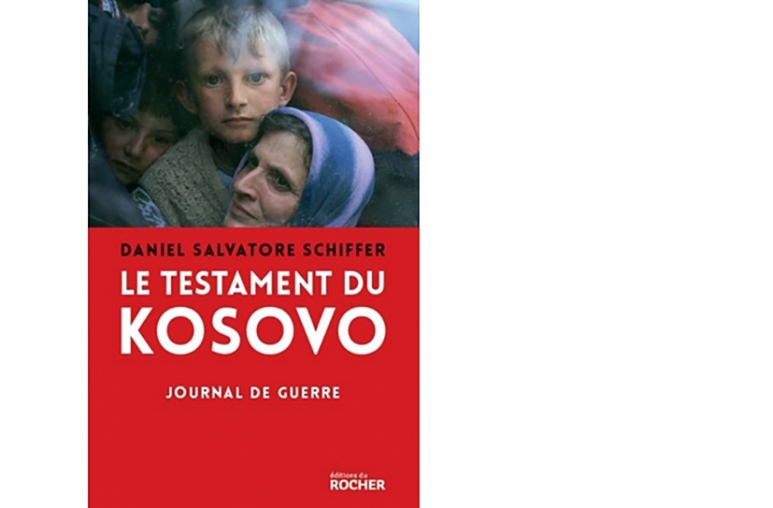
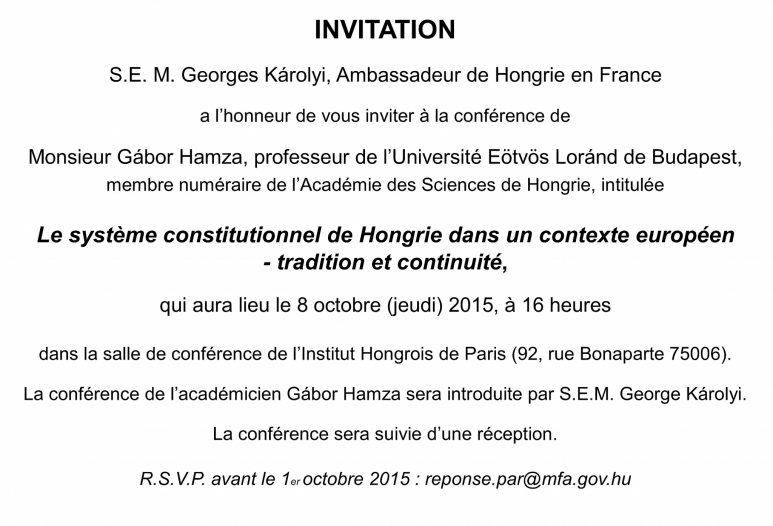
 Il nous est précisé que cette conférence s’adresse en priorité aux juristes. Mais elle intéressera aussi tous les amis de la Hongrie. Ce que nous sommes depuis longtemps de diverses manières, par exemple à raison des longues relations et de l'amitié d'esprit qui nous liaient au regretté Thomas Molnar. Dont plusieurs conférences faites à Marseille peuvent être retrouvées en vidéo sur ce blog.
Il nous est précisé que cette conférence s’adresse en priorité aux juristes. Mais elle intéressera aussi tous les amis de la Hongrie. Ce que nous sommes depuis longtemps de diverses manières, par exemple à raison des longues relations et de l'amitié d'esprit qui nous liaient au regretté Thomas Molnar. Dont plusieurs conférences faites à Marseille peuvent être retrouvées en vidéo sur ce blog.
 La gestion par l’Allemagne des flux migratoires en provenance de Syrie, lesquels ne font que s’ajouter à ceux de la Libye, qui ne se tarissent pas, témoigne, s’il en était besoin, du fait que, contrairement à ce qu’on entend ici ou là, loin de penser « européen »,
La gestion par l’Allemagne des flux migratoires en provenance de Syrie, lesquels ne font que s’ajouter à ceux de la Libye, qui ne se tarissent pas, témoigne, s’il en était besoin, du fait que, contrairement à ce qu’on entend ici ou là, loin de penser « européen », 


 Avec l'information et la désinformation qui passent désormais à la vitesse de la lumière, avec l'appel permanent aux émotions élémentaires et aux réflexes pavloviens, tout se passe comme si, sur le front des luttes, Nabilla avait remplacé Descartes. Un exemple chimiquement pur vient de nous être donné par la chancelière allemande, l'efficace et faussement angélique Angela. Et les réactions médiatico-politiques intenses que ses conduites engendrent.
Avec l'information et la désinformation qui passent désormais à la vitesse de la lumière, avec l'appel permanent aux émotions élémentaires et aux réflexes pavloviens, tout se passe comme si, sur le front des luttes, Nabilla avait remplacé Descartes. Un exemple chimiquement pur vient de nous être donné par la chancelière allemande, l'efficace et faussement angélique Angela. Et les réactions médiatico-politiques intenses que ses conduites engendrent.


 À peine l’Action française bouclait-elle son université d’été – la plus ancienne du paysage politique français puisque datant de 1953 –, que socialistes et écologistes organisaient leurs raouts de rentrée sur fond de querelles intestines (à La Rochelle, Valls était hué par les Jeunes Socialistes) et de démissions (les écologistes Rugy et Placé ont préféré leurs ambitions ministérielles à leurs convictions politiques). Toutefois, avant même la rentrée politique officielle, l’été n’aura pas été avare en événements à la fois tragiques et inquiétants, qui ont donné à nos démagogues l’occasion de déverser leurs propos irresponsables.
À peine l’Action française bouclait-elle son université d’été – la plus ancienne du paysage politique français puisque datant de 1953 –, que socialistes et écologistes organisaient leurs raouts de rentrée sur fond de querelles intestines (à La Rochelle, Valls était hué par les Jeunes Socialistes) et de démissions (les écologistes Rugy et Placé ont préféré leurs ambitions ministérielles à leurs convictions politiques). Toutefois, avant même la rentrée politique officielle, l’été n’aura pas été avare en événements à la fois tragiques et inquiétants, qui ont donné à nos démagogues l’occasion de déverser leurs propos irresponsables.


 L’Allemagne disparaît serait considéré comme l’équivalent du Suicide français d’Éric Zemmour, s’il n’adoptait pas un angle de vue démographique, économique, sociologique et politique aux antipodes des analyses plus historiques et événementielles de l’essayiste français. Il reste vrai, cependant, que le titre français rend imparfaitement compte du propos du livre, qui pourrait davantage s’intituler « L’Allemagne se supprime elle-même », voire « L’Allemagne se suicide ».
L’Allemagne disparaît serait considéré comme l’équivalent du Suicide français d’Éric Zemmour, s’il n’adoptait pas un angle de vue démographique, économique, sociologique et politique aux antipodes des analyses plus historiques et événementielles de l’essayiste français. Il reste vrai, cependant, que le titre français rend imparfaitement compte du propos du livre, qui pourrait davantage s’intituler « L’Allemagne se supprime elle-même », voire « L’Allemagne se suicide ».

 À leurs peuples angoissés et fébriles devant la vague migratoire, les dirigeants européens appellent tous au courage. Mais lequel ? Résister à la vague ou s’effacer ?
À leurs peuples angoissés et fébriles devant la vague migratoire, les dirigeants européens appellent tous au courage. Mais lequel ? Résister à la vague ou s’effacer ?
