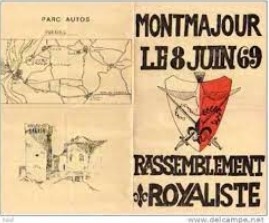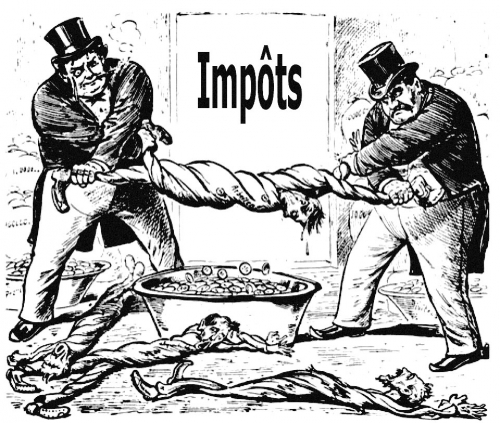GRAND ENTRETIEN - Dans une charge contre le multiculturalisme et le politiquement correct, le sociologue québécois puise dans l'actualité récente des exemples éloquents : suppression du mot « race » de la Constitution, passages piétons aux couleurs de la gay pride à Paris... Bien d'autres sujets essentiels sont évoqués dans cet entretien foisonnant et sans concession réalisé par Alexandre Devecchio pour Figarovox [29.06]. Serons-nous d'accord sur tout ? Pas forcément. Sur le fond, sur la pensée si riche de Mathieu Bock-Côté, nous le serons, à l'évidence. LFAR
GRAND ENTRETIEN - Dans une charge contre le multiculturalisme et le politiquement correct, le sociologue québécois puise dans l'actualité récente des exemples éloquents : suppression du mot « race » de la Constitution, passages piétons aux couleurs de la gay pride à Paris... Bien d'autres sujets essentiels sont évoqués dans cet entretien foisonnant et sans concession réalisé par Alexandre Devecchio pour Figarovox [29.06]. Serons-nous d'accord sur tout ? Pas forcément. Sur le fond, sur la pensée si riche de Mathieu Bock-Côté, nous le serons, à l'évidence. LFAR
Sur fond de moralisation de la question migratoire et de radicalisation féministe, les députés ont voté en commission le retrait du terme «race» de l'article 1er de la Constitution et y ont également introduit l'interdiction de « distinction de sexe ». Que cela vous inspire-t-il ?
Cela faisait un bon moment que la proposition d'un retrait du terme « race » de la Constitution traînait dans le paysage politique. On rappelle avec raison que François Hollande en avait fait la promesse lors de l'élection présidentielle de 2012. Le raisonnement est le suivant : si les races n'existent pas, comme on le dit aujourd'hui, pourquoi les mentionner ? Ils y voient l'aboutissement constitutionnel d'un antiracisme authentique. Pourquoi pas ?
Mais il y a néanmoins un paradoxe étonnant sur lequel on doit se pencher : c'est au moment où on veut bannir le mot race que la question raciale resurgit au cœur de la vie politique, à travers l'action des groupuscules identitaires d'extrême-gauche, dont les Indigènes de la République sont emblématiques. La mouvance indigéniste entend achever la décolonisation en dénationalisant la France, ce qui implique à la fois sa soumission et sa conversion à un multiculturalisme qui veut non seulement réintroduire la race dans le débat public, mais qui veut en faire la catégorie fondatrice de la citoyenneté et de la représentation. Elle pousse à une racialisation des appartenances qui accule ensuite au séparatisme racial revendiqué, comme on le voit avec la multiplication des « rencontres non-mixtes pour personnes racisées » dans le milieu universitaire, pour emprunter les termes de la novlangue diversitaire. En fait, si on se penche un peu sur les textes de référence de cette mouvance, on constate qu'elle cultive un racisme antiblanc décomplexé. S'il y a une tentation raciste en France, elle vient de là. La mouvance indigéniste excite le repli communautariste et cherche à fissurer le noyau intime de la nation. Mais cela ne semble pas troubler exagérément les grands médias, qui accueillent les représentants de cette mouvance à la manière de grands démocrates. La haine raciale est officiellement proscrite, sauf lorsqu'elle vise ceux qu'on nous invite à appeler les « Blancs » parce qu'il s'agirait simplement d'une critique des « dominants » par les « racisés ». La mauvaise conscience occidentale a de l'avenir.
Qu'on me permette un mot sur cette sociologie racialiste qui s'impose de plus en plus dans l'université. Faut-il mettre le Français, l'Allemand, l'Écossais, l'Anglais, le Russe, le Letton, le Québécois et le Néerlandais dans la même catégorie parce qu'ils sont « Blancs » ? Faut-il faire de même avec le Malien, l'Haïtien, le Kenyan et l'Afro-Américain parce qu'ils sont « Noirs » ? Cette racialisation débile des appartenances est incroyablement régressive : elle pousse à l'abolition de l'histoire et de la culture pour naturaliser les groupes humains en grandes catégories zoologiques. Mais puisque cette proposition vient de la gauche, ou du moins, d'une certaine frange de la gauche radicale, on l'accueille favorablement, ou du moins, sans trop la condamner.
Alors devant cela, je me demande quel est le sens de ce vote des députés, qui me semblent incroyablement détachés du réel politique, auquel ils devraient pourtant porter attention. Que pensent les députés qui se sont ralliés à cet amendement de cette effrayante racialisation des appartenances ?
Ce progressisme langagier peut-il vraiment réduire ou corriger les injustices et les inégalités ?
Allons-y d'une évidence : le langage évolue, et d'une époque à une autre, il y a une forme de tri naturel qui n'est rien d'autre qu'un mouvement de civilisation des mœurs. Dans notre monde, on ne dit plus nègre, on ne dit plus rital, on ne dit plus youpin, et globalement, c'est très bien. L'histoire de la politesse nous rappelle que ce qui peut se dire ou ne pas se dire d'une époque à l'autre varie et on peut se réjouir que certaines insultes hier prisées méritent aujourd'hui à ceux qui les emploient une très mauvaise réputation. Il arrive aussi que ce souci de « politesse » bascule dans l'euphémisation du réel, lorsque le sourd devient le malentendant ou l'aveugle, le non-voyant. On ne sait pas trop ce qu'on gagne à parler ainsi, sinon à déréaliser le langage et à l'enfermer dans un univers autoréférentiel.
Mais ce n'est plus de cela dont il s'agit ici dans cette orwellisation du langage qui caractérise aujourd'hui la langue médiatique. Souvent, il s'agit de masquer le réel, tout simplement, comme c'est le cas avec la référence obsédante au vivre-ensemble, au moment même où la société se décompose et s'effiloche. Il peut aussi inverser le sens du réel. Il faudrait se souvenir de Jacqui Smith, l'ancienne ministre de l'intérieur britannique, qui en 2008, avait affirmé qu'il fallait parler non plus d'attentats islamistes, mais anti-islamiques, parce qu'ils seraient contraires à la vocation naturellement pacifique de l'islam. De la même manière, quand un homme comme Jacques Toubon joue avec les chiffres et les définitions pour laisser croire que l'immigration massive n'a pas eu lieu en France depuis 40 ans, comme on l'a vu récemment, il s'engage dans un travail de falsification de la réalité qui pousse le commun des mortels à croire que les autorités cherchent moins aujourd'hui à agir sur le réel qu'à le dissimuler. Cette idéologisation du langage devrait nous pousser à relire Milosz et Koestler, qui ont consacré des pages lumineuses à l'aveuglement idéologique.
La guerre culturelle, qui s'est substituée à la lutte des classes, est d'abord une bataille pour déterminer la signification de notre univers symbolique et pour transformer les codes et repères qui constituent le monde commun. On veut déterminer les paramètres de la perception commune et décider quels phénomènes sociaux ou aura le droit de voir ou non. Comment se représente-t-on la société ? Comment a-t-on le droit de la représenter ? En fait, le politiquement correct est un dispositif inhibiteur installé au cœur de l'espace public qui a pour fonction de refouler dans ses marges ceux qui affichent leur dissidence avec l'orthodoxie diversitaire. Et le politiquement correct se radicalise au rythme où la société diversitaire se décompose, comme s'il fallait à tout prix empêcher qu'on en tienne compte. De ce point de vue, le multiculturalisme est un régime idéocratique et autoritaire.
Je vous donne un exemple : on parle beaucoup, depuis quelques années, d'une « libération de la parole xénophobe » et il est bien vu de s'en inquiéter. Il y aurait même une montée de l'intolérance en Europe, et la démocratie serait mise en péril par la tentation du repli identitaire - on connaît ce lexique. Mais on peut voir les choses autrement : depuis une quarantaine d'années, on a assisté à la criminalisation progressive du sentiment national, au point où même la forme la plus bénigne de patriotisme a été assimilée à une inquiétante dérive nationaliste. À travers cela, c'est le besoin d'enracinement qu'on a moralement disqualifié. Il n'est plus légitime, pour un peuple, de vouloir assurer sa continuité historique ou de défendre ses frontières devant l'immigration massive sans qu'on présente de telles aspirations comme autant de symptômes de la progression de l'extrême-droite dans la vie publique.
Alors s'agit-il vraiment d'une libération de la parole xénophobe, ou du simple éclatement d'une digue idéologique et médiatique qui censurait le sentiment national ? S'agit-il d'un retour du racisme 70 ans après la deuxième guerre mondiale ou d'un refus enfin affirmé de xénophobiser tout ce qui relève de près ou de loin de la nation ? À tout le moins, on comprend que toute bataille politique suppose une bataille pour définir la réalité, mais celle-ci n'est pas infiniment malléable et elle finit par regagner ses droits, que nous la regardions en face ou non.
Plus anecdotique, Anne Hidalgo a décidé d'installer de manière permanente des passages piétons LGBT après qu'un passage piéton « arc-en-ciel » a été recouvert d'insultes homophobes. Dans le même temps, l'Assemblée nationale sera pour la première fois pavoisée aux couleurs LGBT. Cette politique en direction des minorités, sous prétexte de lutte contre les discriminations, ne trahit-elle pas finalement l'idéal égalitaire et anti-communautaire républicain ?
Je ne suis pas certain que cela soit si anecdotique. Ces insultes contre les homosexuels sont inadmissibles, évidemment, et il est bien qu'on le dise, qu'on le répète, même. Ils relèvent d'une bêtise crasse, abjecte et militante qui devrait avoir honte d'elle-même.
Mais on voit ici comment le politiquement correct récupère ces insultes pour les instrumentaliser : on cherche ainsi à faire croire qu'elles seraient symptomatiques d'une renaissance du démon de l'homophobie qui hanterait la France. Il faudrait urgemment se mobiliser contre lui pour le chasser de la cité. Cela correspond à la sociologie diversitaire qui soutient que les sociétés occidentales se définiraient aujourd'hui essentiellement par une structure patriarcale, homophobe, raciste et sexiste qu'il faudrait faire tomber urgemment. Pouvons-nous raison garder ? On constate ici que le système médiatique est prêt à récupérer n'importe quel événement pour maintenir en vie ce grand récit de l'hostilité occidentale à la différence.
 Et cela peut aller plus loin. Si la France suit la pente nord-américaine, c'est au nom de la lutte contre l'homophobie, et demain, contre la transphobie, qu'on voudra de nouveau la convertir à la théorie du genre ou qu'on militera pour la reconnaissance d'un troisième sexe normalisé dans les formulaires administratifs, et cela, pour en finir avec la représentation binaire de la différence sexuelle. Et comme on doit s'y attendre, à ce moment, ceux qui ne participeront pas aux applaudissements obligatoires seront rangés dans le camp des réactionnaires. Cela devrait nous amener à réfléchir à la « lutte contre les discriminations », à laquelle en appellent tous les politiques, sans prendre la peine de réfléchir au cadre théorique dans lequel elle s'inscrit et qui la justifie. La moindre différence est désormais pensée comme une discrimination illégitime à combattre.
Et cela peut aller plus loin. Si la France suit la pente nord-américaine, c'est au nom de la lutte contre l'homophobie, et demain, contre la transphobie, qu'on voudra de nouveau la convertir à la théorie du genre ou qu'on militera pour la reconnaissance d'un troisième sexe normalisé dans les formulaires administratifs, et cela, pour en finir avec la représentation binaire de la différence sexuelle. Et comme on doit s'y attendre, à ce moment, ceux qui ne participeront pas aux applaudissements obligatoires seront rangés dans le camp des réactionnaires. Cela devrait nous amener à réfléchir à la « lutte contre les discriminations », à laquelle en appellent tous les politiques, sans prendre la peine de réfléchir au cadre théorique dans lequel elle s'inscrit et qui la justifie. La moindre différence est désormais pensée comme une discrimination illégitime à combattre.
Autre chose. Il faudrait se questionner sur ce qui, dans le logiciel médiatique, permet de transformer un fait divers en fait politique. Ces insultes sont comprises comme un événement politique exigeant une réponse politique. Mais quelle est la matrice idéologique qui transforme les faits divers en faits politiques, et comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi, par exemple, le scandale de Telford est-il traité comme un fait divers n'ayant aucune signification particulière ? Pourquoi avons-nous parlé avec tant de pudeur des agressions sexuelles à grande échelle de Cologne ? Pourquoi la hausse de l'insécurité causée par l'immigration massive est-elle tue, ou même niée, au point même où ceux qui en font mention passent pour des agitateurs racistes et des prêcheurs de haine ?
En fait, tout ce qui remet en question la grandeur de la société diversitaire est abordé avec une gêne extrême : on craint que si l'information se rend au peuple, ce dernier n'en tire des conclusions indésirables. Alors on ira même jusqu'à criminaliser les porteurs de mauvaises nouvelles, comme on le voit avec les procès idéologiques à répétition, qu'ont subi bien des intellectuels et journalistes français ces dernières années.
De manière plus large, est-on en train d'assister en France à un nouveau tournant politiquement correct? Régis Debray a-t-il raison de parler d'américanisation de l'Europe ?
Je ne suis pas particulièrement porté à l'anti-américanisme mais je constate qu'il est aujourd'hui nécessaire de critiquer une nouvelle forme d'impérialisme idéologique qui vient d'Amérique et qui pousse chaque nation à la déculturation. Ce n'est pas être anti-américain que de ne pas vouloir devenir américain et de ne pas vouloir plaquer sur la France des catégories historiques et sociologiques qui n'ont rien à voir avec elle. Pour parler du politiquement correct, on pourrait peut-être même parler, pour s'inscrire dans l'histoire culturelle américaine, d'une forme de puritanisme idéologique, qui consiste à vouloir purger une société de toutes ses aspérités culturelles et symboliques, pour les rendre conformes au dogme diversitaire. Il faut refouler les mauvais sentiments que nous inspire la postmodernité et envoyer sans cesse à ses contemporains des signes ostentatoires de vertu, pour emprunter la formule de Vincent Trémolet de Villers. On le fera en dénonçant rituellement, et sur une base quotidienne, s'il le faut, les phobies qui polluent notre monde, quitte à en inventer des nouvelles, comme la grossophobie ! Ceux qui prendront la peine de s'intéresser à ce que devient aujourd'hui l'université américaine et aux types de controverses qui l'animent seront sincèrement horrifiés.
Mais on peut aussi voir dans l'idéologie diversitaire qui a fait du politiquement correct son régime de censure médiatique une poursuite de la tentation totalitaire qui hante la modernité et qui se présente aujourd'hui sous un nouveau visage. De nouveau, on rêve à un monde réconcilié, réunifié et absolument transparent à lui-même. Un monde sans identités, mais aussi sans carnivores, sans fumeurs, sans buveurs, sans dragueurs, sans aventuriers et sans relations particulières, c'est-à-dire un monde sans amitié, absolument programmé, lisse, amidonné - un monde qui aurait fait mourir d'ennui un Joseph Kessel et qui donnerait des envies d'exil à un Sylvain Tesson. Nous recommençons à rêver de l'homme nouveau, mais il s'agit cette fois de l'homme sans préjugés, délivré de ses appartenances, de sa culture, de ses désirs et du vieux monde auquel il était encore lié. Le politiquement correct a pour vocation d'étouffer la part du vieux monde encore vivante en lui pour lui permettre d'enfin renaître après son passage dans la matrice diversitaire, purifié et prêt à embrasser une nouvelle figure de l'humanité, délivrée de cette préhistoire morbide qu'aura été l'histoire de l'Occident. Car pour que l'humanité nouvelle advienne, on doit d'abord en finir avec l'Occident en général et l'Europe en particulier. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend fondamentalement rien au progressisme d'aujourd'hui.
Ce politiquement correct a été embrassé depuis longtemps en Amérique du Nord. Quand est-il né exactement? Comment a-t-il imposé son hégémonie culturelle ?
En un mot, il naît sur les campus américains, à partir de la fin des années 1960, et se développe jusqu'aux années 1980, où il commence à s'institutionnaliser dans l'université, avant de devenir médiatiquement hégémonique avec les années 2000. C'est le fruit des Radical Sixties et d'un croisement bien particulier entre le néomarxisme et les formes les plus toxiques de la contre-culture. Très schématiquement, il repose sur une critique radicale de la civilisation occidentale, accusée d'avoir construit une figure aliénante de l'homme, qu'il faudrait déconstruire en s'appuyant sur les différentes minorités qui auraient subi son hégémonie. Il faut dès lors attaquer ou censurer ce qui était encore hier la norme majoritaire de nos civilisations, et valoriser ce qui était marginalis



 Elles se taisent. Et quand elles parlent, c'est pire. Depuis la révélation des violences commises à Cologne, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, par des nuées de migrants sur des femmes allemandes
Elles se taisent. Et quand elles parlent, c'est pire. Depuis la révélation des violences commises à Cologne, pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, par des nuées de migrants sur des femmes allemandes 





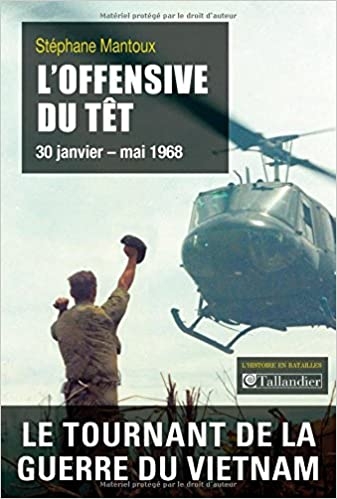
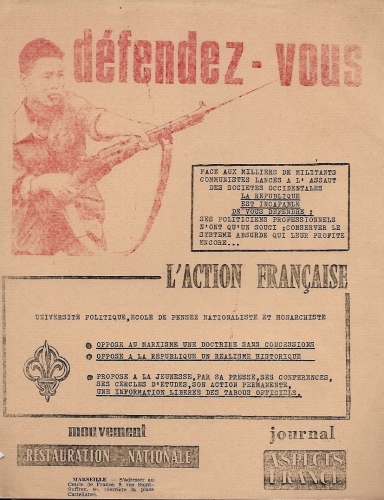
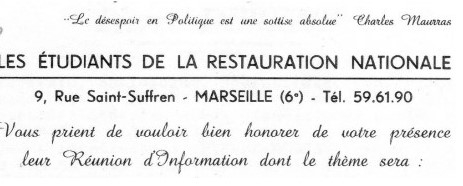
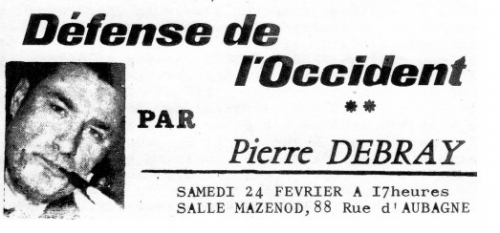
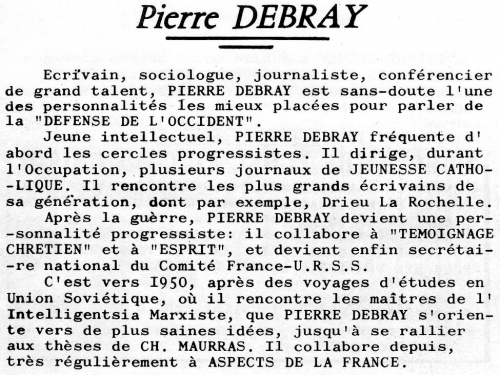
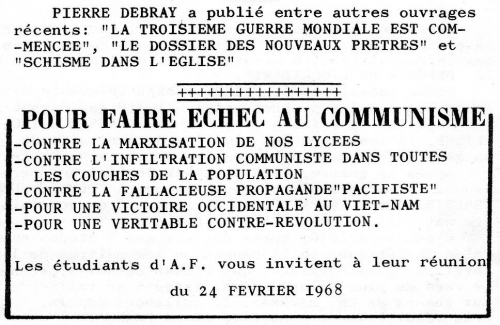

 Nicolas Sarkozy a rendu visite à Vladimir Poutine dans sa datcha proche de Moscou, jeudi 29 octobre, et a prôné le dialogue entre la France et la Russie. Ce virage de celui qui a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2007 vous surprend-elle ?
Nicolas Sarkozy a rendu visite à Vladimir Poutine dans sa datcha proche de Moscou, jeudi 29 octobre, et a prôné le dialogue entre la France et la Russie. Ce virage de celui qui a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN en 2007 vous surprend-elle ?
 GRAND ENTRETIEN - Dans une charge contre le multiculturalisme et le politiquement correct, le sociologue québécois puise dans l'actualité récente des exemples éloquents : suppression du mot « race » de la Constitution, passages piétons aux couleurs de la gay pride à Paris... Bien d'autres sujets essentiels sont évoqués dans cet entretien foisonnant et sans concession réalisé par Alexandre Devecchio pour Figarovox
GRAND ENTRETIEN - Dans une charge contre le multiculturalisme et le politiquement correct, le sociologue québécois puise dans l'actualité récente des exemples éloquents : suppression du mot « race » de la Constitution, passages piétons aux couleurs de la gay pride à Paris... Bien d'autres sujets essentiels sont évoqués dans cet entretien foisonnant et sans concession réalisé par Alexandre Devecchio pour Figarovox  Et cela peut aller plus loin. Si la France suit la pente nord-américaine, c'est au nom de la lutte contre l'homophobie, et demain, contre la transphobie, qu'on voudra de nouveau la convertir à la théorie du genre ou qu'on militera pour la reconnaissance d'un troisième sexe normalisé dans les formulaires administratifs, et cela, pour en finir avec la représentation binaire de la différence sexuelle. Et comme on doit s'y attendre, à ce moment, ceux qui ne participeront pas aux applaudissements obligatoires seront rangés dans le camp des réactionnaires. Cela devrait nous amener à réfléchir à la « lutte contre les discriminations », à laquelle en appellent tous les politiques, sans prendre la peine de réfléchir au cadre théorique dans lequel elle s'inscrit et qui la justifie. La moindre différence est désormais pensée comme une discrimination illégitime à combattre.
Et cela peut aller plus loin. Si la France suit la pente nord-américaine, c'est au nom de la lutte contre l'homophobie, et demain, contre la transphobie, qu'on voudra de nouveau la convertir à la théorie du genre ou qu'on militera pour la reconnaissance d'un troisième sexe normalisé dans les formulaires administratifs, et cela, pour en finir avec la représentation binaire de la différence sexuelle. Et comme on doit s'y attendre, à ce moment, ceux qui ne participeront pas aux applaudissements obligatoires seront rangés dans le camp des réactionnaires. Cela devrait nous amener à réfléchir à la « lutte contre les discriminations », à laquelle en appellent tous les politiques, sans prendre la peine de réfléchir au cadre théorique dans lequel elle s'inscrit et qui la justifie. La moindre différence est désormais pensée comme une discrimination illégitime à combattre.