Pour comprendre la guerre qui oppose l'Europe à l'islamisme, Mathieu Bock-Côté nous invite à redécouvrir Julien Freund. [Figarovox 1.04] A travers Freund, il nous invite ici à renouer avec les fondements du politique, à rejeter l'universalisme radical, à refuser ce que Maurras eût appelé les nuées, à opérer ce que Thibon nommait retour au réel. « Contre le progressisme qui s'imagine pouvoir dissoudre la pluralité humaine dans une forme d'universalisme juridique ou économique et le conflit politique dans le dialogue et l'ouverture à l'autre ». Sa conception du politique et de l'histoire, son anthropologie même, nous ramènent à Bainville et Maurras. A toute l'école d'Action française. Face à cet épuisement de l'identité européenne - dont le constat nous est familier grâce à Jean-François Mattei - Mathieu Bock-Côté nous conduit, comme jadis Pierre Boutang, à la redécouverte d'une pensée qui sauve. Une pensée des profondeurs qui ressurgit des lointains de notre Histoire. Nous sommes ici dans un paysage familier. Lafautearousseau
 Pendant un bon moment, la figure de Julien Freund (1921-1993) a été oubliée. Il était même absent du Dictionnaire des intellectuels français paru en 1996 au Seuil, sous la direction de Jacques Julliard et Michel Winock, comme si sa contribution à la vie des idées et à la compréhension du monde était insignifiante. Son œuvre n'était pas rééditée depuis 1986. L'ancien résistant devenu philosophe qui refusait les mondanités parisiennes et la vision de la respectabilité idéologique qui les accompagne œuvrait plutôt en solitaire à une réflexion centrée sur la nature du politique, sur la signification profonde de cette sphère de l'activité humaine.
Pendant un bon moment, la figure de Julien Freund (1921-1993) a été oubliée. Il était même absent du Dictionnaire des intellectuels français paru en 1996 au Seuil, sous la direction de Jacques Julliard et Michel Winock, comme si sa contribution à la vie des idées et à la compréhension du monde était insignifiante. Son œuvre n'était pas rééditée depuis 1986. L'ancien résistant devenu philosophe qui refusait les mondanités parisiennes et la vision de la respectabilité idéologique qui les accompagne œuvrait plutôt en solitaire à une réflexion centrée sur la nature du politique, sur la signification profonde de cette sphère de l'activité humaine.
Son souvenir a pourtant commencé à rejaillir ces dernières années. Après avoir réédité chez Dalloz en 2004 son maître ouvrage, L'essence du politique, Pierre-André Taguieff lui consacrait un petit ouvrage remarquablement informé, Julien Freund: au cœur du politique, à La Table Ronde en 2008. En 2010, certains des meilleurs universitaires français, parmi lesquels Gil Delannoi, Chantal Delsol et Philippe Raynaud, se rassemblaient dans un colloque consacré à son œuvre, dont les actes seront publiés en 2010 chez Berg international. Son œuvre scientifique y était explorée très largement.
Mais ce sont les événements récents qui nous obligent à redécouvrir une philosophie politique particulièrement utile pour comprendre notre époque. L'intérêt académique que Freund pouvait susciter se transforme en intérêt existentiel, dans une époque marquée par le terrorisme islamiste et le sentiment de plus en plus intime qu'ont les pays occidentaux d'être entraînés dans la spirale régressive de la décadence et de l'impuissance historique. Freund, qui était clairement de sensibilité conservatrice, est un penseur du conflit et de son caractère insurmontable dans les affaires humaines.
Freund ne croyait pas que l'humanité transcenderait un jour la guerre même si d'une époque à l'autre, elle se métamorphosait. Le conflit, selon lui, était constitutif de la pluralité humaine.
Dans son plus récent ouvrage, Malaise dans la démocratie (Stock, 2016), et dès les premières pages, Jean-Pierre Le Goff nous rappelle ainsi, en se référant directement à Freund, que quoi qu'en pensent les pacifistes qui s'imaginent qu'on peut neutraliser l'inimitié par l'amour et la fraternité, si l'ennemi décide de nous faire la guerre, nous serons en guerre de facto. Selon la formule forte de Freund, « c'est l'ennemi qui vous désigne ». C'est aussi en se référant au concept d'ennemi chez Freund qu'Alain Finkielkraut se référait ouvertement à sa pensée dans le numéro de février de La Nef.
En d'autres mots, Freund ne croyait pas que l'humanité transcenderait un jour la guerre même si d'une époque à l'autre, elle se métamorphosait. Le conflit, selon lui, était constitutif de la pluralité humaine. Et contre le progressisme qui s'imagine pouvoir dissoudre la pluralité humaine dans une forme d'universalisme juridique ou économique et le conflit politique dans le dialogue et l'ouverture à l'autre, Freund rappelait que la guerre était un fait politique insurmontable et que l'accepter ne voulait pas dire pour autant la désirer. C'était une philosophie politique tragique. Mais une philosophie politique sérieuse peut-elle ne pas l'être ?
La scène commence à être connue et Alain Finkielkraut l'évoquait justement dans son entretien de La Nef. Freund l'a racontée dans un beau texte consacré à son directeur de thèse, Raymond Aron. Au moment de sa soutenance de thèse, Freund voit son ancien directeur, Jean Hyppolite, s'opposer à sa vision tragique du politique, en confessant son espoir de voir un jour l'humanité se réconcilier. Le politique, un jour, ne serait plus une affaire de vie et de mort. La guerre serait un moment de l'histoire humaine mais un jour, elle aurait un terme. L'humanité était appelée, tôt ou tard, à la réconciliation finale. Le sens de l'histoire en voudrait ainsi.
Freund répondra qu'il n'en croyait rien et que si l'ennemi vous désigne, vous le serez malgré vos plus grandes déclarations d'amitié. Dans une ultime protestation, Hyppolite dira qu'il ne lui reste plus qu'à se réfugier dans son jardin. Freund aura pourtant le dernier mot : si l'ennemi le veut vraiment, il ira chercher Jean Hyppolite dans son jardin. Jean Hyppolite répondra terriblement : « dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me suicider ». Il préférait s'anéantir par fidélité à ses principes plutôt que vivre dans le monde réel, qui exige justement qu'on compose avec lui, en acceptant qu'il ne se laissera jamais absorber par un fantasme irénique.
Un pays incapable de nommer ses ennemis, et qui retourne contre lui la violence qu'on lui inflige, se condamne à une inévitable décadence.
La chose est particulièrement éclairante devant l'islamisme qui vient aujourd'hui tuer les Occidentaux dans leurs jardins. Les élites occidentales, avec une obstination suicidaire, s'entêtent à ne pas nommer l'ennemi. Devant des attentats comme ceux de Bruxelles ou de Paris, elles préfèrent s'imaginer une lutte philosophique entre la démocratie et le terrorisme, entre la société ouverte et le fanatisme, entre la civilisation et la barbarie. On oublie pourtant que le terrorisme n'est qu'une arme et qu'on n'est jamais fanatique qu'à partir d'une religion ou idéologie particulière. Ce n'est pas le terrorisme générique qui frappe les villes européennes en leur cœur.
On peut voir là l'étrange manie des Occidentaux de traduire toutes les réalités sociales et politiques dans une forme d'universalisme radical qui les rend incapables de penser la pluralité humaine et les conflits qu'elle peut engendrer. En se délivrant de l'universalisme radical qui culmine dans la logique des droits de l'homme, les Occidentaux auraient l'impression de commettre un scandale philosophique. La promesse la plus intime de la modernité n'est-elle pas celle de l'avènement du citoyen du monde ? Celui qui confessera douter de cette parousie droit-de-l'hommiste sera accusé de complaisance réactionnaire. Ce sera le cas de Freund.
Un pays incapable de nommer ses ennemis, et qui retourne contre lui la violence qu'on lui inflige, se condamne à une inévitable décadence. C'est ce portrait que donnent les nations européennes lorsqu'elles s'imaginent toujours que l'islamisme trouve sa source dans l'islamophobie et l'exclusion sociale. On n'imagine pas les nations occidentales s'entêter durablement à refuser de particulariser l'ennemi et à ne pas entendre les raisons que donnent les islamistes lorsqu'ils mitraillent Paris ou se font exploser à Bruxelles. À moins qu'elles n'aient justement le réflexe de Jean Hyppolite et préfèrent se laisser mourir plutôt que renoncer à leurs fantasmes ?
Dans La fin de la renaissance, un essai paru en 1980, Freund commentait avec dépit le mauvais sort de la civilisation européenne: « Il y a, malgré une énergie apparente, comme un affadissement de la volonté des populations de l'Europe. Cet amollissement se manifeste dans les domaines les plus divers, par exemple la facilité avec laquelle les Européens acceptent de se laisser culpabiliser, ou bien l'abandon à une jouissance immédiate et capricieuse, […] ou encore les justifications d'une violence terroriste, quand certains intellectuels ne l'approuvent pas directement. Les Européens seraient-ils même encore capables de mener une guerre » ?
On peut voir dans cette dévitalisation le symptôme d'une perte d'identité, comme le suggérait Freund dans Politique et impolitique. «Quels que soient les groupements et la civilisation, quelles que soient les générations et les circonstances, la perte du sentiment d'identité collective est génératrice et amplificatrice de détresse et d'angoisse. Elle est annonciatrice d'une vie indigente et appauvrie et, à la longue, d'une dévitalisation, éventuellement, de la mort d'un peuple ou d'une civilisation. Mais il arrive heureusement que l'identité collective se réfugie aussi dans un sommeil plus ou moins long avec un réveil brutal si, durant ce temps, elle a été trop asservie ».
Le retour à Freund est salutaire pour quiconque veut se délivrer de l'illusion progressiste de la paix perpétuelle et de l'humanité réconciliée. À travers sa méditation sur la violence et la guerre, sur la décadence et l'impuissance politique, sur la pluralité humaine et le rôle vital des identités historiques, Freund permet de jeter un nouveau regard sur l'époque et plus encore, sur les fondements du politique, ceux qu'on ne peut oublier sans se condamner à ne rien comprendre au monde dans lequel nous vivons. Si l'œuvre de Freund trouve aujourd'hui à renaître, c'est qu'elle nous pousse à renouer avec le réel. •
FigaroVox
Mathieu Bock-Côté
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada.




 Simple question : quels sont les émoluments de monsieur Mazerolle ?
Simple question : quels sont les émoluments de monsieur Mazerolle ? 
 S’il y a une chose qu’on ne reprochera pas à Manuel Valls , c’est de manquer de cynisme. Il a ainsi osé déclarer au Journal du Dimanche du 3 avril : « Je ne pense pas que l’on gagne une présidentielle sur un bilan, ni qu’on la perde sur un bilan. On la perd si on ne se projette pas dans l’avenir, si on n’a pas de vision ».
S’il y a une chose qu’on ne reprochera pas à Manuel Valls , c’est de manquer de cynisme. Il a ainsi osé déclarer au Journal du Dimanche du 3 avril : « Je ne pense pas que l’on gagne une présidentielle sur un bilan, ni qu’on la perde sur un bilan. On la perd si on ne se projette pas dans l’avenir, si on n’a pas de vision ». 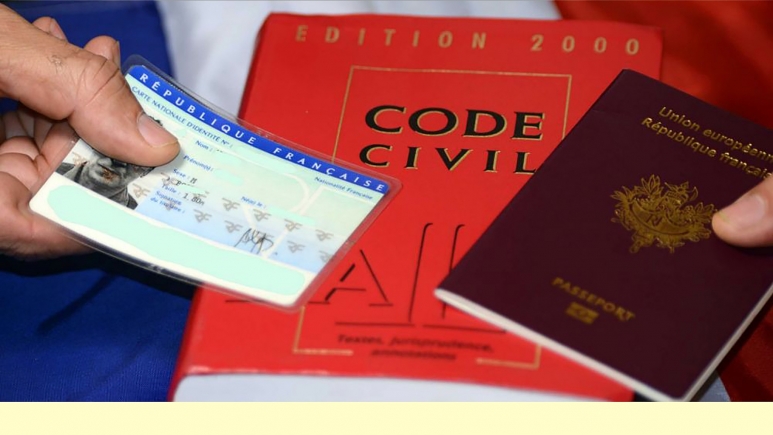
 C’est une plaisanterie bien connue, genre brève de comptoir, sur les responsables politiques dégringolant dans les sondages : ils vont finir par trouver du pétrole… Pour dire le vrai, le destin de François Hollande nous soucie peu. Sans doute parce qu’il n’a rien fait pour qu’on y attachât quelque intérêt, mais surtout parce que nous sommes lassés – avec, quand même, une pointe d’étonnement, malgré notre cuir bien tanné à cet égard – de son étrange obstination à se mettre lui-même hors-jeu. Il n’en demeure pas moins que cette descente aux abîmes nous glace le sang. Pourquoi ? Simplement parce que nous ne pouvons plus ignorer que c’est à notre propre effondrement que nous assistons, comme les passagers d’un avion en perdition dont l’équipage ne parvient plus à arrêter la chute.
C’est une plaisanterie bien connue, genre brève de comptoir, sur les responsables politiques dégringolant dans les sondages : ils vont finir par trouver du pétrole… Pour dire le vrai, le destin de François Hollande nous soucie peu. Sans doute parce qu’il n’a rien fait pour qu’on y attachât quelque intérêt, mais surtout parce que nous sommes lassés – avec, quand même, une pointe d’étonnement, malgré notre cuir bien tanné à cet égard – de son étrange obstination à se mettre lui-même hors-jeu. Il n’en demeure pas moins que cette descente aux abîmes nous glace le sang. Pourquoi ? Simplement parce que nous ne pouvons plus ignorer que c’est à notre propre effondrement que nous assistons, comme les passagers d’un avion en perdition dont l’équipage ne parvient plus à arrêter la chute. 


 Aucune analyse de l’actualité, aucune prévision raisonnable, aucune protestation des populations maltraitées, pressurées, rejetées n’ont jusqu’à présent changé les habitudes politiciennes et l’inconcevable permanence de leur médiocrité. Voilà que la violence absolue surgit... Alors ?
Aucune analyse de l’actualité, aucune prévision raisonnable, aucune protestation des populations maltraitées, pressurées, rejetées n’ont jusqu’à présent changé les habitudes politiciennes et l’inconcevable permanence de leur médiocrité. Voilà que la violence absolue surgit... Alors ?


 Pendant un bon moment, la figure de Julien Freund (1921-1993) a été oubliée. Il était même absent du Dictionnaire des intellectuels français paru en 1996 au Seuil, sous la direction de Jacques Julliard et Michel Winock, comme si sa contribution à la vie des idées et à la compréhension du monde était insignifiante. Son œuvre n'était pas rééditée depuis 1986. L'ancien résistant devenu philosophe qui refusait les mondanités parisiennes et la vision de la respectabilité idéologique qui les accompagne œuvrait plutôt en solitaire à une réflexion centrée sur la nature du politique, sur la signification profonde de cette sphère de l'activité humaine.
Pendant un bon moment, la figure de Julien Freund (1921-1993) a été oubliée. Il était même absent du Dictionnaire des intellectuels français paru en 1996 au Seuil, sous la direction de Jacques Julliard et Michel Winock, comme si sa contribution à la vie des idées et à la compréhension du monde était insignifiante. Son œuvre n'était pas rééditée depuis 1986. L'ancien résistant devenu philosophe qui refusait les mondanités parisiennes et la vision de la respectabilité idéologique qui les accompagne œuvrait plutôt en solitaire à une réflexion centrée sur la nature du politique, sur la signification profonde de cette sphère de l'activité humaine.
 Tout a été déjà écrit. Chaque nouvelle génération doit affronter cette loi d'airain. Et il faut un mélange d'audace et de présomption pour ajouter quand même son propre texte sur la pile. Eugénie Bastié ne manque ni de l'une ni de l'autre. Cette jeune femme a donc choisi d'inscrire son nom sur la liste - déjà longue - des féministes critiques. La tâche est aisée : les femmes peuvent seules critiquer le féminisme - mais la voie est encombrée : de l'inconvénient d'être née à la fin du XXe siècle.
Tout a été déjà écrit. Chaque nouvelle génération doit affronter cette loi d'airain. Et il faut un mélange d'audace et de présomption pour ajouter quand même son propre texte sur la pile. Eugénie Bastié ne manque ni de l'une ni de l'autre. Cette jeune femme a donc choisi d'inscrire son nom sur la liste - déjà longue - des féministes critiques. La tâche est aisée : les femmes peuvent seules critiquer le féminisme - mais la voie est encombrée : de l'inconvénient d'être née à la fin du XXe siècle. Notre auteur touche juste lorsqu'elle pointe: « Le féminisme est devenu le refuge du nouvel ordre moral » ; mais elle ignore qu'il en a toujours été ainsi. Elle vante la féministe à l'ancienne George Sand ; mais on lui rappellera ce qu'en disait Baudelaire : « La femme Sand est le Prudhomme de l'immoralité. Elle a toujours été moraliste. Seulement elle faisait autrefois de la contre-morale. » Elle compare les obsessions grammaticales des féministes à la « novlangue » dans 1984 d'Orwell ; mais les femmes savantes de Molière contrôlaient déjà le langage de ces malotrus de mâles. « J'entends le rire de Beauvoir, et c'est à lui que je dédie ces pages », nous avait-elle lancé en guise de défi au début de son livre. À la fin, malgré ses tentatives talentueuses et culottées, elle a perdu son pari ; et j'entends le rire de Molière, le rire de Baudelaire, le rire de Bossuet, et son fameux rire de Dieu qui rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ; et c'est à eux que je dédie cet article.
Notre auteur touche juste lorsqu'elle pointe: « Le féminisme est devenu le refuge du nouvel ordre moral » ; mais elle ignore qu'il en a toujours été ainsi. Elle vante la féministe à l'ancienne George Sand ; mais on lui rappellera ce qu'en disait Baudelaire : « La femme Sand est le Prudhomme de l'immoralité. Elle a toujours été moraliste. Seulement elle faisait autrefois de la contre-morale. » Elle compare les obsessions grammaticales des féministes à la « novlangue » dans 1984 d'Orwell ; mais les femmes savantes de Molière contrôlaient déjà le langage de ces malotrus de mâles. « J'entends le rire de Beauvoir, et c'est à lui que je dédie ces pages », nous avait-elle lancé en guise de défi au début de son livre. À la fin, malgré ses tentatives talentueuses et culottées, elle a perdu son pari ; et j'entends le rire de Molière, le rire de Baudelaire, le rire de Bossuet, et son fameux rire de Dieu qui rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ; et c'est à eux que je dédie cet article. 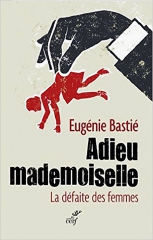
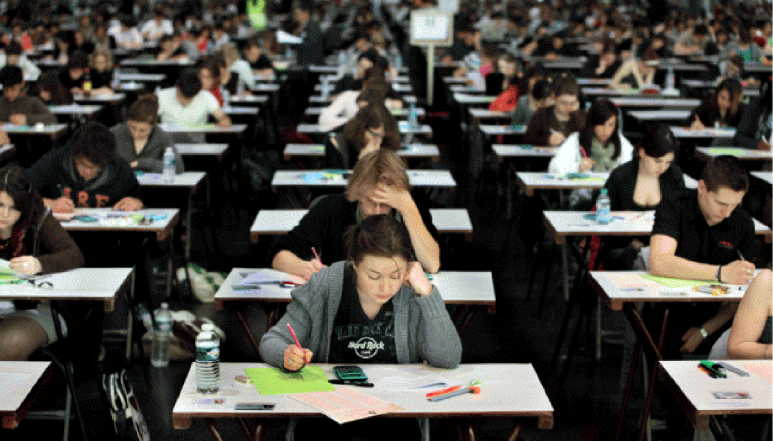
 Deux siècles et demi après son inauguration, l’agrégation est plus que jamais dans la ligne de mire d’une administration égalitariste.
Deux siècles et demi après son inauguration, l’agrégation est plus que jamais dans la ligne de mire d’une administration égalitariste.
 Ce soir, l’amoureux de football que je suis ne regardera pas le match opposant Paris à Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions. Il se trouve que la résiliation de mon abonnement à Canal + ne m’a pas incité à basculer vers la chaîne qatarie BeInSport qui retransmettra le match. Il arrive un moment où il faut mettre ses actes en conformité avec ses convictions. Le football mondialisé de mercenaires que j’exècre repose essentiellement sur les droits télés, et donc sur les abonnements aux chaînes à péage.
Ce soir, l’amoureux de football que je suis ne regardera pas le match opposant Paris à Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions. Il se trouve que la résiliation de mon abonnement à Canal + ne m’a pas incité à basculer vers la chaîne qatarie BeInSport qui retransmettra le match. Il arrive un moment où il faut mettre ses actes en conformité avec ses convictions. Le football mondialisé de mercenaires que j’exècre repose essentiellement sur les droits télés, et donc sur les abonnements aux chaînes à péage.
 Ivan Rioufol, plume bien connue des colonnes du Figaro, revient avec un nouvel essai après De l’urgence d’être réactionnaire en 2012. Le titre, La guerre civile qui vient, est aussi provocateur que le précédent. Là encore, pour l’auteur, il y a urgence : la France – comme l’Europe – est face à un péril comme elle n’en a plus connu depuis longtemps : celui de l’islam radical, le « totalitarisme du XXIe siècle ». Les récents attentats ayant rythmé l’actualité, en France, depuis l’affaire Merah en 2012 jusqu’à ceux de novembre 2015, n’en sont, pourtant, que la sanglante partie émergée.
Ivan Rioufol, plume bien connue des colonnes du Figaro, revient avec un nouvel essai après De l’urgence d’être réactionnaire en 2012. Le titre, La guerre civile qui vient, est aussi provocateur que le précédent. Là encore, pour l’auteur, il y a urgence : la France – comme l’Europe – est face à un péril comme elle n’en a plus connu depuis longtemps : celui de l’islam radical, le « totalitarisme du XXIe siècle ». Les récents attentats ayant rythmé l’actualité, en France, depuis l’affaire Merah en 2012 jusqu’à ceux de novembre 2015, n’en sont, pourtant, que la sanglante partie émergée.
 Depuis 1870 et l'instauration de la République en France, la Révolution a plutôt bonne presse. Le mot lui-même est synonyme universel de progrès, de nécessité, d'avancée, qu'il concerne un nouveau médicament, la mécanisation des outils agricoles ou les régimes alimentaires. Politiquement, il sonne comme une promesse d'avenir radieux : même le maréchal Pétain, instituant pourtant un régime aux accents résolument contre-révolutionnaires, se sentit obligé de reprendre le terme, invitant la France à se lancer dans une « Révolution nationale ». Et nous ne parlons pas d'Hitler et de sa « révolution nationale-socialiste »… Quant à l'événement lui-même, bien que Lénine, Trotski, Mao, Pol Pot et quelques autres dictateurs sanguinaires s'en fussent réclamés à corps et à cris (surtout ceux de leurs millions de victimes), il n'en garde pas moins, dans les livres d'Histoire comme dans la classe politique ou médiatique dominante, auréolé d'un prestige certain. 1789, c'est neuf, donc c'est bien.
Depuis 1870 et l'instauration de la République en France, la Révolution a plutôt bonne presse. Le mot lui-même est synonyme universel de progrès, de nécessité, d'avancée, qu'il concerne un nouveau médicament, la mécanisation des outils agricoles ou les régimes alimentaires. Politiquement, il sonne comme une promesse d'avenir radieux : même le maréchal Pétain, instituant pourtant un régime aux accents résolument contre-révolutionnaires, se sentit obligé de reprendre le terme, invitant la France à se lancer dans une « Révolution nationale ». Et nous ne parlons pas d'Hitler et de sa « révolution nationale-socialiste »… Quant à l'événement lui-même, bien que Lénine, Trotski, Mao, Pol Pot et quelques autres dictateurs sanguinaires s'en fussent réclamés à corps et à cris (surtout ceux de leurs millions de victimes), il n'en garde pas moins, dans les livres d'Histoire comme dans la classe politique ou médiatique dominante, auréolé d'un prestige certain. 1789, c'est neuf, donc c'est bien.