Par Eugénie Bastié
Le 8 mars a été célébré la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Simone de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens ? La philosophe Bérénice Levet déplore - dans un fort intéressant entretien donné à Figarovox [08.03] - qu'il soit devenu aveugle aux nouveaux dangers qui guettent la femme, et notamment le communautarisme islamique.
 Nous célébrons le 8 mars la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens, ou a-t-il au contraire accompli ses promesses ?
Nous célébrons le 8 mars la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens, ou a-t-il au contraire accompli ses promesses ?
Si le féminisme a encore un sens, ce n'est surtout pas celui que lui attachent les néo-féministes, tributaires d'une grille idéologique qui les empêche de se saisir des seuls vrais combats qu'il y aurait encore à mener. L'égalité et la liberté sont acquises pour les femmes en France. Comment peut-on encore parler, ainsi que le font certains, d'un fondement patriarcal de notre société ? Qu'est-ce qu'une société patriarcale ? Une société où la femme dépend entièrement de l'homme, une société où la femme est assignée à résidence et vouée aux tâches domestiques. Or, si ce monde n'est pas tout à fait derrière nous, si patriarcat il y a encore en France, il se rencontre exclusivement dans les territoires perdus de la République. Là, en effet, les principes d'égalité, de liberté, d'émancipation des femmes sont foulés au pied par les hommes. Là, en effet, certaines femmes sont maintenues dans un état de minorité. Mais ce ne sont pas nos mœurs qui sont coupables mais bien l'importation, sur notre sol, de mœurs étrangères aux nôtres. En sorte que si le féminisme a encore un sens, c'est en ces territoires qu'il doit porter le fer or les femmes qui ont le courage de se dresser contre le patriarcat, contre les interdits prescrits par les autorités religieuses, et dont les frères, les fils se font les implacables sentinelles, se retrouvent bien seules.
En dehors d'Elisabeth Badinter, qui sait faire prévaloir l'exigence de vérité et le principe de réalité sur toute idéologie, qui ose nommer les seuls ennemis des femmes aujourd'hui en France ?
Les statistiques sont là pour nous montrer que les inégalités salariales subsistent entre hommes et femmes. La lutte contre les stéréotypes permet-elle selon vous de réduire les inégalités réelles ?
Ne nous laissons pas intimider par le discours ambiant et ces statistiques qu'on ne manque jamais d'exhiber - la seule arme capable d'impressionner à notre époque, disait Hannah Arendt - qui voudraient nous faire croire que les femmes restent d'éternelles victimes de la domination masculine. Vous parlez des inégalités réelles, mais en dehors des inégalités salariales qui en effet persistent, mais dont les femmes triompheront sans tarder et sans qu'il soit nécessaire qu'une quelconque loi intervienne, quels autres exemples pourriez-vous invoquer ? Aucun. Les dernières élections municipales à Paris mettaient aux prises trois femmes et c'est Anne Hidalgo qui dirige la capitale. Qui a été élu à la tête de l'île de France lors des élections départementales de décembre 2015 ? Valérie Pécresse. Le seul parti politique qui puisse s'enorgueillir de gagner des électeurs est dirigé par une femme, Marine Le Pen et a pour figure montante sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. Qui préside à la destinée de France-Culture, de France 2 télévision ou de la Ratp ? Respectivement, Sandrine Treiner, Delphine Ernotte, Elisabeth Borne. Qui vient d'être nommé à la direction du Centre Européen de Recherche Nucléaire ? Fabiola Gianotti. Il faut donc en finir avec cette rhétorique féministe de l'assujettissement.
L'expression « inégalités réelles » que vous avez employée m'évoque la dernière trouvaille sémantique de notre président de la République qui excelle en ce domaine. A la faveur du dernier remaniement ministériel, le chef de l'Etat a ainsi créé un secrétariat d'Etat à l'égalité réelle - on se croit revenu au temps du marxisme et du combat contre l'égalité formelle, il est vrai que François Hollande doit donner des gages à l'aile gauche de son parti et à ses satellites.
Il semble que l'objectif primordial des féministes soit de « mettre la femme au travail » et de lui faire réussir sa carrière. La femme qui n'exerce pas de profession pour éduquer ses enfants appartient elle au passé ?
Tout porte à le croire tant la femme au foyer est aujourd'hui dévalorisée socialement. Les femmes y ont-elles gagné en troquant une injonction contre une autre ? Hier, assignées au foyer, aujourd'hui sommées de travailler…Qu'on me comprenne bien, je ne milite en aucune façon pour un retour des femmes dans la sphère domestique, l'indépendance économique est une immense conquête, elle est la condition même de la liberté. Mais cela ne doit pas nous interdire de nous interroger sur les conséquences quant à l'éducation des enfants, de ce désinvestissement par les deux sexes de l'espace familial.
Avec la naissance, les parents ne donnent pas seulement la vie, ils font entrer l'enfant dans un monde, c'est-à-dire dans un monde vieux, qui le précède, un monde de significations qu'il faut lui transmettre, lui donner à aimer. Il convient donc de l'y escorter, or, requis par leur carrière, leur épanouissement personnel, les parents se sont délestés de cette tâche. « Les parents modernes, écrit le grand sociologue Christopher Lasch, tentent de faire en sorte que leurs enfants se sentent aimés et voulus ; mais cela ne cache guère une froideur sous-jacente, éloignement typique de ceux qui ont peu à transmettre à la génération suivante et qui ont décidé, de toute façon, de donner priorité à leur droit de s'accomplir eux-mêmes ».
La crise de la transmission est telle et la déréliction d'une jeunesse abandonnée à elle-même devient si éclatante, que peut-être y aura-t-il un retour de bâton. Que les parents renoueront avec leur responsabilité de parents. Sinon mieux vaut renoncer à mettre au monde des enfants.
Sous l'impulsion de l'idéologie du genre, il semble que désormais l'horizon du féminisme ne soit plus l'égalité mais l'interchangeabilité…
Le féminisme s'est égaré en adoptant les postulats du Genre. En ratifiant ce petit vocable, en apparence inoffensif, qui s'est imposé afin de marquer une scission parfaite entre le donné biologique et anatomique (que prend en charge le mot sexe) et l'identité sexuée et sexuelle, qui serait purement culturelle (que désigne le mot Genre), le féminisme s'est littéralement désincarné. Rappelons en un mot l'enjeu de cette théorie. « On ne naît pas femme, on le devient » disait Simone de Beauvoir. Le Genre considère que l'auteur du Deuxième sexe est demeurée comme en retrait de sa propre intuition et en poursuit la logique à son terme : si l'on ne naît pas femme, pourquoi le deviendrait-on ? Si l'identité sexuée et sexuelle est sans étayage dans la nature, dans le corps, dans l'incarnation, bref si tout est culturel, pourquoi ne pas s'essayer à tous les codes, jouer de toutes les identités. Les partisans du Genre se grisent ainsi de l'obsolescence de l'identité ou de la « flexibilité sexuelle » (le Gender fluid) dont les grandes marques de luxe seraient les promoteurs au travers de leur collection de mode.
Partant, éduquer différemment son enfant selon qu'il naît dans un corps féminin ou un corps masculin, transmettre les normes, les codes que notre civilisation attache à chacun des deux sexes est assimilée à de l'assignation identitaire, du « formatage ». Que l'humanisation de l'homme ait partie liée avec l'inscription dans une humanité particulière nous est devenu inintelligible, que ces codes, ces significations partagées cimentent une société, nous est indifférent. Le Genre travaille assurément à l'interchangeabilité des deux sexes mais plus énergiquement encore, à la désidentification. La nov-éducation, acquise aux postulats du Genre et promue par notre ministre de l'Education nationale, entend parachever un processus commencé dans les années 1970. Après la désidentification religieuse et la désidentification nationale, il s'agit désormais d'accomplir la désidentification sexuée et sexuelle.
Les féministes ont tardé à s'indigner pour le scandale de Cologne. Au moment où éclatait l'affaire en Allemagne, elles se mobilisaient contre l'absence de femmes dans la sélection du festival d'Angoulême. Que révèle selon-vous ce deux-poids deux mesures ?
Elles ont plus que tardé, elles sont demeurées muettes et quand elles sont sorties de leur silence, elles ont pris le parti de ne pas s'indigner, comme Clémentine Autain, ou alors à front renversé, à l'instar de Caroline de Haas qui a rageusement invité ceux qui avait l'outrecuidance de rendre publics les faits, à aller « déverser leur merde raciste ailleurs ». Ce deux-poids deux-mesures - qu'on se souvienne également du traitement réservé à Dominique Strauss-Kahn - révèle la déroute du féminisme, son incapacité à être au rendez-vous, son inutilité et son irresponsabilité. Une chasse ouverte aux femmes se produit au cœur de l'Europe, - 766 plaintes sont déposées à la police, dont 497 pour agression sexuelle - et les égéries du néo-féminisme restent impassibles.
Leur mutisme tient d'abord, mais la chose a suffisamment été dite, au fait que les prédateurs étaient musulmans et qu'entre deux maux - la violence faite aux femmes et le risque d'alimenter le racisme, de « faire le jeu du Front National », - les néo-féministes n'hésitent pas un instant. Elles sacrifient les femmes. La barbarie peut croître, leur conscience est sauve : elles restent du côté de ceux qu'elles ont définitivement rangés dans le camp des opprimés, des réprouvés, des damnés de la terre.
Leur résistance vient aussi, et ce point me semble décisif bien qu'il ait été peu ou pas relevé, de ce que ces faits les obligeraient à se désavouer elles-mêmes. De quel récit vivent-elles ? De celui de l'éternelle domination des femmes par les hommes. A les suivre, tout resterait à faire, l'égalité, la liberté ne seraient que formelles. Lorsque Kamel Daoud écrit: « Ce que je jalouse dans l'Occident, la seule avance qu'il a comparé à nous, c'est dans le rapport des femmes », elles doivent s'étrangler. Or, si ces événements nous révoltent, c'est pour leur sauvagerie, naturellement, mais non moins pour l'offense faite à nos mœurs en matière de relation homme/femme, des mœurs taillées dans l'étoffe de l'égalité et de la liberté, et notre art de la mixité des sexes : les femmes habitent l'espace public sans hantise de voir les hommes se jeter sur elles comme de proies.
D'aucuns, comme Kamel Daoud ou Claude Habib, ont vu dans le réveillon cauchemardesque de Cologne le symbole d'un choc des civilisations. Partagez-vous ce constat ?
Il faut le dire, ces pratiques barbares ne sont pas même d'un autre âge. L'Occident n'a jamais connu de telles mœurs. Jusqu'au XXe siècle, les femmes étaient certes en état de minorité juridique par rapport à leur époux, mais elles n'étaient pas de la chair livrée à l'hallali des hommes. Les hommes ont été « polis » par les femmes, ils ont appris à dompter le désir que l'autre sexe leur inspire, à emprunter tours et détours. Ils n'ont pas exigé que l'objet de leur concupiscence se voile de la tête au pied pour ne pas céder sans délai à la tentation, ils ont appris les règles de la galanterie. Et dans notre imaginaire, il n'est rien qui évoque les scènes décrites par les victimes de Cologne sinon L'Enlèvement des Sabines tel que peint par Poussin qui a su rendre magistralement les sentiments que les femmes allemandes ont dû éprouver le soir de la Saint-Sylvestre, cette peur panique qui s'empare des femmes prises au piège, dans un guet-apens. Bref, ces actes portent atteinte à l'un des biens les plus précieux de notre civilisation, la condition des femmes.
Nos féministes ne veulent y voir qu'une version, paroxystique certes, d'une menace qui pèserait en permanence sur les femmes. Autrement dit la différence ne serait que de degré, nullement de nature. Or, si ces actes nous terrorisent au sens fort, c'est parce que nous savons qu'ils ne sont pas le fait de quelques hommes particulièrement brutaux et/ou avinés en cette nuit de Saint-Sylvestre, mais qu'ils sont pratiques communes dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient dont ces hommes sont originaires. Ce type d'agression sexuelle de masse a un nom en arabe, Taharrush gamea .Le procès en islamophobie intenté à Kamel Daoud pour avoir eu le courage d'établir un lien entre les agressions sexuelles de Cologne et les mœurs dans lesquelles les agresseurs ont grandi est hautement significatif de la cécité et de l'irresponsabilité à laquelle l'idéologie confine.
Oui il s'agit bien d'un choc des civilisations, et, ce qui me semble capital, rappel de ce que nous sommes une civilisation et une civilisation qui, après avoir été accablée de tous les maux, accusée de tous les péchés, n'a guère à rougir d'elle-même. Rappel également et spécialement sur ce chapitre des relations entre les hommes et les femmes, de ce que toutes les civilisations ne se valent pas. •
Eugénie Bastié
Bérénice Levet est docteur en philosophie et professeur de philosophie à l'Ecole Polytechnique et au Centre Sèvres. Son essai La Théorie du genre, ou le monde rêvé des anges, préfacé par Michel Onfray, vient de paraître en livre de poche.

 « Madame la ministre,
« Madame la ministre,
 Nous célébrons le 8 mars la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens, ou a-t-il au contraire accompli ses promesses ?
Nous célébrons le 8 mars la « journée de la femme ». Trente ans après la mort de Beauvoir, le féminisme a-t-il encore un sens, ou a-t-il au contraire accompli ses promesses ?
 « Oui ou non l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public ? »
« Oui ou non l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public ? » 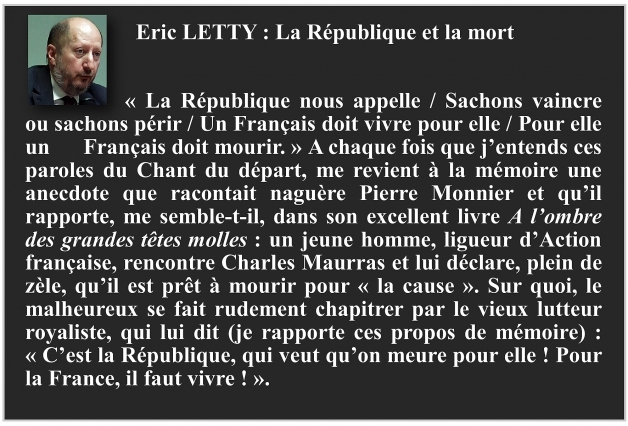

 Politique, si tu parles vrai, agis vrai en mode greffage de couilles
Politique, si tu parles vrai, agis vrai en mode greffage de couilles
 Les quelque douze cent mille signataires présumés de la pétition lancée sur Internet contre les modifications du Code du travail voulues par Manuel Valls, soutenues par Emmanuel Macron, cautionnées par François Hollande et présentées par Myriam El Khomri, les quelques millions de Français qui vont débrayer ou défiler pour manifester leur hostilité à ce projet ont-ils seulement pris la peine de s’en procurer et d’en lire le texte, le connaissent-ils dans le moindre détail, en comprennent-ils toutes les modalités, en mesurent-ils toutes les conséquences ? Évidemment non. Pas plus que leurs parents ou leurs aînés lorsqu’ils manifestaient en 1986 leur hostilité à la loi Devaquet, en 1994 leur opposition au contrat d’insertion professionnelle d’Édouard Balladur, en 1995 à la réforme des régimes spéciaux de retraite proposée par Alain Juppé ou en 2006 au contrat première embauche de Dominique de Villepin, et qu’ils faisaient chaque fois reculer le gouvernement. À chacun son travail et c’est naturellement au législateur qu’il revient normalement, en dernière analyse, de rédiger, d’amender, de corriger ou de repousser un projet de loi.
Les quelque douze cent mille signataires présumés de la pétition lancée sur Internet contre les modifications du Code du travail voulues par Manuel Valls, soutenues par Emmanuel Macron, cautionnées par François Hollande et présentées par Myriam El Khomri, les quelques millions de Français qui vont débrayer ou défiler pour manifester leur hostilité à ce projet ont-ils seulement pris la peine de s’en procurer et d’en lire le texte, le connaissent-ils dans le moindre détail, en comprennent-ils toutes les modalités, en mesurent-ils toutes les conséquences ? Évidemment non. Pas plus que leurs parents ou leurs aînés lorsqu’ils manifestaient en 1986 leur hostilité à la loi Devaquet, en 1994 leur opposition au contrat d’insertion professionnelle d’Édouard Balladur, en 1995 à la réforme des régimes spéciaux de retraite proposée par Alain Juppé ou en 2006 au contrat première embauche de Dominique de Villepin, et qu’ils faisaient chaque fois reculer le gouvernement. À chacun son travail et c’est naturellement au législateur qu’il revient normalement, en dernière analyse, de rédiger, d’amender, de corriger ou de repousser un projet de loi.


 Francis Fukuyama pensait que l’histoire s’achèverait dans un large consensus universel sur la démocratie libérale. Les faits lui ont donné tort : l’histoire continue. Elle semble même s’accélérer dangereusement depuis quelque temps, comme on le lira dans ce numéro de Politique magazine.
Francis Fukuyama pensait que l’histoire s’achèverait dans un large consensus universel sur la démocratie libérale. Les faits lui ont donné tort : l’histoire continue. Elle semble même s’accélérer dangereusement depuis quelque temps, comme on le lira dans ce numéro de Politique magazine.
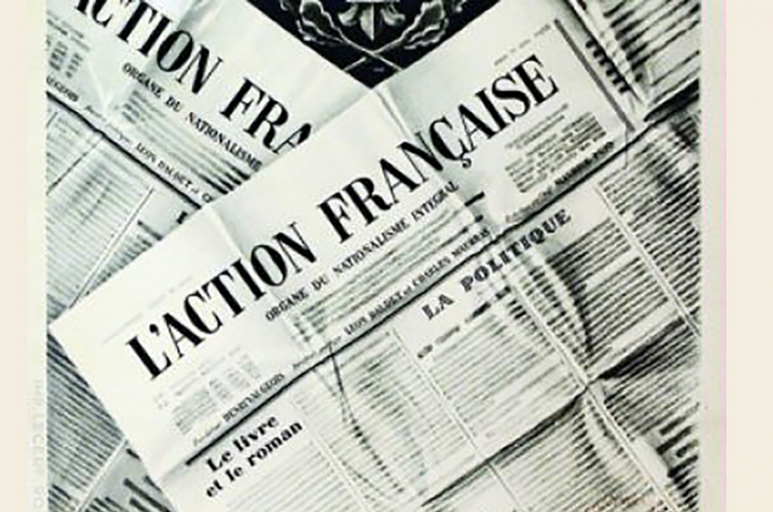
 « Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public ? » Telle est la question fameuse posée par Maurras en 1900 à ses contemporains - et particulièrement aux nationalistes français -, dans son Enquête sur la monarchie. Ces quatre adjectifs sont un excellent moyen de résumer l'ensemble de la doctrine d'Action française.
« Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public ? » Telle est la question fameuse posée par Maurras en 1900 à ses contemporains - et particulièrement aux nationalistes français -, dans son Enquête sur la monarchie. Ces quatre adjectifs sont un excellent moyen de résumer l'ensemble de la doctrine d'Action française.


 Si elle n'a pas lu Modiano, peut-être Fleur Pellerin a-t-elle parcouru Chateaubriand ? Le Vicomte a, en son temps, expérimenté la perte d'un ministère...
Si elle n'a pas lu Modiano, peut-être Fleur Pellerin a-t-elle parcouru Chateaubriand ? Le Vicomte a, en son temps, expérimenté la perte d'un ministère... 
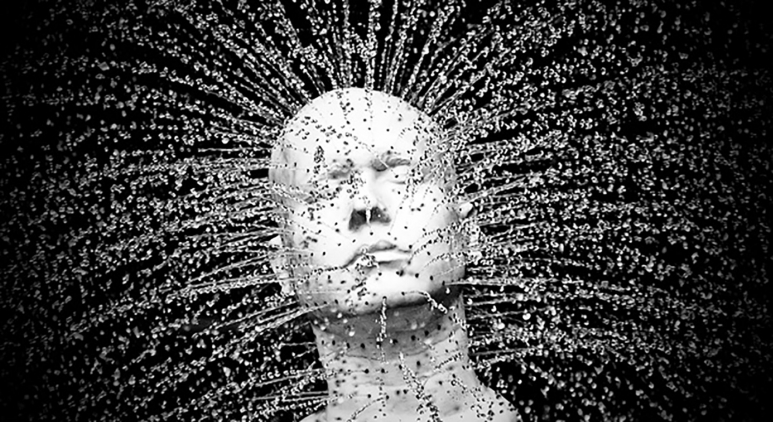
 Une société ne se caractérise pas seulement par ce qu’elle est, mais aussi par ce qu’elle vise. L’homme est un être normatif et chaque société est caractérisée par des « utopies » qui constituent son armature morale et lui donnent une échelle commune de valeurs.
Une société ne se caractérise pas seulement par ce qu’elle est, mais aussi par ce qu’elle vise. L’homme est un être normatif et chaque société est caractérisée par des « utopies » qui constituent son armature morale et lui donnent une échelle commune de valeurs.