Littérature • Joseph Roth : Quand le plus grand romancier autrichien pensait la politique

Les Trotta, père et fils, dans La Marche de Radetsky adaptée pour la télévision
Par Matthieu Baumier
C'est là une excellente recension [Causeur, 17.06] d'un livre qui est décrit comme important et qui nous donne l'occasion d'évoquer ici un très grand auteur autrichien qui nous a passionnés et enchantés depuis quelques décennies. Il dépeint et restitue dans ses principaux ouvrages l'Autriche-Hongrie des Habsbourg et, dans le cas présent, la société berlinoise autour de l'entre-deux-guerres. Un temps où existait une Europe estimable, même si elle se faisait la guerre avec déraison. Un prétexte à lire ou relire La Marche de Radetzsky et sa suite, La Crypte des capucins. LFAR
 Écrit par l’un des plus grands écrivains de langue allemande, Joseph Roth, auteur justement célèbre pour La Marche de Radetzsky, Gauche et Droite est une surprise.
Écrit par l’un des plus grands écrivains de langue allemande, Joseph Roth, auteur justement célèbre pour La Marche de Radetzsky, Gauche et Droite est une surprise.
Quand on rencontre un livre exceptionnel dont on ignorait l’existence, c’est un choc. Gauche et Droite a été publié en Allemagne en 1929, et édité une première fois en France en 2000. Sans bénéficier de l’écho que son brio mérite pourtant. Un grand merci aux Belles Lettres de le rendre de nouveau aisément accessible.
Un monde qui disparaît
Ce livre a paru trois ans avant La Marche de Radetzsky, « roman-monde » par lequel Roth fait vivre de l’intérieur la chute de l’Autriche-Hongrie. Dans les pas d’une famille, au long de trois générations. Un roman qui fait penser, par exemple, de par son ampleur et la place de la famille, à d’autres chefs-d’œuvres comme Les Buddenbrook de Thomas Mann. Roth, c’est un écrivain de cette veine et de cet ordre-là. Il y a quelque chose de ces ambiances, celles d’un monde qui disparaît tandis qu’il était « le » monde : les sociétés bourgeoises germanophones d’Allemagne comme d’Autriche-Hongrie, Vienne et Berlin en somme. Joseph Roth est né en 1894 en Galicie, province austro-hongroise jusqu’à la défaite des Habsbourg durant la Première Guerre Mondiale. Du côté de l’Ukraine actuelle. Mort en 1939 à Paris, il a vécu la charnière d’un siècle mais plus encore, celle d’un monde. La Grande Guerre est ce moment qui voit s’écrouler la « Belle Époque », et plus généralement le monde né du 19e siècle et de la Révolution industrielle. Écroulement particulièrement vif à Berlin et Vienne où il est aussi disparition des empires vaincus. Ce sont des modes de vie qui s’estompent, des mondes engloutis. Et ce sont ces moments que l’écriture de Joseph Roth fait vivre.
Paul et Théodore
Juif de langue allemande, Roth a déjà une dizaine de livres au compteur quand paraît Gauche et Droite. Il est alors à Berlin. La force d’évocation de ce que fut la Mitteleuropa saisit son lecteur, dans ce roman comme dans la suite de son œuvre. L’écriture de Joseph Roth, c’est le ton et la couleur d’un Berlin disparu. Familier, tant le monde englouti dont parle l’écrivain est inscrit en nous, Européens. Et cependant étrange tant cela semble maintenant lointain. À peine un siècle et pourtant… Les grands textes ont peu à voir avec la temporalité, celle de leur écriture comme celle de leur lecture. Parlant de ces hommes d’un Empire disparu, Roth parle aussi de nous : « L’homme est tombé dans un trou et là, prisonnier du vide de son corps, il marche d’un pas lourd à travers la nuit ». Cet homme, c’est nous. Il n’y a pas véritablement de héros dans Gauche et Droite, même si le protagoniste apparemment principal en est Paul Bernheim, évoqué dès la première phrase du roman par un narrateur dont l’on ne saisira l’identité qu’à la toute dernière ligne : « J’ai gardé le souvenir d’une époque où Paul Bernheim promettait de devenir un génie ».
Il y a Paul, son frère Théodore aussi. Ils sont ennemis. Théodore flirte avec le nationalisme allemand völkisch, s’engage même. Il est raciste, antisémite. Paul, de retour de la guerre, fait des affaires, essaie de maintenir une entreprise familiale menacée par le développement d’un capitalisme nouveau fondé sur l’actionnariat. Un capitalisme qui donne le pouvoir économique à des aventuriers comme Brandeis, autre personnage essentiel du roman. Il y a les figures de femmes aussi, la mère, les épouses. Fortes personnalités, loin d’être effacées dans un monde bourgeois où les femmes apprennent à bien distinguer le mariage et l’amour. Une bourgeoisie, une économie familiale ancienne, un Empire s’écroulent, et les hommes anciens sont tenus à bout de bras par des hommes venus de nulle part, mariés à des comédiennes. Des hommes qui font les richesses nouvelles, comme Nikolas Brandeis, émigré russe juif.
Ecriture nostalgique
On peut percevoir de la nostalgie dans l’écriture de Roth. C’est surtout d’observation qu’il s’agit. À travers l’évocation des Bernheim, famille sur le déclin, comme de Berlin, où se situe l’essentiel du roman, Joseph Roth donne une chronique minutieuse de la société allemande et autrichienne de son époque. L’affrontement entre les deux frères Bernheim est aussi le tourbillon politique qui gangrène la République de Weimar. Une époque où un Hitler ou un autre arpentent les brasseries. Un monde traumatisé par la Première Guerre Mondiale, la défaite, l’effondrement. Mais un monde d’effervescence : politique, cinéma, théâtre, presse, cabaret, affaires, actionnariat, montée de la xénophobie, nationalismes… On pense à Jünger, et aux corps francs. Gauche et Droite est un très grand roman de langue allemande, ainsi qu’on peut le dire des romans de Thomas Mann. Et une sacrée belle surprise pour son lecteur. •
Gauche et droite de Joseph Roth (Belles Lettres, 2017 - 14,50 €)
Matthieu Baumier
est essayiste et romancier.

 Peu à peu les hommes émergent du sommeil, la nuit est encore noire, quelques flambeaux dessinent des ombres inquiétantes sur le vieux rempart romain.
Peu à peu les hommes émergent du sommeil, la nuit est encore noire, quelques flambeaux dessinent des ombres inquiétantes sur le vieux rempart romain. 
 Le Parlement égyptien s’est réuni, mardi 13 juin, pour discuter d’une proposition de loi visant à interdire aux parents d’attribuer des prénoms occidentaux à leurs enfants sur l’initiative du député Bedier Abdel Aziz.
Le Parlement égyptien s’est réuni, mardi 13 juin, pour discuter d’une proposition de loi visant à interdire aux parents d’attribuer des prénoms occidentaux à leurs enfants sur l’initiative du député Bedier Abdel Aziz.
 En l'an 494 avant Jésus Christ, les citoyens pauvres de Rome s'estimant bafoués, quittèrent tous la ville et se retirèrent sur la colline de l'Aventin. Cet épisode est connu sous le nom de « Sécession de la plèbe ».
En l'an 494 avant Jésus Christ, les citoyens pauvres de Rome s'estimant bafoués, quittèrent tous la ville et se retirèrent sur la colline de l'Aventin. Cet épisode est connu sous le nom de « Sécession de la plèbe ». 
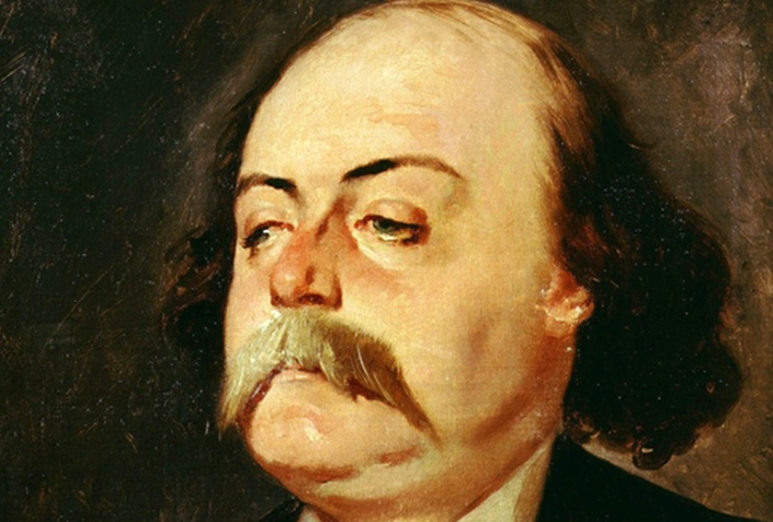

 « Rome, Chartres, Dreux. Trois lieux qui ont en commun d’appartenir à notre patrimoine chrétien, vivant.
« Rome, Chartres, Dreux. Trois lieux qui ont en commun d’appartenir à notre patrimoine chrétien, vivant. Nous étions avec Philomena à Chartres pour la messe solennelle de clôture du pèlerinage de la Pentecôte. Quelle merveille du Moyen-Âge que cette cathédrale. Tout me plait. La voir au loin dans cette Beauce que j’aime, signe du lien tissé en France entre la terre et le ciel. Ses vitraux mis en valeur par les restaurations successives qui ont rendu au chœur tout son éclat. La liturgie de cette messe de clôture sous les bons offices de Monseigneur Pansard, évêque de Chartres, dans une cathédrale pleine à craquer de jeunes gens aux visages marqués par la fatigue, mais heureux. Ces chants du chœur qui s’élèvent sous les hautes voûtes comme un hymne d’action de grâce.
Nous étions avec Philomena à Chartres pour la messe solennelle de clôture du pèlerinage de la Pentecôte. Quelle merveille du Moyen-Âge que cette cathédrale. Tout me plait. La voir au loin dans cette Beauce que j’aime, signe du lien tissé en France entre la terre et le ciel. Ses vitraux mis en valeur par les restaurations successives qui ont rendu au chœur tout son éclat. La liturgie de cette messe de clôture sous les bons offices de Monseigneur Pansard, évêque de Chartres, dans une cathédrale pleine à craquer de jeunes gens aux visages marqués par la fatigue, mais heureux. Ces chants du chœur qui s’élèvent sous les hautes voûtes comme un hymne d’action de grâce.


 Faut-il renoncer aux fondamentaux, demande Lafautearousseau. Non, bien sûr !
Faut-il renoncer aux fondamentaux, demande Lafautearousseau. Non, bien sûr !
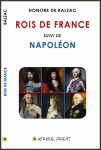


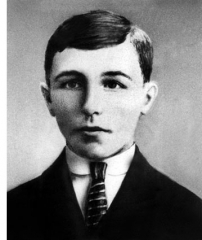 DANS CE CLIMAT, POURQUOI ABATTRE LE FILS DE DAUDET ?
DANS CE CLIMAT, POURQUOI ABATTRE LE FILS DE DAUDET ?

 Le 1er juin dernier, visitant le Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique d’Etel, dans le Morbihan, Emmanuel Macron entend évoquer les différents types d’embarcation utilisés : « Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa » dit quelqu'un. Macron-la-science, croyant peut-être montrer l'étendue de ses connaissances « rebondit », comme on dit chez les journalistes : « Ah non, c’est à Mayotte le kwassa-kwassa ». Effet garanti, l'auditoire est « bluffé », toujours comme on dit chez les journalistes. Mais voilà que « moi-je » ajoute, rigolard : « Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent ». Le silence gêné fait place à l'amusement, devant ce « dérapage », là encore, comme on dit chez les journalistes... Un peu plus tard, on apprenait que le président des Comores exigeait des excuses, que Macron ne fit pas, se contentant d'un coup de téléphone, qualifié d'amical (?)...
Le 1er juin dernier, visitant le Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique d’Etel, dans le Morbihan, Emmanuel Macron entend évoquer les différents types d’embarcation utilisés : « Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa » dit quelqu'un. Macron-la-science, croyant peut-être montrer l'étendue de ses connaissances « rebondit », comme on dit chez les journalistes : « Ah non, c’est à Mayotte le kwassa-kwassa ». Effet garanti, l'auditoire est « bluffé », toujours comme on dit chez les journalistes. Mais voilà que « moi-je » ajoute, rigolard : « Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent ». Le silence gêné fait place à l'amusement, devant ce « dérapage », là encore, comme on dit chez les journalistes... Un peu plus tard, on apprenait que le président des Comores exigeait des excuses, que Macron ne fit pas, se contentant d'un coup de téléphone, qualifié d'amical (?)... On a beaucoup parlé, durant la dernière campagne présidentielle, de la Guyane, où pas loin de la moitié de la population est composée d'étrangers clandestins ; et de Mayotte, où s'est rendu Macron, et où c'est presque la même chose : on ne pourra rien faire là-bas tant que ces personnes ne retrouveront pas leur terre d'origine, et qu'une submersion démographique d'une telle ampleur ruinera à la fois les locaux et immigrants eux-mêmes (c'est d'ailleurs la même chose aussi, bien évidemment, pour la métropole...).
On a beaucoup parlé, durant la dernière campagne présidentielle, de la Guyane, où pas loin de la moitié de la population est composée d'étrangers clandestins ; et de Mayotte, où s'est rendu Macron, et où c'est presque la même chose : on ne pourra rien faire là-bas tant que ces personnes ne retrouveront pas leur terre d'origine, et qu'une submersion démographique d'une telle ampleur ruinera à la fois les locaux et immigrants eux-mêmes (c'est d'ailleurs la même chose aussi, bien évidemment, pour la métropole...). 
 Il n'est ni dans notre vocation ni dans nos habitudes de nous ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Nous avons du reste bien assez à faire comme cela en nous occupant seulement de notre tâche centrale : faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de rétablir dans sa vigueur passée notre chère France, que le Système déclasse inexorablement depuis 1875.
Il n'est ni dans notre vocation ni dans nos habitudes de nous ingérer dans les affaires intérieures d'un pays souverain. Nous avons du reste bien assez à faire comme cela en nous occupant seulement de notre tâche centrale : faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de rétablir dans sa vigueur passée notre chère France, que le Système déclasse inexorablement depuis 1875.

