Culture • Loisirs • Traditions
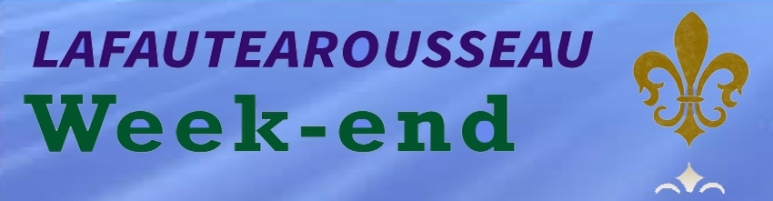
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
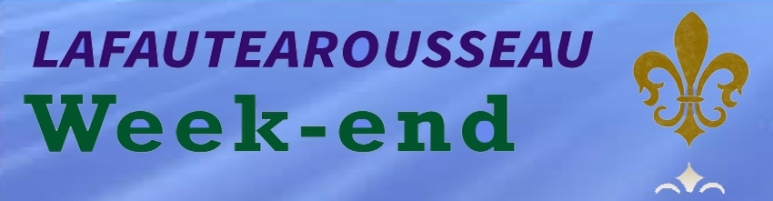



Par Mathieu Bock-Côté
 Dans cette tribune du Journal de Montréal [25.12] Mathieu Bock-Côté invite les sociétés occidentales à « assumer ce qu’on pourrait appeler les marqueurs identitaires les plus profonds de notre civilisation », notamment le christianisme et particulièrement l'héritage catholique. L'Eglise catholique elle-même ne nous y invite plus avec autant de netteté. Volens nolens, cet héritage demeure pourtant un marqueur fondamental de notre identité. LFAR
Dans cette tribune du Journal de Montréal [25.12] Mathieu Bock-Côté invite les sociétés occidentales à « assumer ce qu’on pourrait appeler les marqueurs identitaires les plus profonds de notre civilisation », notamment le christianisme et particulièrement l'héritage catholique. L'Eglise catholique elle-même ne nous y invite plus avec autant de netteté. Volens nolens, cet héritage demeure pourtant un marqueur fondamental de notre identité. LFAR

Dans un monde menacé par un islam politique particulièrement militant, certains esprits anachroniques sentent encore le besoin de sonner la charge contre le catholicisme, comme s’il fallait enfin en finir avec lui. C’est le cas d’une Femen qui s’est jetée sur la crèche du Vatican lundi matin pour s’emparer de la statue de l’Enfant Jésus en dénonçant le travers sexiste du catholicisme. Le procès est entendu : l’Église catholique est encore assignée au mauvais rôle, et les médias, globalement, aiment l’y maintenir, comme si elle représentait une survivance anachronique dans le monde moderne. Il faut lutter contre le catholicisme comme s’il demeurait le principal obstacle avant l’avènement d’un nouveau monde pour de bon délivré de la tradition. Chaque fois qu’on l’humiliera, on applaudira, d’autant plus que l’orthodoxie diversitaire aime mettre toutes « les religions » dans le même sac dès qu’il est question de l’émancipation féminine, ce qui permet de ne pas réfléchir à la question bien particulière de l’islam.
Il est difficile de ne pas mettre en relation cette intervention des Femen avec l’absurde censure d’un film de Noël dans une école française quand les enseignants ont compris qu’il n’était pas sans lien avec les origines de cette fête et se sont empressés de l’arrêter en plein milieu. Pour reprendre l’explication loufoque rapportée par les journalistes qui ont rendu publique cette histoire, « il ne s'agit pas d'un film sur une légende de Noël mais sur l'histoire de la nativité ». On se demandera si celui qui a dit ça est complètement bête ou simplement de mauvaise foi. La scène est quand même d’une invraisemblable stupidité. On veut bien croire que la fête de Noël est aujourd’hui déchristianisée, au point même d’être neutralisée dans de plus vastes « fêtes de fin d’année », mais il n’en demeure pas moins que si l’histoire a ses droits, on conviendra au moins de ses origines chrétiennes. Faut-il désormais censurer toute mention des racines chrétiennes de l’Occident pour ne pas froisser les tenants de l’orthodoxie diversitaire et les représentants les plus intransigeants des religions non-chrétiennes ? Les Américains, sans se tromper, parlent depuis des années d’une guerre contre Noël.
Plusieurs l’ont noté, le remplacement du traditionnel Joyeux Noël par Joyeuses Fêtes s’inscrit, consciemment ou inconsciemment, dans ce processus de déchristianisation de la culture. En 2009, les commerçants du Plateau Mont-Royal, à Montréal, avaient cru trouver la formule la plus inclusive qui soit pour ne vexer personne en souhaitant « Joyeux Décembre ». La formule était incroyablement ridicule mais montrait jusqu’où peut aller la censure du réel pour ne pas heurter les sensibilités minoritaires exacerbées qui hurlent à la discrimination dès qu’on redécouvre que toutes les religions n’ont pas laissé la même empreinte sur notre civilisation. Il y a dans le monde occidental un zèle déconstructeur qui pousse à vouloir éradiquer toutes les traces du christianisme, comme si on espérait un jour le chasser du décor et l’effacer de la vie publique : la diversité pourrait alors s’exprimer et le christianisme serait privé de ses derniers privilèges. On a pu le constater il y a quelques semaines encore avec l’affaire de la croix de Ploërmel, qu’on a prétendu condamner au nom de la laïcité alors qu’il s’agissait surtout de pousser plus loin la neutralisation de l’identité historique de la France. Un jour pour ne plus heurter personne, faudra-t-il changer de calendrier ?
Sommes-nous encore dans un monde au moins partiellement chrétien ? Telle est la question. Il ne s’agit pas de savoir si nous croyons personnellement à la religion catholique, mais si nous assumons ce que Pierre Manent appelle la « marque chrétienne » de notre civilisation – c’est-à-dire que le catholicisme a servi de matrice civilisationnelle au monde occidental et qu’on ne peut nous y arracher complètement sans mutiler notre propre identité. On oublie aussi qu’on peut parfaitement assumer cette marque chrétienne et l’idée de laïcité, aussi fondamentale que nécessaire – les deux ne sont contradictoires que pour ceux qui peinent à réconcilier les différentes facettes d’une même civilisation. Il faut une certaine excentricité intellectuelle, en fait, aujourd’hui, pour croire que c’est le catholicisme qui menace la laïcité et qui cherche à occuper de nombreuses manières l’espace public en y faisant sentir de manière de plus en plus agressive sa présence.
Une question essentielle surgit : comment maintenir vivant un patrimoine de civilisation marqué par le christianisme quand la foi qui l’alimentait est morte, ou du moins, complètement déculturée et pratiquée sérieusement seulement dans les marges ? Il faut, pour cela, amener la philosophie politique à réfléchir aux conditions mêmes de possibilité de notre civilisation. Il ne s’agit plus seulement de réfléchir au régime politique de la cité mais à la conception de l’homme sur laquelle elle repose – sur son anthropologie, pour le dire autrement. Cela implique aussi de dégager notre compréhension du politique d’un présentisme asséchant en renouant avec une conception historique de la communauté politique, qui fasse droit à la part sacrée de l’appartenance à la cité. En d’autres mots, on peut ressaisir le christianisme à travers un patriotisme de civilisation qui n’impose à personne quelque foi que ce soit mais qui réinscrit le politique dans l’histoire en se tenant loin de la tentation de la table-rase. L’art politique a davantage à voir avec l’histoire qu’avec la gestion.
On y revient alors : ce n’est pas en déconstruisant elles-mêmes leur propre socle de civilisation que les sociétés occidentales sauront vraiment se montrer à la hauteur des exigences de l’hospitalité. Au contraire, plus elles se renient et moins ceux qui les rejoignent peuvent vraiment les aimer. La haine de soi ne fait rêver personne, le nihilisme non plus. Il ne s’agit pas de fantasmer sur je ne sais quelle reconfessionnalisation de l’État ou d’idéaliser de quelque manière que ce soit la parole du Pape ou d’autres officiels du monde catholique mais simplement d’assumer ce qu’on pourrait appeler les marqueurs identitaires les plus profonds de notre civilisation : la cité ne saurait être une simple structure juridique sans épaisseur historique et culturelle. Elle plonge ses racines dans le cœur de l’homme et ne saurait se fermer aux besoins fondamentaux de l’âme humaine. Mais pour plusieurs, aujourd’hui, cette simple évidence passe étrangement pour un scandale. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007), de Le multiculturalisme comme religion politique (éd. du Cerf, 2016) et de Le Nouveau Régime (Boréal, 2017).

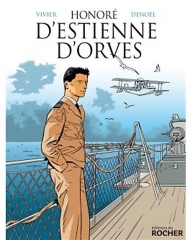 Rencontre en images avec un officier de Marine pionnier de la Résistance.
Rencontre en images avec un officier de Marine pionnier de la Résistance.
Issu d'une famille royaliste, Honoré d'Estienne d'Orves (1901-1941) fut un pionnier de la Résistance. « Libre dans ses idées, il refuse de se soumettre face à la défaite, à contre-courant de l'opinion dominante
», souligne son petits-fils, Augustin, en introduction d'une bande dessinée qui lui est consacrée. Au fil des pages, le lecteur est ballotté d'une période à l'autre, au risque, parfois, de s'y perdre un peu. Le héros nous livre lui-même ses souvenirs, accompagnant des images souvent sans dialogue.
ÉDUQUÉ DANS LA FOI
« Je reçois une éducation qui fait la part belle à la famille, à la France, à la foi, mais aussi aux arts et à la curiosité intellectuelle
», raconte-t-il notamment. Formé à l'école Polytechnique, il entre dans la Marine en 1923. Quand sonne le glas de l'armistice, tandis qu'il sert en Égypte, la flotte n'est-elle pas intacte ? Du moins l'était-elle jusqu'au drame de Mers el-Kebir… « Après ce massacre, je ne pouvais plus accepter de rallier l'armée anglaise
», explique-t-il. Quelques mois plus tard, cependant, il est accueilli à Londres par l'amiral Muselier, chef des Forces navales françaises libres. En décembre 1940, il revient en France, où il installe une liaison radio. Trahi, il est arrêté et condamné à mort, suscitant le respect de ses juges. Le 29 août 1941, à l'heure de son exécution, il donne l'accolade à un officier allemand :« nous avons fait tous les deux notre devoir
», lui dit-il devant des soldats ébahis.
NÉCESSAIRE PÉDAGOGIE ?
Le dessin n'est pas des plus détaillé. Quant à la police utilisée, elle n'est pas particulièrement lisible. Par ailleurs, était-il bien nécessaire de préciser dans une note de bas de page ce que furent la Grande Guerre ou la bataille d'Angleterre ? Peut-être cette BD est-elle destinée aux plus jeunes… On regrettera que l'amiral Darlan y soit présenté comme le chef d'un gouvernement « collaborationniste
» ; la plupart des historiens ne parlent-ils pas plutôt de « collaboration
» ? Ces réserves mises à part, la publication de cette BD relève d'une heureuse initiative. •
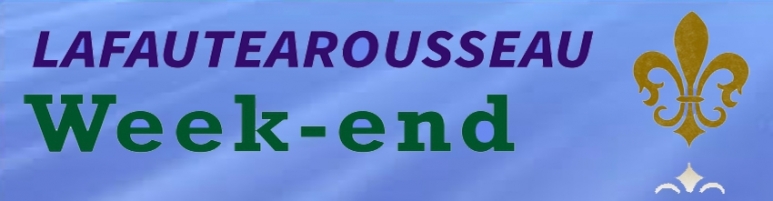

Par Paul-François Schira
 Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe [Figarovox, 28.12]. Il analyse en fait, bien plus encore, la crise de notre démocratie - de plus en plus formelle - et celle des sociétés post-modernes. S'il nous le permet, nous lui dirions que pour former le « nous » - qu'il souhaite - et non pas seulement le « je » ou le « moi » dont il dresse la juste critique, la France - plus peut-être que d'autres nations - a toujours eu besoin d'une « incarnation » à sa tête. Une incarnation pérenne qui lui soit consubstantielle et ne résulte pas d'une élection. D'où notre attachement au principe dynastique qui rend encore bien des services dans d'autres pays. Le « plus de politique » qu'il nous faut, le voilà ! Lafautearousseau
Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe [Figarovox, 28.12]. Il analyse en fait, bien plus encore, la crise de notre démocratie - de plus en plus formelle - et celle des sociétés post-modernes. S'il nous le permet, nous lui dirions que pour former le « nous » - qu'il souhaite - et non pas seulement le « je » ou le « moi » dont il dresse la juste critique, la France - plus peut-être que d'autres nations - a toujours eu besoin d'une « incarnation » à sa tête. Une incarnation pérenne qui lui soit consubstantielle et ne résulte pas d'une élection. D'où notre attachement au principe dynastique qui rend encore bien des services dans d'autres pays. Le « plus de politique » qu'il nous faut, le voilà ! Lafautearousseau
Les Français se désintéressent-ils de leur pays ?
D'un côté, les baromètres de la confiance tenus par le Cevipof font figurer avec constance « la méfiance, le dégoût et l'ennui » dans les sentiments que ressentent les Français à l'égard de la politique. La fin de cette grande année électorale confirme ce désengagement : taux d'adhésion aux partis traditionnels en berne, incapacité du parti au pouvoir, En Marche !, de fédérer une base militante dans la durée, tout ceci dans le cadre d'une baisse régulière des taux de participation aux élections politiques de ce pays.
De l'autre, les mêmes baromètres notent que seuls moins de 10% des Français ne s'intéressent pas du tout à la politique. Il faut voir les foules qui se pressent aux journées du patrimoine, ou l'engouement suscité par les œuvres puisées dans l'histoire et la géographie nationales ! Immense soif de transmission, d'appartenance.
D'où vient ce paradoxe ?
C'est peut-être, en première approche, la scène politique qui nous a désolés, avec ses acteurs opportunistes jouant leurs gammes pour tirer à eux les applaudissements des médias. Les « affaires », bien sûr, n'arrangent pas les choses. On s'écœure du comportement égocentré de ces hommes politiques, dont 90% des Français estiment qu'ils ne se préoccupent pas du tout de ce que pensent les citoyens.
Mais dès lors que l'homme a toujours été homme, mélange de sublime et de mesquin, attiré par convoitise autant que par noblesse vers le pouvoir, pourquoi cette personnalisation malsaine de la politique nous semble-t-elle accentuée aujourd'hui ?
Peut-être, en deuxième approche, parce que le spectacle des ambitions personnelles remplit un vide : celui de la pensée et de l'action commune.
Le vide de la pensée et de l'action commune prend la forme d'un discours raisonnable. Ce discours transforme en finalités politiques les certitudes qui relèvent de l'ordre des moyens. Il semble nous signifier que l'amour de notre pays ne vaut plus grand chose dans la « vraie vie », celle de la « complexité d'un monde globalisé en pleine mutation ». Ces mutations - mondialisation, innovation, concurrence, flux financiers ou migratoires - sont posées comme inéluctables, univoques et irrésistibles ; si c'est au politique de les organiser efficacement, on abandonne aux individus, plus ou moins talentueux, le soin de leur donner un sens, ou de se faire écraser par elles - moyennant quelques allocations.
La politique devient alors l'apanage de quelques techniciens, et se réduit à un simple divertissement « people » à l'égard du commun des mortels. C'est la forme impériale de la gouvernance qui réapparaît, et qui détruit ce lent travail de maturation qui, de Capet à De Gaulle, a façonné notre peuple et nos institutions pour former la nation.
La nation n'est pas l'empire, ce territoire infini sur lequel une maison conquérante exerce une domination - par la coercition ou la séduction - à l'égard de ses ressources et sur ses sujets. Elle n'est pas un espace indéfini, mais un lieu particulier ; ce ne sont pas des multitudes de sujets qui y vaquent à leurs occupations, mais un peuple qui y séjourne ; ce n'est pas un lien de domination qui les tient, mais un lien d'appartenance qui s'ancre dans une culture partagée, et qui se projette dans le monde par l'expression d'une volonté commune.
Entre les universalismes religieux de Rome et politique de Charles Quint puis des Habsbourg, la France s'est constituée en nation afin de créer un corps vivant autonome, suffisamment cohérent, dont l'angoissante quête de stabilité interne l'a rendue disposée à orienter, à peser sur et à donner du sens aux événements qui lui étaient extérieurs.
La nation se résume en un cri: «nous voulons». Ce cri suppose un «nous» en même temps qu'un «voulons». C'est le propre de la conjugaison que d'accoler le sujet à l'action, car c'est elle qui donne du sens au langage. Il faut un nous, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, pour générer la confiance nécessaire à l'exercice d'une volonté. Il faut aussi une volonté, c'est-à-dire le sentiment de donner un sens à l'appartenance, pour qu'il y ait un nous. Les deux sont indissociables.
Or à quoi assistons-nous aujourd'hui? A la dissolution du « nous », certes ; mais à la disparition du « voulons », surtout. Les deux phénomènes sont simultanés ; mais, des deux, il me semble que c'est le second qui doit jouer, dans la prise de conscience collective, le rôle de la poule. La crise de l'identité n'est que le symptôme de ce que l'on commence à ne plus savoir pour quoi, en vue de quelle finalité, nous sommes « nous ».
L'efficacité à la place du sens
Il est frappant de remarquer combien bon nombre de programmes politiques se focalisent essentiellement sur la question des moyens, rarement sur celle des finalités. Ils ne concernent bien souvent que la machinerie de l'Etat dont il faudrait déboucher les tuyaux, comme si une entreprise communiquait moins sur le service qu'elle rendait que sur sa manière de le rendre. Il faut rationaliser la dépense ; optimiser les recettes ; être transparent ; numériser ; simplifier ; communiquer avec pédagogie.
L'horizon politique est remplacé par l'horizon administratif : on fait le prélèvement à la source, parce que c'est plus efficace ; et on supprimera à terme le foyer fiscal, parce qu'on a fait le prélèvement à la source. Peut-on encore s'interroger sur le sens que peut avoir un système déclaratif fiscal, ou sur celui que prend le principe d'imposition par foyer ? Un modèle s'effondre au nom de l'efficacité sans que sa finalité ne soit clairement débattue. D'où ce sentiment d'être ballottés au gré d'une catallaxie court-termiste, cette agrégation de comportements spontanés sans vision d'ensemble dont la totalité peut aboutir, mais on s'en rend compte trop tard, à une soustraction du bien-être global.
Cette perte du sens politique au profit de l'administration des choses est due à la circonstance que l'on assimile la volonté commune au totalitarisme, dont le meilleur antidote serait l'individualisme. Hormis l'organisation efficace des moyens (les procédures juridiques, l'économie de marché), la postmodernité a fait le pari rassurant de rendre le politique aussi neutre que possible et de l'expurger de toute finalité autre que la promotion des individus.
Nulle fin de l'histoire tranquille dans cette sortie du politique, mais plutôt un retour au chaos de l'état de sauvagerie. Le refus de concevoir même qu'il existe un commun qu'il reviendrait à l'homme de servir, c'est l'âge du narcissisme, où l'on se sert dès lors qu'on a les moyens de le faire ; où l'on cherche à retirer quelque chose du commun, plutôt que d'y ajouter ; où l'on ne cultive plus la retenue de soi laissant libre le champ du travail partagé, mais où l'on se répand aussi loin qu'on puisse aller. Lorsque la seule finalité admise, c'est la liberté de chacun sous réserve de la liberté d'autrui, alors l'espace commun se privatise, et ne se réduit plus qu'à la fine membrane qui sépare deux individus: « l'autre » devient par définition une irritation, qu'il faut manipuler, détruire, ou, dans le meilleur des cas, subir.
Les institutions, la culture, la civilisation censées élever ces comportements perdent toute leur légitimité dès lors qu'elles se réduisent au droit et au marché, c'est-à-dire à l'organisation optimale de rapports de forces. Les chocs d'idées deviennent des chocs de personnes dès lors que ces dernières ne conçoivent plus le lieu de leur demeure commune: c'est le terreau sur lequel se nourrissent les antiques promesses de fusion communautaire recherchant l'utopique homogénéité, culturelle ou religieuse, d'individus semblables agrégés en une sorte de lobby d'intérêts.
Le sentiment actuel des Français ne doit donc pas être pris pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas parce que la France serait une vieille dame, la nation un cadre obsolète, le patriotisme un sentiment arriéré, que les Français s'éloignent de la politique. Mais, en revanche, c'est parce que les Français s'éloignent de la politique en n'y voyant plus qu'un désolant divertissement que la France risque de devenir une vieille dame, la nation un cadre obsolète, le patriotisme un sentiment « so 1945 ».
L'indifférence marquée à l'égard du système électoral, et le succès de la proposition d'En Marche ! de dépasser les clivages gauche/droite qui en a été son corollaire, ne sont pas un plébiscite en faveur du Grand Jeu planétaire. Penser que tel est le cas, c'est prendre la conséquence d'un phénomène pour sa cause. Et cette confusion nous livre un enseignement : nous sommes tentés de nous désintéresser de la politique non parce que nous ne croyons plus en notre pays, ni même parce que les acteurs du monde politique ne font que semblant d'y croire, mais parce que nous oublions que les premiers acteurs du monde politique, c'est nous-mêmes : recréer le commun, retrouver l'honneur de le servir, relève, dans nos vies quotidiennes, familiales, associatives ou professionnelles, de notre propre responsabilité. Si nous en avons marre de la politique, c'est en fait parce qu'il nous en faut davantage. •
Paul-François Schira est haut fonctionnaire et maître de conférences à Sciences-Po

Par Guilhem de Tarlé
L’Échange des princesses, un film de Marc Dugain, avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Andréa Ferréol, Anamaria Vartolomei, Juliane Lepoureau et Catherine Mouchet, d’après le roman éponyme de Chantal Dumas (éd. du Seuil, 2013).
Sans doute, je regrette de n’avoir pas lu le roman dont a été tiré le film, mais ce très bon long-métrage me rappelle l’excellent Marie-Caroline, reine de Naples, publié en 2014 par Amable de Fournoux (ed. Pygmalion), qui retrace aussi l’importance de ces mariages princiers dans le gouvernement des monarchies.
Dans un décor majestueux, on ouvre une page d’Histoire peu glorifiante sur ces petites filles qu’on gère comme des marchandises – certes très précieuses, mais marchandises quand même - dont l’unique raison d’être – là encore très précieuse – est de garantir une descendance au Roi et d’assurer ainsi la continuité de l’État.
Difficile de distinguer dans ce récit la part de la vérité et celle de la fiction, la part de l’Histoire et celle du roman. J’ai ressenti par moment un certain féminisme qui pourrait paraitre justifié dans notre société de l’enfant-roi… ces petites princesses sont peut-être appelées à être Reines dans différents pays, mais elles ne sont pas reines dans leurs familles !
Contre ces « mariages forcés » - qu’on le veuille ou non, même si j’ai du mal à l’écrire, c’en sont - le réalisateur fait la part belle aux mœurs du « mariage pour tous » et, à tort ou à raison, donne une très mauvaise image du duc Louis IV Henri de Bourbon-Condé.
Bref un film à voir, très intéressant, mais peu amène pour ces familles royales, à l’exception de la charmante petite infante d’Espagne et aussi de la Princesse Palatine, mère du Régent. •

 Que le sermon de Noël du pape François ait contenu des passages propres à provoquer le scandale, ce qui n'est gère douteux, ne nous empêchera pas de garder envers le Souverain Pontife le ton et le respect dûs au chef d'une Eglise qui pendant tant de siècles a façonné notre Civilisation. Cela ne nous empêchera pas davantage de dire notre désapprobation de son propos au soir de Noël.
Que le sermon de Noël du pape François ait contenu des passages propres à provoquer le scandale, ce qui n'est gère douteux, ne nous empêchera pas de garder envers le Souverain Pontife le ton et le respect dûs au chef d'une Eglise qui pendant tant de siècles a façonné notre Civilisation. Cela ne nous empêchera pas davantage de dire notre désapprobation de son propos au soir de Noël.
Nous n'imiterons pas le pape François lorsqu'il empiète sur le terrain politique : nous n'entrerons pas dans l'exégèse théologique ...
Cependant, comme la plupart des Français, nous connaissons suffisamment les évangiles pour savoir que Joseph et Marie se rendant de Nazareth à Bethléem pour s'y faire recenser n'y sont pas présentés comme des migrants mais comme des voyageurs. Ils obéissent en l'espèce non pas directement à la loi de Dieu, des prêtres ou des rabbins, mais au pouvoir politique, en l'occurrence celui de l'empereur romain, païen ; les Ecritures ne disent pas non plus, nous semble-t-il, qu'ils ont été rejetés par les gens de Bethléem mais qu'ils ont dû être logés dans une grotte attenante à la salle commune où simplement il n'y avait plus de place. Quant à la fuite en Egypte, elle est celle d'une famille de trois personnes ; pas de millions de réfugiés ou de migrants ; elle est de courte durée avec esprit de retour des trois réfugiés dans leur patrie sitôt le danger passé. Elle n'a rien à voir en tout cas avec une migration massive de peuplement.
On ne peut pas faire reproche au pape de prêcher la charité personnelle aux fidèles catholiques. On peut en revanche s'opposer comme citoyens à ses empiétements dans le domaine politique qui est celui des peuples et des gouvernants.
Remercions donc le Saint-Père, si nous sommes chrétiens, de nous inviter à la charité ; mais portons à sa connaissance en tant que membres de la communauté française que nous avons déjà accepté de recevoir chez nous un très grand nombre d'étrangers, sans nul doute un beaucoup trop grand nombre ; que nous en avons payé chèrement le prix ; que, même, nous devrions nous préoccuper d'organiser le retour dans leur pays d'origine d'un grand nombre d'entre eux indésirables chez nous ; et qu'en conséquence, nous ne sommes nullement disposés à en recevoir de nouveaux contingents ; enfin que cette politique relève de notre souveraineté et non, en l'espèce, de la sienne.
Rassurons les catholiques : ce langage n'est ni iconoclaste ni nouveau. C'est celui que nos rois tenaient aux papes lorsqu'ils prétendaient intervenir dans les affaires de la France. Cela non plus, d'ailleurs, n'est pas nouveau. •
Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien ci-dessous

Par Mathieu Bock-Côté
 Dans cette tribune du Journal de Montréal [28.12] Mathieu Bock-Côté dit des propos du pape - mieux sans-doute et autrement - la même chose que nous. [Voir article précédent]. La charge du pape François en faveur de l'immigration, au soir de Noël, ne vise en fait que l'Europe. Peut-être surtout, comme on le dit, la catholique Pologne. Mais aussi la France, sans aucun doute. Gardons présent à l'esprit qu'en matière politique, en tout ce qui touche au Bien Commun de notre patrie, nous sommes - ou devrions être - seuls souverains. LFAR
Dans cette tribune du Journal de Montréal [28.12] Mathieu Bock-Côté dit des propos du pape - mieux sans-doute et autrement - la même chose que nous. [Voir article précédent]. La charge du pape François en faveur de l'immigration, au soir de Noël, ne vise en fait que l'Europe. Peut-être surtout, comme on le dit, la catholique Pologne. Mais aussi la France, sans aucun doute. Gardons présent à l'esprit qu'en matière politique, en tout ce qui touche au Bien Commun de notre patrie, nous sommes - ou devrions être - seuls souverains. LFAR

Depuis quelques années, le pape François a multiplié les déclarations invitant l’Occident à s’ouvrir aux vagues migratoires.
Entre les vrais réfugiés et les migrants économiques, il ne distingue pas vraiment : il ne veut voir qu’une misère humaine réclamant qu’on lui porte secours. Même s’il fait quelques nuances, il invite globalement les Européens à accueillir avec le sourire ceux qui entrent chez eux sans même frapper à la porte.
Occident
Il lui importe peu que les Européens se sentent submergés : ils doivent faire un effort supplémentaire de charité pour ne pas renier leur humanité.
C’est dans cet esprit qu’il a récemment comparé les migrants à Jésus et ses parents. On comprend le message : qui ferme la porte aux migrants la ferme au Christ.
On comprend que, pour le pape, un bon chrétien ne saurait jamais s’opposer à l’immigration massive qui transforme l’Europe démographiquement.
Lorsqu’il est question du pape, les médias occidentaux pratiquent l’écoute sélective. Lorsqu’il parle de religion, ils s’en fichent. Mais lorsqu’il plaide pour la dissolution des frontières, ils lui donnent le titre de grand sage et nous invitent à suivre ses conseils.
C’est qu’il radicalise le préjugé sans-frontiériste dominant chez nos élites économiques et médiatiques.
En gros, l’Occident serait devenu riche en pillant la planète et il serait normal qu’aujourd’hui, il se fasse pardonner en accueillant sans rechigner les déshérités du monde entier. Cette vision de l’histoire est fausse et déformée, mais elle monopolise la conscience collective.
Du haut de son magistère, le pape fait la morale sans trop s’intéresser aux conséquences pratiques de cette révolution migratoire. Il y a là une terrible irresponsabilité.
Dans un livre essentiel paru début 2017, Église et immigration : le grand malaise, le journaliste français Laurent Dandrieu, lui-même catholique, décryptait la pensée du pape et, plus globalement, de l’Église, autour de cette question. Il observait une inquiétante indifférence de l’Église devant le droit des peuples à conserver leur identité.
Au-delà des déclarations du pape François, on doit constater que l’immigration massive est probablement le grand enjeu de notre époque. Ce sont des masses humaines qui se mettent en mouvement.
Le phénomène ne date pas d’hier : depuis le début des années 1980, on s’en inquiète, mais personne n’ose le maîtriser, et pour cela, il prend de l’ampleur.
Responsabilité
Et on aura beau sermonner les peuples occidentaux en leur expliquant que la diversité est une richesse, ils se sentent néanmoins bousculés, dépossédés. S’ils veulent bien accueillir un certain nombre de malheureux, ils ne peuvent accueillir pour autant toute la misère du monde.
Les vagues migratoires des dernières années ont quelque chose de traumatisant. On entre illégalement et massivement en Europe. Les pays sont incapables de faire respecter leurs frontières. Leurs équilibres sociaux et culturels sont compromis. Les tensions identitaires augmentent.
L’immigration est une question explosive. Et les irresponsables qui accusent de xénophobie ceux qui voudraient mieux la contrôler et faire respecter les frontières enveniment la situation. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007), de Le multiculturalisme comme religion politique (éd. du Cerf, 2016) et de Le Nouveau Régime (Boréal, 2017).

 DÉBAT - Après un départ de quinquennat mitigé sur plan de la popularité, le président de la République Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Fait-il un sans-faute à la tête de l'État ? Zemmour affirme non sans raison : « Macron a compris ce qu'était un roi élu en France ». Ce qui n'empêche qu'il n'est pas un roi véritable. Lequel, comme Macron l'avait diagnostiqué en 2016, manque toujours à la France. [RTL 22.12].
DÉBAT - Après un départ de quinquennat mitigé sur plan de la popularité, le président de la République Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Fait-il un sans-faute à la tête de l'État ? Zemmour affirme non sans raison : « Macron a compris ce qu'était un roi élu en France ». Ce qui n'empêche qu'il n'est pas un roi véritable. Lequel, comme Macron l'avait diagnostiqué en 2016, manque toujours à la France. [RTL 22.12].
La rédaction numérique RTL
Dans les sondages Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans l'estime des Français. Pour expliquer ce regain presque historique de popularité Nicolas Domenach l'affirme : « Emmanuel Macron a rehaussé la fonction de président de la République ».
Le chef de l'État a "fait preuve d'autorité, selon l'éditorialiste de RTL, et il a réussi à faire revenir optimisme et progrès. « Le déclinisme prôné par Zemmour a été renversé cul par-dessus tête ». Éric Zemmour confirme un point soulevé par son contradicteur, Emmanuel Macron a bien rehaussé la fonction présidentielle.
Mais c'était facile selon lui : vu « les deux clowns que l'on avait avant, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui n'ont jamais été présidents ». D'après Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy « c'était de Funès » et François Hollande était « fagoté comme Bourvil ». « On avait La Grande Vadrouille et là on a de nouveau un président ».

 L'Observatoire de l'Europe [23.12] nous a fait connaître cette « Déclaration de Paris » que, malgré sa longueur, nous publions in extenso en raison de son importance. Elle rejoint notre propre souci d'une vraie Europe que notre opposition aux actuelles institutions européennes et à leur idéologie, ne saurait faire passer au second plan. Certes, nous aurions à discuter bien des points de cette déclaration, nombre de formulations vagues ou imprécises. Le débat est ouvert. Son inspiration d'ensemble mérite toute notre attention et sous de nombreux aspects notre approbation. Lafautearousseau
L'Observatoire de l'Europe [23.12] nous a fait connaître cette « Déclaration de Paris » que, malgré sa longueur, nous publions in extenso en raison de son importance. Elle rejoint notre propre souci d'une vraie Europe que notre opposition aux actuelles institutions européennes et à leur idéologie, ne saurait faire passer au second plan. Certes, nous aurions à discuter bien des points de cette déclaration, nombre de formulations vagues ou imprécises. Le débat est ouvert. Son inspiration d'ensemble mérite toute notre attention et sous de nombreux aspects notre approbation. Lafautearousseau
« Une Europe en laquelle nous pouvons croire » : la vibrante déclaration de Paris signée par des universitaires, penseurs et intellectuels de réunis à Paris veut rompre avec la double imposture de la « fausse Europe » : le supranationalisme et le multiculturalisme. Les signataires ont pris acte de la faillite idéologique de l'UE actuelle et du risque pour l'Europe, en minant ses nations à laisser s'évanouir sa grande civilisation. Mais plutôt que de se torturer d'angoisses stériles et d'ajouter encore un autre volume à la littérature abondante sur « le déclin de l'Occident «, ces penseurs européens ont préféré exprimer positivement et solennellement leur attachement à ce qu'ils dénomment « la vraie Europe «, cachée sous les abstractions à la mode et l'idéologie de notre époque. Cette Déclaration de Paris est un appel retentissant pour une compréhension renouvelée et une appréciation du véritable génie de l'Europe. C'est une invitation aux peuples d'Europe à retrouver activement ce qu'il y a de meilleur dans notre héritage commun et à construire ensemble un avenir de paix, d'espoir et de dignité.
La Déclaration de Paris
1. L’Europe nous appartient et nous appartenons à l’Europe. Ces terres constituent notre maison, nous n’en avons aucune autre. Les raisons pour lesquelles nous chérissons l’Europe dépassent notre capacité à expliquer ou justifier cette fidélité. C’est une affaire d’histoires communes, d’espérances et d’amours. C’est une affaire de coutumes, de périodes de joie et de douleur. C’est une affaire d’expériences enthousiasmantes de réconciliation, et de promesses d’un avenir partagé. Les paysages et les événements de l’Europe nous renvoient des significations propres, qui n’appartiennent pas aux autres. Notre maison est un lieu où les objets nous sont familiers et dans laquelle nous nous reconnaissons, quelle que soit la distance qui nous en éloigne. L’Europe est notre civilisation, pour nous précieuse et irremplaçable.
Notre maison.
2. L’Europe, dans sa richesse et grandeur, est menacée par une vision fausse qu’elle entretient d’elle-même. Cette fausse Europe se voit comme l’aboutissement de notre civilisation, mais, en réalité, elle s’apprête à confisquer les patries. Elle cautionne une lecture caricaturale de notre histoire, et porte préjudice au passé. Les porte-étendards de cette fausse Europe sont des orphelins volontaires, qui conçoivent leur situation d’apatrides comme une noble prouesse. La fausse Europe se targue d’être le précurseur d’une communauté universelle, qui n’est ni une communauté, ni universelle.
Une fausse Europe nous menace.
3. Les partisans de cette fausse Europe sont envoûtés par les superstitions d’un progrès inévitable. Ils croient que l’Histoire est de leur côté, et cette foi les rend hautains et dédaigneux, incapables de reconnaître les défauts du monde post-national et post-culturel qu’ils sont en train de construire. Dès lors, ils sont ignorants des vraies sources de la décence humaine. Ils ignorent et même répudient les racines chrétiennes de l’Europe. Simultanément, ils prennent bien soin de ne pas froisser les musulmans, censés adopter joyeusement leur perspective laïque et multiculturelle. Noyée dans ses superstitions et son ignorance, aveuglée par des visions utopiques et prétentieuses, cette fausse Europe étouffe toute dissidence – au nom, bien sûr, de la liberté et de la tolérance.
La fausse Europe est utopique et tyrannique
4. Nous entrons dans une voie sans issue. La plus grande menace pour l’avenir de l’Europe n’est ni l’aventurisme de la Russie ni l’immigration musulmane. L’Europe véritable est menacée par l’étau suffocant dont cette fausse Europe nous écrase. Nos nations, et notre culture partagée, se laissent exténuer par des illusions et des aveuglements à propos de ce qu’est l’Europe et ce qu’elle devrait être. Nous prenons l’engagement de résister à cette menace pour notre avenir. Nous défendrons, soutiendrons et nous nous ferons les champions de cette Europe véritable, cette Europe à laquelle en vérité nous appartenons tous.
Nous devons protéger l’Europe véritable.
5. L’Europe véritable attend et encourage la participation active dans le projet commun de vie politique et culturelle. L’idéal européen est un idéal de solidarité fondé sur le consentement à un corps juridique appliqué à tous, mais limité dans ses exigences. Ce consentement n’a pas toujours pris la forme d’une démocratie représentative. Cependant, nos traditions de fidélité civique, quelles qu’en soient les formes, reflètent un assentiment fondamental à nos fondements culturels. Par le passé, les Européens se sont battus pour rendre nos systèmes politiques plus ouverts à la participation collective, et nous sommes humblement fiers de cette histoire. En dépit des modalités qu’ils ont utilisées, parfois à travers la rébellion générale, ils ont affirmé haut et fort qu’en dépit de leurs injustices et de leurs échecs, les traditions des peuples de ce continent sont les nôtres. Notre vocation réformatrice fait de l’Europe un séjour où l’on recherche toujours plus de justice. Notre esprit de progrès prend racine dans notre amour pour notre terre natale et notre fidélité à son égard.
La solidarité et la loyauté civique encouragent la participation active.
6. Un esprit européen d’unité nous incite à nous faire confiance dans l’espace public, même quand nous ne nous connaissons pas. Les parcs publics, les places et les larges avenues des villes et métropoles européennes racontent l’esprit politique européen : nous partageons notre vie commune et la res publica. Nous partons du principe qu’il est de notre devoir d’être responsables pour l’avenir de nos sociétés. Nous ne sommes pas des sujets passifs, sous la domination de pouvoirs despotiques, qu’ils soient religieux ou laïques. Nous ne sommes pas non plus couchés devant d’implacables forces de l’Histoire. Etre européen signifie posséder un pouvoir politique et historique. Nous sommes les auteurs de notre destin partagé.
Nous ne sommes pas des sujets passifs.
7. L’Europe véritable est une communauté de nations. Nous avons nos propres langues, traditions et frontières. Néanmoins, nous avons toujours reconnu une affinité des uns pour les autres, même quand nous étions en désaccords, voire même en guerre. Cette unité-dans-la-diversité nous parait naturelle. Cette affinité est remarquable et précieuse, car elle ne va pas de soi. La forme la plus commune d’unité-dans-la-diversité est l’empire, que les rois guerriers européens ont tenté de recréer après la chute de l’Empire romain. L’attrait d’une forme impériale a perduré, bien que le modèle de l’Etat-nation ait pris le dessus : cette forme politique lie le peuple à la souveraineté. L’Etat-nation dès lors est devenu la caractéristique principale de la civilisation européenne.
L’Etat-nation est la marque de fabrique de l’Europe.
8. Une communauté nationale s’enorgueillit toujours d’elle-même, a tendance à se vanter de ses prouesses nationales dans tous les domaines, et entre en compétition avec les autres nations, parfois sur le champ de bataille. Les concurrences nationales ont blessé l’Europe, parfois gravement, mais n’ont jamais compromis notre unité culturelle. On peut même constater le contraire. A mesure que les Etats européens s’établissaient distinctement, une identité commune européenne se renforçait. De la terrible boucherie des deux guerres mondiales du XX° siècle, nous sommes sortis encore plus résolus à honorer notre héritage commun. C’est là le témoignage d’une civilisation profondément cosmopolite : nous ne cherchons une unité d’empire forcée ou imposée. Au contraire, le cosmopolitisme européen reconnaît que l’amour patriotique et la loyauté civique débouchent sur un horizon plus large.
Nous ne soutenons pas une unité imposée et forcée.
9. L’Europe véritable a été façonnée par le Christianisme. L’empire universel spirituel de l’Eglise a conféré une unité culturelle à l’Europe, sans passer par un empire politique. Cela a permis le déploiement de fidélités civiques au sein d’une culture européenne partagée. L’autonomie de ce que nous appelons la société civile est devenue une caractéristique fondamentale de la vie européenne. De plus, l’Evangile chrétien ne nous apporte pas un système de lois d’origine divine. Aussi la diversité des lois séculaires des nations peut-elle être proclamée et honorée sans remettre en cause l’unité européenne. Ce n’est pas un hasard si le déclin de la foi chrétienne en Europe a correspondu aux efforts renouvelés pour étblir une unité politique, un empire de la finance et un empire de normes, arguant de sentiments pseudo-religieux universels, en passe d’être construite par l’Union Européenne.

Par Edouard de Saint Blimont
Récemment, deux économistes ont donné une conférence à l’Ecole de guerre intitulée Le Jour d’après - le titre est évocateur - sur l’inéluctable crise économique qui vient, du fait notamment de l’effondrement de la démographie des pays occidentaux. Il convient donc, ont-ils souligné, que nos gouvernements s’engagent dans une politique nataliste vigoureuse, qu’ils ne rognent pas le budget de la défense car ce monde en crise sera nécessairement turbulent et qu’ils préparent les cerveaux à affronter « le jour d’après ». Si sur les deux premiers points, les acteurs politiques sont loin du compte, les mesures éducatives prises par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, ne vont-elles pas dans le bon sens ?
Demi-mesures ?
Celles-ci semblent bien tourner la page du laxisme et de l’anarchie promues en principe de politique éducative par Belkacem. Elles manifestent d’abord le souci de restaurer l’ordre et la discipline : les portables qui transforment quotidiennement les élèves en autistes resteront dans les casiers, le port de l’uniforme est sérieusement évoqué et le redoublement serait à nouveau institué. Le ministre laisse le soin aux acteurs locaux de décider ou pas de la pertinence des activités périscolaires. Le travail est remis à l’honneur et les mesures prises rompent avec le vieux fantasme socialiste d’une école qui serait surtout un lieu de vie : les classes bilangues sont rétablies, l’enseignement du latin et du grec à nouveau promu, on veillera même à ce que les devoirs soient faits.
Certes, on pourra toujours considérer qu’en recherchant surtout le consensus, le ministre sape ces mesures dans leur fondement. Deux exemples : le port de l’uniforme qu’il faudrait imposer par voie d’autorité serait laissé à la libre décision des établissements mais alors si la diversité vestimentaire subsiste, l’uniforme cesse d’uniformiser ! On pourrait croire que l’opération devoirs faits invaliderait définitivement la thèse de ceux qui voulaient supprimer les devoirs à la maison au motif que ceux-ci amplifient les inégalités. En réalité, si les circulaires considèrent que les devoirs sont indispensables à une qualité de l’apprentissage … elles donnent aussi raison à « ceux qui y voient un risque d’accroissement des inégalités sociales. » C’est pourquoi, on les fera dans l’établissement. Le ministre pose ainsi des actes mais en laissant la possibilité au camp adverse de les discuter. Libéralisme quand tu nous tiens ! Ces mesures ont cependant pour elles d’introduire la possibilité d’une autre logique éducative.
Neurosciences vs considérations sociologiques.
Si Jean-Michel Blanquer souhaite obtenir le consensus sur des mesures qui répugnent à la sensibilité de gauche des acteurs éducatifs, il aspire en même temps à imposer comme une vérité transcendant tout débat les mesures en matière de lecture et d’orthographe. Exit la méthode globale : on remet à l’honneur la méthode syllabique. On a assez badiné avec l’orthographe. Dorénavant, une dictée par jour. Pour en convaincre définitivement les enseignants, le ministre s’appuie sur les travaux de Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Ce dernier, chargé de présider le conseil scientifique de l’Education nationale, considère qu’un apprentissage de la lecture par la méthode syllabique facilite très tôt le déchiffrement en libérant le cerveau pour d’autres tâches : « ce n’est que lorsque le décodage des mots devient automatique que l’enfant peut se concentrer sur le sens du texte », affirme Dehaene. Les recherches de Dehaene prouvent ainsi que la méthode syllabique est un instrument plus approprié que la méthode globale pour permettre à l’enfant d’acquérir des compétences authentiques en lecture. Blanquer rassure : il s’agit de convaincre, pas d’imposer.
Retour du scientisme ? s’effraient les sociologues qui considèrent que cette approche revient à transformer l’enfant en rat de laboratoire, en faisant l’impasse sur sa psychologie, le contexte social dans lequel il se trouve, contexte qui détermine son désir d’apprendre. Lelièvre, Lussault, Meirieu, dont les inspirateurs sont, entre autres, les marxisants Bourdieu et Passeron, reviennent en force dans le débat pour défendre des positions dont la logique mène à l’inexorable abaissement du niveau.
Quelle issue ?
Il n’est donc pas certain que le mammouth se remette si facilement en marche. On peut craindre qu’il ne connaisse à nouveau un « grand hiver », pour reprendre le titre du beau roman d’Ismaël Kadaré, si ceux qui ont contribué à son perpétuel enlisement ne reprennent in fine le pouvoir, en faisant valoir que leur position est plus humaine que celle des neurosciences. Il est vrai qu’on ne peut faire valoir la suprématie des thèses neurocognitives si, dans le même temps, on admet la possibilité pour des thèses alternatives, pour ne pas dire contraires, de faire valoir leur point de vue. Il est urgent de sortir du consensus ou d’une logique strictement scientifique pour s’arrimer à une analyse philosophique qui fera apparaître les tenants de la pédagogie moderne pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des imposteurs, coupables d’avoir fait régresser les écoliers de France. Pour cela, il est urgent de définir les voies d’un redressement. Un ultime exemple le fera comprendre : Jean-Michel Blanquer veut qu’on donne à nouveau des repères chronologiques en histoire. Certes, mais à quoi servent les repères si on ne définit pas une direction ? On le sait mieux avec les travaux de Paul Ricoeur, qui constitue une référence pour Emmanuel Macron : la narration historique s’effectue en lien étroit avec les attentes du présent. Or quelles sont-elles aujourd’hui pour nous, chrétiens soucieux de préserver notre civilisation des dérives qui la menacent ? Préserver notre civilisation de l’aventure islamique ? On lira alors avec profit Aristote au Mont Saint Michel de Sylvain Gouguenheim qui effectue une mise au point salutaire : ce sont les penseurs chrétiens qui ont été dans l’histoire les dépositaires, les traducteurs et les passeurs de la pensée grecque, sans laquelle notre civilisation ne serait ce qu’elle est. Les « penseurs » musulmans n’y sont pour rien. Veut-on écarter définitivement le spectre de la résurgence d’une révolution dévastatrice ? Tournons-nous vers Stéphane Courtois qui dresse la figure monstrueuse de Lénine ou vers François Furet qui insiste sur les aberrations de 1789.
Ce sont des travaux de savants… au même titre que ceux de Stanislas Dehaene, dans son domaine. J.M Blanquer serait bien inspiré de demander aux auteurs de manuels (puisqu’il favorise leur retour) d’intégrer les leçons de ces scientifiques pour construire un récit national qui nous soit enfin profitable. Et puis, cela nous évitera de tomber dans la stupide commémoration de 68 qu’on nous prépare. •

 Nous avons appris avec peine le décès d'Alain Bourrit, membre de longue date de l'Action française.
Nous avons appris avec peine le décès d'Alain Bourrit, membre de longue date de l'Action française.
 Il avait rejoint l'Union Royaliste Provençale peu avant Mai 68, à Marseille, où il a passé sa vie. Alain Bourrit était professeur de lettres, sa culture était vaste, ses centres d'intérêt variés. A la fin des années 60, il avait participé au camp Maxime Real del Sarte. Il a animé à Marseille et dans la région de nombreux cercles d'études ; il participait aux rassemblements royalistes de Montmajour et des Baux de Provence ; il y a quelques années encore, il avait donné plusieurs conférences aux Cafés politiques de Lafautearousseau [Photo ci-contre] : l'on en trouve trace sur Viméo.
Il avait rejoint l'Union Royaliste Provençale peu avant Mai 68, à Marseille, où il a passé sa vie. Alain Bourrit était professeur de lettres, sa culture était vaste, ses centres d'intérêt variés. A la fin des années 60, il avait participé au camp Maxime Real del Sarte. Il a animé à Marseille et dans la région de nombreux cercles d'études ; il participait aux rassemblements royalistes de Montmajour et des Baux de Provence ; il y a quelques années encore, il avait donné plusieurs conférences aux Cafés politiques de Lafautearousseau [Photo ci-contre] : l'on en trouve trace sur Viméo.
Nous perdons un vieil ami dont nous garderons le souvenir fidèle. Lafautearousseau et l'Union Royaliste Provençale présentent à son épouse et à sa famille leurs amicales condoléances.
Alain Bourrit était Camelot du Roi.
Rendez-vous ce jour à 15 heures au funérarium du cimetière Saint-Pierre, à Marseille.

Par François Marcilhac

On savait Emmanuel Macron disciple du philosophe Paul Ricœur. On ignorait qu’il était, en même temps, adepte de l’école péripatéticienne.
Aristote déambulait en dissertant avec ses disciples dans les allées du Lycée ; notre président déambule dans les couloirs de l’Élysée, entouré de caméras, pour répondre aux questions complaisantes d’un journaliste de la télévision d’État, le tout enregistré le mardi pour être diffusé le dimanche suivant. On n’est jamais trop prudent ! En marche… vers feu l’ORTF ? Il ne s’agit que d’une anecdote, mais elle en dit long sur cet art de la communication qui, inauguré sous Giscard, a remplacé la parole régalienne. Certes, il n’y a rien à retenir de ce vrai-faux entretien déambulatoire. Sinon qu’il faudra encore attendre deux ans pour espérer voir la courbe du chômage s’inverser – Hollande, sors de ce corps ! Qu’il est temps de rattraper notre retard en matière d’énergies renouvelables et qu’on peut compter sur lui pour voir partout surgir de terre des éoliennes défigurant le paysage. Qu’ayant fait le don de sa personne à la France, il fait « le maximum pour
[nous] protéger, pour éviter que les conflits n’adviennent, pour préparer
[notre] avenir commun, pour préparer le meilleur futur
». Ou encore, « que d’ici mi, fin-février, on aura gagné la guerre en Syrie
» – Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont été soulagés de l’apprendre.
Le culte du Moi
Pourquoi cet entretien maintenant ? Alors que jamais la France n’a été aussi inégalitaire, comme l’a montré une passionnante enquête récemment publiée dans Le Monde, l’exécutif est en hausse dans les sondages, dans une période calme, c’est vrai, de discussion budgétaire, dont les décisions, bientôt définitivement votées, n’ont évidemment pas encore pu faire sentir leurs effets, surtout sur les classes moyennes. Macron joue sur le front international, plus consensuel car plus éloigné des Français, tandis que le Gouvernement fait dans la com’ : envers la « France périphérique
», en se déplaçant à Cahors, économique et identitaire, en annonçant durcir la lutte contre les faux réfugiés. Peut-être Macron a-t-il jugé nécessaire, à la veille de nouvelles réformes, de focaliser les caméras sur sa personne, dans un exercice sidérant de culte du Moi. Apprentissage, formation professionnelle et assurance chômage, asile et immigration, réforme des institutions, sans oublier les dossiers néo-calédonien et corse, la décision sur Notre-Dame-des-Landes ou la rupture démagogique avec un consensus vieux de quarante-cinq ans sur le 90 km/h sur route : Macron veut continuer d’aller vite en 2018 et a besoin pour cela de saturer l’espace pour apparaître comme le deus ex machina des maux de la France. Ce que confirme encore cet anniversaire fêté à Chambord, le château construit par François Ier, le « prince architecte
», après la victoire de Marignan. Ne cessant de singer la fonction royale, dans l’espoir que les Français soient dupes, et déjà maître des horloges, Macron se pense aussi en nouvel architecte de la France. Voire en sauveur de la planète au moment où nous sommes, paraît-il, en train de perdre la lutte contre le réchauffement climatique, comme Superman l’a seriné lors du raout écologique et financier international (« One Planet Summit
» dans le texte) qu’il avait réuni à Paris la semaine dernière.
Car la France ou les affaires internationales ne sont jamais, pour lui, que l’occasion de parler de lui-même. Le propos le plus révélateur de son entretien sur France 2, d’un point de vue clinique s’entend, a été : « [Les Français] ont décidé en mai dernier d’élire un président de trente-neuf ans qui sortait de nulle part. La France a stupéfait
[sic] l’Europe et le monde par son choix.
» Macron serait donc, de son propre aveu, une personnalité stupéfiante. Quant à « sortir de nulle part
», à moins que l’Inspection des finances, la banque Rotschild, le secrétariat général de la Présidence de la République ou le ministère de l’Économie ne soient « nulle part
», Macron, peut, en effet apparaître comme un homme neuf ! Au sens non pas romain de l’homo novus, bien qu’il le soit en un certain sens, mais plus prosaïque de celui qui n’aurait aucune responsabilité dans les politiques conduites avant son arrivée. Ce qui est évidemment un mensonge. Deux exemples parmi tant d’autres : outre le bradage de notre industrie – secrétaire général puis ministre de l’Économie, il a livré la branche énergie d’Alstom aux Américains, avant de livrer, devenu président de la République, sa branche transports aux Allemands –, il était au secrétariat général de la Présidence, chargé, qui plus est, des questions fiscales, quand a été concocté ce « scandale d’État
» (dixit son successeur Bruno Le Maire à Bercy) qu’est la taxe sur les dividendes des grandes entreprises, mise en oeuvre sous Hollande et déclarée inconstitutionnelle ; facture pour l’État : 10 milliards d’euros. Une enquête interne l’a évidemment blanchi.
La recette autrichienne
Alors, stupéfiant, Macron ? En tout cas moins modeste qu’un jeune chancelier autrichien, le plus jeune dirigeant du monde, pour le coup – il a trente et un ans – qui, sans penser avoir stupéfié le monde, lui, réussit en quelques semaines ce que Merkel, avec toute son expérience, ne réussit plus en Allemagne : former une coalition. Il est vrai que c’est avec les populistes du FPÖ, qui ont obtenu pour la première fois trois ministères régaliens – Intérieur, Défense et Affaires étrangères –, alors que l’Autriche présidera le Conseil de l’Union européenne au second semestre 2018. Paris, avec sa morgue habituelle – Macron avait déjà donné des leçons à la Pologne –, compte sur le respect des sacro-saintes « valeurs européennes
» par l’Autriche. Loiseau, la ministre de l’Europe, y sera même « très attentive
».
Occasion de nous interroger sur les grandes manœuvres qui agitent la “droite” française au lendemain de la victoire de Wauquiez, que Macron a particulièrement ciblé, lors de son soliloque déambulatoire, car il sait que la vraie menace pourrait venir du retour d’une droite de conviction, dont Wauquiez semble, à tort ou à raison, l’incarnation. Seul un avenir, qu’on peut supposer proche, car Wauquiez aura bientôt à prendre des décisions tranchantes en matière de positionnement idéologique, nous dira si le costume n’est pas trop grand pour cet ancien bébé Barrot, que sa large victoire à la tête de son parti avec un taux de participation honorable devrait inciter à jouer la carte d’une droite qui n’a plus peur de son ombre et ne cherche plus, inlassablement, son droit moral à l’existence dans le jugement léonin d’une gauche dont l’empire idéologique commence, seulement, à s’effriter après avoir failli sur les plans où elle était la plus attendue, économique et social. Mais renverser plusieurs décennies de honte de soi ne sera pas aisé. Si nous assistons, comme le montre le succès d’un récent dictionnaire, à un retour du conservatisme, le caractère ambigu d’un tel phénomène n’est pas sans interroger. La victoire de Macron au printemps dernier en est le signe : s’il s’est fait élire au nom d’un progressisme assurément ringard, c’est qu’il a su instrumentaliser le besoin de dégagisme en assimilant le personnel politique sortant, dont il fait pourtant partie, à un passé politicien lui-même identifié au conservatisme, au profit d’une société civile qui n’est qu’un slogan. Lorsque la bulle Macron éclatera, seule une droite inflexible sur la question migratoire, tournée vers la question sociale, intransigeante sur le respect de l’identité nationale et de notre souveraineté et ouvertement décomplexée en termes d’alliances pourra susciter quelque espoir. Ce fut en tout cas la recette autrichienne. •