Toutes les solutions possibles et imaginables pour sortir de la crise sont mauvaises. Et, de toutes façons, ne résoudront pas cette crise, au fond.
La solution est donc politique, au sens fort et premier du terme, donc institutionnelle...
C'est ce que pense Hilaire de Crémiers, qui l'écrit dans son article paru dans Politique Magazine - Juillet/Août 2010 (n° 87) :
L’heure de la politique - Il n’est pas sûr que les Français sachent ce qui les attend, ni ce que devrait être une politique française....
L’heure de la politique
Il n’est pas sûr que les Français sachent ce qui les attend, ni ce que devrait être une politique française.
Nul ne peut plus y échapper : la rigueur est maintenant …de rigueur. C’est un changement de mentalité qui va devoir s’imposer. Pendant des décennies, une, puis deux générations d’hommes de nos pays occidentaux, essentiellement dans les classes dirigeantes, ont cru au progrès indéfini que rendait possible le prodigieux développement des sciences et des techniques. Et ils pensaient que la croissance économique qui en était le fruit, serait également indéfinie. Dans leur esprit, il suffisait de toujours la doper par des procédés habiles pour obtenir les résultats escomptés.
Le mythe
Et comme, dans leurs croyances, cette croissance était la fin de toutes choses, le seul but recherché de l’activité humaine, l’unique conclusion de tous leurs raisonnements, en quelque domaine que ce fût, la politique elle-même n’était plus qu’un outil subordonné. Les hommes politique, en somme, n’étaient plus chargés que d’organiser la société des loisirs, de l’abondance, du bonheur, au fond d’assurer la répartition des richesses. C’était les thèmes des campagnes électorales. Certes, il était reconnu que cette machinerie économique provoquait des dégâts sociaux et environnementaux ; il était même concédé que ces dégâts pouvaient être dramatiques, mais il suffisait d’intégrer un souci écologique, une préoccupation sociale dans les programmes électoraux pour justifier l’utilité de l’action politique. Le devoir de l’homme politique était, en fait, d’atténuer les inconvénients du système, d’améliorer la qualité de vie, de créer des filets sociaux pour rattraper les laissés-pour-compte de la merveilleuse croissance, de la mirifique mondialisation.
Les regards étaient détournés de la dégradation morale et sociale de quartiers entiers, de zones de plus en plus nombreuses et lépreuses, des effroyables conséquences humaines d’une immigration incontrôlée, mais aussi bien, et sans doute encore plus gravement, des fractures profondes d’une société qui ne se reconnaissait plus dans les principes qui l’avaient constituée. Peu importait : il fallait avancer toujours dans la même direction.
Les disputes sérieuses n’éclataient que sur des questions de pilotage de la société, la plus essentielle étant de savoir qui la piloterait ! Lui, elle, ou moi ! Question primordiale !
Une classe politqiue qui, insensiblement mais inexorablement, s'éloigne de plus en plus des préoccupations immédiates des Français...
Qui pilotera : lui, elle ou moi ?...
En France, les 35 heures, la retraite à 60 ans participaient de cette croyance. L’Etat pourvoyait et continuerait à pourvoir à tout. Pour tous.
La gauche faisait son beurre des progrès économiques et les transformait en acquis sociaux. La droite ne revenait jamais sur ces avancées ; elle ne faisait que les aménager. Le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007 était « travailler plus » : c’était « pour gagner plus ». Il n’était jamais dit que c’était tout simplement nécessaire.
L’essentiel des débats de fonds portaient sur les choix dits sociétaux : affirmation indéfiniment répétée du droit imprescriptible de dire et de faire n’importe quoi, de sa vie, de la vie des autres, avec pour seule norme morale et politique de ne jamais enfreindre les règles du « politiquement correct » qui servent d’armature à cette société politique en déliquescence.
Tout cela a été admirablement dit et décrit par quelques philosophes sociaux, insuffisamment écoutés parce que leurs propos dérangeaient : des Jean-François Mattéi, des Chantal Delsol, pour ne citer qu’eux.
"...avec pour seule norme morale et politique de ne jamais enfreindre les règles du « politiquement correct » qui servent d’armature à cette société politique en déliquescence..."
…et la réalité
Et puis voilà que la réalité aujourd’hui, explose. Et cette réalité ne correspond plus au schéma habituel. Il est instructif de voir l’attitude des gouvernants français. Ils voient…et ils ne voient pas ; ils savent…et ils ne savent pas. C’est comme un refus d’examiner la réalité qu’ils sont cependant dans l’obligation d’examiner.
Qui ne se souvient de Nicolas Sarkozy qui, au début de cette année 2010 si tragique, voulut rencontrer des Français sur un plateau de télévision pour répondre publiquement à leurs questions : oui, disait-il, « ça » allait mal ; mais « ça » irait mieux, question de volontarisme. La croissance allait reprendre, la chère croissance, et le chômage baisser et tout s’arranger ; l’épreuve serait de courte durée !
Impossible de tenir pareil discours aujourd’hui ! Et pourtant, en ce début d’été, les calculs gouvernementaux s’accrochent encore à des hypothèses de croissance de 2,5 % pour les années à venir. C’est que le gouvernement a besoin de ce chiffre pour que son compte soit bon : rentrées de recettes fiscales, amélioration des comptes sociaux ; 35 milliards, grâce à cette prévision, arriveraient dans les caisses de l’Etat, lesquels s’ajouteraient à 65 milliards récupérés sur les restrictions budgétaires, les niches fiscales, l’arrêt des crédits de relance. Et voilà, croit-on, les 100 milliards atteints qui sont nécessaires au rééquilibrage des comptes de la nation et à la réduction des déficits qui est exigée tant par les marchés que par les instances européennes et mondiales !
Mais si…Oui, si…si « ça » ne se passe pas ainsi, comme, étant donné la crise, c’est plus que prévisible…Si les manettes qu’on s’imagine tenir, ne fonctionnent plus, si la croissance se dérobe, si la baisse des recettes fiscales se poursuit, si les déficits du coup s’aggravent, si la dette devient de plus en plus chère, ce qu’elle est en passe de devenir, si les taux s’élèvent dangereusement, si la situation n’est plus tenable, si…
"Mais si…Oui, si…si « ça » ne se passe pas ainsi, comme, étant donné la crise, c’est plus que prévisible…Si... si... si..."
La France a cru échapper à la rigueur ! Ne pas employer le mot, ne pas imaginer la chose est tout à fait caractéristique d’un certain état d’esprit. Mais voici que le spectre de cette rigueur abhorrée se profile à l’horizon de la rentrée : elle s’annonce en même temps que la réforme des retraites, car les déficits sociaux de 35 milliards qui ne peuvent aller, eux aussi, qu’en augmentant, ne permettent plus d’atermoyer ou de tergiverser. En même temps, le gel des dépenses frappera tous les ministères. Il a été question du gel des salaires des fonctionnaires. L’Etat n’assurera plus – et de loin – les dotations dont les collectivités territoriales ont besoin pour assumer toutes les charges dont les compétences leur ont été transférées, surtout en matière sociale. Ces mêmes collectivités territoriales sont endettées et, pour beaucoup, chargées de mauvaises dettes aux taux qui ne font qu’empirer, impossibles à gérer, que l’imprévoyance politicienne a laissé s’accumuler.
Tout arrive en même temps : c’est dit, c’est non dit. Quelques hauts fonctionnaires voient… quelques hommes politiques, extrêmement rares… Claude Guéant a voulu signifier à la communauté financière dans un entretien au Financial Times à la mi-juin que la France avait quelque conscience du drame qui se jouait.
La Commission européenne dans ses recommandations du mois de juin souligne l’insuffisance des ajustements français qui sont fondés, dit-elle, « sur un scénario macro-économique beaucoup trop optimiste » ; la croissance ne sera pas à 2,5 %, mais au mieux à 1,5 %. Et le commissaire Olli Rehn, chargé des affaires économiques et monétaires, d’insister sur les risques relatifs à de fausses hypothèses de croissance et de rentrées fiscales. Les conséquences de la crise et les décisions prises vont peser sur l’endettement français qui atteindra les 88 ou 89 % du PIB en 2011, et sans doute plus en 2012, si des corrections ne sont pas apportées. Plus de 100 % ?
Autant dire que le plan Fillon, comme la plupart des plans, ne correspond déjà plus à la situation.
"...le commissaire Olli Rehn "voit" des prévisions françaises basées "sur un scénario macro-économique beaucoup trop optimiste ; la croissance ne sera pas à 2,5 %, mais au mieux à 1,5 %..."
La politique à l’heure de vérité
Au mois d’avril dernier, Papandréou avait tenu aux Grecs un discours d’union nationale. Il affirmait gravement que c’était l’avenir même de la Grèce qui était en jeu. Mais ce discours était tenu trop tard : la tempête due à l’irresponsabilité démocratique et à l’endettement massif ne pouvait plus être détournée.
La crise sonne l’heure de la politique responsable. L’économie et les finances, aussi importantes soient-elles, sont subordonnées à la décision politique. C’est ce à quoi s’essaye Barak Obama, malgré ses propres préjugés, en affirmant, autant qu’il le peut, une autorité souveraine face au défis du monde : sauver les Etats-Unis, sauver la nation, voilà la règle. À l’heure de la marée noire et des risques financiers majeurs, c’est une évidence. La Chine dans sa volonté de puissance ne connaît que ce seul but national et c’est la raison de toutes ses décisions, y compris d’ajustement monétaire.
La chancelière allemande, malgré sa situation politique difficile, s’est fixé pour objectif, comme toute son équipe gouvernementale, de tirer l’Allemagne de la crise, de défendre ses intérêts. Elle sera implacable. Elle a imposé sa loi à l’Europe sur les budgets, sur les règles, sur les plans, sur les sanctions. L’Allemagne ne garde, ne gardera l’euro qu’à ces conditions. Elle a décrété son propre plan d’économies de 80 milliards sans prévenir personne. Nicolas Sarkozy se trouve refait sur ses prétentions à une gouvernance économique européenne dont l’Allemagne ne veut pas plomber son redressement. Elle sait où sont ses intérêts et ses zones d’influence. N’a-t-elle pas la suprématie en Europe, même dans l’agro-alimentaire où, maintenant, elle efface la France ?
David Cameron et son chancelier de l’Echiquier, George Osborne, ont présenté leur projet de « budget d’urgence » qui est le plan d’austérité le plus stricte qu’ait connu la Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale : 88 milliards de livres (106 Mds d’euros) sur les quatre ans qui viennent, dont 34 milliards de livres (41 Mds d’euros) dès la première année. Réduction drastique de toutes les dépenses , augmentation de tous les impôts…C’est qu’il faut absolument éviter une dégradation de la notation de la dette souveraine. L’Angleterre en est là, mais elle le sait. Et l’Angleterre ne pense qu’à l’Angleterre et tant pis, même pour les Etats-Unis qui ne s’y retrouveront pas.
Au G 20 de Toronto.
Anglais, Chinois, Allemands, Etats-Uniens... pensent à eux, et à eux seuls.
Et la France ?
"Ce qu’elle semble vouloir sauver, c’est l’euro, la zone euro, la gouvernance européenne…la gouvernance mondiale…et son système de retraite par répartition !"
L’Espagne, l’Italie, le Portugal n’arrivent pas à donner la même impression d’énergie. L’Espagne est terriblement grevée par l’état de ses banques et par les actifs douteux du secteur immobilier. Les taux de ses obligations d’Etat à 10 ou 30 ans ne cessent d’augmenter ; la barre des 5 % est ou est sur le point d’être franchie ; et il lui faut trouver 110 milliards d’ici la fin de l’année.
Et la France ? Terrible question. Ce qu’elle semble vouloir sauver, c’est l’euro, la zone euro, la gouvernance européenne…la gouvernance mondiale…et son système de retraite par répartition !
Au G20, à Toronto les 26 et 27 juin, elle prétend briller et imposer ses vues. Mais ses partenaires décideront sans elle, y compris sur les taxes bancaires et les régulations financières, en fonction de leurs intérêts : ce sera déjà fait quand ce magazine paraîtra.
La BCE, dans son bulletin mensuel de juin, a signalé le risque d’une insolvabilité de plusieurs grosses banques européennes : « La probabilité d’un défaut simultané d’au moins deux groupes bancaires importants et complexes de la zone euro a fortement augmenté le 7 mai à des valeurs plus hautes qu’au lendemain de l’effondrement de Lehman Brothers… ». Autant dire que la crise est devant nous. A bon entendeur, salut.
Dans de telles circonstances il faudrait un gouvernement français qui ne pensât qu’à la France. La politique française retrouverait quelque grandeur.





 Cette Éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :
Cette Éphéméride vous a plu ? En cliquant simplement sur le lien suivant, vous pourrez consulter, en permanence :

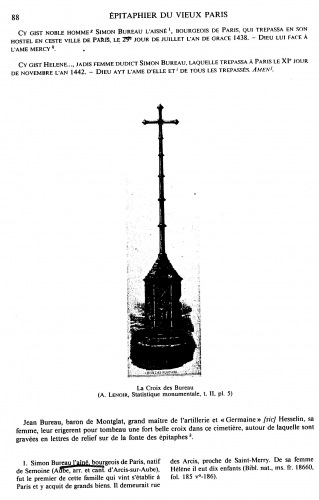





 Aimer la France, la servir, c'est d'abord connaître son Histoire et ceux qui l'ont faite : artistes, savants, hommes de guerre et d'Église, inventeurs, architectes, maçons et jardiniers...
Aimer la France, la servir, c'est d'abord connaître son Histoire et ceux qui l'ont faite : artistes, savants, hommes de guerre et d'Église, inventeurs, architectes, maçons et jardiniers...
















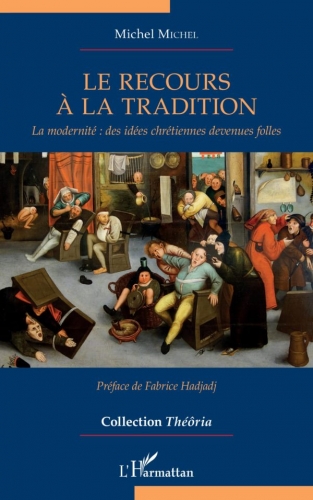
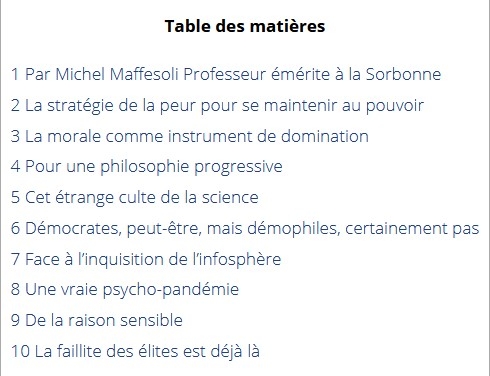



















 Le 23 ou 24 novembre dernier, j’ai acheté le Monde — je me souviens à peu près de la date, parce que l’événement est tellement rare qu’il fait tache : je n’ai pas trop à cœur de financer l’un des journaux officiels (avec Libé) de la mondialisation décomplexée.
Le 23 ou 24 novembre dernier, j’ai acheté le Monde — je me souviens à peu près de la date, parce que l’événement est tellement rare qu’il fait tache : je n’ai pas trop à cœur de financer l’un des journaux officiels (avec Libé) de la mondialisation décomplexée.