Fabrice Hadjadj : Questions-Réponses essentielles et critiques sur notre époque [4]

Guerre des sexes ?

Fabrice Hadjadj publie un recueil de chroniques où il mêle des réflexions inspirées de la vie quotidienne sur le sexe, la religion, la technique et le travail. Entre Houellebecq et Chesterton, il nous livre une profonde critique de l'époque ... Ces réflexions sont importantes et ne sont pas à prendre à la légère. Elle traitent de l'essentiel, de l'avenir de notre société et des personnes qui lui appartiennent par la naissance et par la tradition. Nous publions ces réponses de Fabrice Hadjadj à Eugénie Bastié [Figarovox, 21.12.2017] comme une suite, en plusieurs journées. Lafautearousseau

Vous terminez votre recueil par un «conte de Noël». À l'heure où la consommation a pris le pas sur le rite, quel sens peut encore avoir cette fête chrétienne ?
Nous en arrivons à la consommation des siècles. Notre système est très fragile. La collapsologie est devenue une science très en vogue. La dinde aux marrons peut grossir jusqu'à nous boucher la vue, le fait est là : la pie-grièche à ventre rose disparaît du territoire français. Nous n'en sommes qu'au début de la disparition des espèces et des énormes flux migratoires consécutifs au réchauffement climatique.
Le black-out n'est pas loin qui éteindra toutes les illuminations des artères commerciales : heureux ceux qui auront encore des bougies ! Quant aux cyborgs, qu'on nous présente comme des immortels, ils ne trouveront plus à recharger leurs prothèses ou à changer leurs pièces, et ils tomberont en panne.
En fait, je ne suis ni décliniste ni progressiste. Je suis très simplement apocalyptique. Nous sommes les premières générations à être assurées non seulement que « les civilisations sont mortelles », comme disait Valéry, mais que l'espèce humaine est vouée à l'extinction - à plus ou moins long terme.
Quel est le sens de cette certitude ? Et pourquoi continuer, dès lors, avec l'aventure humaine ? Il faudra bien, une fois que les écrans ne s'allumeront plus, que l'on se pose pour de bon la question. Alors on apercevra peut-être l'étoile au-dessus de l'étable de Bethléem: ce bébé juif qui paraît au milieu de la nuit, entre sa mère, son père, le bœuf et l'âne, l'adoration des bergers et des rois, c'est l'Éternel qui nous dit qu'il est bon d'être humain, d'avoir un corps, de travailler de ses mains, de parler du ciel à travers les simples choses de la terre, et que même si le monde devait disparaître demain - la figure de ce monde passe, dit saint Paul - il faudrait encore tenir notre poste, planter des arbres, élever des enfants, leur transmettre la poésie de la louange et de la supplication. Ce mystère de l'Incarnation sera le dernier rempart contre le transhumanisme, l'islamisme, l'animalisme, le spiritualisme et toutes les autres formes contemporaines de la désespérance. • Suite et fin.
Directeur de l'université Philantropos. Il publie « Dernières nouvelles de l'homme (et de la femme aussi) », Taillandier, 352 p., 18,90 €.

Journaliste Débats et opinions
A lire dans Lafautearousseau ...
Fabrice Hadjadj : Questions-Réponses essentielles et critiques sur notre époque [1]
Fabrice Hadjadj : Questions-Réponses essentielles et critiques sur notre époque [2]
Fabrice Hadjadj : Questions-Réponses essentielles et critiques sur notre époque [3]

 BILLET - Le nombre de candidatures se multiplie pour le titre de premier secrétaire d'un PS aux abois. Mais pour Éric Zemmour, les postulants se battent seulement pour le rôle de croque-mort.
BILLET - Le nombre de candidatures se multiplie pour le titre de premier secrétaire d'un PS aux abois. Mais pour Éric Zemmour, les postulants se battent seulement pour le rôle de croque-mort. 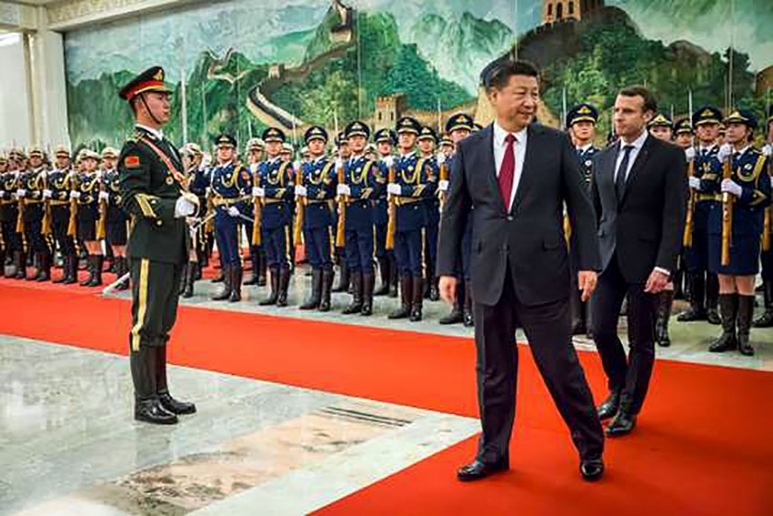


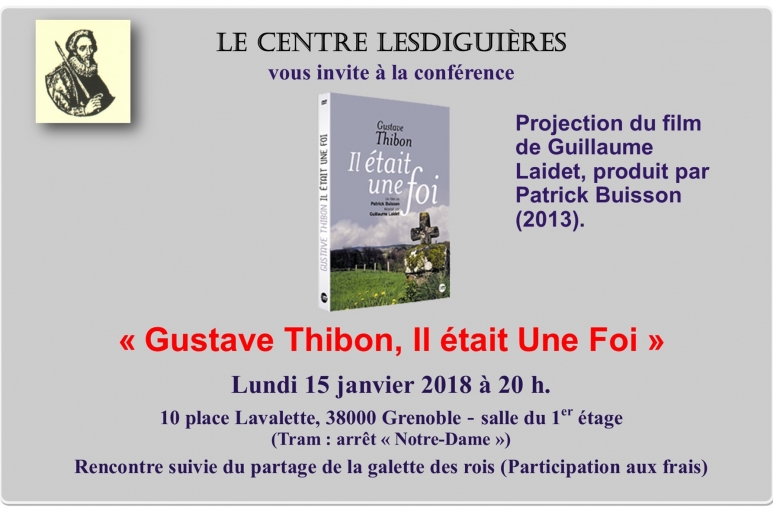

 Nous avons le plaisir de communiquer aux lecteurs et amis de Lafautearousseau notre nouvelle adresse postale ci-après :
Nous avons le plaisir de communiquer aux lecteurs et amis de Lafautearousseau notre nouvelle adresse postale ci-après :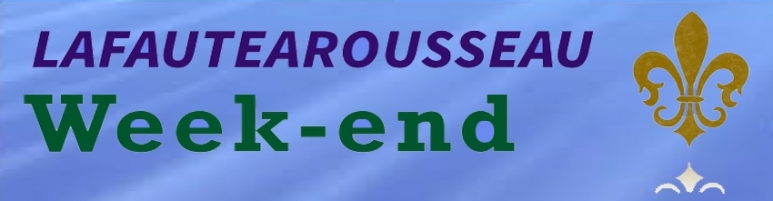

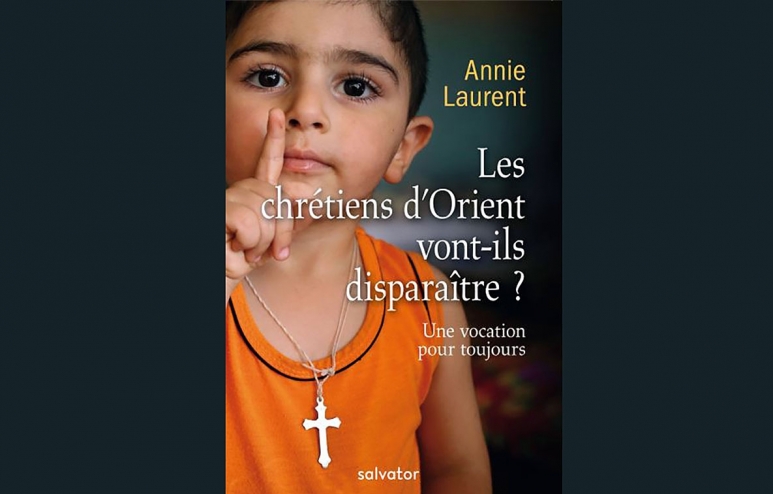



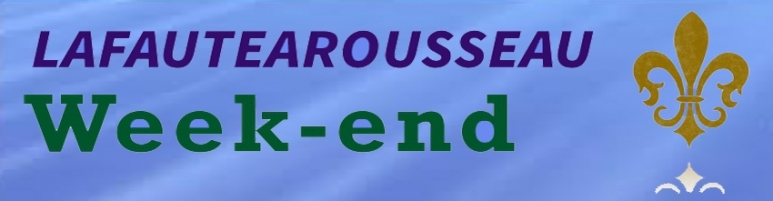
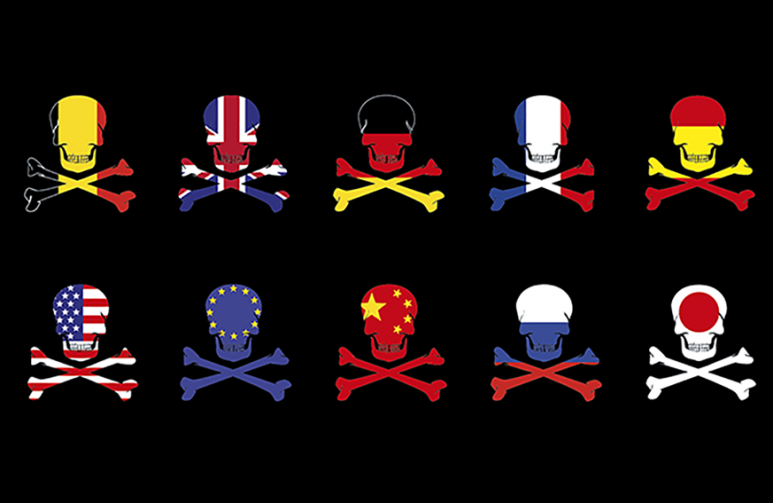
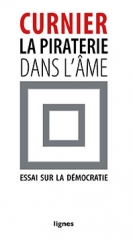 Pourquoi recommander la lecture d'un essai sur la démocratie : la piraterie dans l'âme de J.P/ Curnier
Pourquoi recommander la lecture d'un essai sur la démocratie : la piraterie dans l'âme de J.P/ Curnier 


