Par Pierre Renucci
C'est une réflexion particulièrement intéressante - ce que pourrait être une monarchie pour la France d'aujourd'hui - que nous propose ici Pierre Renucci. Certes nous ignorons tout des circonstances dans lesquelles la nécessité de la monarchie pourrait apparaître aux Français ; nous ne savons pas à quelles nécessités, à quels besoins du moment, elle aurait à répondre, ni pour quelles urgences elle serait appelée et donc quelles formes elle pourrait prendre. Mais, fût-ce en se fondant sur les réalités d'aujourd'hui, politiques, sociales et institutionnelles, l'idée monarchique prend corps et crédibilité si l'on tente d'en définir les contours et si l'on expose quel pourrait être le fonctionnement d'une monarchie pour notre temps. C'est ce que fait ici Pierre Renucci suscitant notre réflexion et peut-être le débat. Sa conviction est que, pour peu qu'on lui en expose les réels avantages, le peuple français acceptera volontiers un roi conscience du pays. LFAR
 Quand, au détour d’une conversation avec une personne raisonnablement ouverte d’esprit, je m’aventure à évoquer l’hypothèse du retour du Roi, la réaction immédiate se traduit invariablement par cette question : « Le Roi ? Mais que ferait-il ? » Question qui ne révèle pas d’hostilité de principe, mais un scepticisme non dénué de bon sens. Il faut bien comprendre que le Français a deux images du Roi. L’une, contemporaine, que lui renvoient les monarchies constitutionnelles européennes. L’autre, historique, celle de nos rois absolus de droit divin. Or aucune ne lui convient vraiment. La première lui paraît sympathique, esthétique, utile comme symbole national, voire non dépourvue de quelque influence sur le pouvoir. Mais au Roi-symbole, il préfère son Président-monarque détenteur du pouvoir. La seconde, quoique toute française, ne lui paraît plus adaptée à son époque. Au Roi-monarque héréditaire, il préfère son Président-monarque élu. Bref le Français n’est pas royaliste, il est monarchiste et veut choisir son monarque. Alors, utopie que le retour de la Couronne ? Non point. Sans parler de circonstances gravissimes qui en feraient l’ultime recours, le Roi remplirait une fonction en toute période. Une fonction bien supérieure à la simple représentation symbolique de la Nation, bien supérieure aussi à celui de gouverner. Je le vois comme une conscience active, c’est-à-dire à la fois un modérateur lorsqu’il s’agit de dénoncer un danger et un incitateur lorsqu’il s’agit de provoquer un bienfait. Il serait celui qui introduirait dans la constitution la mixité qui lui manque. Mais précisément, avant de déterminer comment lui donner ce rôle de conscience, il faut expliquer ce qu’est une constitution mixte. Ce préalable est hélas indispensable puisque nos régimes occidentaux n’en connaissent plus, et que l’idée même s’est effacée de nos cerveaux.
Quand, au détour d’une conversation avec une personne raisonnablement ouverte d’esprit, je m’aventure à évoquer l’hypothèse du retour du Roi, la réaction immédiate se traduit invariablement par cette question : « Le Roi ? Mais que ferait-il ? » Question qui ne révèle pas d’hostilité de principe, mais un scepticisme non dénué de bon sens. Il faut bien comprendre que le Français a deux images du Roi. L’une, contemporaine, que lui renvoient les monarchies constitutionnelles européennes. L’autre, historique, celle de nos rois absolus de droit divin. Or aucune ne lui convient vraiment. La première lui paraît sympathique, esthétique, utile comme symbole national, voire non dépourvue de quelque influence sur le pouvoir. Mais au Roi-symbole, il préfère son Président-monarque détenteur du pouvoir. La seconde, quoique toute française, ne lui paraît plus adaptée à son époque. Au Roi-monarque héréditaire, il préfère son Président-monarque élu. Bref le Français n’est pas royaliste, il est monarchiste et veut choisir son monarque. Alors, utopie que le retour de la Couronne ? Non point. Sans parler de circonstances gravissimes qui en feraient l’ultime recours, le Roi remplirait une fonction en toute période. Une fonction bien supérieure à la simple représentation symbolique de la Nation, bien supérieure aussi à celui de gouverner. Je le vois comme une conscience active, c’est-à-dire à la fois un modérateur lorsqu’il s’agit de dénoncer un danger et un incitateur lorsqu’il s’agit de provoquer un bienfait. Il serait celui qui introduirait dans la constitution la mixité qui lui manque. Mais précisément, avant de déterminer comment lui donner ce rôle de conscience, il faut expliquer ce qu’est une constitution mixte. Ce préalable est hélas indispensable puisque nos régimes occidentaux n’en connaissent plus, et que l’idée même s’est effacée de nos cerveaux.
♦
Le concept remonte à l’Antiquité grecque. Aristote l’utilisait déjà, par exemple pour vanter la réforme de Solon qui avait aboli à Athènes la toute-puissance oligarchique « en pratiquant un mélange [‘‘mixanta’’ en grec] constitutionnel heureux ». La mixité consistait ici en ce que l’Aréopage était oligarchique, l’élection des magistrats aristocratique et l’organisation des tribunaux démocratique. Hélas, continue Aristote, Éphialte et Périclès bouleversèrent l’équilibre, notamment en « mutilant les pouvoirs de l’Aréopage » au profit de l’assemblée populaire. Alors on passa de la « démocratie de nos pères », cette démocratie équilibrée par la mixité, à la « démocratie actuelle », celle qui « flatte le peuple comme un tyran ». Retenons donc qu’une constitution mixte mélange des éléments de nature différente afin de ne donner l’omnipotence à aucun. Bien sûr la chimie s’effectue différemment selon le lieu et l’époque, mais toujours avec un élément dominant, qui peut être monarchique, aristocratique, démocratique, oligarchique. L’essentiel est que l’élément dominant –la démocratie dans l’exemple d’Aristote- accepte le garde-fou de la mixité.
Le plus bel exemple de constitution mixte offert par l’Antiquité reste la république romaine du III° siècle av. J.-C. L’historien grec Polybe écrira au siècle suivant que « personne […] n’aurait pu dire avec certitude si l’ensemble du régime était aristocratique, démocratique ou monarchique […] Car lorsqu’on regardait le pouvoir des consuls, le régime paraissait parfaitement monarchique ; mais d’après le pouvoir du Sénat, c’était cette fois une aristocratie ; et si maintenant on considérait le pouvoir du peuple, cela semblait nettement une démocratie ». Cette mixité permit un équilibre entre les éléments interdépendants. : impossible pour aucun de prédominer à l’excès, car sa tentative serait « contrebalancée et entravée par les autres […]. Tous restent en l’état, réfrénés dans leur élan ou craignant dès le début l’opposition du voisin ».
Une correction à cette excellente description de Polybe : ce régime était de dominante aristocratique, ce que chacun savait avec certitude et acceptait. La devise même de la République l’atteste : Senatus Populusque Romanus (S.P.Q.R.). Le Sénat aristocratique est nommé avant le Peuple au sens institutionnel (c.-à-d. les assemblées populaires).
Précision très importante pour ce qui va suivre. Le Sénat ne votait pas les lois, n’élisait pas non plus les magistrats. Il rendait des avis appelés senatus consulta qui ne liaient pas les assemblées populaires en droit ; toutefois leur autorité était suffisamment forte pour qu’un magistrat ne pût leur proposer une loi ou un candidat contraires au souhait des sénateurs. En langage juridique moderne on dirait que le magistrat était lié à l’avis conforme du Sénat. Retenons cela : il n’est pas nécessaire d’avoir le pouvoir pour détenir du pouvoir.
Avec l’éphémère cité solonienne et la magnifique république romaine, la monarchie française reste le modèle le mieux accompli de la mixité constitutionnelle, celle-là même à laquelle Érasme pensait lorsqu’il écrivait dans son Institution du prince chrétien, « Le prince préfèrera que sa monarchie soit adoucie par des emprunts à l’aristocratie et à la démocratie, afin de ne pas tomber dans la tyrannie ».
À la même époque, Claude de Seyssel, analysant le régime français dans sa Grant monarchie française discerne trois retenails (freins) à l’absolutisme royal : d’abord la religion qui, si le Roi se fait tyran, permet à « tout prélat […] et à un simple prêcheur de le reprendre et arguer publiquement et en sa barbe » ; ensuite les parlements dont il « n’est en la puissance des roys les déposer sinon par forfaicture » ; enfin la police (c.-à-d. les lois fondamentales), si solide « que les princes n’entreprennent pas d’y déroger, et quand le vouldroient faire, l’on n’obéit point à leurs commandements ». Ces lois ne sont pas seulement ce qu’on nommerait aujourd’hui constitution, elles sont aussi dans l’esprit de Seyssel, celles qui garantissent les libertés des corps intermédiaires (provinces, villes, corporations…) et des individus.
Laissons le juriste Charles Dumoulin résumer, à la manière d’Aristote et Polybe, la formule politique française : « Royaume de France, c’est monarchie avec un assaisonnement, composition et température d’aristocratie et démocratie des estats ». Telle était le système français bien équilibré que Bossuet rappellera avec force. Il durera jusqu’à Louis XV.
♦
Aucun des trois systèmes évoqués ne serait viable aujourd’hui. La démocratie solonienne, l’aristocratie républicaine romaine, la monarchie française étaient belles parce qu’en harmonie avec leurs temps. Mais leurs temps sont révolus et leur retour serait anachronique. Ainsi, ne rêvons pas au Roi-monarque : aujourd’hui le pouvoir use trop vite son détenteur pour être viager. En revanche, aurait toute sa place un Roi qui, sans détenir le pouvoir, aurait l’autorité pour le canaliser, le modérer et plus encore, l’orienter et l’inspirer. Mutatis mutandis, un Roi qui jouerait le rôle du Sénat romain…
Nous en avons grand besoin. Sous le nom de démocratie, ce que nous connaissons aujourd’hui n’est qu’une oligarchie élective. Cette « partitocratie », assise sur une classe politico-médiatique qui se reproduit en vase clos, gouverne sans qu’aucun frein ne la retienne, même quand elle se vend à la ploutocratie mondialisée. Quant à la votation, elle s’y réduit à la légitimation rituelle de l’alternance d’équipes semblables.
Seul un roi héréditaire, libre de sa parole et disposant d’une autorité garantie par la constitution aurait les moyens de policer cette classe dirigeante. Certes il ne gouvernerait ni ne légiférerait mais, si je puis me permettre cette image, sans avoir la main sur le timon, il aurait l’œil sur le timonier. Pas seulement pour le sermonner, mais pour le conseiller, l’inciter et lui montrer les limites à ne pas dépasser.
Sur le plan institutionnel, l’idée est simple. La pratique constitutionnelle actuelle est celle d’un régime parlementaire dualiste c.-à-d. un parlementarisme dans lequel le Gouvernement est responsable devant la chambre basse et devant le chef de l’État. Je dis la pratique, parce que la lettre est, elle, moniste : rien en effet dans la constitution n’autorise le Président à démettre le Premier ministre et rien ne l’autorise à gouverner à sa place. Au contraire, d’une part l’art. 20 dispose que le « Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » et qu’« il est responsable devant le Parlement » ; d’autre part l’art. 21 précise que le « Premier ministre dirige l’action du Gouvernement ». Ce n’est qu’en période de cohabitation que la lettre moniste s’appliquait.
Partant, l’avènement d’un Roi qui ne soit ni un Roi-monarque, ni un Roi-symbole, mais un Roi-conscience, nécessite qu’il s’inscrive dans un parlementarisme qui ne soit ni moniste, ni dualiste. Ni moniste, parce que ce serait en faire un Roi-symbole, ni dualiste parce que ce serait en faire un Roi-monarque. Ce nouveau parlementarisme, appelons-le parlementarisme mixte. Comme le moniste, il donnerait le pouvoir au Premier ministre, et au Parlement seul le droit d’accorder ou non la confiance au Gouvernement. Comme le dualiste, il donnerait au chef de l’État des prérogatives qui en ferait un acteur incontournable.
Peu d’articles de la constitution de la V° République seraient à modifier pour réaliser ce bouleversement :
- Art. 18 : L’actuel droit de message du chef de l’État au Parlement doit permettre un authentique discours du Trône annuel. Entendons une déclaration de politique générale dans laquelle le Roi exprime en toute liberté sa vision de l’état de la France et indique les réformes dont il souhaite que le Gouvernement se saisisse. Hormis le discours du Trône, le Roi pourrait adresser ponctuellement des messages sur les sujets de son choix. Bien sûr ce droit de message resterait un pouvoir propre, c.-à-d. non soumis à contreseing.
- Art. 44 : Le droit d’amendement qui appartient aujourd’hui au Gouvernement et au Parlement sera élargi au Roi. Il pourrait ainsi intervenir dans l’élaboration de la loi en proposant des modifications aux projets ou propositions déposés.
- Art. 10, al.2 : Ce texte autorise le Président à demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette sorte de véto suspensif est toutefois soumise à contreseing. Il conviendra d’en faire un pouvoir propre du Roi, lequel pourra ainsi relancer le débat sur un sujet dont il estime qu’il n’a pas été convenablement traité par le Parlement et le Gouvernement.
- Art. 11 : Le référendum législatif est aujourd’hui proposé par le Gouvernement ou les deux assemblées au Président, lequel accepte ou refuse (laissons de côté l’initiative populaire qui ne nous intéresse pas directement ici, et reste inutilisée pour l’heure). Dans les faits, la proposition gouvernementale est purement formelle : tous les référendums furent lancés à l’initiative du Président. Afin que le Roi conserve cette liberté, l’article 11 devra mentionner expressément son droit propre d’appeler le peuple à référendum. Ainsi il pourra non seulement proposer directement au peuple une loi qu’il estime nécessaire, mais aussi lui demander de trancher sur un projet de loi, à son avis mauvais, que le Parlement s’apprête à voter.
- Art. 9 : Le Président préside le conseil des ministres. Cela n’apparaît pas anormal puisqu’il est le véritable chef de la majorité parlementaire et donc le principal décideur politique. Ce n’est que lors des cohabitations, que sa présidence du conseil devenait nominale face au Premier ministre. Le Roi n’aura aucun besoin de cette présidence qui serait, elle, toujours nominale, puisque le nouveau chef de la majorité parlementaire et principal décideur politique sera désormais le Premier ministre. En revanche, le Roi devra assister de droit aux conseils des ministres et participer aux délibérations pour exercer son autorité modératrice et inspiratrice.
- Art. 12 : La dissolution de l’Assemblée nationale est un pouvoir propre du Président qui l’exerce après simple consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées. Dans un régime parlementaire moniste, la dissolution de la Chambre par le Gouvernement est le pendant du renversement du Gouvernement par la Chambre. L’initiative de la dissolution revient donc normalement au Premier ministre, le prononcé de la dissolution par le chef de l’État n’étant que formel. Sous la V° République il n’y eut que cinq dissolutions, dont deux avaient simplement pour but de mettre l’Assemblée en adéquation avec le Président Mitterrand nouvellement élu (1981 & 1988). Les trois autres furent plus typiquement parlementaires et effectuées en accord avec le Premier ministre.
Pas plus qu’il n’a le droit de renvoyer le Gouvernement, le Roi n’aurait celui de dissoudre la chambre basse. Cela relèvera du seul Premier ministre. En revanche, le Roi pourra le lui proposer officiellement, si les circonstances lui semblent exiger que le Peuple se prononce.
- Art. 16 : En cas de péril grave, le Président peut décider d’exercer les pleins-pouvoirs, entendons la dictature au sens romain du terme. Cette possibilité doit-elle passer au Roi ? La question est délicate. Un roi-conscience qui ne gouverne pas en période normale, devrait-il gouverner en dictator en période anormale ? D’un point de vue strictement logique, non. Mais n’est-ce pas justement, parce qu’un péril grave voire mortel menace le pays, que le roi-conscience, chef d’État parfaitement libre, sera le mieux à même de le conjurer ? On a envie de répondre oui ; mais le risque serait grand pour le Roi. Le péril grave nécessite des réactions brutales voire sanglantes, qui engageraient sa responsabilité tôt ou tard. Or, le Roi étant constitutionnellement irresponsable, la crise pourrait s’achever avec sa chute.
Mieux vaudrait alors que le Premier ministre exerce la dictature provisoire, mais avec autorisation expresse du Roi.
La question du feu nucléaire est en partie liée à l’article 16, puisque c’est à la menace de guerre nucléaire que les constituants songeaient en l’écrivant. Certes le déclenchement nucléaire ne nécessite pas les pleins-pouvoirs. Toutefois on n’imagine mal deux attributaires différents : si le Premier ministre peut faire usage de l’article 16, il doit aussi être détenteur du feu nucléaire. Or aujourd’hui, ce n’est pas la constitution mais un décret qui confie au Président l’usage de la force nucléaire. Il conviendra donc de le modifier pour l’attribuer au Premier ministre. Est-il souhaitable de lui associer le Roi, autrement dit d’instaurer une « double clef » qui nécessiterait l’accord conjoint des deux têtes de l’Exécutif ? Ce serait peut-être la meilleure solution…
Les autres droits du Président passeraient au Roi, notamment la nomination aux emplois supérieurs de l’État (art. 13, al.2) et la signature des décrets délibérés en conseils des ministres (13, al. 1). Ces deux attributs du chef de l’État sont soumis à contreseing, en sorte que ces nominations et décrets nécessitent l’accord du Premier ministre. Le Roi aura donc dans ces deux domaines essentiels un poids important, puisque le Gouvernement ne pourra rien décider sans lui. La sagesse commandera bien sûr de trouver de bons ajustements avec le Premier ministre qui reste le détenteur du pouvoir réglementaire de droit commun.
♦
« Les formules politiques, disait Maurras, ne sont pas des gaufriers, et si les lois des nations, comme celles du monde et de l’Hommes, sont immuables, il faut voir que toutes les situations de l’histoire et de la géographie sont originales. Elles ont quelque chose d’unique qui doit être traité comme tel. »
Les Français aiment être gouvernés par un monarque élu ? Respectons ce choix. Il est une étape de leur histoire. Ce monarque peut ne plus être le Président, mais le Premier ministre d’un régime parlementaire. Le Premier anglais, le Kanzler allemand ont-ils moins de pouvoir que le Président de la V° République ? Non, ils ont comme lui le pouvoir. Cela pour la raison que le parlementarisme n’est rien d’autre que le transfert du pouvoir des mains du Roi à celles du Premier ministre. Le fait que la pratique constitutionnelle de la V° République ait permis au Président de capter ce qui appartient au Chef du Gouvernement ne change fondamentalement rien à cette vérité.
L’essentiel est que le mode de scrutin permette de dégager une majorité indiscutable, afin qu’en votant pour un député, l’électeur choisisse par transparence le Premier ministre de son choix, autrement dit son monarque. Pourquoi même ne pas imaginer une élection au suffrage universel direct du Premier ministre comme aujourd’hui le Président, suivie d’élections législatives ? Ce serait reproduire le schéma actuel qui assure au Président une Assemblée de sa couleur. Quoi qu’il en soit, si le Peuple français conserve sa prérogative élective, il acceptera volontiers un Roi-conscience. La désaffection – sinon le dégoût - qu’il ressent pour la classe politique et pour le système en général, lui feront comprendre l’avantage de flanquer son Premier ministre-monarque d’un Roi qui ne doit rien à personne et qui n’obéit à aucun autre intérêt que celui de la Nation.
Encore faut-il le lui expliquer. Mais cela est aussi et surtout affaire de prince… •
Pierre Renucci
Historien du droit, des institutions et des faits sociaux


 Nous poursuivons la publication de notre série, dont la lecture expliquera à ceux qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies. LFAR
Nous poursuivons la publication de notre série, dont la lecture expliquera à ceux qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies. LFAR

 Quand, au détour d’une conversation avec une personne raisonnablement ouverte d’esprit, je m’aventure à évoquer l’hypothèse du retour du Roi, la réaction immédiate se traduit invariablement par cette question : « Le Roi ? Mais que ferait-il ? » Question qui ne révèle pas d’hostilité de principe, mais un scepticisme non dénué de bon sens. Il faut bien comprendre que le Français a deux images du Roi. L’une, contemporaine, que lui renvoient les monarchies constitutionnelles européennes. L’autre, historique, celle de nos rois absolus de droit divin. Or aucune ne lui convient vraiment. La première lui paraît sympathique, esthétique, utile comme symbole national, voire non dépourvue de quelque influence sur le pouvoir. Mais au Roi-symbole, il préfère son Président-monarque détenteur du pouvoir. La seconde, quoique toute française, ne lui paraît plus adaptée à son époque. Au Roi-monarque héréditaire, il préfère son Président-monarque élu. Bref le Français n’est pas royaliste, il est monarchiste et veut choisir son monarque. Alors, utopie que le retour de la Couronne ? Non point. Sans parler de circonstances gravissimes qui en feraient l’ultime recours, le Roi remplirait une fonction en toute période. Une fonction bien supérieure à la simple représentation symbolique de la Nation, bien supérieure aussi à celui de gouverner. Je le vois comme une conscience active, c’est-à-dire à la fois un modérateur lorsqu’il s’agit de dénoncer un danger et un incitateur lorsqu’il s’agit de provoquer un bienfait. Il serait celui qui introduirait dans la constitution la mixité qui lui manque. Mais précisément, avant de déterminer comment lui donner ce rôle de conscience, il faut expliquer ce qu’est une constitution mixte. Ce préalable est hélas indispensable puisque nos régimes occidentaux n’en connaissent plus, et que l’idée même s’est effacée de nos cerveaux.
Quand, au détour d’une conversation avec une personne raisonnablement ouverte d’esprit, je m’aventure à évoquer l’hypothèse du retour du Roi, la réaction immédiate se traduit invariablement par cette question : « Le Roi ? Mais que ferait-il ? » Question qui ne révèle pas d’hostilité de principe, mais un scepticisme non dénué de bon sens. Il faut bien comprendre que le Français a deux images du Roi. L’une, contemporaine, que lui renvoient les monarchies constitutionnelles européennes. L’autre, historique, celle de nos rois absolus de droit divin. Or aucune ne lui convient vraiment. La première lui paraît sympathique, esthétique, utile comme symbole national, voire non dépourvue de quelque influence sur le pouvoir. Mais au Roi-symbole, il préfère son Président-monarque détenteur du pouvoir. La seconde, quoique toute française, ne lui paraît plus adaptée à son époque. Au Roi-monarque héréditaire, il préfère son Président-monarque élu. Bref le Français n’est pas royaliste, il est monarchiste et veut choisir son monarque. Alors, utopie que le retour de la Couronne ? Non point. Sans parler de circonstances gravissimes qui en feraient l’ultime recours, le Roi remplirait une fonction en toute période. Une fonction bien supérieure à la simple représentation symbolique de la Nation, bien supérieure aussi à celui de gouverner. Je le vois comme une conscience active, c’est-à-dire à la fois un modérateur lorsqu’il s’agit de dénoncer un danger et un incitateur lorsqu’il s’agit de provoquer un bienfait. Il serait celui qui introduirait dans la constitution la mixité qui lui manque. Mais précisément, avant de déterminer comment lui donner ce rôle de conscience, il faut expliquer ce qu’est une constitution mixte. Ce préalable est hélas indispensable puisque nos régimes occidentaux n’en connaissent plus, et que l’idée même s’est effacée de nos cerveaux.

 Une petite plaque apposée sur un immeuble du 52, rue Beauregard, dans le deuxième arrondissement de Paris vient rappeler que, le matin du 21 janvier 1793, le baron Jean-Pierre de Batz, aidé de quelques amis proches, a tenté de faire évader, sans succès, le roi Louis XVI condamné à mort, quelques jours auparavant (15 janvier) par la majorité des 749 députés de la Convention. Ce jour-là, après un procès d’une quinzaine de jours, du 10 au 26 décembre 1792, les représentants du peuple de la République naissante votent en quelques heures la mort de « Louis Capet ». Quatre questions leur sont posées :
Une petite plaque apposée sur un immeuble du 52, rue Beauregard, dans le deuxième arrondissement de Paris vient rappeler que, le matin du 21 janvier 1793, le baron Jean-Pierre de Batz, aidé de quelques amis proches, a tenté de faire évader, sans succès, le roi Louis XVI condamné à mort, quelques jours auparavant (15 janvier) par la majorité des 749 députés de la Convention. Ce jour-là, après un procès d’une quinzaine de jours, du 10 au 26 décembre 1792, les représentants du peuple de la République naissante votent en quelques heures la mort de « Louis Capet ». Quatre questions leur sont posées :

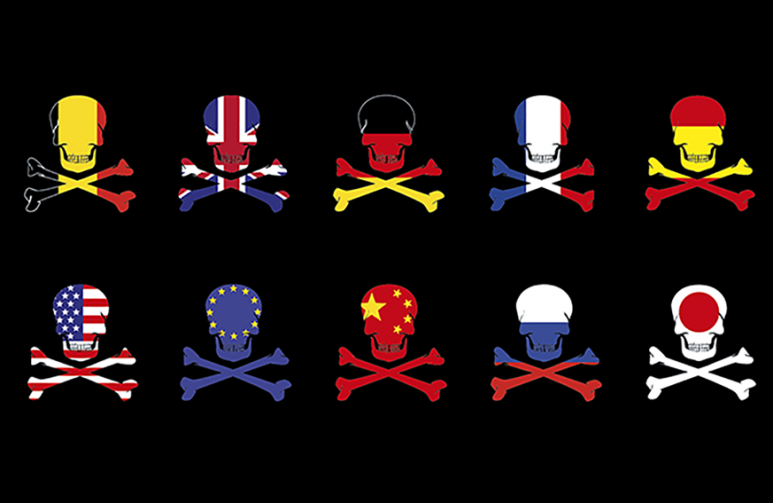
 Pourquoi recommander la lecture d'un essai sur la démocratie : la piraterie dans l'âme de J.P/ Curnier
Pourquoi recommander la lecture d'un essai sur la démocratie : la piraterie dans l'âme de J.P/ Curnier 

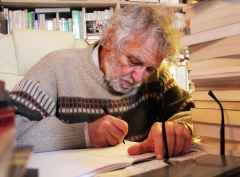
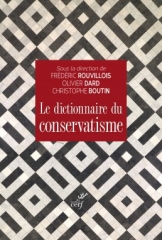 Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ».
Ce n’est là qu’un faible aperçu de la richesse de ce dictionnaire qui, par ses développements, ne cesse d’inciter à toujours plus creuser et complexifier la réflexion. On prêtera, notamment, attention aux liens qu’une tradition politique entretient avec des courants philosophiques aussi caractéristiques que le thomisme et plus généralement avec le christianisme. De sa part, on ne saurait admettre nulle neutralité axiologique, ce qui l’éloigne de l’ère du vide dans toutes ses désinences, d’un libéralisme incertain (« Le libéral, disait le général de Gaulle, est celui qui pense que son adversaire a raison ») mais qui pourrait le rendre apte à affronter un des défis les plus graves, « le remplacement d’un monde par une réalité virtuelle qui dissimule mal les risques d’un nouveau totalitarisme ». Ainsi pourrait enfin se détacher « une volonté de perdurer dans l’être, ancrée aux coeurs des hommes » qui permette « de fédérer des axes et, peut-être, de rassembler une famille ». 
 Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe
Selon les baromètres Cevipof, moins de 10% des Français se désintéressent totalement de la politique, mais corrélativement ils lui adressent un sentiment de méfiance. Paul-François Schira analyse les causes de ce paradoxe 
 DÉBAT - Après un départ de quinquennat mitigé sur plan de la popularité, le président de la République Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Fait-il un sans-faute à la tête de l'État ? Zemmour affirme non sans raison : « Macron a compris ce qu'était un roi élu en France ». Ce qui n'empêche qu'il n'est pas un roi véritable. Lequel, comme Macron l'avait diagnostiqué en 2016, manque toujours à la France.
DÉBAT - Après un départ de quinquennat mitigé sur plan de la popularité, le président de la République Emmanuel Macron n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Fait-il un sans-faute à la tête de l'État ? Zemmour affirme non sans raison : « Macron a compris ce qu'était un roi élu en France ». Ce qui n'empêche qu'il n'est pas un roi véritable. Lequel, comme Macron l'avait diagnostiqué en 2016, manque toujours à la France. 







 L'interview d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et de longues heures d'antenne sur toutes les chaînes, les jours d'avant, d'après, et le dimanche soir fatidique où elle fut donnée, quoique, de l'aveu général, Macron n'y ait pas dit grand-chose, en tout cas rien de substantiel, et que cette interview n'ait été rien d'autre qu'un « exercice de style ».
L'interview d'Emmanuel Macron a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et de longues heures d'antenne sur toutes les chaînes, les jours d'avant, d'après, et le dimanche soir fatidique où elle fut donnée, quoique, de l'aveu général, Macron n'y ait pas dit grand-chose, en tout cas rien de substantiel, et que cette interview n'ait été rien d'autre qu'un « exercice de style ».