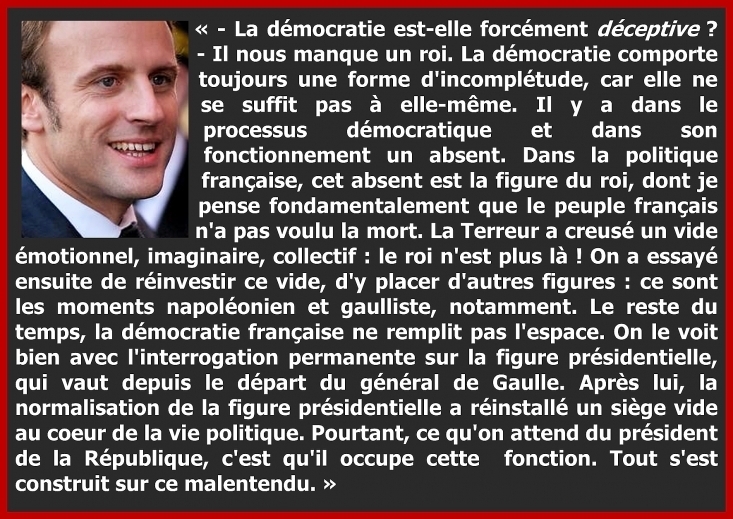D'illustres admirateurs et quelques grands amis ...
Publié le 23 février 2018 - Réactualisé le 23 mars 2018
 Il y a cent-cinquante ans - un siècle et demi ! - que Maurras est né à Martigues, en Provence [1868] « au bord des eaux de lumière fleuries » [1|.
Il y a cent-cinquante ans - un siècle et demi ! - que Maurras est né à Martigues, en Provence [1868] « au bord des eaux de lumière fleuries » [1|.
Il y a plus d'un siècle qu'il a inauguré son royalisme militant en publiant son Enquête sur la monarchie (1900). Et il y a presque 70 ans - une vie d'homme - qu'il est mort à Saint-Symphorien les Tours [1952]. Mais les passions qu'il a si souvent suscitées de son vivant - qu'elles fussent d'admiration ou de détestation, l'une et l'autre souvent extrêmes - ne semblent pas s'être émoussées avec le temps. Prêtes toujours à s'élancer. Comme pour attester une forme paradoxale et performative de présence de sa pensée et de son action.
On sait que la décision d'exclusion du ministre de la Culture, Mme Nyssen, a fini par susciter une vague d'indignations assez générale qui s'est retournée contre son auteur. Mme Nyssen ne savait pas ou avait oublié que depuis notre Gaule ancestrale ou le lointain Moyen-Âge, énorme et délicat, les Français détestent les interdictions. Et les Hauts Comités les démentis du Pouvoir.
Mais cette réprobation n'empêche pas à propos de Maurras l'inévitable mention, dogmatiquement prononcée, des « zones d’ombre ». Expression d'une notable imprécision, lourde de mystérieux et inquiétants sous-entendus et le plus souvent inexpliquée ... À propos de Maurras, on réprouve l'interdit - en bref, on veut benoîtement la liberté d'expression - mais on accuse le fond.
« Zones d’ombre » est porteur d'opprobre. De quoi s'agit-il ? Qu'a donc fait ce Maurras qu'admiraient Proust, Péguy, Malraux et le général De Gaulle ; qui fut l'ami de Bainville et de Daniel Halévy, de Bernanos et de Joseph Kessel, de Barrès et d'Anatole France, d'Apollinaire et de Thibon, de Gaxotte et de Boutang ? Qui fut académicien français. Que consultait Poincaré au cœur de la Grande Guerre, que citait Pompidou dans une conférence demeurée célèbre à Science-Po Paris. « Zones d'ombre » ? Fût-ce brièvement, il nous faut bien tenter de dire le fond des choses, de quitter l'allusion sans courage et sans nuances.
Quatre grands reproches sont faits à Maurras : son antirépublicanisme, son nationalisme, son antisémitisme et son soutien à Vichy.
LA CONTRE-REVOLUTION
Le premier - le plus fondamental - est d'avoir été un penseur contre-révolutionnaire ; d’être le maître incontesté de la Contre-Révolution au XXe siècle ; d'avoir combattu la République et la démocratie, du moins sous sa forme révolutionnaire à la française ; enfin d'être royaliste. Options infamantes ? En France, oui. Mais en France seulement. Et pour la doxa dominante. La Révolution ni la République n'aiment qu'on rappelle leurs propres zones d'ombre. Leurs origines sanglantes, la Terreur, la rupture jamais cicatrisée avec notre passé monarchique, avec l'ancienne France, qu'elles ont imposée. « Soleil cou coupé » ... écrira Apollinaire (2). Et, à la suite, à travers de terribles épreuves et quelques drames, toute l'histoire d'un long déclin français, d'un inexorable affaissement de notre civilisation, que Zemmour a qualifié de suicide et dont nous-mêmes, aujourd'hui, vivons encore l'actualité. Faut-il rappeler qu'au début des années soixante (1960), De Gaulle, monarchiste, avait envisagé que le Comte de Paris lui succède ? Que François Mitterrand dans sa jeunesse était monarchiste et que, comme en atteste, plus tard, sa relation constante avec le comte de Paris, il l'était sans-doute resté ? Quant à l'actuel président de le Réplique, on connaît ses déclarations sur le roi qui manque à la France ... Sur sa conviction que les Français n'ont pas voulu la mort de Louis XVI, la mort du roi ... (3) Faut-il reprocher à De Gaulle, Mitterrand ou Macron telle « zone d’ombre » ? Comme à Maurras ? Ce dernier voulut simplement, à la différence de ces derniers grands-hommes, que ce qu'il savait nécessaire pour la France devînt réalité. Il y consacra sa vie et y sacrifia sa liberté.
LE NATIONALISME
Le nationalisme, autre « zone d’ombre » ? Être nationaliste, un motif d'opprobre, de rejet moral ? Non, s'il s'agit d'un nationalisme quelconque à travers le monde. Oui - pour la bien-pensance - s'il s'agit du nationalisme français. Maurras l'avait défini comme « une douloureuse obligation » dont la cause et le contexte sont historiques, bien plus qu’idéologiques : l'humiliante défaite de 1870 et l'affrontement franco-allemand qui ne cessera jamais vraiment entre 1870 et 1945. « Douloureuse obligation » créée aussi par l'absence de roi, laissant la France aux mains, pour ne pas dire à la merci, d'un régime faible divisé et imprévoyant, qui la plaçait en situation d'infériorité face à l'Allemagne impériale. Plus tard, face à l'Allemagne nazie. Au cours de chacune des deux avant-guerres, Maurras avait vécu dans l'angoisse de l'impréparation où nous maintenait l'État républicain, laquelle devait rendre la guerre à la fois inévitable et terriblement meurtrière. Avant 1914, il avait eu la vision tragique de ce qui se préparait : « Au bas mot, en termes concrets, 500 000 jeunes français couchés froids et sanglants sur leur terre mal défendue » (4). On sait ce qu'il en fut, qui fut bien pis. Entre 1935 et 1939, l'on eut la reproduction du même scénario. La trahison de Blum refusant d'armer la France face au nazisme en même temps qu'il menait une politique étrangère belliciste irresponsable, les agissements du Parti Communiste, aux ordres de Moscou, comme Blum l'était de la IIème Internationale, allaient rendre le futur conflit mondial inévitable. « Pourquoi faut-il de tels retours ? « écrira alors Maurras. Dans la douleur, nous dit Boutang. On sait qu'il vécut cette période dans la certitude de la guerre et de la guerre perdue. Le « miracle de la Marne » qui avait sauvé la France en 1914, ne se renouvellerait pas ... Tel fut, au-delà du simple patriotisme, le nationalisme maurrassien. Nationalisme non de conquête ou d'expansion mais de défense d'un pays menacé. Menacé de l'extérieur et de l'intérieur, car le danger allemand n'était pas le seul qui pesât sur la France. Son désarmement mental, social, politique et culturel, ses divisions, étaient à l'œuvre comme elles peuvent l'être encore aujourd'hui pour diverses raisons supplémentaires dont certaines - comme l'invasion migratoire ou le mondialisme - que Maurras n'eut pas à connaître. Elles justifient, elles aussi, la persistance de la « douloureuse obligation » d’un nationalisme français.
L'ANTISEMITISME
L'antisémitisme est un autre des grands griefs faits à Maurras. Il n'est pas un thème central dans son œuvre et dans sa pensée - comme il le fut pour Edouard Drumont dont l'influence avait été considérable à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est pourtant à l'antisémitisme que l'on réduit souvent Maurras dans les débats d'aujourd'hui.
Une évidence s'impose ici : on ne comprendra rien à l'antisémitisme de Maurras, celui de son temps, très répandu en tous milieux, si, par paresse d'esprit ou inculture, l'on se contente de le considérer et de le juger avec des yeux qui ont vu, des mémoires qui savent, ce que vécurent les Juifs d'Europe entre 1930 et 1945, ce qu'était devenu l'antisémitisme en une époque barbare. Dans la jeunesse de Charles Maurras et encore longtemps après, l'antisémitisme fut une opposition politique, culturelle et si l'on veut philosophique à l'influence excessive que leur communautarisme natif - singulièrement apte à « coloniser » - conférait aux Juifs de France. À propos de cet antisémitisme politique de Maurras, Éric Zemmour propose une comparaison tirée de l'Histoire : « Son antisémitisme était un antisémitisme d'État, qui reprochait aux Juifs un pouvoir excessif en tant que groupe constitué, à la manière de Richelieu luttant contre « l'État dans l'État » huguenot. » (5) Avant la seconde guerre mondiale, il n'y avait pas là motif à rupture personnelle ou sociale, ni même un motif d'inimitié. Le jeune Maurras est lié à Anatole France. Il fréquente le salon de l'égérie de France, Madame Arman de Cavaillet, née Lippmann ; il est l'ami de Marcel Proust, plus qu'à demi Juif (sa mère est née Weil). Ils resteront amis, quoique Proust ait été dreyfusard, jusqu'à la mort de l'auteur de la Recherche. Proust l'a écrit, aussi bien que son admiration pour Maurras, Bainville et Daudet. On se souvient que Léon Daudet, disciple de Drumont bien davantage que Maurras ne le sera jamais, fit obtenir à Proust le prix Goncourt pour A l'ombre des jeunes-filles en fleur, en 1919 ... L'un des plus vifs admirateurs de Charles Maurras et son ami jusqu'à sa mort après la Seconde Guerre mondiale (1962, dix ans après Maurras), sera l'un des Juifs les plus éminents du XXe siècle, Daniel Halévy, dont, pour la petite histoire, mais pas tout à fait, la fille épousera Louis Joxe, résistant, ministre du général De Gaulle, et père de Pierre Joxe. De Daniel Halévy, l’auteur d’Essai sur l'accélération de l'Histoire, Jean Guitton écrira : « Il avait un culte pour Charles Maurras qui était pour lui le type de l'athlète portant le poids d'un univers en décadence. » (6)
L'antisémitisme politique de Maurras, au temps de sa pleine gloire, ne le sépara pas des grandes amitiés que nous avons citées et de l'admiration que lui portèrent, de Malraux à Bernanos, les plus illustres personnalités de son temps. Maurras eut-il le tort de ne pas comprendre que la persécution des Juifs au temps du nazisme rendait toute manifestation d'antisémitisme contestable ou même fautive ? Impardonnable ? On peut le penser, comme Éric Zemmour. C'est ignorer toutefois deux points essentiels : 1. ce que souffrirent les Juifs lors du conflit mondial ne fut vraiment connu dans toute son ampleur qu'après-guerre, 2. Peut-être est-il triste ou cruel de le rappeler mais le sort des Juifs ne fut pas le souci principal ni même accessoire, des alliés pendant la guerre. Ni Staline, lui-même antisémite, ni Roosevelt, ni Churchill, ni De Gaulle, ne s'en préoccupèrent vraiment et n'engagèrent d'action pour leur venir en aide, nonobstant leurs appels au secours. Le souci premier de Charles Maurras était la survie de la France et son avenir. S’il s’en prit nommément à des personnalités juives bien déterminées pendant l’Occupation (comme à nombre d'autres), c’est qu’elles lui semblaient conduire des actions selon lui dangereuses et contraires aux intérêts de la France en guerre.
L'antisémitisme moderne, sans remonter à ses sources chrétiennes, pourtant réelles, trouve de fait son origine et son fondement dans les Lumières et l'Encyclopédie. L'on aurait bien du mal à exclure de la mémoire nationale toutes les personnalités illustres, françaises et autres, qui l'ont professé. Dont, en effet, Charles Maurras qui louait Voltaire de participer du « génie antisémitique de l’Occident ». Ce génie était de résistance intellectuelle et politique. Il n'était pas exterminateur. L'évidence est que les événements du XXe siècle ont jeté une tache sans-doute indélébile sur toute forme - même fort différente - d'antisémitisme. Cela est-il une raison pour reconnaître aux communautés juives de France ou d'ailleurs plus de droits d’influence qu’au commun des mortels ? Deux des présidents de la Ve république ne l'ont pas cru et ont parfois été taxés d'antisémitisme : le général De Gaulle, après sa conférence de presse de 1965 et ses considérations à propos d'Israël ; mais aussi François Mitterrand refusant obstinément – et en quels termes ! - de céder aux pressions des organisations juives de France, qu’il trouvait tout à fait excessives, pour qu’il présente les excuses de la France à propos de la déportation des Juifs sous l'Occupation (7). Ce que feront ses successeurs …
LE SOUTIEN A VICHY
Dernier des grands reproches adressés à Maurras : son soutien à Vichy. Nous n'avons pas l'intention de traiter longuement de ce sujet. Est-il encore pertinent ? Vichy est sans postérité. Il ne laisse ni héritage ni héritiers et n'est qu'un épisode tragique de notre histoire, conséquence incise du plus grand désastre national que la France moderne ait connu et qui aurait pu la tuer.
Il est absurde de définir Maurras comme « pétainiste ». Il était royaliste et contre-révolutionnaire. Qu'il ait pratiqué l'Union Sacrée en 1914-1918 ne le faisait pas républicain. Pas plus que son soutien au vieux maréchal ne fera de lui un pétainiste. Maurras ne fut pas davantage un « collabo » ; il détestait les Allemands qui le traitèrent en ennemi. Il refusa d’approuver la politique de collaboration. Il fut la cible des plus violentes attaques de la presse collaborationniste de Paris.
Entre la politique de Vichy - analogue à celle de la Prusse après Iéna ou de l'Allemagne de Weimar après l'autre guerre (finasser à la manière de Stresemann) - et la stratégie gaulliste de lutte contre l'occupant depuis l'étranger, l'on sait aujourd'hui laquelle des deux options l'a politiquement emporté. Ce n'était pas donné, c'était encore très incertain aux premiers jours de la Libération. Le grand historien Robert Aron, à propos de la politique de Vichy, pose cette question : « La Prusse après Iéna écrasée par un vainqueur intraitable n'a-t-elle pas su ruser elle aussi pour se relever et reprendre sa place parmi les États victorieux ? » (8). Une telle politique ne mérite ni opprobre ni infamie, fût-elle vaincue. C’est pourquoi François Mitterrand, comme nombre de ses pareils, devenu résistant, ne rompit jamais ses amitiés vichystes. Entre les deux mondes, il n’y eut de fossé infranchissable que pour les zélateurs intempérants d’après la bataille…
Y eut-il des excès de la part de Maurras au cours de la période considérée ? Sans aucun doute. Les maurrassiens sérieux n'ont jamais prétendu qu'il fût infaillible. Excès de plume surtout en un temps de tensions extrêmes où se jouait l’avenir de la Patrie. Croit-on qu'il n'y ait pas eu d'excès dans le camp d'en face ? Sous l’occupation et plus encore à la Libération ? Passons ! Car, pour en terminer, notre avis sur cette matière sensible, est que le président Pompidou fit une sage et bonne action lorsque, répondant aux critiques de ceux qui lui reprochaient la grâce qu'il avait accordée à l'ex-milicien Paul Touvier, il déclara ceci qui devrait servir de charte aux Français d’aujourd’hui : « Notre pays depuis un peu plus de 30 ans a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'Occupation et ses horreurs, la Libération, par contre-coup l'épuration, et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine. Et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs, des deux côtés, et l'exode de millions de Français chassés de leurs foyers, et du coup l'OAS, et ses attentats et ses violences et par contre-coup la répression … Alors je me sens en droit de dire : allons-nous éternellement maintenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-t-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s’aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient ? » (9)
Reste alors Charles Maurras, grand penseur, écrivain, poète, félibre, académicien et patriote français qui appartient au patrimoine national. •
1. Anatole France, poème dédicatoire pour Le Chemin de Paradis de Charles Maurras
2. Zone, Alcools, 1913
3. Emmanuel Macron, Le 1 Hebdo, 8 juillet 2015
4. Kiel et Tanger, 1910 (913, 1921 …)
5. Eric Zemmour, Figaro Magazine du 2.02.2018
6. Jean Guitton, Un siècle une vie, Robert Laffont, 1988, 361 pages
7. Jean-Pierre Elkabbach « François Mitterrand, conversation avec un Président » (1994)
8. Robert Aron, Histoire de Vichy, Fayard 1954, 766 pages
9. Conférence de presse du 21 septembre 1972.
Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien suivant ...



 Ce qu'explique ici Éric Zemmour
Ce qu'explique ici Éric Zemmour  Il est né le divin enfant ! Le troisième ! Et un garçon, encore ! La passion médiatique et populaire que suscite la naissance des enfants royaux d'Angleterre est un mystère à élucider. A une époque où les rois sont considérés comme des pantins inutiles et ridicules, traces d'un passé révolu, pourquoi s'intéresser à une monarchie millénaire ? A une époque où toute marque de hiérarchie et de verticalité est systématiquement couverte de sarcasmes ou d'insultes, comment peut-on exalter une supériorité qui ne doit rien au mérite et tout à la naissance ? A une époque où les femmes sont louées pour ce qu'elles font et méprisées pour ce qu'elles sont, comment peut-on passer en boucle le sourire au demeurant charmant d'une princesse dont le seul exploit est d'avoir donné des héritiers au trône ?
Il est né le divin enfant ! Le troisième ! Et un garçon, encore ! La passion médiatique et populaire que suscite la naissance des enfants royaux d'Angleterre est un mystère à élucider. A une époque où les rois sont considérés comme des pantins inutiles et ridicules, traces d'un passé révolu, pourquoi s'intéresser à une monarchie millénaire ? A une époque où toute marque de hiérarchie et de verticalité est systématiquement couverte de sarcasmes ou d'insultes, comment peut-on exalter une supériorité qui ne doit rien au mérite et tout à la naissance ? A une époque où les femmes sont louées pour ce qu'elles font et méprisées pour ce qu'elles sont, comment peut-on passer en boucle le sourire au demeurant charmant d'une princesse dont le seul exploit est d'avoir donné des héritiers au trône ?

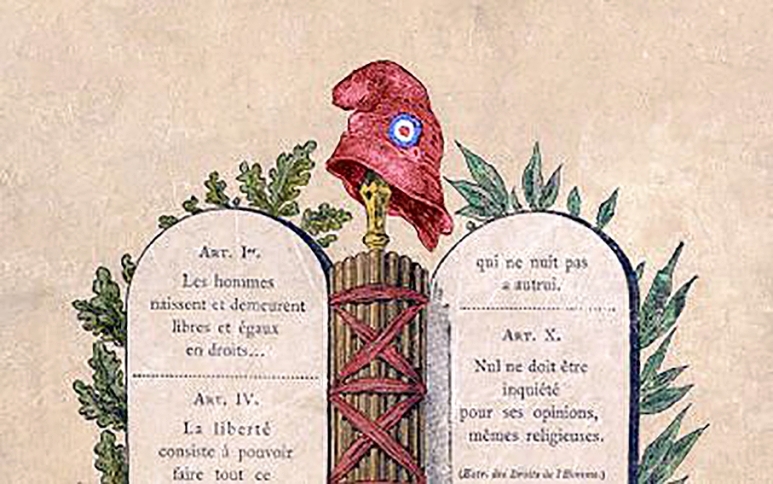
 En affirmant qu’ « un agnosticisme rigoureux à l’égard de l’idée de modernité est peut-être impraticable », Paul Ricœur, devenu quelques années après sa mort une figure intellectuelle éminente de la République macronienne, admet dans son essai La Mémoire, l’histoire, l’oubli que l’âge moderne ne correspond pas à un déclin du religieux proprement dit, mais plutôt à la transformation radicale de la manière d’appréhender la religion.
En affirmant qu’ « un agnosticisme rigoureux à l’égard de l’idée de modernité est peut-être impraticable », Paul Ricœur, devenu quelques années après sa mort une figure intellectuelle éminente de la République macronienne, admet dans son essai La Mémoire, l’histoire, l’oubli que l’âge moderne ne correspond pas à un déclin du religieux proprement dit, mais plutôt à la transformation radicale de la manière d’appréhender la religion. Voilà un essai dérangeant pour la « rien-pensance » qui régit aujourd’hui tant le « politiquement correct » que le « médiatiquement formaté », les deux piliers du nouveau façonnage sociétal qui incarnent précisément, dans ce qu’elle a de visible, « la modernité ».
Voilà un essai dérangeant pour la « rien-pensance » qui régit aujourd’hui tant le « politiquement correct » que le « médiatiquement formaté », les deux piliers du nouveau façonnage sociétal qui incarnent précisément, dans ce qu’elle a de visible, « la modernité ».









 Nous avons achevé hier la publication de l'étude magistrale de Pierre Debray parue en novembre 1985, sous le titre Une politique pour l'an 2000. On s'y reportera avec profit en utilisant les vingt-six liens ci-dessous.
Nous avons achevé hier la publication de l'étude magistrale de Pierre Debray parue en novembre 1985, sous le titre Une politique pour l'an 2000. On s'y reportera avec profit en utilisant les vingt-six liens ci-dessous.