 Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ?
Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ?
À certains égards, oui. Emmanuel Macron, très consciemment, a cherché à monopoliser l’aspiration au renouveau qui traverse la vie politique française depuis quelques années. Il s’est voulu le grand débloqueur d’une société bloquée. C’était de bonne guerre: qui n’aurait pas réclamé ce rôle ? Il s’est même cru prêt à enfiler les habits de l’homme providentiel : il se croyait assez grand pour eux. C’était peut-être un peu présomptueux.
Rappelons-nous les suites immédiates des législatives, après la victoire d’En Marche: Macron voulait manifestement rassembler dans son parti l’ensemble des volontés réformatrices. Plus encore, c’est à l’intérieur d’En Marche que devaient s’exprimer les contradictions raisonnables de la société et ses débats légitimes, Emmanuel Macron accomplissant finalement le vieux fantasme giscardien d’un parti rassemblant deux Français sur trois, dans une société purgée de ses passions tristes et renouant avec l’optimisme et le progrès. Le parti moderniste, résolument européen et partisan de la mondialisation heureuse, venait de rassembler ses troupes et de faire éclater les vieux clivages, qui le divisaient contre lui-même. Une France nouvelle, réconciliée avec son époque, allait émerger. Dans cet esprit, tout désaccord de fond avec la nouvelle présidence était assimilé à une forme d’extrémisme ou de populisme et devait être refoulé dans les marges – au mieux, c’était un reste pétrifié du monde d’hier qu’il s’agissait simplement de laisser mourir. Autrement dit, Emmanuel Macron a rêvé de recréer l’espace public en occupant tout son espace central, pour refouler ses adversaires dans la périphérie.
Il faut dire qu’il avait une situation stratégique exceptionnelle. Le paysage politique semblait en décomposition grave. Le FN s’est disqualifié lors de la présidentielle, la droite était cognée, hébétée, sonnée, groggy, la gauche classique semblait ramenée à un créneau très étroit, d’autant que Macron s’était en partie fait élire en occupant son espace politique. Macron pouvait redéfinir le jeu politique à son avantage en choisissant ses adversaires. Il y est parvenu pendant un temps en privilégiant son affrontement avec Jean-Luc Mélenchon, avec la complicité du système médiatique qui était très heureux de se débarrasser de la question identitaire, comme si sa présence dans le débat public relevait désormais d’un mauvais cauchemar dont la France serait sortie. Macron lui-même n’est pas très à l’aise sur ces questions: dans la mesure du possible, il s’en tenait éloigné.
Mais la dynamique politique était inévitablement appelée à se recomposer. Macron ne pouvait rester éternellement maître du jeu. En politique, même le plus chanceux des hommes ne dispose pas éternellement d’une conjoncture idéale.
« Il ne suffit pas d’avoir un jeune président charmant, cultivé et audacieux pour faire oublier que nos temps sont tragiques et que des questions comme l’immigration massive, par exemple, continuent de se poser brutalement à notre civilisation, comme on l’a vu cet été avec l’Aquarius. En d’autres mots, les questions politiques les plus fondamentales remontent à la surface et il faut y répondre politiquement. »
Quand il est interrogé sur l’action qu’il met en oeuvre, Emmanuel Macron situe souvent sa réponse sur le terrain des résultats et de l’efficacité, et refuse de débattre de ses idées. Quelles sont les conséquences de ce positionnement sur la vie politique française ?
 C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.
C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.
La grande question de notre temps est la question identitaire. C’est à travers elle qu’aujourd’hui, on renoue avec les fondements de la cité. Le préjugé matérialiste commun aux libéraux et aux marxistes ne doit plus nous faire écran : l’homme ne saurait se réduire à la simple gestion de ses besoins primaires, même si les questions économiques sont évidemment fondamentales. On pourrait en dire de même des questions sociétales. Encore la droite doit-elle s’emparer sérieusement de ces questions, ce que fait notamment un Bruno Retailleau, il faut le mentionner. Une question s’impose, finalement: dans quelle civilisation voulons-nous vivre ? Il importe alors de mettre en scène les désaccords fondamentaux qui aujourd’hui, émergent dans la vie publique, sans chercher à se cacher derrière un faux consensualisme.
Dans ce contexte, la droite a tout intérêt à assumer nettement son désaccord avec le président, et à ne pas se laisser intimider par ceux qui l’accusent de se « radicaliser » ou de se « droitiser »: ces accusations servent surtout à la neutraliser idéologiquement, à l’inhiber politiquement et culturellement. Elles sont normalement relayées par cette frange de la droite idéologiquement satellisée par la gauche et qui n’en finit plus de donner des gages de respectabilité au camp d’en face, pour enfin recevoir son brevet d’humanisme.
« Ceux qui voudront défier véritablement Emmanuel Macron ne devront pas simplement se présenter comme de meilleurs gestionnaires des mêmes idéaux que lui, mais marquer une différence philosophique de fond sur leur conception du monde et de la France. »
Peut-on établir un lien entre la disparition du politique et l’européanisation de notre vie politique ?
Absolument. Ce lien est même fondamental : si on ne le fait pas, on ne comprend plus rien. Dans la modernité, le cadre national permet une démocratisation du politique: c’est dans ce cadre qu’un peuple peut délibérer des finalités qu’il entend poursuivre politiquement, dans la mesure où les hommes, pour débattre, ont besoin d’un monde commun, d’un univers de sens partagé et de repères dépassant leurs désaccords. Le politique quitte alors le registre de la gestion pour s’inscrire dans celui du projet collectif, qu’on ne confondra pas avec celui de l’utopie. Philippe Seguin, en son temps, l’avait deviné : qui largue la nation largue le politique. Le préjugé habermassien qui veut que le politique, pour renaître à l’heure de la mondialisation, doive être reconstitué au niveau supranational est désavoué par la 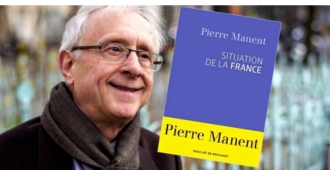 réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).
réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).
Je rappellerai un principe tout simple : la démocratie a besoin d’un peuple pour s’incarner, sans quoi, elle se dénature dans une forme de juridisme minimaliste qui laisse complètement l’aspiration des hommes à maîtriser leur destin. Et il n’y a pas de peuple européen au singulier. Dès lors, l’Europe telle qu’elle s’est construite depuis trente ans était une machine à neutraliser les peuples : pire encore, elle avait la tentation de dissoudre son être historique, comme si elle devait donner l’exemple d’un monde devant se vider de toute substance pour s’universaliser. Faut-il pour autant congédier l’Europe à la manière des Britanniques ? Si j’étais britannique, j’aurais voté en faveur du Brexit, mais la France n’est pas la Grande-Bretagne. Sa situation géopolitique n’est pas la même. Le choix n’est pas entre l’Europe des européistes et le saut vers le Frexit.
« Il faut reconstituer politiquement l’Europe, mais non pas à la manière d’une superstructure technocratique désincarnée et autoritaire neutralisant et déconstruisant ses nations. La civilisation européenne n’est pas cette masse floue, aux frontières indiscernables qui en vient à dégoûter les peuples mais une réalité historique qu’on ne parviendra à constituer politiquement qu’en respectant la diversité des peuples qui la composent, et en ne cherchant pas non plus à les homogénéiser et les standardiser bêtement. »
Il y a dans tout cela une dimension très pratique. Les souverainetés nationales sont en ce moment entravées et condamnées à l’impuissance : elles doivent se délivrer de ce qui les étouffe. Cela impliquera notamment de rompre avec le gouvernement des juges à l’européenne qui incarne une forme de despotisme droit-de-l’hommiste à la légitimité plus qu’incertaine. De ce point de vue, qui prend au sérieux la réforme de l’Europe est obligé de constater qu’à travers elle, on renoue avec la question du régime.
Un peu moins d’un an et demi après son élection, la politique de Macron est critiquée pour la première fois pour son inefficacité (chômage, croissance, immigration, couacs du prélèvement à la source, démission de Hulot…). Vit-il un tournant de son quinquennat de ce point de vue-là ?
Ce qui me frappe, en ce moment, c’est le désenchantement assez brutal d’une présidence qui avait d’abord envouté une bonne partie de la population, et même, de l’opposition. Pendant quelques mois, on ne savait pas trop comment s’opposer à Macron. Élu par la gauche, il était même parvenu, avec un certain talent, à occuper une partie l’espace symbolique du conservatisme, en restaurant la verticalité de la fonction présidentielle, et en restaurant la dimension littéraire de la parole présidentielle. Macron ne faisait pas honte. Il redonnait même une certaine fierté aux Français.
« Macron avait compris qu’il pouvait occuper une partie de l’espace de la droite à très peu de frais. De même, à coup de petites phrases bien calculées, il savait aussi occuper l’espace de la transgression. Sa popularité des derniers mois vient d’abord de là. Et c’est aussi par là qu’il déçoit, car il y a des limites à se maintenir au sommet grâce au pouvoir de l’illusion : la politique n’est pas qu’un théâtre. Un jour, la rhétorique doit se concrétiser, ou alors, elle devient exaspérante. »
Mais vous avez raison, Macron se présentait comme celui qui réussirait là où les autres ont échoué. Il débloquerait la France. Il redonnerait de la vigueur à l’action publique. C’était l’anti-décliniste en chef. Qu’en est-il ? Ne soyons pas trop sévère. On ne change pas en un an de part en part, et cela, même si on opte pour la thérapie de choc, ce que Macron n’a pas fait. Il faudra encore du temps pour évaluer les effets de ses politiques sociales et économiques, sur lesquelles il voulait être évalué, même s’il commence à s’embourber. Mais ses adversaires seront en droit de lui demander : vous pensiez restaurer l’action publique et lui redonner sa noblesse. L’avez-vous fait ? Tout dépend des attentes du commun des mortels par rapport au pouvoir. Il sait qu’il n’est pas capable de miracles : mais il espère au moins quelques décisions résolues de la part de leaders ne reculant pas à la première tempête.
Alors que les résultats sont moins au rendez-vous, Macron a-t-il touché les limites de la dépolitisation, perçue jusqu’alors comme une réponse possible à l’instabilité politique et aux blocages issus des prétendues crispations idéologiques des représentants de « l’ancien monde » ?
Nouveau monde, ancien monde, ces distinctions, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose. Nous sommes ici victimes d’une sloganisation de la pensée politique. La vie politique, qu’on le veuille ou non, met d’abord en scène les contradictions qui traversent une cité et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps ! Des hommes s’affrontent, des valeurs s’affrontent, des philosophies s’affrontent. On peut bien refouler dans les marges toutes les contradictions fondamentales: on crée alors les conditions d’une révolte « populiste » ou du moins, on favorise le retour de la fonction tribunicienne, qui donne l’illusion d’une insurrection démocratique des classes populaires, alors qu’elle consacre leur sécession civique. Emmanuel Macron ne se sauve pas de la politique et découvre même que les familles politiques issues du « monde d’hier » sont bien plus résistantes qu’on ne le croyait. Dans le monde qui est le nôtre, Emmanuel Macron découvre l’opposition et constate que ses idées sont contestées et que sa majorité est contradictoire. Si vous voulez, après l’illusion du nouveau monde, le réel reprend ses droits.
La volonté de gouverner « en même temps » pourrait-elle faire office d’idéologie si Emmanuel Macron se décidait à abandonner son discours technocrate pour « redonner du sens politique » à son action, comme le réclament certains de ses proches aujourd’hui ?
Tout gouvernement, quel qu’il soit, gouverne selon le principe du « en même temps », dans la mesure où dans la cité s’expriment des aspirations humaines contradictoires mais également légitimes. Il y a au cœur de l’homme une aspiration à l’enracinement, mais il y en a aussi une au cosmopolitisme. Il y a une aspiration à l’appartenance, mais une autre à la dissidence. Il y en a une à la liberté, et une autre à l’égalité. L’art politique consiste à composer avec ces aspirations contradictoires, en sachant qu’elles sont inégalement répandues dans la population, et que d’une époque à l’autre, elles peuvent varier dans leur intensité. Un homme politique qui voudrait enfermer le monde dans une seule idée pourrait à bon droit se faire accuser de mutiler le réel et d’étouffer la vie qui s’exprime toujours dans mille contrastes, et dans de vraies et belles contradictions.
« Cela dit, l’en-même-temps macronien semble moins se présenter comme une doctrine transcendant les pôles contradictoires de la vie politique autour d’un projet sachant donner une direction à notre époque qu’à la manière d’une doctrine s’enfermant peu à peu dans ces contradictions, sans parvenir à les surmonter. »
 Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.
Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.
Traduisons tout cela de manière prosaïque : on ne peut pas être éternellement Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa. Un jour, il faut choisir. ■
* 5.09.2018

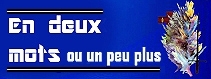
 Au Danemark, le plus sudiste des États scandinaves, le Chef de l'État est allé chercher, dit-on, un soutien à sa rêverie européiste qui n'en a quasiment plus. Mais le Danemark, le plus paisible des royaumes, entend conserver son identité, sa souveraineté, et, dans un message de Noël qui avait surpris (2016) mais fut suivi d'effets, la reine Margrethe II avait mis en garde ses compatriotes contre les dangers d'un accueil massif de migrants*. Le Danemark durcit aujourd'hui sa politique migratoire jusque-là dangereusement laxiste. Nonobstant les consignes de Bruxelles. Les mises en garde royales, pour les Danois, ont prévalu.
Au Danemark, le plus sudiste des États scandinaves, le Chef de l'État est allé chercher, dit-on, un soutien à sa rêverie européiste qui n'en a quasiment plus. Mais le Danemark, le plus paisible des royaumes, entend conserver son identité, sa souveraineté, et, dans un message de Noël qui avait surpris (2016) mais fut suivi d'effets, la reine Margrethe II avait mis en garde ses compatriotes contre les dangers d'un accueil massif de migrants*. Le Danemark durcit aujourd'hui sa politique migratoire jusque-là dangereusement laxiste. Nonobstant les consignes de Bruxelles. Les mises en garde royales, pour les Danois, ont prévalu.  Le cas de l'Espagne est différent, plus complexe. Elle est royaume depuis la nuit des temps. Si l'on additionne les années qu'ont duré ses deux républiques, fût-ce en comptant les périodes de guerre civile qu’elles ont connues et perdues, on ne dépasse pas la dizaine. Mais l'Espagne n'a jamais atteint le niveau français d'unité politique. Elle est aujourd'hui affaiblie par le séparatisme catalan et, le cas échéant, basque. La société civile espagnole est presque aussi dissoute que la nôtre et que celles de l'Occident en général. Il n'empêche : l'Espagne a vécu quarante-trois ans de paix civile depuis que la monarchie y a été rétablie (1975), quatre-vingts si l'on compte la période franquiste. Les connaisseurs de l'histoire d'Espagne sauront que depuis plusieurs siècles une aussi longue période de paix civile ne lui avait pas été donnée. Sans son roi qui l'unit tant bien que mal, il est assez probable qu'il y aurait aujourd'hui une république à Barcelone, une autre à Bilbao et peut-être à Séville, sans compter celle qui ne manquerait pas de s'instaurer à Madrid. Cela ne s'accomplirait pas dans l'ordre et la concorde. L'Espagne renouerait avec ses vieilles luttes fratricides. L'Europe que nous aimons, la vraie, s'en trouverait encore diminuée.
Le cas de l'Espagne est différent, plus complexe. Elle est royaume depuis la nuit des temps. Si l'on additionne les années qu'ont duré ses deux républiques, fût-ce en comptant les périodes de guerre civile qu’elles ont connues et perdues, on ne dépasse pas la dizaine. Mais l'Espagne n'a jamais atteint le niveau français d'unité politique. Elle est aujourd'hui affaiblie par le séparatisme catalan et, le cas échéant, basque. La société civile espagnole est presque aussi dissoute que la nôtre et que celles de l'Occident en général. Il n'empêche : l'Espagne a vécu quarante-trois ans de paix civile depuis que la monarchie y a été rétablie (1975), quatre-vingts si l'on compte la période franquiste. Les connaisseurs de l'histoire d'Espagne sauront que depuis plusieurs siècles une aussi longue période de paix civile ne lui avait pas été donnée. Sans son roi qui l'unit tant bien que mal, il est assez probable qu'il y aurait aujourd'hui une république à Barcelone, une autre à Bilbao et peut-être à Séville, sans compter celle qui ne manquerait pas de s'instaurer à Madrid. Cela ne s'accomplirait pas dans l'ordre et la concorde. L'Espagne renouerait avec ses vieilles luttes fratricides. L'Europe que nous aimons, la vraie, s'en trouverait encore diminuée.  Quant au Maroc, il suffit de songer à ce qu'il en serait advenu si l'attentat de Skhirat fomenté par la Libye de Kadhafi contre le roi Hassan II et la famille royale (1971) avait réussi, ou celui ourdi par le général Oufkir l'année suivante (attaque du Boeing du roi au-dessus du détroit de Gibraltar) ou encore si l'actuel souverain y était renversé ou tué par un quelconque complot islamiste, ce qui n’est pas une hypothèse fantaisiste... Le bienfait qu'apporte à son pays le régime monarchique marocain malgré ses défauts, saute aux yeux.
Quant au Maroc, il suffit de songer à ce qu'il en serait advenu si l'attentat de Skhirat fomenté par la Libye de Kadhafi contre le roi Hassan II et la famille royale (1971) avait réussi, ou celui ourdi par le général Oufkir l'année suivante (attaque du Boeing du roi au-dessus du détroit de Gibraltar) ou encore si l'actuel souverain y était renversé ou tué par un quelconque complot islamiste, ce qui n’est pas une hypothèse fantaisiste... Le bienfait qu'apporte à son pays le régime monarchique marocain malgré ses défauts, saute aux yeux.  amilles aristocratiques et populaires. L'Europe est l'œuvre des Habsbourg, des Hohenzollern, des Capétiens, des Savoie, des Saxe-Cobourg, des Romanov, de la Couronne britannique, etc. Et c'est dans ce qui subsiste de leur héritage que nous survivons aujourd'hui. Héritage qui fut et reste en partie superbe, même s'il ne faut pas l'idéaliser. Les démocraties ou dites telles qui, dans le sillage des Lumières, gèrent cet héritage depuis un peu plus de deux siècles, n'y ont ajouté, en tout cas de leur fait, à peu près rien de substantiel ni qui mérite l'admiration. Elles y ont retranché beaucoup. Elles ont ouvert l'ère des guerres de masse qui ont laissé le continent exsangue : de millions d'hommes sacrifiés et de richesses englouties. Elles ont coupé les peuples de leurs racines profondes, détruit, surtout en France, les communautés intermédiaires qui faisaient leur organicité ; elles veulent aujourd'hui les fondre - c'est à dire les tuer - dans la mondialisation, l'immigration massive, etc. De démocratie elles n'ont d'ailleurs que le nom : ce sont en vérité des ploutocraties. Elles nous ont fait passer, comme Maurras l'avait vu, « de l'autorité des princes de notre sang sous la verge des marchands d'or ». ** L'avilissement de la civilisation européenne et le déclin de sa puissance s'en sont inexorablement suivis.
amilles aristocratiques et populaires. L'Europe est l'œuvre des Habsbourg, des Hohenzollern, des Capétiens, des Savoie, des Saxe-Cobourg, des Romanov, de la Couronne britannique, etc. Et c'est dans ce qui subsiste de leur héritage que nous survivons aujourd'hui. Héritage qui fut et reste en partie superbe, même s'il ne faut pas l'idéaliser. Les démocraties ou dites telles qui, dans le sillage des Lumières, gèrent cet héritage depuis un peu plus de deux siècles, n'y ont ajouté, en tout cas de leur fait, à peu près rien de substantiel ni qui mérite l'admiration. Elles y ont retranché beaucoup. Elles ont ouvert l'ère des guerres de masse qui ont laissé le continent exsangue : de millions d'hommes sacrifiés et de richesses englouties. Elles ont coupé les peuples de leurs racines profondes, détruit, surtout en France, les communautés intermédiaires qui faisaient leur organicité ; elles veulent aujourd'hui les fondre - c'est à dire les tuer - dans la mondialisation, l'immigration massive, etc. De démocratie elles n'ont d'ailleurs que le nom : ce sont en vérité des ploutocraties. Elles nous ont fait passer, comme Maurras l'avait vu, « de l'autorité des princes de notre sang sous la verge des marchands d'or ». ** L'avilissement de la civilisation européenne et le déclin de sa puissance s'en sont inexorablement suivis.  Dans cette dernière hypothèse, la plus favorable, celle où nous nous ressaisirions face au danger, l'on ne donnera pas cher des régimes politiques dérisoires et faillis du genre de celui aujourd’hui établi en France. Nonobstant les velléités de verticalité et de grandeur du président Macron. Après à peine un peu plus d'un an d'exercice du pouvoir l'on voit bien au terme d'un été chaotique qu'il en a rêvé en vain. Le Système dont il procédait, qu'il était sans-doute destiné à servir, l'a déjà rattrapé. Les velléités ont fait long feu. ■
Dans cette dernière hypothèse, la plus favorable, celle où nous nous ressaisirions face au danger, l'on ne donnera pas cher des régimes politiques dérisoires et faillis du genre de celui aujourd’hui établi en France. Nonobstant les velléités de verticalité et de grandeur du président Macron. Après à peine un peu plus d'un an d'exercice du pouvoir l'on voit bien au terme d'un été chaotique qu'il en a rêvé en vain. Le Système dont il procédait, qu'il était sans-doute destiné à servir, l'a déjà rattrapé. Les velléités ont fait long feu. ■


 On aurait aimé pouvoir créditer M. El Karoui (photo) d’avoir franchi, d’un rapport à l’autre, le pas lexical qui va d’islam à islamisme et attendre en conséquence de lui certaines vérités. M. El Karoui décrit certes fort bien les modalités de propagation de la lèpre salafiste qui gangrène les si mal nommées « cités » par un maillage très intelligent, lequel allie embrigadement intellectuel par internet et embrigadement physique dans les salles de sport. Les résultats sont épouvantables comme le montrent deux exemples fournis par le quotidien La Provence du 11 septembre : 20 à 25% des musulmans de Marseille seraient salafistes ; vingt-et-un mille personnes seraient inscrites en France au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractè
On aurait aimé pouvoir créditer M. El Karoui (photo) d’avoir franchi, d’un rapport à l’autre, le pas lexical qui va d’islam à islamisme et attendre en conséquence de lui certaines vérités. M. El Karoui décrit certes fort bien les modalités de propagation de la lèpre salafiste qui gangrène les si mal nommées « cités » par un maillage très intelligent, lequel allie embrigadement intellectuel par internet et embrigadement physique dans les salles de sport. Les résultats sont épouvantables comme le montrent deux exemples fournis par le quotidien La Provence du 11 septembre : 20 à 25% des musulmans de Marseille seraient salafistes ; vingt-et-un mille personnes seraient inscrites en France au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractè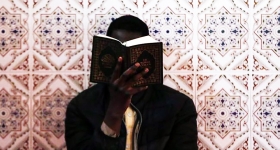 Rien d’étonnant, dès lors, si les principales propositions du rapport pèchent par hypocrisie et/ou par angélisme. Ainsi en est-il du renforcement de l’apprentissage de l’arabe dans les écoles, collèges et lycées sous prétexte qu’au cours des dernières années
Rien d’étonnant, dès lors, si les principales propositions du rapport pèchent par hypocrisie et/ou par angélisme. Ainsi en est-il du renforcement de l’apprentissage de l’arabe dans les écoles, collèges et lycées sous prétexte qu’au cours des dernières années  pas en effet, dans ce pays, de vouloir s’ingérer dans le modus vivendi de la communauté musulmane. Ainsi viennent de s’achever, ce samedi 15, les « assises territoriales de l'islam de France » : messieurs les préfets de la République étaient invités à « faire émerger des propositions inédites » pour permettre au pouvoir exécutif de donner au plus tôt « à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République » (propos de M. Macron devant le Congrès). Comment ne pas être sceptique ? On sait bien que n’ont été un succès ni le Conseil français du culte musulman fondé par M. Sarkozy ni la mission de M. Chevènement à la tête de
pas en effet, dans ce pays, de vouloir s’ingérer dans le modus vivendi de la communauté musulmane. Ainsi viennent de s’achever, ce samedi 15, les « assises territoriales de l'islam de France » : messieurs les préfets de la République étaient invités à « faire émerger des propositions inédites » pour permettre au pouvoir exécutif de donner au plus tôt « à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République » (propos de M. Macron devant le Congrès). Comment ne pas être sceptique ? On sait bien que n’ont été un succès ni le Conseil français du culte musulman fondé par M. Sarkozy ni la mission de M. Chevènement à la tête de
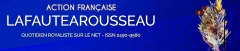 Après notre histoire, notre culture et nos paysages, les déconstructeurs s'attaquent à une autre borne séculaire de l'identité française : notre langue qui est un composant essentiel de notre liberté. Au nom du sacro-saint modernisme. « Toujours la même chanson » qui fait accepter n'importe quoi ! C'est ce qu'explique ici Éric Zemmour avec qui nous sommes cent fois d'accord. [Figaro magazine de vendredi 7 septembre] LFAR
Après notre histoire, notre culture et nos paysages, les déconstructeurs s'attaquent à une autre borne séculaire de l'identité française : notre langue qui est un composant essentiel de notre liberté. Au nom du sacro-saint modernisme. « Toujours la même chanson » qui fait accepter n'importe quoi ! C'est ce qu'explique ici Éric Zemmour avec qui nous sommes cent fois d'accord. [Figaro magazine de vendredi 7 septembre] LFAR 
 Notre chère langue française est un chef-d'œuvre en péril. Les nouvelles générations - produits de l'éducation moderniste - ignorent, voire méprisent, l'orthographe ; et torturent cruellement une syntaxe qui ne leur a rien fait. La langue française n'évolue pas, elle se désagrège. On ne peut pas lire Voltaire, Rousseau, Hugo, Chateaubriand, Balzac, Stendhal ou Proust si on abandonne les contraintes syntaxiques, grammaticales et orthographiques, qu'ils ont respectées (qui s'accorde avec contraintes !). On les condamne à devenir des oripeaux glorieux d'un passé devenu illisible, à l'instar du français ancien du Moyen Âge. Le français connaîtra alors le destin de l'anglais, devenu « globish » à force de réductions, de simplifications, langue parlée par le monde entier mais devenue médiocre langage de communication, sabir d'aéroport et de grande surface comme il y a des « muzak » d'ascenseur. Mais c'est sans doute l'objectif.
Notre chère langue française est un chef-d'œuvre en péril. Les nouvelles générations - produits de l'éducation moderniste - ignorent, voire méprisent, l'orthographe ; et torturent cruellement une syntaxe qui ne leur a rien fait. La langue française n'évolue pas, elle se désagrège. On ne peut pas lire Voltaire, Rousseau, Hugo, Chateaubriand, Balzac, Stendhal ou Proust si on abandonne les contraintes syntaxiques, grammaticales et orthographiques, qu'ils ont respectées (qui s'accorde avec contraintes !). On les condamne à devenir des oripeaux glorieux d'un passé devenu illisible, à l'instar du français ancien du Moyen Âge. Le français connaîtra alors le destin de l'anglais, devenu « globish » à force de réductions, de simplifications, langue parlée par le monde entier mais devenue médiocre langage de communication, sabir d'aéroport et de grande surface comme il y a des « muzak » d'ascenseur. Mais c'est sans doute l'objectif.

 Cette opération intervient au moment où le Brésil pleure son patrimoine détruit lors de l'incendie de l'ancien palais impérial devenu Musée national à Rio de Janeiro. « Créé en 1818 par le roi portugais João VI, il abritait notamment le squelette de Luzia, plus ancien humain découvert dans le pays, datant d'environ 11.000 ans », rapporte Le Pélerin dans son édition du 6 septembre, et environ 20 millions de pièces conservées en cet endroit ont disparu en une seule nuit, n'en laissant que cendres et regrets, colère aussi. Les raisons qui expliquent, non pas l'incendie mais son ampleur et ses conséquences dévastatrices, sont éminemment politiques, comme « les coupes budgétaires décidées par le gouvernement libéral et affectant, entre autres, l'entretien du bâtiment ». Cela doit nous alerter sur la précarité de ce qui est face aux événements toujours possibles de l'incendie, du vandalisme ou du vol, et nous inciter à prendre quelques précautions et quelques initiatives pour préserver, entretenir et, surtout, valoriser ce que nous possédons comme patrimoine physique, mais sans jamais négliger « l'esprit des choses », ce patrimoine immatériel et symbolique qui donne du sens aux monuments et aux objets d'hier et d'avant-hier.
Cette opération intervient au moment où le Brésil pleure son patrimoine détruit lors de l'incendie de l'ancien palais impérial devenu Musée national à Rio de Janeiro. « Créé en 1818 par le roi portugais João VI, il abritait notamment le squelette de Luzia, plus ancien humain découvert dans le pays, datant d'environ 11.000 ans », rapporte Le Pélerin dans son édition du 6 septembre, et environ 20 millions de pièces conservées en cet endroit ont disparu en une seule nuit, n'en laissant que cendres et regrets, colère aussi. Les raisons qui expliquent, non pas l'incendie mais son ampleur et ses conséquences dévastatrices, sont éminemment politiques, comme « les coupes budgétaires décidées par le gouvernement libéral et affectant, entre autres, l'entretien du bâtiment ». Cela doit nous alerter sur la précarité de ce qui est face aux événements toujours possibles de l'incendie, du vandalisme ou du vol, et nous inciter à prendre quelques précautions et quelques initiatives pour préserver, entretenir et, surtout, valoriser ce que nous possédons comme patrimoine physique, mais sans jamais négliger « l'esprit des choses », ce patrimoine immatériel et symbolique qui donne du sens aux monuments et aux objets d'hier et d'avant-hier. L’État ne doit pas être un simple organe d'administration économique, comme le souhaiteraient les adeptes d'un libéralisme oublieux du Bien commun et partagé ; il se doit d'être le protecteur des arts et des pierres qui fondent la nation, avant que d'en être le financier ultime si besoin est. Cela implique aussi de ne pas laisser le passé nous commander mais d'en préserver les fondations solides sans lesquelles il n'est pas d'avenir souverain possible: la France n'est pas, ne doit pas être un musée. Mais elle doit être elle-même, libre, dans une logique permanente de « tradition critique » et de « fidélité créatrice ». Le bon usage de notre riche patrimoine peut en être une illustration utile et, en tout cas, nécessaire : oublier cela serait, non seulement un risque pour la pérennité de ce qui est, mais un péril pour ce que nous sommes au regard du monde et de l'histoire...
L’État ne doit pas être un simple organe d'administration économique, comme le souhaiteraient les adeptes d'un libéralisme oublieux du Bien commun et partagé ; il se doit d'être le protecteur des arts et des pierres qui fondent la nation, avant que d'en être le financier ultime si besoin est. Cela implique aussi de ne pas laisser le passé nous commander mais d'en préserver les fondations solides sans lesquelles il n'est pas d'avenir souverain possible: la France n'est pas, ne doit pas être un musée. Mais elle doit être elle-même, libre, dans une logique permanente de « tradition critique » et de « fidélité créatrice ». Le bon usage de notre riche patrimoine peut en être une illustration utile et, en tout cas, nécessaire : oublier cela serait, non seulement un risque pour la pérennité de ce qui est, mais un péril pour ce que nous sommes au regard du monde et de l'histoire...

 Nicolas Hulot a quitté le gouvernement. C’était prévisible. Il l’a fait sans ménagement ; il a démissionné sans se présenter devant le chef de l’État ni devant le chef du gouvernement. Il s’est cru insulté ; il a insulté en retour ! Il avait le sentiment d’être un pantin, ce qui était évident. Le ministre de la Transition écologique ne peut être qu’une sorte de caution morale dans un gouvernement de techniciens, pour ne pas dire de technocrates, chargé de faire adopter des mesures économiques commandées par Bruxelles et sous la pression d’une conjoncture de moins en moins favorable. L’écologie politique n’est qu’un discours. Arrêter le nucléaire est impossible et serait suicidaire ; construire des éoliennes sur tous les horizons commence à indisposer les Français qui se sentent violenter. Le reste ne peut être que des mesurettes entre l’absurde, l’inutile, le superflu qui coûte toujours cher. Hulot n’est pas à plaindre ; il retournera à cette écologie profitable qui est sa marque de fabrique et qui lui donne de solides revenus. Son discours se vendra d’autant plus cher.
Nicolas Hulot a quitté le gouvernement. C’était prévisible. Il l’a fait sans ménagement ; il a démissionné sans se présenter devant le chef de l’État ni devant le chef du gouvernement. Il s’est cru insulté ; il a insulté en retour ! Il avait le sentiment d’être un pantin, ce qui était évident. Le ministre de la Transition écologique ne peut être qu’une sorte de caution morale dans un gouvernement de techniciens, pour ne pas dire de technocrates, chargé de faire adopter des mesures économiques commandées par Bruxelles et sous la pression d’une conjoncture de moins en moins favorable. L’écologie politique n’est qu’un discours. Arrêter le nucléaire est impossible et serait suicidaire ; construire des éoliennes sur tous les horizons commence à indisposer les Français qui se sentent violenter. Le reste ne peut être que des mesurettes entre l’absurde, l’inutile, le superflu qui coûte toujours cher. Hulot n’est pas à plaindre ; il retournera à cette écologie profitable qui est sa marque de fabrique et qui lui donne de solides revenus. Son discours se vendra d’autant plus cher. C’est si vrai que Stéphane Bern fait savoir aussi son mécontentement. Et, lui, il sait de quoi il parle : le patrimoine français, il le connaît et vraiment : villages, villes, clochers, châteaux. Il a vu, commenté, apprécié ; il défend et promeut avec sincérité, s’étant lui-même personnellement mis à la tâche. Il ne fait pas de politique : il cherche à sauver des monuments ; il essaye de trouver de l’argent ; il travaille ; il fixe des priorités. Le ministère de la Culture est dirigé n’importe comment ; y a sévi jusqu’à aujourd’hui une dame qui est en froid avec la justice, qui, enivrée par son poste, s’est crue arrivée et qui est incapable d’assurer les directions de son ministère dont plusieurs sont privées de titulaire. Le ministère ne vient pas en aide à une personnalité comme Stéphane Bern ; il dépense son maigre argent à tout-va pour des questions de prestige et sur les choix idéologiques et capricieux de Madame. Sa sotte suffisance a déjà fait démissionner la commission chargée des commémorations nationales. Maintenant, elle a décidé, pour faire plaisir aux gens d’argent – telle est la macronie –, d’écarter des décisions concernant le patrimoine les architectes des bâtiments de France : ces hauts fonctionnaires d’une remarquable culture – nous en avons encore – sont les vrais gardiens de notre patrimoine. Stéphane Bern menace de démissionner lui aussi ; il ne veut pas être condamné à jouer les utilités. Alors qui, demain, au ministère de la Culture ?
C’est si vrai que Stéphane Bern fait savoir aussi son mécontentement. Et, lui, il sait de quoi il parle : le patrimoine français, il le connaît et vraiment : villages, villes, clochers, châteaux. Il a vu, commenté, apprécié ; il défend et promeut avec sincérité, s’étant lui-même personnellement mis à la tâche. Il ne fait pas de politique : il cherche à sauver des monuments ; il essaye de trouver de l’argent ; il travaille ; il fixe des priorités. Le ministère de la Culture est dirigé n’importe comment ; y a sévi jusqu’à aujourd’hui une dame qui est en froid avec la justice, qui, enivrée par son poste, s’est crue arrivée et qui est incapable d’assurer les directions de son ministère dont plusieurs sont privées de titulaire. Le ministère ne vient pas en aide à une personnalité comme Stéphane Bern ; il dépense son maigre argent à tout-va pour des questions de prestige et sur les choix idéologiques et capricieux de Madame. Sa sotte suffisance a déjà fait démissionner la commission chargée des commémorations nationales. Maintenant, elle a décidé, pour faire plaisir aux gens d’argent – telle est la macronie –, d’écarter des décisions concernant le patrimoine les architectes des bâtiments de France : ces hauts fonctionnaires d’une remarquable culture – nous en avons encore – sont les vrais gardiens de notre patrimoine. Stéphane Bern menace de démissionner lui aussi ; il ne veut pas être condamné à jouer les utilités. Alors qui, demain, au ministère de la Culture ? Les Français se sont trompés d’homme fort : une fois de plus ! Il faudrait un gouvernement resserré et rassemblé avec de fortes personnalités, toutes vouées au seul service de la France. Car, après tout, c’est pour cet unique but qu’il existe un État français. Les Français sont lassés des discours ; ils sont indignés d’un chef de l’État qui passe sont temps à l’Étranger à les insulter. Et qui pense qu’il n’existe pas plus de Français que de Danois ! Macron lutte contre « le nationalisme », c’est sa ligne électorale, tout en étant obligé de constater que le « nationalisme » renaît partout. Concrètement, il alimente celui des autres pendant qu’il ne cesse d’affaiblir politiquement, économiquement, socialement, ce qui peut rester encore de forces françaises.
Les Français se sont trompés d’homme fort : une fois de plus ! Il faudrait un gouvernement resserré et rassemblé avec de fortes personnalités, toutes vouées au seul service de la France. Car, après tout, c’est pour cet unique but qu’il existe un État français. Les Français sont lassés des discours ; ils sont indignés d’un chef de l’État qui passe sont temps à l’Étranger à les insulter. Et qui pense qu’il n’existe pas plus de Français que de Danois ! Macron lutte contre « le nationalisme », c’est sa ligne électorale, tout en étant obligé de constater que le « nationalisme » renaît partout. Concrètement, il alimente celui des autres pendant qu’il ne cesse d’affaiblir politiquement, économiquement, socialement, ce qui peut rester encore de forces françaises.
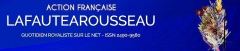


 Le tribunal d’Aix-en-Provence (photo) l’a condamné à 18 mois, dont la moitié avec sursis.
Le tribunal d’Aix-en-Provence (photo) l’a condamné à 18 mois, dont la moitié avec sursis. 


 Mais il y a beaucoup plus grave que l’illustration de cette tare chronique du jacobinisme dans les finances publiques, et Stéphane Bern a eu le courage de le mettre en lumière, en dénonçant (photo) la loi en voie de promulgation, sur les aménagements du parc immobilier dite « loi Elan».
Mais il y a beaucoup plus grave que l’illustration de cette tare chronique du jacobinisme dans les finances publiques, et Stéphane Bern a eu le courage de le mettre en lumière, en dénonçant (photo) la loi en voie de promulgation, sur les aménagements du parc immobilier dite « loi Elan».  Pour l’instant le gouvernement s’est contenté de paroles lénifiantes, telle
Pour l’instant le gouvernement s’est contenté de paroles lénifiantes, telle
 Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ?
Dans Le nouveau pouvoir, Régis Debray parle de « dépolitisation de la politique ». Emmanuel Macron a-t-il « dépolitisé » son action depuis son élection ? C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité.
C’est la posture classique de ce qu’on appelait encore hier la troisième voie, qui prétend faire une politique post-idéologique. Autrement dit, Macron reprend en ce moment la stratégie de Tony Blair (photo) , qui disait mener non pas une politique de gauche ou de droite, mais une politique efficace. La politique ne serait qu’une forme achevée de pragmatisme. C’est une manière de dissoudre la politique dans la seule gestion, et d’invisibiliser rhétoriquement le fondement philosophique de toute décision politique. Ce n’est qu’une illusion, évidemment: quoi qu’on pense, toute décision politique engage une certaine idée du monde, une certaine idée de l’homme. Et pour cela, les idées de Macron doivent être débattues. Il est nécessaire d’expliciter la philosophie macronienne, comme ont cherché à le faire chacun à leur manière Brice Couturier et Philippe Raynaud, qui en proposent une lecture à la fois favorable et convaincante dans deux ouvrages de grande qualité. 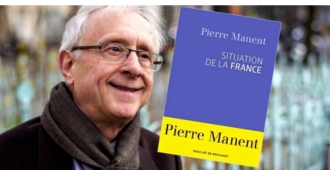 réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).
réalité : il suffit de regarder l’Europe d’aujourd’hui pour constater que le niveau national demeure celui où le politique est substantiel. C’est là où se révèle le mieux sa part sacrée. J’ajoute que les nations ne sont pas des constructions artificielles sans profondeur, que l’on pourrait déconstruire pour composer ensuite aussi artificiellement de nouvelles formes politiques. On relira sur la question les travaux essentiels de Pierre Manent (photo).  Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.
Macron parle de la psychologie profonde des peuples mais en même temps, semble croire à leur dissolution dans un grand tout mondialisé, comme si la souveraineté française devait se transvider intégralement dans la souveraineté européenne. Il célèbre la culture classique française, au point même de l’incarner de très belle manière, mais il se permet aussi des pitreries culturelles (photo) qui ne sont pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Il annonce une certaine fermeté en matière migratoire mais assimile aux passions tristes la peur de devenir étranger chez soi, qui hante aujourd’hui les peuples européens.

 A cette heure, sans-doute éviterons-nous Daniel Cohn-Bendit ministre. Mais quelle déchéance pour l'Etat, le Gouvernement, la fonction présidentielle ! Après la démission de Nicolas Hulot en direct sur France Inter, sans qu'il en ait avisé quiconque, nous aurons eu droit ce weekend au déballage médiatique de Daniel Cohn-Bendit lui-même, à son récit des propositions qui lui étaient faites pour succéder à Hulot, à l'étalage de ses états d'âme, à la confirmation (définitive ?) de son refus ... Quel luxe ! Nous n'aimons guère les mots excessifs et grandiloquents. (Toujours les mêmes !) Mais il s'agit-là d'une honte, d'un scandale dans l'Etat. D'une autre gravité que l'affaire Benalla qui a surtout excité les esprits superficiels. Que valent ces écologistes politiques ? C'est ce qu'explique ici Éric Zemmour avec qui nous sommes cent fois d'accord.
A cette heure, sans-doute éviterons-nous Daniel Cohn-Bendit ministre. Mais quelle déchéance pour l'Etat, le Gouvernement, la fonction présidentielle ! Après la démission de Nicolas Hulot en direct sur France Inter, sans qu'il en ait avisé quiconque, nous aurons eu droit ce weekend au déballage médiatique de Daniel Cohn-Bendit lui-même, à son récit des propositions qui lui étaient faites pour succéder à Hulot, à l'étalage de ses états d'âme, à la confirmation (définitive ?) de son refus ... Quel luxe ! Nous n'aimons guère les mots excessifs et grandiloquents. (Toujours les mêmes !) Mais il s'agit-là d'une honte, d'un scandale dans l'Etat. D'une autre gravité que l'affaire Benalla qui a surtout excité les esprits superficiels. Que valent ces écologistes politiques ? C'est ce qu'explique ici Éric Zemmour avec qui nous sommes cent fois d'accord.  Duflot (photo) n'avait pas réussi à s'entendre avec Valls, et comme Voynet avait passé sa vie gouvernementale à chouiner sous Jospin. Napoléon disait: «Je commande ou je me tais.» Les verts disent: «Je commande ou je pleurniche.»
Duflot (photo) n'avait pas réussi à s'entendre avec Valls, et comme Voynet avait passé sa vie gouvernementale à chouiner sous Jospin. Napoléon disait: «Je commande ou je me tais.» Les verts disent: «Je commande ou je pleurniche.»



