SOCIÉTÉ & PHILOSOPHIE POLITIQUE • ÉCOLOGIE INTÉGRALE ET IDENTITÉ

De Axel Tisserand
Le directeur adjoint de la revue Limite a publié dans Marianne une tribune, dans laquelle il réfute que l’écologie intégrale soit liée à l’identité. Est-ce contradictoire avec le titre-même de Limite qui induit la notion de frontière ? Droit de réponse par Axel Tisserand dans L'Incorrect, le 16 mai 2019.
RÉPONSE À GAULTIER BÈS
Comme Gaultier Bès de Berc [1], je n’aime guère, moi non plus, « la polémique, surtout à l’heure du numérique où la réaction précède et remplace bien souvent la réflexion ».
Comme lui aussi, je pense que « le malentendu s’éclaircit aisément pourvu qu’on fasse un peu d’histoire des idées, de manière factuelle et non biaisée. » Gaultier Bès, directeur-adjoint de la revue Limite, est revenu dans Marianne sur le concept d’ « écologie intégrale », accusée récemment d’être une écologie identitaire, notamment dansLibération [2]. Pire : « L’accusation la plus grossière (et récurrente tant une certaine parodie du journalisme se réduit à un copié-collé hâtif) concerne notre filiation supposée à Charles Maurras. » Aussi, comprenons-nous que Gaultier outragé, Gaultier brisé, Gaultier martyrisé veuille enfin se libérer d’une accusation aussi diffamatoire !
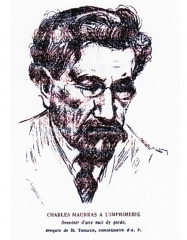 Il ne s’agit pas de reprocher à Gaultier Bès de refuser une filiation maurrassienne qui n’est sans doute pas la sienne, et c’est bien son droit !, mais, plutôt, et dans un copié-collé hâtif de tout ce qui traîne sur Maurras, de récuser cette filiation comme une souillure qui risque de devenir médiatiquement indélébile si elle n’est pas dénoncée aussitôt avec la plus extrême fermeté. Et de se placer, dans une autre filiation, celle de Maritain, qui, on le sait, après avoir été un compagnon de route de l’Action française, notamment au sein de laRevue universelle, en raison d’une « impardonnable légèreté », selon sa femme Raïssa, ce qui est tout de même une explication un peu courte, tourna casaque, en 1927, après la mise à l’index de l’Action française par le pape Pie XI à la toute fin de décembre 1926.
Il ne s’agit pas de reprocher à Gaultier Bès de refuser une filiation maurrassienne qui n’est sans doute pas la sienne, et c’est bien son droit !, mais, plutôt, et dans un copié-collé hâtif de tout ce qui traîne sur Maurras, de récuser cette filiation comme une souillure qui risque de devenir médiatiquement indélébile si elle n’est pas dénoncée aussitôt avec la plus extrême fermeté. Et de se placer, dans une autre filiation, celle de Maritain, qui, on le sait, après avoir été un compagnon de route de l’Action française, notamment au sein de laRevue universelle, en raison d’une « impardonnable légèreté », selon sa femme Raïssa, ce qui est tout de même une explication un peu courte, tourna casaque, en 1927, après la mise à l’index de l’Action française par le pape Pie XI à la toute fin de décembre 1926.
« Quoi qu’il en soit, affirme Gaultier Bès, en 1926, lorsque l’Église catholique condamne l’Action française, Maritain n’hésite pas. Il publie Primauté du spirituel pour récuser le « politique d’abord » cher à Maurras. » « N’hésite pas ? » L’assertion est imprudente, d’autant qu’il avait publié, certainement avec une « impardonnable légèreté », quelques mois plus tôt, un autre opuscule, Une opinion sur Charles Maurras et le devoir des catholiques, dans lequel, devant l’amoncellement des nuages, il démontrait, saint Thomas à l’appui, qu’il n’était pas incompatible d’être catholique et camelot du Roi… Nul ne saurait lui reprocher, en 1927, d’avoir choisi l’obéissance absolue au saint Père, mais il convient de rappeler les faits.
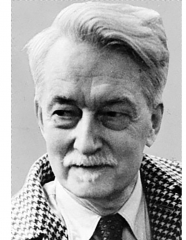 Du reste, la mise à l’index, plus que la condamnation (puisque, contrairement à ce qui arriva au Sillon de Marc Sangnier, l’Action française ne fut jamais condamnée par une encyclique), fut levée en 1939 sans que le nationalisme intégral ni le politique d’abord aient dû être biffés de la doctrine — Maritain, [Photo] avait démontré dans son premier opuscule leur totale compatibilité avec le catholicisme. Aussi, si, dix ans après, « en 1936, le philosophe Jacques Maritain publie Humanisme intégral, essai de philosophie politique chrétienne, dans lequel il s’oppose frontalement au « nationalisme intégral » du théoricien de l’Action française » — nationalisme intégral qui est, chez Maurras, et Maritain le savait, le nom de la monarchie, et non celui d’un « nationalisme exagéré » comme disaient les papes —, c’est que la pensée de Maurras devait tout de même continuer de le tarauder. Maritain y dit d’ailleurs encore son admiration pour Maurras, qualifié de combattant pertinent des « faux dogmes libéraux » et salué pour avoir opéré les nécessaires « redressements intellectuels […] dans l’ordre de la pensée politique ».
Du reste, la mise à l’index, plus que la condamnation (puisque, contrairement à ce qui arriva au Sillon de Marc Sangnier, l’Action française ne fut jamais condamnée par une encyclique), fut levée en 1939 sans que le nationalisme intégral ni le politique d’abord aient dû être biffés de la doctrine — Maritain, [Photo] avait démontré dans son premier opuscule leur totale compatibilité avec le catholicisme. Aussi, si, dix ans après, « en 1936, le philosophe Jacques Maritain publie Humanisme intégral, essai de philosophie politique chrétienne, dans lequel il s’oppose frontalement au « nationalisme intégral » du théoricien de l’Action française » — nationalisme intégral qui est, chez Maurras, et Maritain le savait, le nom de la monarchie, et non celui d’un « nationalisme exagéré » comme disaient les papes —, c’est que la pensée de Maurras devait tout de même continuer de le tarauder. Maritain y dit d’ailleurs encore son admiration pour Maurras, qualifié de combattant pertinent des « faux dogmes libéraux » et salué pour avoir opéré les nécessaires « redressements intellectuels […] dans l’ordre de la pensée politique ».
Comme le relève le maritanien Yves Floucat, Maritain n’affirmait-il pas lui-même « qu’il avait décidé de contribuer de manière décisive à la fondation de la Revue universelle “avant tout en mémoire de Pierre Villard [dont l’héritage servit à la création de la revue], et de la façon dont il a joint dans sa pensée l’œuvre et Maurras et la mienne” ? » (in Carnet de notes)
Et Gaultier Bès de partir en vrille, ou plutôt en des antinomies auxquelles Kant n’aurait sûrement pas songé : « Pour le dire autrement, ce n’est pas d’abord la France que nous défendons, mais la biosphère. Pas la nation, mais la Création. Notre ennemi n’est pas ce qui est étranger, mais ce qui est démesuré. »
Amusant, parce que s’il y a un philosophe de la limite, et du fini, c’est bien Maurras, qui en écrivit une apologie dans la préface d’Anthinéa. Amusant aussi, parce que, non seulement Maurras, mais les papes eux-mêmes, n’opposèrent jamais la création à la nation, l’un, l’agnostique, les autres, au nom de leur foi, faisant de celle-ci une médiété, entre l’homme charnel et l’humanité, et pour les seconds, du patriotisme, une vertu chrétienne, reposant, notamment, sur la lecture thomiste du 4e commandement — un saint Thomas qui, si on en croit Bès, aurait opposé Maurras à Maritain, alors que Maurras revendiqua toujours sa dette à Thomas. Et Bès, d’ajouter encore : « Car si nous prônons une relocalisation générale, ce n’est pas au nom d’une identité sacralisée, mais au nom de ce qu’Ivan Illich appelait la convivialité ».
Or l’identité ne fut jamais un concept maurrassien. On ne la trouve même pas dans le copieux Dictionnaire politique et critique, qui rassemble les notions clés de la doctrine maurrassienne. Quant à sa sacralisation, ou à celle de la nation, faut-il oublier qu’il salua dès 1914 Pie X de traiter les belligérants « avec l’égalité d’un père, comme ses propres et légitimes enfants » ou qu’il regretta en pleine bataille de Verdun la fin de cette unité humaine qu’esquissait la « République chrétienne » en Europe — un souci qu’il partageait avec Maritain ? « Nous sommes de ces nationalistes qui ne méprisent ni n’avons jamais méprisé dans les choses humaines l’humanité, l’universel ». En 1926, encore, il enseigne aux étudiants d’AF qu’ « au point de vue humain, la division de l’Europe en nations indépendantes […] n’est certainement pas un progrès. »
Et pour en finir avec la sacralisation de l’identité ou de la nation, en 1937, il exulta devant la publication par Pie XI de l’Encyclique contre le nazisme, Mit brennender Sorge : « On sait maintenant ce qui est interdit, c’est l’hitlérisme, […] c’est la métaphysique religieuse du sol et du sang ». Pour l’ « identité sacralisée », Gaultier Bès repassera…
D’autant que, tout cela, il le sait. Lors de son intervention remarquée [3] au colloque de l’Action Française en 2017 sur le Bien commun, devant le prince Jean, tout en marquant ses différences, ce qui est bien normal, et même heureux, il se plaçait dans une approche plus constructive, moins manichéenne, sachant qu’il trouvait un écho favorable parmi le public dans sa définition de la famille comme microsociété primordiale, et son refus à la fois de l’individualisme et de l’étatisme : c’est au nom de la famille précisément que Maurras refuse à la fois le contractualisme roussien et le fascisme, dont il traite la doctrine de « folie » en raison de sa statolâtrie dès 1929. Ce qui n’est en rien contradictoire avec la nécessité de penser le bien commun à l’échelle de la biosphère, la nation étant un intermédiaire entre la personne et les microsociétés (les familles et associations), d’une part, et la terre, de l’autre.
 D’ailleurs, comme l’ajoutait alors Gaultier Bès, « personne n’habite la terre, on habite tous un territoire » : tel est précisément le sens du nationalisme maurrassien. Bès ajoute alors : « Pour moi la nation est moins importante que la famille même si elles ne sont pas du tout dans mon esprit opposées. […] Je ne suis pas l’inventeur de l’expression “écologie intégrale”, pas plus d’ailleurs que le pape François, et Stéphane Blanchonnet, qui est en face de moi, l’a utilisée avant moi, et je crois que je ne te l’avais jamais dit, c’est l’occasion, je ne sais pas s’il est le premier, il le dira lui-même, mais Falk van Gaver l’avait utilisée aussi de son côté. J’ai repris une expression qui circulait déjà » — Stéphane Blanchonnet, qui est le président du comité directeur de l’AF, avait fait une conférence sur l’écologie intégrale en 2011 [4].
D’ailleurs, comme l’ajoutait alors Gaultier Bès, « personne n’habite la terre, on habite tous un territoire » : tel est précisément le sens du nationalisme maurrassien. Bès ajoute alors : « Pour moi la nation est moins importante que la famille même si elles ne sont pas du tout dans mon esprit opposées. […] Je ne suis pas l’inventeur de l’expression “écologie intégrale”, pas plus d’ailleurs que le pape François, et Stéphane Blanchonnet, qui est en face de moi, l’a utilisée avant moi, et je crois que je ne te l’avais jamais dit, c’est l’occasion, je ne sais pas s’il est le premier, il le dira lui-même, mais Falk van Gaver l’avait utilisée aussi de son côté. J’ai repris une expression qui circulait déjà » — Stéphane Blanchonnet, qui est le président du comité directeur de l’AF, avait fait une conférence sur l’écologie intégrale en 2011 [4].
Puis, après avoir explicitement paraphrasé « une formule célèbre » (« Tout ce qui est national est nôtre », la formule du duc d’Orléans reprise par l’AF ) en : « Tout ce qui est local est nôtre », de conclure : « La nation est un lieu, donc déjà une forme de relocalisation, surtout à l’ère globale ». Propos que la salle ne manqua pas d’applaudir. Propos tout à fait maurrasso-compatible.
Oui, « le malentendu s’éclaircit aisément pourvu qu’on fasse un peu d’histoire des idées, de manière factuelle et non biaisée ». Certes, il n’est pas facile, aujourd’hui, en ces temps de manichéisme, d’y échapper lorsqu’il s’agit de plaire. Mais le bushisme mental, qui consiste à identifier le camp du mal pour mieux le condamner et quémander une place dans le camp du bien est toujours une défaite de l’intelligence. C’est, en tout cas, une trahison de ladisputatio, si chère à saint Thomas. ■



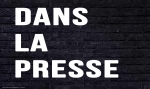


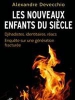

 Ce vendredi [17 mai], le prince Charles-Philippe d’Orléans, duc d’Anjou, était à Bruxelles pour rencontrer le chef indigène brésilien Raoni. Le chef Raoni vient d’entamer une tournée de trois semaines en Europe pour alerter sur la déforestation de l’Amazonie et tenter de collecter un million d’euros pour la protection de la réserve de Xingu, foyer de plusieurs communautés autochtones du Brésil, face aux menaces que font peser sur elle les exploitations forestières et les industries agroalimentaires.
Ce vendredi [17 mai], le prince Charles-Philippe d’Orléans, duc d’Anjou, était à Bruxelles pour rencontrer le chef indigène brésilien Raoni. Le chef Raoni vient d’entamer une tournée de trois semaines en Europe pour alerter sur la déforestation de l’Amazonie et tenter de collecter un million d’euros pour la protection de la réserve de Xingu, foyer de plusieurs communautés autochtones du Brésil, face aux menaces que font peser sur elle les exploitations forestières et les industries agroalimentaires. A propos du titre de duc d'Anjou
A propos du titre de duc d'Anjou

 J’ai peu de souvenir de son Blood Ties, mais son Rock’n Roll de 2017 et ce Nous finirons ensemble peuvent, selon moi, effectivement finir ensemble… au cimetière des navets, pour ne pas dire à la poubelle, avec notamment sa banalisation des couples de même sexe…
J’ai peu de souvenir de son Blood Ties, mais son Rock’n Roll de 2017 et ce Nous finirons ensemble peuvent, selon moi, effectivement finir ensemble… au cimetière des navets, pour ne pas dire à la poubelle, avec notamment sa banalisation des couples de même sexe…
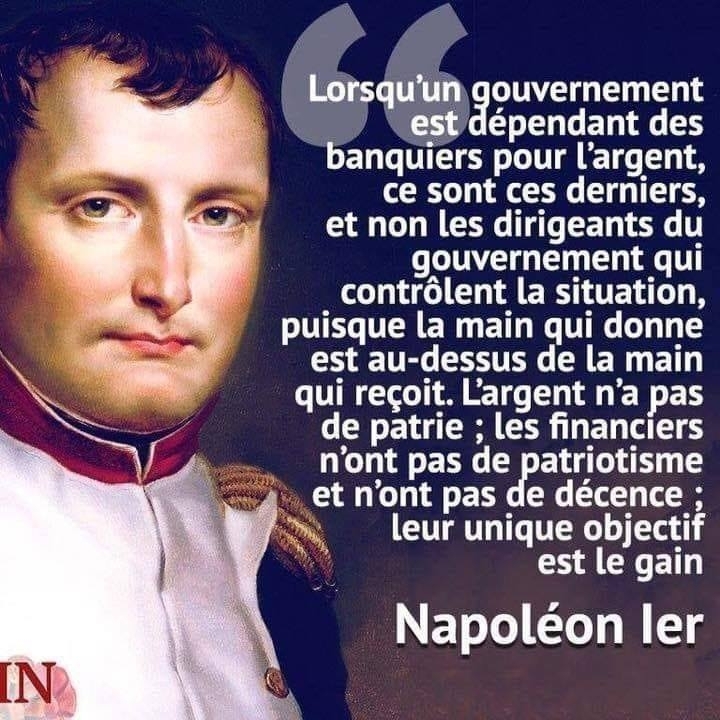

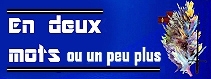



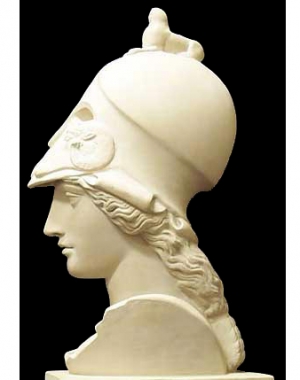 Les élections du 26 mai prochain verront en tout cas s’affronter trente-quatre listes de toutes les tendances possibles, y compris royaliste, sans que l’on sache vraiment si les débats les plus nécessaires seront abordés, et si les idées évoquées, bonnes ou mauvaises, dépasseront le petit cercle des commentateurs politiques et celui, moins restreint, des militants des listes en lice. Peut-on se satisfaire de ce constat ? Je ne crois pas, et il me semble, qu’une fois de plus, il faudra emprunter des chemins de traverse pour retrouver la voie de la passion politique, celle qui bouscule et qui fonde, celle qui peut ouvrir des perspectives, non pour le mandat court d’un député européen, mais pour les générations qui sont, qui viennent et qui viendront. Il est des enjeux que l’on ne peut méconnaître : autour du souci environnemental et de ses diverses déclinaisons ; autour de la grande question de la guerre et de la paix (les deux ne pouvant être disjointes) ; autour de la pérennité et de la transmission renouvelée d’une civilisation française qui ne peut être figée sous peine de disparaître, et du dialogue incessant avec les civilisations voisines ; autour de la place et du rôle des hommes dans le processus économique et de leurs implications sociales ; etc. Autant d’enjeux qui, aujourd’hui, ne sont qu’effleurés (dans le meilleur des cas) quand ils devraient irriguer les réflexions et les projets des listes et des candidats au Parlement européen, même s’il faut bien reconnaître que celui-ci n’a guère d’autre pouvoir que de discuter des textes préparés ailleurs et par d’autres, et de les voter ou de les refuser… Mais qu’importe ? Le débat électoral n’est-il pas là, justement, pour dépasser les seules contingences électorales et évoquer d’autres fondations possibles ?
Les élections du 26 mai prochain verront en tout cas s’affronter trente-quatre listes de toutes les tendances possibles, y compris royaliste, sans que l’on sache vraiment si les débats les plus nécessaires seront abordés, et si les idées évoquées, bonnes ou mauvaises, dépasseront le petit cercle des commentateurs politiques et celui, moins restreint, des militants des listes en lice. Peut-on se satisfaire de ce constat ? Je ne crois pas, et il me semble, qu’une fois de plus, il faudra emprunter des chemins de traverse pour retrouver la voie de la passion politique, celle qui bouscule et qui fonde, celle qui peut ouvrir des perspectives, non pour le mandat court d’un député européen, mais pour les générations qui sont, qui viennent et qui viendront. Il est des enjeux que l’on ne peut méconnaître : autour du souci environnemental et de ses diverses déclinaisons ; autour de la grande question de la guerre et de la paix (les deux ne pouvant être disjointes) ; autour de la pérennité et de la transmission renouvelée d’une civilisation française qui ne peut être figée sous peine de disparaître, et du dialogue incessant avec les civilisations voisines ; autour de la place et du rôle des hommes dans le processus économique et de leurs implications sociales ; etc. Autant d’enjeux qui, aujourd’hui, ne sont qu’effleurés (dans le meilleur des cas) quand ils devraient irriguer les réflexions et les projets des listes et des candidats au Parlement européen, même s’il faut bien reconnaître que celui-ci n’a guère d’autre pouvoir que de discuter des textes préparés ailleurs et par d’autres, et de les voter ou de les refuser… Mais qu’importe ? Le débat électoral n’est-il pas là, justement, pour dépasser les seules contingences électorales et évoquer d’autres fondations possibles ?




 « Je tiens à faire part aux Français, engagés ou non dans cette campagne, des réflexions que m’inspire la tradition millénaire que j’incarne. »
« Je tiens à faire part aux Français, engagés ou non dans cette campagne, des réflexions que m’inspire la tradition millénaire que j’incarne. »



 Cette chronique, ce sont des choses vues. Vues samedi 11 de ce mois au colloque sur l'Europe organisé par l'Action française. L'auteur est bienveillant, sympathique mais peut-être a-t-il vu surtout ce que l'on a envie de voir quand on est étudiant et jeune : la jeunesse militante, les camelots du roi, les risques d'agression, etc. Il a entrevu Buisson, et les trois jeunes intervenants à la table-ronde où il était prévu que des jeunes s'expriment. C'est tout. Ce n'est évidemment pas la réalité de ce colloque. Mais qu'importe. Peut-être Jean Bexon a-t-il tout de même vu l'essentiel lorsqu'il conclut : «
Cette chronique, ce sont des choses vues. Vues samedi 11 de ce mois au colloque sur l'Europe organisé par l'Action française. L'auteur est bienveillant, sympathique mais peut-être a-t-il vu surtout ce que l'on a envie de voir quand on est étudiant et jeune : la jeunesse militante, les camelots du roi, les risques d'agression, etc. Il a entrevu Buisson, et les trois jeunes intervenants à la table-ronde où il était prévu que des jeunes s'expriment. C'est tout. Ce n'est évidemment pas la réalité de ce colloque. Mais qu'importe. Peut-être Jean Bexon a-t-il tout de même vu l'essentiel lorsqu'il conclut : «  Par Jean Bexon, é
Par Jean Bexon, é

 lafautearousseau n'a jamais donné de consignes de vote s'il s'agit de désigner un parti politique quelconque. Nous ne le ferons pas davantage pour les prochaines européennes. Nous ne nous privons pas, toutefois, d'indiquer dans quel sens conforme à l'intérêt national il nous paraît utile de voter. C'est ce que fait l'appel ci-dessous lancé par l'Action Française en la circonstance. Voter pour une liste souverainiste dont le programme consiste à refonder un projet européen sur la base d'une alliance de nations souveraines, nous paraît être, en effet, la ligne politique qui s'impose. LFAR
lafautearousseau n'a jamais donné de consignes de vote s'il s'agit de désigner un parti politique quelconque. Nous ne le ferons pas davantage pour les prochaines européennes. Nous ne nous privons pas, toutefois, d'indiquer dans quel sens conforme à l'intérêt national il nous paraît utile de voter. C'est ce que fait l'appel ci-dessous lancé par l'Action Française en la circonstance. Voter pour une liste souverainiste dont le programme consiste à refonder un projet européen sur la base d'une alliance de nations souveraines, nous paraît être, en effet, la ligne politique qui s'impose. LFAR Élections européennes : un appel de l'Action française
Élections européennes : un appel de l'Action française
 « Depuis deux ans, tout se passe comme si Macron venait d’atterrir en France, comme un nouveau PDG qui découvre son bureau. »
« Depuis deux ans, tout se passe comme si Macron venait d’atterrir en France, comme un nouveau PDG qui découvre son bureau. »
