Par Jean-Paul Brighelli
On s'éloigne ici passablement du thème de la politesse traité précédemment. Mais on a la verdeur de la langue de Brighelli, la vigueur de sa plume, la rudesse bienvenue, décapante, de son expression, pour moquer, non sans arguments sérieux et même techniques, la « féminisation des noms de métiers, fonctions grades ou titres », le féminisme vulgaire en général, et quelques autres choses encore qui abîment notre langue, bafouent notre culture ou avilissent notre société. Il emploie pour ce faire quelques vocables assez grossiers qui choqueront peut-être certains, mais le sont, pourtant, beaucoup moins, dans le fond, que ce qu'il dénonce. Il a bien raison de le faire et l'on s'en félicite. Lafautearousseau
 13 novembre 2016. « François Hollande et Anne Hidalgo, la maire de Paris, inaugure six plaques commémorant les attentats du 13 novembre 2015 » — disent les médias à l’heure même où j’écris.
13 novembre 2016. « François Hollande et Anne Hidalgo, la maire de Paris, inaugure six plaques commémorant les attentats du 13 novembre 2015 » — disent les médias à l’heure même où j’écris.
Passons sur le fait que les médias (ni les plaques commémoratives) ne précisent au nom de quelle idéologie des terroristes ont assassiné des gens au hasard des rues. Mais « la » maire…
En décembre 1986, Frédéric Dard-San-Antonio sort la Fête des paires. L’occasion de rejouer en titre d’une ambiguïté maintes fois moquée dans l’œuvre du plus grand écrivain de langue française des trente dernières années du XXème siècle : j’ai encore le souvenir très vif d’un autre roman de la série où parlant de deux individus, il précisait : « Ils sortent du même maire, mais pas de la même paire »…
Le 6 octobre 2014, Julien Aubert, député UMP, a été sanctionné financièrement pour avoir donné du « Madame le président » à Sandrine Mazetier qui présidait l’Assemblée ce soir-là. Rappelé à l’ordre, mais récidiviste malgré tout, Julien Aubert s’est entendu dire par son interlocutrice courroucée : « Monsieur Aubert, soit vous respectez la présidence de la séance, soit il y a un problème. C’est madame LA présidente ou il y a un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ». « Faites un rappel à l’ordre. Moi j’applique les règles de l’Académie française », lui a répondu Julien Aubert. Finalement sanctionné, l’élu du Vaucluse sera privé, pendant un mois, de 1.378 euros, soit le quart de l’indemnité parlementaire.
À noter que ce n’était pas le premier accrochage entre ces deux-là. Au mois de janvier 2014, Julien Aubert avait déjà appelé Sandrine Mazetier (qui proposa jadis de débaptiser les écoles maternelles parce qu’elles trouvait que l’adjectif réduisait la femme à sa fonction reproductrice) « Madame le vice-président » — ce à quoi le député de la huitième circonscription de Paris avait cru bon d’ironiser en répliquant à celui qui avait masculinisé son titre : « Monsieur la députée, vous étiez la dernière oratrice inscrite. »
Trait d’humour, mais faute réelle contre la langue. « Député », lorsqu’il s’agit d’un représentant à l’Assemblée nationale, est une fonction, et si son genre apparent est le masculin, son genre réel est le neutre — le latin avait les trois genres, mais le français n’en a conservé que deux, confondant globalement le masculin et le neutre. Seules des féministes bornées (et non, les deux termes ne sont pas forcément synonymes, Madame de Merteuil est pour moi l’exemple-type dans la fiction de ce que peut être une féministe intelligente, et Elisabeth Badinter dans la vie réelle) l’idée de confondre le masculin — à valeur générique — et le mâle.
L’Académie a d’ailleurs réagi à cette polémique picrocholine en précisant (« La féminisation des noms de métiers, fonctions grades ou titres », mise au point publiée le 10 octobre 2014) que si elle « n’entend nullement rompre avec la tradition de féminisation des noms de métiers et fonctions qui découle de l’usage même », « elle rejette un esprit de système qui tend à imposer, parfois contre le vœu des intéressées, des formes telles que professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure, etc., pour ne rien dire de chercheure, qui sont contraires aux règles ordinaires de dérivation et constituent de véritables barbarismes. » Et de rappeler que Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss, appelés dès 1984 en consultation au chevet des féministes outr(ag)ées, après avoir noté « qu’en français comme dans les autres langues indo-européennes, aucun rapport d’équivalence n’existe entre le genre grammatical et le genre naturel » (et l’on pouvait faire confiance à Georges Dumézil pour dire des choses exactes sur les langues indo-européennes), avaient déclaré :
« En français, la marque du féminin ne sert qu’accessoirement à rendre la distinction entre mâle et femelle. La distribution des substantifs en deux genres institue, dans la totalité du lexique, un principe de classification permettant éventuellement de distinguer des homonymes, de souligner des orthographes différentes, de classer des suffixes, d’indiquer des grandeurs relatives, des rapports de dérivation, et favorisant, par le jeu de l’accord des adjectifs, la variété des constructions nominales… Tous ces emplois du genre grammatical constituent un réseau complexe où la désignation contrastée des sexes ne joue qu’un rôle mineur. Des changements, faits de propos délibéré dans un secteur, peuvent avoir sur les autres des répercussions insoupçonnées. Ils risquent de mettre la confusion et le désordre dans un équilibre subtil né de l’usage, et qu’il paraîtrait mieux avisé de laisser à l’usage le soin de modifier. »
Les deux auteurs, non sans quelque malice, soulignaient d’ailleurs qu’en français, c’est le féminin qui est le genre « marqué », ou intensif — et le masculin le genre « non marqué », ou extensif. Et que « pour réformer le vocabulaire des métiers et mettre les hommes et les femmes sur un pied de complète égalité, on devrait recommander que, dans tous les cas non consacrés par l’usage, les termes du genre dit « féminin » — en français, genre discriminatoire au premier chef — soient évités ; et que, chaque fois que le choix reste ouvert, on préfère pour les dénominations professionnelles le genre non marqué. »
En clair, non seulement « professeure » ou « auteure » sont des barbarismes répugnants, mais dire « la députée », « la ministre » — ou « la maire » — est une faute contre la République — en ce que justement la loi ne fait pas de différence entre les citoyens, et même qu’elle condamne toute discrimination à ce niveau. C’est ce qui a motivé en 1793 l’exécution d’Olympe de Gouges, qui outre ses tendances girondines avait, en proclamant « les droits de la femme et de la citoyenne », commis un crime contre le bon sens, confondant « l’homme » (« homo », en latin) de la Déclaration des droits de 1789 et le mâle (« vir »), objet de ses répulsions. Guillotiner était peut-être une sanction un peu lourde pour une confusion linguistique, d’autant que la Révolution avait omis de faire des femmes des citoyennes à part entière — mais le temps n’était pas aux demi-mesures.
Loin de moi, bien entendu, l’idée d’infliger une peine aussi lourde aux journalistes du Monde ou de Libé, qui ont traité Theresa May de « première ministre » (et la seconde, c’est qui ?), au vice-président de l’Assemblée ou au ministre de l’Education — fonctions temporaires qui existeront après leurs actuelles détentrices. Si l’usage féminise volontiers les métiers, « il résiste à étendre cette féminisation aux onctions qui sont des mandats publics ou des rôles sociaux distincts de leurs titulaires et accessibles aux hommes et aux femmes à égalité, sans considération de leur spécificité. » Vouloir à toute force dire « vice-présidente » ou « la ministre » relève d’un sexisme borné qu’un sentiment républicain vrai doit éteindre dans l’œuf.
Ces complaisances linguistiques sont l’écho servile d’un certain féminisme contemporain, promu par les « chiennes de garde » et par Mme Vallaud-Belkacem lorsqu’elle était ministre des Droits des femmes. Pas le féminisme des suffragettes, ni celui de Beauvoir ou même de Gisèle Halimi. Pas celui d’Annie Le Brun, surréaliste spécialiste de Sade (dont les héroïnes n’ont pas attendu Osez le féminisme pour « oser le clito »), qui défendant son pamphlet Lâchez tout (1977) le 10 janvier 1978 sur le plateau d’Apostrophes, dénonçait déjà « le terrorisme idéologique de la femellitude » et le « corporatisme sexuel qui nivelle toutes les différences pour imposer la seule différence des sexes ». Le féminisme imbécile de celles et ceux qui croient qu’un vagin qui monologue dit forcément des choses intelligentes — ou plus intelligentes que celles que lâche un type con comme une bite, si je puis ainsi m’exprimer. •
PS. Ce qui précède est adapté d’un ouvrage sur la langue française écrit l’été dernier, qui aurait dû paraître en novembre, puis en février, et qui ne paraîtra peut-être jamais, l’éditeur tenant apparemment à me faire payer le fait que je n’applaudisse pas frénétiquement tout ce qui sort de la Gauche au pouvoir. Ainsi va l’édition en cette France démocratico-fasciste.
Bonnet d'âne
Le blog de Jean-Paul Brighelli

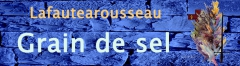 Ainsi donc ce seront François Fillon et Alain Juppé qui porteront les couleurs de ce qui s'appelle « la droite et le centre ».
Ainsi donc ce seront François Fillon et Alain Juppé qui porteront les couleurs de ce qui s'appelle « la droite et le centre ». 
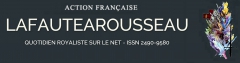 « Au secours, Maurras revient ! ». s'alarmait l'Obs, le mois dernier, dans une vidéo pour les nuls, où un journaliste indigne - François Reynaert - dressait de Charles Maurras un portrait d'une pauvreté extrême. Pauvre et faux à la fois ! Il s'agissait de faire savoir « pourquoi on doit s'inquiéter du retour de Maurras, l'idole de Patrick Buisson ». Le même Patrick Buisson qui venait de publier un ouvrage de réflexion politique profonde, connaissant un grand succès et suscitant de nombreux éloges venus de tous les bords ...
« Au secours, Maurras revient ! ». s'alarmait l'Obs, le mois dernier, dans une vidéo pour les nuls, où un journaliste indigne - François Reynaert - dressait de Charles Maurras un portrait d'une pauvreté extrême. Pauvre et faux à la fois ! Il s'agissait de faire savoir « pourquoi on doit s'inquiéter du retour de Maurras, l'idole de Patrick Buisson ». Le même Patrick Buisson qui venait de publier un ouvrage de réflexion politique profonde, connaissant un grand succès et suscitant de nombreux éloges venus de tous les bords ...  Chose étonnante pour certains : l'influence et l'attrait que Maurras exerce aussi aujourd'hui sur une nouvelle jeunesse, nombreuse et ardente. Ainsi celle qui s'est rassemblée, avec quelques anciens, à Roquevaire, ce samedi [19.11] et qui s'est rendue en cortège à travers les rues de la petite ville provençale sur son tombeau pour un hommage fervent. (Illustration en titre).
Chose étonnante pour certains : l'influence et l'attrait que Maurras exerce aussi aujourd'hui sur une nouvelle jeunesse, nombreuse et ardente. Ainsi celle qui s'est rassemblée, avec quelques anciens, à Roquevaire, ce samedi [19.11] et qui s'est rendue en cortège à travers les rues de la petite ville provençale sur son tombeau pour un hommage fervent. (Illustration en titre). 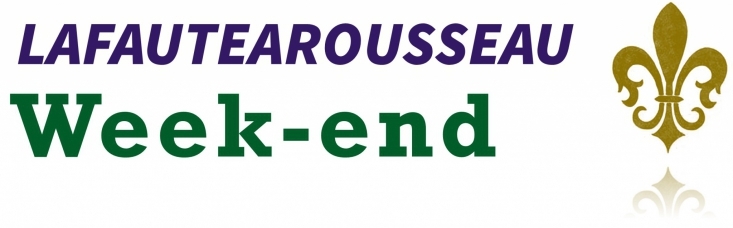



 Rares sont ceux, probablement, qui n'abordent pas avec une certaine perplexité la querelle entourant la place accordée ou non à la crèche dans les bâtiments publics. Non pas qu'elle soit sans intérêt : au contraire, cette querelle pose la question du rapport de la nation française avec le catholicisme, qui l'a marqué d'une profonde empreinte, et qui est encore agissant en elle, malgré la sacralisation de la laïcité républicaine. N'est-il pas légitime que l'identité historique d'une nation s'inscrive de différentes manières au cœur de ses institutions ? En fait, on se demande comment on peut voir dans la présence publique de ce symbole un scandale, à une époque où le catholicisme n'a plus rien de conquérant et semble surtout demander qu'on reconnaisse sa valeur patrimoniale. Faut-il vraiment s'offusquer de cette trace visible de la religion du pays dans ses institutions ? La crèche compromet-elle sérieusement la laïcité ? Qui s'imagine vraiment que le catholicisme français témoignerait ici d'un fantasme de la restauration ?
Rares sont ceux, probablement, qui n'abordent pas avec une certaine perplexité la querelle entourant la place accordée ou non à la crèche dans les bâtiments publics. Non pas qu'elle soit sans intérêt : au contraire, cette querelle pose la question du rapport de la nation française avec le catholicisme, qui l'a marqué d'une profonde empreinte, et qui est encore agissant en elle, malgré la sacralisation de la laïcité républicaine. N'est-il pas légitime que l'identité historique d'une nation s'inscrive de différentes manières au cœur de ses institutions ? En fait, on se demande comment on peut voir dans la présence publique de ce symbole un scandale, à une époque où le catholicisme n'a plus rien de conquérant et semble surtout demander qu'on reconnaisse sa valeur patrimoniale. Faut-il vraiment s'offusquer de cette trace visible de la religion du pays dans ses institutions ? La crèche compromet-elle sérieusement la laïcité ? Qui s'imagine vraiment que le catholicisme français témoignerait ici d'un fantasme de la restauration ?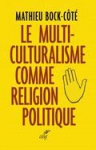 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'
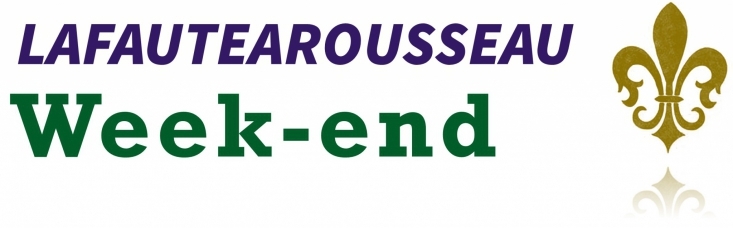
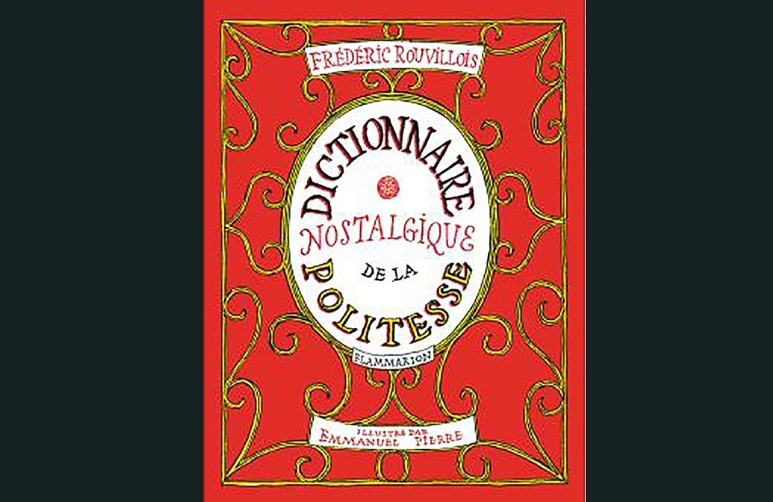
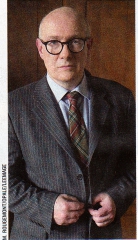

 13 novembre 2016. « François Hollande et Anne Hidalgo, la maire de Paris, inaugure six plaques commémorant les attentats du 13 novembre 2015 » — disent les médias à l’heure même où j’écris.
13 novembre 2016. « François Hollande et Anne Hidalgo, la maire de Paris, inaugure six plaques commémorant les attentats du 13 novembre 2015 » — disent les médias à l’heure même où j’écris.
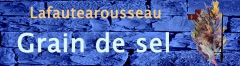 Ils voulaient tous tellement bien faire - ou, plutôt, ne pas mal faire - qu'on aurait dit qu'ils s'étaient rognés les ongles et que, de fait, ils se retenaient pour ne pas faire de faute : résultat, un moment long, très long, de sept monologues en même temps, à peine coupés par moments d'un - rare - bon mot ou de ce que l'on espéra jusqu'au bout, mais en vain, voir devenir un réel débat entre eux...
Ils voulaient tous tellement bien faire - ou, plutôt, ne pas mal faire - qu'on aurait dit qu'ils s'étaient rognés les ongles et que, de fait, ils se retenaient pour ne pas faire de faute : résultat, un moment long, très long, de sept monologues en même temps, à peine coupés par moments d'un - rare - bon mot ou de ce que l'on espéra jusqu'au bout, mais en vain, voir devenir un réel débat entre eux... Pour ce qui est d'Elkabbach, il aurait mieux fait de suivre l'injonction restée célèbre - au point, maintenant, d'appartenir à l'histoire, du moins celle du journalisme - de Georges Marchais : « Taisez-vous, Elkabbach !». S'il s'était tu, au moment où il a cru finaud de s'en prendre à Bruno Le Maire, le décrétant déjà éliminé, il se serait évité le juste « recadrage » de ce dernier :
Pour ce qui est d'Elkabbach, il aurait mieux fait de suivre l'injonction restée célèbre - au point, maintenant, d'appartenir à l'histoire, du moins celle du journalisme - de Georges Marchais : « Taisez-vous, Elkabbach !». S'il s'était tu, au moment où il a cru finaud de s'en prendre à Bruno Le Maire, le décrétant déjà éliminé, il se serait évité le juste « recadrage » de ce dernier :

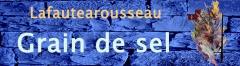 Effrayant et inquiétant : que dire d'autre, après avoir pris connaissance du dernier rapport du Secours Catholique sur l'inexorable montée de la pauvreté en France ?
Effrayant et inquiétant : que dire d'autre, après avoir pris connaissance du dernier rapport du Secours Catholique sur l'inexorable montée de la pauvreté en France ? 
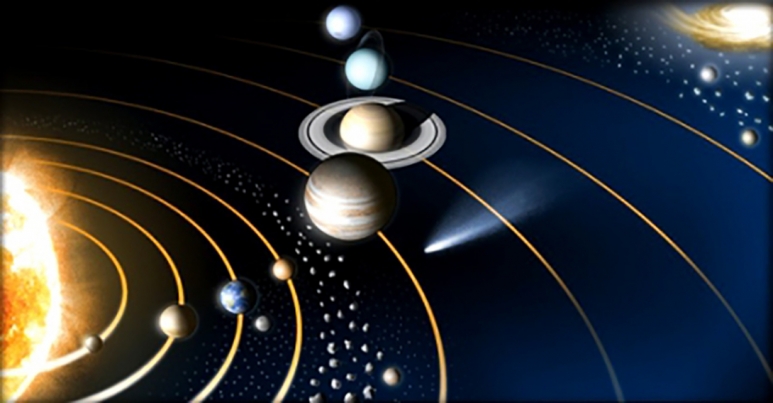
 La question – évidemment importante et légitime - nous a été posée dans les commentaires : « Le "Système" et sa contestation sont à l'ordre du jour. S'agit-il là d'une tendance lourde ? (…) Il est temps d'éclairer les uns et les autres sur ce que nous nommons " le système ". (…) Pour lutter contre le Système, (…) encore faut-il le définir avec plus de précisions et en dessiner finement le contour.» Mais la réponse ne va pas de soi. Même si, « aujourd'hui, la contestation du Système se généralise massivement et si on ne peut donc pas nier que le terme soit "ressenti".»
La question – évidemment importante et légitime - nous a été posée dans les commentaires : « Le "Système" et sa contestation sont à l'ordre du jour. S'agit-il là d'une tendance lourde ? (…) Il est temps d'éclairer les uns et les autres sur ce que nous nommons " le système ". (…) Pour lutter contre le Système, (…) encore faut-il le définir avec plus de précisions et en dessiner finement le contour.» Mais la réponse ne va pas de soi. Même si, « aujourd'hui, la contestation du Système se généralise massivement et si on ne peut donc pas nier que le terme soit "ressenti".»