Entretien par Eugénie Bastié
Laurent Dandrieu réagit ici à la publication d'un texte dans lequel le pape François va très loin dans la défense des migrants [Figarovox, 22.08]. Il déplore le désintérêt du souverain pontife pour les pays qui les accueillent. Lafautearousseau, de son côté (voir lien en fin d'article) a marqué son désaccord avec ces déclarations. Lorsque le Pape empiète sue le terrain politique et lorsque, ce faisant, il nuit gravement à la sécurité ou à la stabilité de notre société, nous n'avons aucunement l'obligation de le suivre et, au contraire, en de tels cas, nous avons le devoir de nous y opposer. LFAR
 Le pape François vient de publier un texte où il plaide pour «faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale», et appelle à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos? Sont-ils inédits ?
Le pape François vient de publier un texte où il plaide pour «faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale», et appelle à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos? Sont-ils inédits ?
Il me semble que ce message qui vient d'être publié en préparation de la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018, qui aura lieu le 14 janvier prochain, est dans la droite ligne des positions défendues par le pape François depuis le début de son pontificat, mais qu'il va cependant plus loin que d'habitude sur un certain nombre de points. Dans un entretien accordé à une radio portugaise le 14 septembre 2015, par exemple, le pape reconnaissait le risque d'infiltration terroriste lié à la crise des migrants, mais n'en ajoutait pas moins qu'« à l'évidence, si un réfugié arrive, en dépit de toutes les précautions liées à la sécurité, nous devons l'accueillir, car c'est un commandement de la Bible ». Quand, dans ce nouveau message, François écrit que « le principe de la centralité de la personne humaine (…) nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale », il donne en quelque sorte une version plus théorique de cette précédente déclaration.
La question est de savoir si, ce faisant, il ne cède pas à un certain idéalisme, potentiellement désastreux : car c'est oublier que la sécurité nationale est le plus sûr rempart de la sécurité personnelle, et qu'il n'existe aucune sécurité personnelle qui puisse exister en dehors de cadres politiques, juridiques et légaux qui en sont le rempart. Aucune sécurité personnelle ne peut exister si les nations occidentales, par exemple, du fait du terrorisme ou d'une immigration incontrôlée et ingérable, basculent dans l'anarchie.
Par ailleurs, le principe de la centralité de la personne humaine oblige à considérer, aussi, que les citoyens des nations occidentales ont un droit évident à la sécurité nationale. On attend vainement, tout au long de ce texte, une prise en considération des intérêts des populations des pays d'accueil, qui ont droit, eux aussi, à la sollicitude de l'Église, et dont une partie de plus en plus importante vit, elle aussi, des situations de grande détresse et de grande précarité, matérielle, spirituelle et morale.
Deuxième élément important et pour le coup très novateur de ce texte : le pape prend position pour « la défense des droits et de la dignité des migrants ainsi que des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire » : ce qui veut dire qu'il réclame des droits égaux pour les clandestins et pour les immigrants légaux, pour les demandeurs d'asile et pour les immigrés économiques. Parmi ces droits figurent « la liberté de mouvement dans le pays d'accueil, la possibilité de travailler et l'accès aux moyens de télécommunication »: ce qui veut dire, concrètement, que le pape réclame un droit d'installation préalable pour tous les migrants, avant même que soit étudié leur cas. Ce qui revient à donner une prime à l'illégalité d'autant plus forte qu'il est évident qu'un clandestin qui, entre-temps, aura trouvé un moyen de subsistance, aura d'autant moins de chance de voir son dossier rejeté. Cette prime à l'illégalité me paraît une seconde atteinte, très forte, contre les droits des nations et la citoyenneté: car la nation, la citoyenneté n'existent que par un consensus sur la légitimité de la loi. Si on postule que la loi est faite pour être contournée, il n'y a plus de bien commun possible.
Ce discours a-t-il selon vous une dimension politique ?
Un autre aspect du message me semble clarifier ce qui apparaissait jusqu'alors une ambiguïté dans le discours de François. Il prônait jusqu'alors une grande générosité dans l'accueil, sans que l'on sache toujours si cela signifiait un simple rappel évangélique de la charité avec laquelle le chrétien se doit de traiter l'étranger croisé sur sa route, ce qui relève à l'évidence du rôle du pape, ou s'il s'agissait d'un appel plus politique, et donc plus discutable, à ouvrir les frontières. En stipulant que la protection des migrants « commence dans le pays d'origine », c'est-à-dire consiste à les accompagner à la source dans leur désir de migrer, le pape assume plus clairement que jamais la dimension politique de ce discours, la volonté de ne pas se cantonner à affronter une situation de fait, mais en quelque sorte d'accompagner et d'encourager ce mouvement migratoire vers l'Europe.
Dernière clarification : en stipulant que les migrants doivent être mis en situation de se réaliser y compris dans leur dimension religieuse, le pape François donne une sorte de blanc-seing à l'entrée massive de populations de religion musulmane et à l'acclimatation de la religion musulmane sur le continent européen, en semblant indifférent aux innombrables problèmes identitaires et sécuritaires que cela pose.
La position de François tranche-t-elle avec celle de ses prédécesseurs, et notamment celle de Benoit XVI ? Que dit l'Église sur le devoir d'accueillir les migrants?
La continuité est indéniable, et est attestée dans ce message par des nombreuses citations de son prédécesseur. Quand le pape prône le regroupement familial, au risque de transformer systématiquement les réfugiés temporaires en immigrés permanents, il ne fait que reprendre des positions défendues inlassablement, par exemple, par Jean-Paul II et Benoît XVI, comme je le montre abondamment dans mon livre.
Le discours de l'Église, en son Catéchisme, reconnaît à la fois le droit de migrer quand la nécessité s'en fait sentir, et le droit des États de limiter les flux quand ils l'estiment nécessaire. Mais, dans les faits, le discours des papes oublie fréquemment ce second aspect. Il l'oublie d'autant plus volontiers que l'Église a souvent cédé à une vision quasi messianique des phénomènes migratoires, censés conduire vers « l'unité de la famille humaine », selon l'expression de Jean XXIII. Jean-Paul II écrit ainsi que « parmi toutes les expériences humaines, Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption de l'homme », et Benoît XVI y voit une « préfiguration anticipée de la cité sans frontières de Dieu ». Face à cela, la protection de la population des pays d'accueil est condamnée à peser de peu de poids, et de fait, elle est quasiment absente du regard que l'Église pèse sur les phénomènes migratoires. En face de cela, l'Église prône inlassablement l'intégration du Migrant, avec un grand M, sans se poser la question de savoir concrètement qui est ce migrant, et si le fait qu'il vienne, en grand nombre, avec un bagage culturel et religieux radicalement différent du nôtre, et dans certains cas incompatible avec le nôtre, ne rend pas cette intégration pour le moins illusoire.
L'État nation et l'existence de frontières se justifient-ils d'un point de vue théologique?
Bien évidemment, car c'est une suite logique du commandement d'honorer son père et sa mère. Saint Thomas d'Aquin écrit qu'« il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie » et, à la suite de saint Augustin, stipule qu'on doit la charité en priorité à ceux qui nous sont proches par les liens du sang ou de la citoyenneté. Léon XIII écrit que « la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement le pays où nous sommes nés et où nous avons été élevés », et Pie XII enseigne que « dans l'exercice de la charité il existe un ordre établi par Dieu, selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le Divin maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'imminente destruction de la Cité sainte.»
Plus récemment, Jean-Paul II a abondamment développé cette « théologie des nations », des nations qu'il ne voit pas seulement comme un bien politique, un outil au service du bien commun, mais à qui il reconnaît une dignité spirituelle éminente : la nation, explique-t-il, de toutes les communautés humaines, est « la plus importante pour l'histoire spirituelle de l'homme ». Il va même jusqu'à dire que « la fidélité à l'identité nationale possède aussi une valeur religieuse. » De là, on peut évidemment déduire que les nations ont un droit irrépressible à défendre leur identité nationale face aux menaces extérieures, comme une immigration incontrôlée et inintégrable.
« L'intégration n'est pas une assimilation qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle », a aussi dit le pape. Y a-t-il position traditionnelle de l'église en matière d'assimilation ?
Cette condamnation de l'assimilation, au nom du respect de la culture d'origine de l'immigré, est malheureusement une constante dans le discours de l'Église sur l'immigration. Jean-Paul II va jusqu'à la renvoyer dos à dos avec des politiques de discrimination allant jusqu'à l'apartheid : « On doit en effet exclure aussi bien les modèles fondés sur l'assimilation, qui tendent à faire de celui qui est différent une copie de soi-même, que les modèles de marginalisation des immigrés, comportant des attitudes qui peuvent aller jusqu'aux choix de l'apartheid. » Je dis « malheureusement », car on ne voit pas bien, dès lors, malgré les appels répétés de l'Église à une politique d'intégration, comment l'appel de la hiérarchie catholique à un accueil généreux des migrants pourrait ne pas déboucher sur un multiculturalisme, d'ailleurs parfaitement assumé par le pape François.
Le problème est que ce multiculturalisme aboutit dans les faits à un refus de considérer la culture du pays d'accueil comme une culture de référence, et rend de facto l'intégration illusoire. Sous la pression de l'immigration de masse et de l'idéologie multiculturaliste, les sociétés occidentales se réduisent de plus en plus à une juxtaposition de communautés d'origines, de cultures et de religions différentes, qui se regardent en chiens de faïence faute d'avoir de référence commune, autre que de très vagues principes abstraits, tels que cette « culture de la rencontre » à laquelle le pape François tend à réduire l'identité européenne. Le bien commun, faute de valeurs partagées, se réduit ainsi à un vivre ensemble qui, de plus en plus, tourne dans la réalité à un apartheid de fait. Soit le contraire du but recherché, et une catastrophe civilisationnelle majeure en germe tant pour les peuples européens que pour les populations immigrées. •
Laurent Dandrieu est rédacteur en chef des pages Culture à Valeurs Actuelles. Il a publié Église et immigration, le grand malaise. Le pape et le suicide de la civilisation européenne, de Laurent Dandrieu. Presses de la Renaissance, 288 p., 17,90 €.

Eugénie Bastié
Journaliste & essayiste - Sa biographie
A lire aussi dans Lafautearousseau ...
Désolés, Saint-Père, nous ne sommes pas d'accord

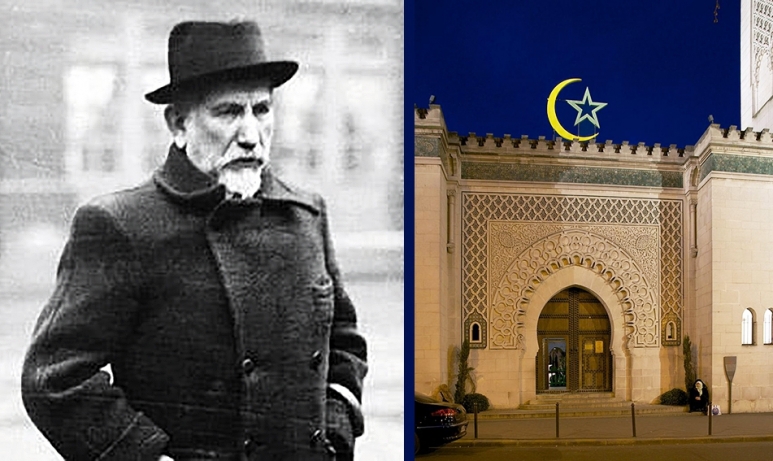
 On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays.
On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays. « Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... Nous venons de commettre le crime d’excès. Fasse le ciel que nous n’ayons pas à le payer avant peu et que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse. »
« Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... Nous venons de commettre le crime d’excès. Fasse le ciel que nous n’ayons pas à le payer avant peu et que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse. »





 Nous allons donc conclure - provisoirement - notre série de réflexions [Cf. liens en fin d'article] sur quelques points d'Histoire importants des rapports Islam-Europe.
Nous allons donc conclure - provisoirement - notre série de réflexions [Cf. liens en fin d'article] sur quelques points d'Histoire importants des rapports Islam-Europe.  « ... Les écrivains du XVIIIème siècle se sont plu à représenter les Croisades sous un jour odieux. J'ai réclamé un des premiers contre cette ignorance ou cette injustice. Les Croisades ne furent des folies, comme on affectait de les appeler, ni dans leur principe, ni dans leur résultat. Les Chrétiens n'étaient point les agresseurs. Si les sujets d'Omar, partis de Jérusalem, après avoir fait le tour de l'Afrique, fondirent sur la Sicile, sur l'Espagne, sur la France même, où Charles Martel les extermina, pourquoi des sujets de Philippe Ier, sortis de la France, n'auraient-ils pas faits le tour de l'Asie pour se venger des descendants d'Omar jusque dans Jérusalem ?
« ... Les écrivains du XVIIIème siècle se sont plu à représenter les Croisades sous un jour odieux. J'ai réclamé un des premiers contre cette ignorance ou cette injustice. Les Croisades ne furent des folies, comme on affectait de les appeler, ni dans leur principe, ni dans leur résultat. Les Chrétiens n'étaient point les agresseurs. Si les sujets d'Omar, partis de Jérusalem, après avoir fait le tour de l'Afrique, fondirent sur la Sicile, sur l'Espagne, sur la France même, où Charles Martel les extermina, pourquoi des sujets de Philippe Ier, sortis de la France, n'auraient-ils pas faits le tour de l'Asie pour se venger des descendants d'Omar jusque dans Jérusalem ?

 Dès 1353, la dynastie turque des Ottomans, fondée par Osman 1er, prit pied en Europe : c'est en effet cette année-là que, follement appelé à l'aide par l'usurpateur Jean Cantacuzène, et jouant pleinement des dissensions suicidaires des chrétiens de l'Empire byzantin, le successeur d'Osman fonda à Gallipoli le premier établissement turc en Europe.
Dès 1353, la dynastie turque des Ottomans, fondée par Osman 1er, prit pied en Europe : c'est en effet cette année-là que, follement appelé à l'aide par l'usurpateur Jean Cantacuzène, et jouant pleinement des dissensions suicidaires des chrétiens de l'Empire byzantin, le successeur d'Osman fonda à Gallipoli le premier établissement turc en Europe. Avec
Avec Ecoutons Michel Mourre : » Jusque vers 1700, les Turcs devaient rester un danger permanent pour l'Europe chrétienne. Sous Mehmet II, ils poursuivirent leur avance dans toutes les directions. Vers l'Ouest, en s'emparant de la Bosnie (1463) et de l’Albanie, où Skanderbeg leur avait opposé une longue résistance ; du côté de la mer Noire, en enlevant la Crimée aux Génois (1475) ; du côté de l'Arménie, en liquidant l’Etat grec de Trébizonde (1461). L'une après l'autre, les places génoises et vénitiennes de la mer Egée et de la Morée [Péloponnèse], passaient aux mains des Ottomans, qui commençaient à mener la guerre à la fois sur mer et sur terre et s'installaient même à Otrante, en Italie du Sud (1480) ...»
Ecoutons Michel Mourre : » Jusque vers 1700, les Turcs devaient rester un danger permanent pour l'Europe chrétienne. Sous Mehmet II, ils poursuivirent leur avance dans toutes les directions. Vers l'Ouest, en s'emparant de la Bosnie (1463) et de l’Albanie, où Skanderbeg leur avait opposé une longue résistance ; du côté de la mer Noire, en enlevant la Crimée aux Génois (1475) ; du côté de l'Arménie, en liquidant l’Etat grec de Trébizonde (1461). L'une après l'autre, les places génoises et vénitiennes de la mer Egée et de la Morée [Péloponnèse], passaient aux mains des Ottomans, qui commençaient à mener la guerre à la fois sur mer et sur terre et s'installaient même à Otrante, en Italie du Sud (1480) ...» 




 Etre un bon élève n'est rien si on ne creuse ses talents , non pour plaire à ses maîtres , mais pour répondre à sa vraie vocation, en les étonnant.
Etre un bon élève n'est rien si on ne creuse ses talents , non pour plaire à ses maîtres , mais pour répondre à sa vraie vocation, en les étonnant. 

 François Bousquet est journaliste et écrivain. Il participe à la revue Éléments. Il a publié une biographie de l'écrivain pamphlétaire Jean-Edern Hallier. Il a publié récemment
François Bousquet est journaliste et écrivain. Il participe à la revue Éléments. Il a publié une biographie de l'écrivain pamphlétaire Jean-Edern Hallier. Il a publié récemment  Alexandre Devecchio
Alexandre Devecchio
 Bravo à cet ancien principal de collège des quartiers nord de Marseille pour avoir écrit ce livre coup de poing qui pointe les dangers de l'emprise de l'Islam sur les adolescents et appelle à en finir avec la loi du silence.
Bravo à cet ancien principal de collège des quartiers nord de Marseille pour avoir écrit ce livre coup de poing qui pointe les dangers de l'emprise de l'Islam sur les adolescents et appelle à en finir avec la loi du silence. 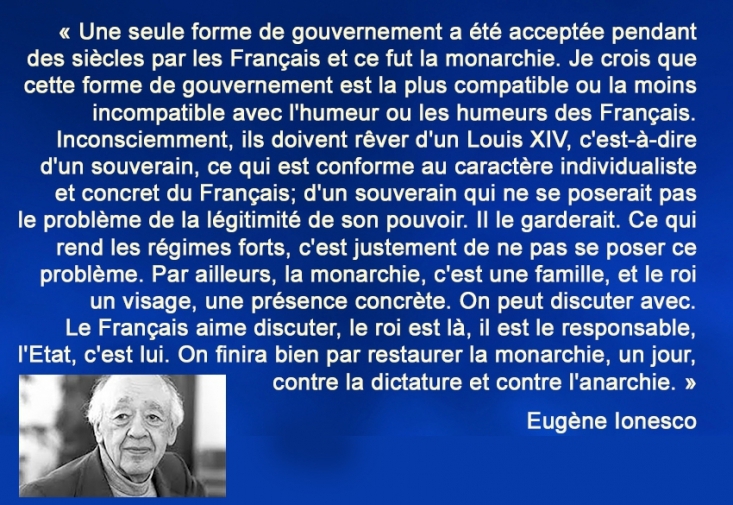

 Après sa fulgurante conquête du pouvoir, balayant les caciques et les candidats du Système, les vieilles structures partisanes, ce dont personne ne s'est plaint et que nul ne regrette, en tout cas pas nous, voici déjà pour Emmanuel Macron le temps de la défiance et du déclin.
Après sa fulgurante conquête du pouvoir, balayant les caciques et les candidats du Système, les vieilles structures partisanes, ce dont personne ne s'est plaint et que nul ne regrette, en tout cas pas nous, voici déjà pour Emmanuel Macron le temps de la défiance et du déclin. 
 Le pape François vient de publier un texte où il plaide pour «faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale», et appelle à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos? Sont-ils inédits ?
Le pape François vient de publier un texte où il plaide pour «faire passer la sécurité personnelle [des migrants] avant la sécurité nationale», et appelle à un accueil beaucoup plus large des migrants. Que vous inspirent ces propos? Sont-ils inédits ?