Michel Houellebecq : « Les enfants de pauvres n'ont pas peur de la gauche »
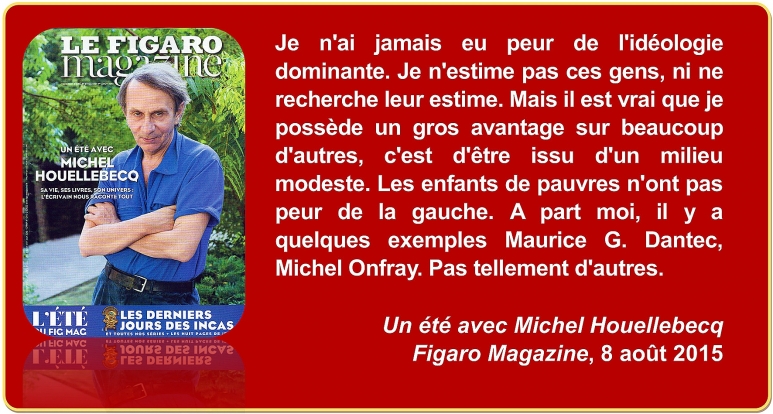
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
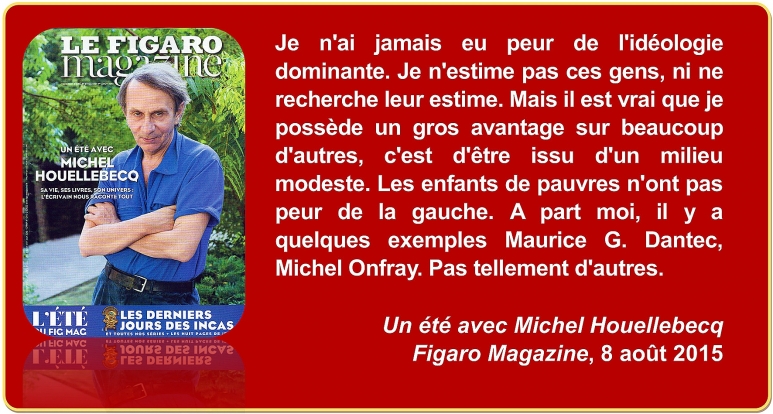

Une remarquable chronique de Jérôme Leroy, écrivain et rédacteur en chef culture de Causeur.
 On réédite un Michel Déon pour l’été. C’est toujours une bonne idée de rééditer un Déon, surtout avec un joli bandeau de Loustal. Déon nous rappelle l’époque, pas si lointaine, où le succès public n’était pas forcément contradictoire avec la qualité littéraire. Et comme tout allait ensemble, cela donnait de très bons films quand on adaptait au cinéma un roman de Déon: Un taxi mauve de Boisset avec Noiret, Rampling, Fred Astaire et l’Irlande dans le rôle principal, vous vous souvenez? En plus, il y avait quelque chose de plaisant à voir un cinéaste de gauche adapter un écrivain de droite. Si vous voulez trouver l’équivalent aujourd’hui, vous pouvez toujours chercher. Le goût vécu comme manière de dépasser les clivages politiques, c’est une idée qui a dû mourir à l’orée des années 80, la décennie où tout le monde est devenu très moral tout en choisissant le pognon et la réussite comme valeurs cardinales.
On réédite un Michel Déon pour l’été. C’est toujours une bonne idée de rééditer un Déon, surtout avec un joli bandeau de Loustal. Déon nous rappelle l’époque, pas si lointaine, où le succès public n’était pas forcément contradictoire avec la qualité littéraire. Et comme tout allait ensemble, cela donnait de très bons films quand on adaptait au cinéma un roman de Déon: Un taxi mauve de Boisset avec Noiret, Rampling, Fred Astaire et l’Irlande dans le rôle principal, vous vous souvenez? En plus, il y avait quelque chose de plaisant à voir un cinéaste de gauche adapter un écrivain de droite. Si vous voulez trouver l’équivalent aujourd’hui, vous pouvez toujours chercher. Le goût vécu comme manière de dépasser les clivages politiques, c’est une idée qui a dû mourir à l’orée des années 80, la décennie où tout le monde est devenu très moral tout en choisissant le pognon et la réussite comme valeurs cardinales.
Les gens de la nuit, à l’origine, est un roman de 1958. Longtemps, sa première phrase nous a hantés, nous qui sommes insomniaques comme pas deux: «Cette année-là, je cessai de dormir. » C’est ce qui donne ce caractère d’hallucination précise au livre qui se déroule pour l’essentiel entre le coucher du soleil et l’aube ; dans le périmètre de Saint-Germain-des-Prés, celui que continuent à rechercher les touristes des années 2010 alors qu’il est devenu un continent disparu aussi improbable que l’Atlantide.
Le narrateur des Gens de la Nuit a trente ans. c’est un fils de bonne famille: la preuve, son père va être élu à l’Académie Française. Cela fait un peu ricaner le fils. Michel Déon, dans la préface qu’il donne pour l’occasion, se moque gentiment de son propre revirement sous l’habit vert.
Le fils sort de trois ans de Légion et pour s’occuper fait un métier tout neuf. Avec deux amis, il a monté ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui une agence de com’. Dans les années 50, on disait relations publiques. Son activité consiste surtout à promener des clients étrangers dans le « gay paris ». C’est ennuyeux mais ça le distrait d’un chagrin d’amour, un vrai chagrin d’amour, celui qui vous dévaste et vous transforme en fantôme de vous-même.
Comme chez tous les gens pudiques, le narrateur en souffre d’autant plus qu’il en parle peu et seulement à lui-même. On retrouve là, si vous voulez, cette esthétique éminemment française de la retenue qui commence avec Madame de Lafayette et s’arrête avec les Hussards dont Michel Déon fut un éminent représentant. Depuis, on hurle, on pleure, on éructe, on se lamente, dans le roman comme ailleurs, ce qui est encore plus fatigant, à la longue, que de passer ses nuits de bar en bar et de manger des pieds de porcs à l’aube du côté des Halles.
Pour s’occuper le narrateur fait des rencontres dans les caves de jazz et les bistrots ouverts très tard. Il a une liaison avec Gisèle qui est comme lui un oiseau de nuit, mais du genre bohème. Elle vit à l’hôtel avec Maggy, elle porte des pantalons fuseaux, elle aime faire l’amour et à l’occasion, quand elle n’a pas de papier pour prendre une adresse, elle remonte son chandail pour qu’on écrive sur sa peau nue.
On n’est pas très loin de l’Occupation, non plus. Le narrateur devient l’ami d’un peintre très doué qui ne veut plus peindre et qui est un ancien de la Légion Charlemagne puis il sauve de la bastonnade une étudiante communiste, Noire de surcroît. Il se débarrasse avec l’aide du peintre du buste de son aïeul qu’il trouve aussi pompeux que son père dans le bois de Boulogne et il découvre que le peintre et l’étudiante sont amants.
Bref, il fait un peu n’importe quoi, ses amis aussi, mais ce n’importe quoi enchante. Extrait d’un dialogue avec l’étudiante communiste:
« - C’est merveilleux, dit-elle, je ne pensais pas que nous étions si bien organisés. Il y a longtemps que tu surveilles le coin?
- J’y arrivais à la minute. Et pourquoi me tutoyez vous?
- Tu n’es pas un camarade?
Elle s’était rejetée contre la portière, le regard soudain dur.
- Non.
- Alors pourquoi m’avoir tirée de là?
- Pour rien. Pour le plaisir. Pour l’honneur. »
La dernière réplique pourrait faire une belle devise, comme celle du Prince de Ligne
qui avait répondu, quand on lui demandait les raisons de son exil au moment de l’Empire: « L’honneur. L’humeur. L’horreur. »
Ce qui est amusant, en plus, avec le recul, c’est que l’on s’aperçoit que dans ces années-là, et dans les mêmes parages bistrotiers, les personnages des Gens de la Nuit auraient pu croiser la bande de Debord et des premiers situs qui dérivaient sur le mode « psychogéographique » afin de réenchanter la ville. Ainsi, cette scène où le peintre fait découvrir au narrateur à l’aube le ballet purement gratuit des arroseuses municipales devant l’Hôtel de Ville avant qu’elles ne se mettent au travail.
Pour le reste, est-il utile de savoir que le narrateur guérira de son chagrin d’amour un peu à la manière de Swann ou de Frédéric Moreau, que le comportement erratique et angoissé de nombre de personnages est dû à la « poudre » qui fait son apparition dans Paris et qu’il y a du roman noir dans Les gens de la nuit ?
Sans doute, mais le plaisir donné par ce roman est ailleurs, dans quelque chose qui ne vieillit pas, qui ne vieillira jamais et qui s’appelle la mélancolie : « Nous ne sommes pas nombreux à connaître ses secrets, pas nombreux mais inguérissables. »
Les gens de la nuit de Michel Déon (édition revue et corrigée, La Table Ronde) 5,93 €
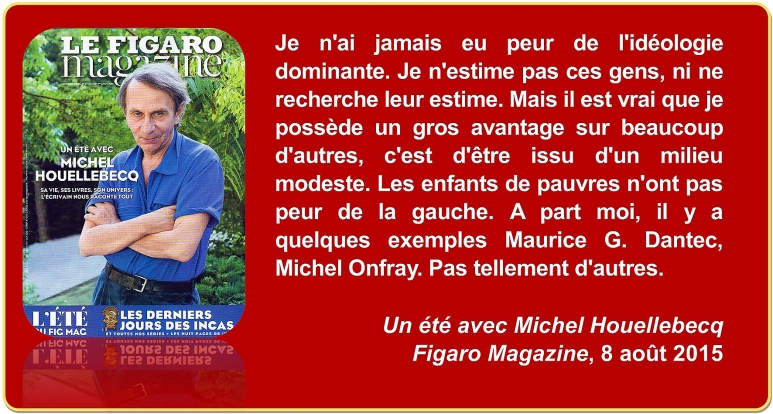
Cliquer ici pour lire

Philippe Bilger peint notre République sous les traits d'une « ado attardée ». Une République qu'il nomme aussi prépubère. Nous ne le contredirons pas. Il a raison.
Verlaine, lui, l'avait vue au contraire déchue, en immonde vieillarde lui inspirant un terrible sonnet qui insulte Marianne dans des termes fort gaillards, comme seul un poète y est autorisé. Poème, en effet, antirépublicain à l'extrême.
« Ado attardée », République prépubère ou immonde vieillarde ? On peut sans-doute l'envisager sous l'un ou l'autre aspect.
Voici, en tout cas, la vision de Paul Verlaine. Iconoclaste, il est vrai, mais dont l'auteur n'en est pas moins l'un des plus grands poètes français. •
Buste pour mairies
Marianne est très vieille et court sur ses cent ans,
Et comme dans sa fleur ce fut une gaillarde,
Buvant, aimant, moulue aux nuits de corps de garde,
La voici radoteuse, au poil rare, et sans dents.
La bonne fille, après ce siècle d’accidents,
A déchu dans l’horreur d’une immonde vieillarde
Qui veut qu’on la reluque et non qu’on la regarde,
Lasse, hélas ! d’hommes, mais prête comme au bon temps.
Juvénal y perdrait son latin, Saint-Lazare
Son appareil sans pair et son personnel rare,
A guérir l’hystérique égorgeuse des Rois.
Elle a tout, rogne, teigne… et le reste et la gale !
Qu’on la pende pour voir un peu dinguer en croix
Sa vie horizontale et sa mort verticale.
Paul Verlaine, sonnet, Invectives, Buste pour mairies (1881)

Par Robert Redeker [Propos recueillis par Alexandre Devecchio]
Une intéressante réflexion de Robert Redeker; notamment sur le néo-scientisme de Google, puisant à cette sorte de religiosité qui alimente aussi les sectes.
Dans une lettre ouverte, des scientifiques et intellectuels, dont Stephen Hawking et Noam Chomsky demandent l'interdiction des « armes autonomes offensives sans contrôle significatif d'un être humain.» « Comme les biologistes et les chimistes qui ne veulent pas fabriquer des armes biologiques et chimiques, la plupart des chercheurs en intelligence artificielle n'ont aucun intérêt pour les armes ». écrivent-ils. Que cela vous inspire-t-il ?
 Robert Redeker : Cette citation est remarquable parce qu'elle pointe une forme inédite de guerre, jamais envisagée: la guerre des objets contre l'homme. « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » demandait le poète Francis Jammes. Non : l'âme, c'est ce qui recherche la paix. Ont-ils alors une conscience, le savoir de soi ? Chez l'homme la conscience est une fonction de l'âme, témoignant de sa liberté. Un vers magnifique de Victor Hugo, dans La Légende des Siècles, exprime la fusion de l'âme, de la conscience et de la liberté : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». L'autonomie des objets (des armes) dont vous parlez est tout le contraire de Caïn, c'est-à-dire de l'homme : c'est une autonomie sans liberté, sans conscience, donc incapable de remords (Hugo pointe le remords poursuivant le criminel même après son décès), sans âme. De ce point de vue la crainte, assez répandue, de voir un jour les machines supplanter l'homme en ses facultés les plus élevées me paraît relever du fantasme, pouvant donc être étudiée par une anthropologie de l'imaginaire. Cependant, qu'elles parviennent, dans un très proche avenir, à la dépasser en intelligence tactique, purement opératoire, est une certitude. Pourront-elles pour autant déclarer la guerre à leur créateur ? Du fait de leur différence de nature avec l'homme, ce risque, dont l'évocation fait frissonner la sensibilité et assure une récréation à la pensée, est exclu.
Robert Redeker : Cette citation est remarquable parce qu'elle pointe une forme inédite de guerre, jamais envisagée: la guerre des objets contre l'homme. « Objets inanimés avez-vous donc une âme ? » demandait le poète Francis Jammes. Non : l'âme, c'est ce qui recherche la paix. Ont-ils alors une conscience, le savoir de soi ? Chez l'homme la conscience est une fonction de l'âme, témoignant de sa liberté. Un vers magnifique de Victor Hugo, dans La Légende des Siècles, exprime la fusion de l'âme, de la conscience et de la liberté : « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». L'autonomie des objets (des armes) dont vous parlez est tout le contraire de Caïn, c'est-à-dire de l'homme : c'est une autonomie sans liberté, sans conscience, donc incapable de remords (Hugo pointe le remords poursuivant le criminel même après son décès), sans âme. De ce point de vue la crainte, assez répandue, de voir un jour les machines supplanter l'homme en ses facultés les plus élevées me paraît relever du fantasme, pouvant donc être étudiée par une anthropologie de l'imaginaire. Cependant, qu'elles parviennent, dans un très proche avenir, à la dépasser en intelligence tactique, purement opératoire, est une certitude. Pourront-elles pour autant déclarer la guerre à leur créateur ? Du fait de leur différence de nature avec l'homme, ce risque, dont l'évocation fait frissonner la sensibilité et assure une récréation à la pensée, est exclu.
Pour la première fois, nous allons devoir cohabiter sur la terre avec une espèce que nous avons créée. Cela va-t-il modifier la définition même de l'humanité ?
Nous nous retrouvons dans un monde à trois : les machines, les animaux et les hommes. Jusqu'ici les outils et machines n'étaient pas intelligents, ils n'étaient que des prolongements des organes humains. Voici qu'ils deviennent des prolongements de son cerveau, et acquièrent une part d'autonomie. Il va falloir apprendre à vivre à trois. L'autonomie de ces machines est illusoire, seconde, inévitablement limitée : elle dérive de l'autonomie humaine. Une machine, aussi perfectionnée soit-elle, dépend toujours, ontologiquement, de son créateur. C'est pourquoi ces machines ne parviendront jamais au degré d'autonomie qui est celui des hommes et des animaux. Elles peuvent, à l'occasion, et non par nature, être nos ennemies, jamais nos rivales. Une différence apparaît entre ces machines et les animaux: dans un monde de plus en plus sous l'emprise de la technique: les animaux ont besoin de notre protection (nous avons des devoirs envers eux, même s'il est absurde de leur accorder des droits), l'aide des hommes leur est due sans qu'ils en aient conscience, alors que nous n'avons aucun devoir envers les machines. Ceci s'explique : les animaux et les hommes sont des fins en soi, les machines sont créées pour l'utilité de l'homme, son bien être ou le bien public (l'homme se doit les détruire dès qu'elles contreviennent à ce bien-être). Il n'y a pas de devoir envers les machines. Plus ces machines gagneront en puissance, plus l'homme lui-même tendra à leur ressembler, plus il sera important de maintenir comme une norme rigoureuse la définition « classique », « humaniste » de l'homme, héritée aussi bien des Grecs que du christianisme et de Kant. Pareille définition est un rempart et un garde-fou.
L'hypothèse souvent développée par le cinéma de voir la machine supplanter l'homme vous parait-elle réaliste ? La religion du progrès va-t-elle conduire à notre destruction ?
L'imaginaire a besoin de la fin du monde pour sublimer l'angoisse - au sens freudien de la sublimation: la transformer en lui donnant un contenu acceptable par la conscience, par exemple à travers des créations artistiques -, cette affection fondamentale de l'être humain, étrangère à toute machine. La littérature - pensons au Golem, à Frankenstein - et le cinéma sont le lieu de ce travail de sublimation. Des siècles durant, le christianisme (y compris ses hérésies) a porté cet imaginaire de la fin du monde à travers le discours sur l'Apocalypse. Cet imaginaire se nourrit de la pulsion de mort, il est l'ombre de Thanatos. Il est un rapport trouble à la mort. Dans nos temps post-chrétiens, le mythe de la fin du monde change de vêtements, l'angoisse demeurant la même: l'apocalypse peut être apportée soit par des extra-terrestres, soit par des machines qui décideraient de nous exterminer. Le discours sur ces machines qui mèneraient une guerre à l'homme se développe selon la même structure que celui sur les extra-terrestres. Les mêmes fantasmes et les mêmes peurs l'habitent. Selon lui, l'homme serait soumis au risque d'être détruit par des intelligences non-humaines. Lorsqu'elles sont extra-terrestres, ces intelligences hostiles viennent du dehors. Lorsqu'elles sont des machines, elles viennent du dedans, étant une externalisation des facultés du cerveau humain. Je dis du cerveau, non de la conscience ou de l'âme, qui sont des réalités différentes. En fait, l'une et l'autre, l'intelligence des extra-terrestres et celle des machines, sont avant tout des productions de l'imagination humaine, des projections dans le monde objectif de ce que l'homme porte au plus profond de lui. Du coup, avant tout, les guerres ainsi imaginées sont des guerres qui se déploient au sein de l'âme humaine.
Certains veulent mettre un coup d'arrêt à cette évolution. Peut-on arrêter le progrès ?
Il n'est pas certain qu'il s'agisse de progrès. Il ne faut pas oublier cependant que ces évolutions peuvent se révéler utiles au bien être des hommes, à la médecine, à la chirurgie. Il ne faut pas oublier non plus que ces intelligences peuvent être nos serviteurs en faisant à notre place ce que nous ne pouvons faire. A ce titre aucun droit n'existe de les arrêter. Quoiqu'il en soit, quand bien même ce droit existerait-il, il y a un destin métaphysique de la technique, qui a bien été mis en lumière par Heidegger, dont rien ne dit que puissions sortir dans un futur proche. Un destin est un envoi depuis une origine qui est aussi une destination. Le destin technique de l'Occident se façonne dans la grande révolution intellectuelle (scientifique et philosophique) du XVIIème siècle. On ne sort pas de la technique (pas plus d'ailleurs que du capitalisme, cet autre destin de l'Occident) par un acte de la volonté.
Au-delà du problème des robots autonomes, google développe actuellement une idéologie transhumaniste et se donne les moyens de la faire triompher. Cette volonté de la firme californienne de créer un homme nouveau est-elle totalitaire ?
La volonté de fabriquer un homme nouveau a connu de multiples figures dans la modernité. Le communisme et le nazisme en ont été de monstrueux exemples. Cette volonté est la signature même des utopies totalitaires. Exprimer cette ambition trahit quelque chose à quoi l'on ne prête pas assez attention: l'entreprise Google est une entreprise politique, pas uniquement commerciale et technologique, dont le but est de soumettre les hommes à son propre fantasme, à une idéologie unique, à fabriquer un homme unique (comme on parle de pensée unique) planétaire.
« Quel que soit le problème rencontré, que ce soit un grand challenge pour l'humanité ou un problème très personnel, il y a une idée, une technologie qui attend d'être découverte pour le résoudre » assurait au Time Magazine Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google. La science peut-elle vraiment résoudre tous les problèmes ?
Il n'y a rien de nouveau dans ce propos, qui était déjà tenu par le positivisme dans sa version obtuse au XIXème siècle. Il tient dans un mélange assez classique d'ignorance de la nature humaine, trahissant une inculture philosophique et théologique consternante, et de millénarisme de bas étage. Ici, le millénarisme de la technique apparaît. Ray Kurzweil n'est pas différent du ridicule Monsieur Homais, le pharmacien d'Yonville dans le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Ce Monsieur Homais du nouveau siècle, Ray Kurzweil, ne se rend peut être pas compte que son rationalisme n'est qu'une croyance, extrêmement fruste, qui porte le nom péjoratif de scientisme. Voyons en elle un néo-scientisme naïf, pour ne pas dire bête. Au-delà de la bêtise, l'arrogance et la volonté de domination montrent dans ce propos leur hideux visage. S'imaginant rationaliste et scientifique, cette foi dans la science et la technique n'est rien d‘autre que de la religiosité dévoyée, celle-là même dont s'alimentent les sectes.
Face à ce postmodernisme triomphant, on assiste au retour en force des religions et des identités, notamment à travers la montée en puissance de l'islam radical. Le risque n'est-il pas d'être pris en étau entre deux totalitarismes ?
Ce sont deux totalitarismes différents qui reposent sur une haine commune de l'homme tel qu'il est. Ce sont aussi deux volontés de domination appuyées sur deux idéologies schématiques. On remarquera que cet islamisme, que vous appelez islam radical mais qui est en fait un islam politique, utilise les technologies informatiques les plus sophistiquées, réunissant l'archaïsme obscurantiste et la postmodernité techno-scientifique. Il faut distinguer ces phénomènes: retour des religions, des identités, et montée de l'islam radical. Les deux premiers renvoient, souvent maladroitement, à un besoin de réhumanisation du monde, quand le dernier renvoie à l'opposé, au désir de destruction, passant par le point commun de tous les totalitarismes, la déshumanisation. Il n'est pas possible d'indexer le développement de l'islamisme sur le retour des religions. Il ressemble plutôt à ces contrefaçons de religion que furent les religions séculières du XXème siècle, les idéologies totalitaires. Contrefaçon de rationalisme dans le cas de l'utopie Google et des idées de Ray Kurzweil, contrefaçon de religion dans le cas de l'islamisme. •
 Professeur agrégé de philosophie, Robert Redeker est écrivain. Son dernier livre « Le progrès, point final ? » vient de paraître aux éditions Ovadia.
Professeur agrégé de philosophie, Robert Redeker est écrivain. Son dernier livre « Le progrès, point final ? » vient de paraître aux éditions Ovadia.

Cet entretien avec Fabrice Luchini est paru dans Le Figaro du 13 décembre 2014. « Poésie ? » le spectacle du comédien, rencontre, depuis le mois de janvier 2015, un succès phénoménal. Les réservations se font déjà pour l'année 2016.
« Poésie ? » Théâtre des Mathurins. Réservations: 01 42 65 90 00 ou 0892 68 36 22
Vous jouez un spectacle intitulé « Poésie ? ». Vos choix sont de plus en plus exigeants...
Fabrice LUCHINI. - La poésie ne s'inscrit plus dans notre temps. Ses suggestions, ses silences, ses vertiges ne peuvent plus être audibles aujourd'hui. Mais je n'ai pas choisi la poésie comme un militant qui déclamerait, l'air tragique : « Attention, poète ! » J'ai fait ce choix après avoir lu un texte de Paul Valéry dans lequel il se désole de l'incroyable négligence avec laquelle on enseignait la substance sonore de la littérature et de la poésie. Valéry était sidéré que l'on exige aux examens des connaissances livresques sans jamais avoir la moindre idée du rythme, des allitérations, des assonances. Cette substance sonore qui est l'âme et le matériau musical de la poésie.
Valéry s'en prend aussi aux diseurs...
Il écrit, en substance, que rien n'est plus beau que la voix humaine prise à sa source et que les diseurs lui sont insupportables. Moi, je suis un diseur, donc je me sens évidemment concerné par cette remarque. Avec mes surcharges, mes dénaturations, mes trahisons, je vais m'emparer de Rimbaud, de Baudelaire, de Valéry. Mais pas de confusion : la poésie, c'est le contraire de ce qu'on appelle « le poète », celui qui forme les clubs de poètes. Stendhal disait que le drame, avec les poètes, c'est que tous les chevaux s'appellent des destriers. Cet ornement ne m'intéresse pas. Mais La Fontaine, Racine, oui. Ils ont littéralement changé ma vie. Je n'étais pas « un déambulant approbatif », comme disait Philippe Muray, mais je déambulais, et j'ai rencontré, un jour, le théâtre et la poésie comme Claudel a vu la lumière une nuit de Noël.
La poésie est considérée comme ridicule, inutile ou hermétique...
Elle a ces trois vertus. Ridicule, c'est évident. Il suffit de prononcer d'un air inspiré : « Poète, prends ton luth...» Musset est quatorze fois exécrable, disait Rimbaud, et tout apprenti épicier peut écrire un Rolla. Inutile, elle l'est aussi. Hermétique, c'est certain. J'aimerais réunir les gens capables de m'expliquer Le Bateau ivre.
C'est un luxe pour temps prospère ?
La poésie, c'est une rumination. C'est une exigence dix fois plus difficile qu'un texte de théâtre. La poésie demande vulnérabilité, une capacité d'être fécondée. Le malheur est que le détour, la conversation, la correspondance qui sont les symboles d'une civilisation ont été engloutis dans la frénésie contemporaine. Nietzsche, il y a un siècle, fulminait déjà contre les vertus bourgeoises qui avaient envahi la Vieille Europe. Vous verrez, disait-il, ils déjeuneront l'oeil sur leur montre et ils auront peur de perdre du temps. Imaginez le philosophe allemand devant un portable !
Vous êtes hostile au portable ?
J'en ai un comme tout le monde. Mais c'est immense, l'influence du portable sur notre existence. Une promenade, il y a encore vingt ans, dans une rue pouvait être froide, sans intérêt, mais il y avait la passante de Brassens, ces femmes qu'on voit quelques secondes et qui disparaissent. Il pouvait y avoir des échanges de regard, une possibilité virtuelle de séduction, un retour sur soi, une réflexion profonde et persistante. Personne, à part peut-être Alain Finkielkraut, n'a pris la mesure de la barbarie du portable. Il participe jour après jour à la dépossession de l'identité. Je me mets dans le lot.
N'est-ce pas un peu exagéré ?
La relation la plus élémentaire, la courtoisie, l'échange de regard, la sonorité ont été anéantis pour être remplacés par des rapports mécaniques, binaires, utilitaires, performants. Dans le train, dans la rue, nous sommes contraints d'entendre des choses que nous aurions considérées comme indignes en famille. Dans mon enfance, le téléphone était au centre d'un couloir parce qu'on ne se répandait pas.
C'est le triomphe de Warhol, du « Moi ». Nous vivons un chômage de masse, il y a mille personnes qui perdent leur métier par jour et ces pauvres individus ont été transformés en petites PME vagabondes. Constamment, ils déambulent comme s'ils étaient très occupés. Mais cela se fait avec notre consentement : tout le monde est d'accord, tout le monde est sympa. Et la vie qui doit être privée est offerte bruyamment à tous. Les problèmes d'infrastructures des vacances du petit à Chamonix par rapport au grand frère qui n'est pas très content, le problème du patron qui est dégueulasse : nous saurons tout ! Si au moins on entendait dans le TGV : « Le dessein en est pris, je pars, cher Théramène », et que, de l'autre côté du train, un voyageur répondait bien fort : « Déjà pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les deux mers que sépare Corinthe », peut-être alors le portable serait supportable.
C'était mieux avant...
« Le réel à toutes les époques était irrespirable », écrivait Philippe Muray. J'observe simplement qu'on nous parle d'une société du « care », d'une société qui serait moins brutale, moins cruelle. Je remarque qu'une idéologie festive, bienveillante, collective, solidaire imprègne l'atmosphère. Et dans ce même monde règne l'agression contre la promenade, la gratuité, la conversation, la délicatesse. Je ne juge pas. Je fais comme eux. Je rentre dans le TGV. Je mets un gros casque immonde. J'écoute Bach, Mozart ou du grégorien. Je ne regarde personne. Je n'adresse la parole à personne et personne ne s'adresse à moi. La vérité est que je prends l'horreur de cette époque comme elle vient et me console en me disant que tout deuil sur les illusions de sociabilité est une progression dans la vie intérieure.
Vous n'aimez pas notre époque...
Elle manque de musicalité. Elle est épaisse et schizophrène aussi. Elle mêle à une idéologie compassionnelle, une vraie brutalité individualo-technologique. Une des pires nouvelles des vingt dernières années a été l'invention du mot « sociétal ». Pour des gens qui aiment la musique, l'avenir sentait mauvais.
Vous résistez à cette évolution ?
C'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir une parole de résistance, même modeste. Ce qui m'amuse, c'est de mettre un peu de poésie dans l'écrasante supériorité de l'image, à l'heure de l'écrasante puissance de la bêtise. Il faut reconnaître qu'elle a pris des proportions inouïes. Ce qui est dramatique, disait Camus, c'est que « la bêtise insiste ». La poésie, la musique n'insistent pas.
C'est-à-dire ?
Nous sommes comme lancés dans une entreprise sans limite d'endormissement. Une entreprise magnifiquement réglée pour qu'on soit encore plus con qu'avant. Mais je ne crache pas dans la soupe, je profite à plein de ce système. Je ne pourrais pas vivre si je restais dix heures avec Le Bateau ivre. Je ne pourrais pas vivre comme Péguy, comme Rimbaud, qui finissait par trouver sacré le désordre de son esprit. Moi, je ne suis pas un héros qui se dérègle intérieurement. Je fréquente ces grands auteurs, mais rien ne m'empêche de me vautrer dans un bon Morandini. C'est peut-être pour cela que les gens ne me vivent pas comme un ennemi de classe. Au départ, je suis coiffeur, il ne faut pas l'oublier. J'étais très mauvais, mais je l'ai été pendant dix ans.
Vous avez choisi de jouer dans de très petites salles. Vous devenez snob ?
Je ne veux pas imposer la parole que je sers. Je suis un artisan, et ceux qui veulent achètent. J'ai choisi la Villette, un endroit de 70 places. On va dire que je tourne un peu dandy. Eh bien, oui ! Un peu baudelairien. Trois semaines plus tard, j'irai au Lucernaire, parce que Laurent Terzieff y jouait. J'ai aussi le droit de ne pas être préoccupé par la projection sonore dans une grande salle ou par le fait de mettre un micro qui dénature le timbre de la voix.
Vous avez toujours du mal à être de gauche ?
Je n'y arrive pas et je crains de ne pouvoir grimper l'Himalaya de générosité que ça exige. En ce qui concerne la culture, l'énorme problème de la gauche (la droite n'est pas brillante, elle est en dessous de tout, parce qu'elle est affairiste), c'est le regard condescendant vis-à-vis des goûts du peuple. Les hommes de gauche trouvent très tristes que les femmes de ménage rêvent de rouler en 4 × 4 ! Le drame de la gauche, c'est l'invocation de la culture pour tous. Terzieff ne voulait pas être subventionné : il haïssait la subvention.
Et votre public ?
Il y a de tout dans mes spectacles. Pour Philippe Muray, j'ai même eu des prêtres en soutane. J'ai une affection pour les prêtres en soutane, la messe en latin, même si j'y vais très rarement. Dans ce domaine aussi je suis baudelairien. Il y a un public de droite, donc, mais aussi des bobos en Vélib'. Qui en retire quoi ? Il faut être humble. On pourrait jouer cinquante ans et les gens continueront à dire simplement : quelle mémoire !
Vous êtes devenu le dépositaire et l'ambassadeur de la littérature française...
Comment se fait-il qu'un cancre inapte joue le rôle que vous me prêtez ? Inconsciemment, l'autodidacte plaît énormément, parce qu'il n'y a pas l'emprise universitaire du « très bien », du capable de parler de tout comme tous les gens de l'ENA qui savent tenir une conversation sur Mallarmé, l'Afrique ou la réduction des déficits. L'obsessionnel (et l'autodidacte) est extraordinairement limité. Sa culture a été acquise à la force du poignet. Mais il peut témoigner, parce que ce qu'il connaît, il le connaît en profondeur et ça l'habite. Quand il trouve un métier, un instrument, ça lui permet de prolonger ce travail long et pénible. Avec le métier, vous n'êtes plus un phénomène. Louis Jouvet disait : « La vocation, c'est pratiquer un miracle avec soi-même.» Le métier détruit le « moi ».
Par exemple ?
Le fait de travailler pendant un an la structure du XVIIe siècle vous guérit. Parce que le XVIIe est complètement structuré et complètement libre. La Fontaine en est l'incarnation suprême. La Fontaine, c'est une pure liberté au milieu de la contrainte, une pure invention au milieu de la rigueur, une pure subversion au milieu d'une exquise courtoisie. Une pure anarchie au milieu d'un super ordre. La Fontaine, c'est le patron ! Écoutons Perette et le Pot au lait : « Légère et court vêtue, elle allait à grands pas...» « Légère et court vêtue » : on la voit, devant nous, en minijupe, les jambes en mouvement, c'est une pub de Dim! C'est ça, la beauté : l'agencement dans le rien. Tout ce qui est fleuri en littérature est intolérable. Regardez le génie de Céline : « La tante à Bebert rentrait des commissions, elle avait déjà pris le petit verre, il faut bien dire également qu'elle reniflait un peu l'éther.» En quelques mots, il redonne à la pauvreté, à la misère, à la banlieue sa vérité.
Pourquoi continuer à jouer ce rôle de passeur ?
Comme artisan, j'ai besoin de me confronter à ce qui est difficile. Je pourrais vivre en ayant une vie de cardiologue à la retraite. La piscine à débordement me tenterait bien, mais il faut une grande santé psychologique pour l'assumer et la pratiquer, je n'ai pas cette santé-là. J'essaye donc d'avancer dans le mystère du verbe et de la création, et je fais honnêtement commerce de ce qui me hante. Mais j'essaye toutefois de rester à ma place. Être comédien, c'est s'éloigner de l'aristocratie de la pensée. C'est un dérèglement psychique qui n'a rien de glorieux. Peut-être aidons-nous un peu à créer, le temps d'un soir, une « ré-appartenance » avec nos semblables. Au théâtre, dit Claudel, il se passe quelque chose, comme si c'était vrai. Le mensonge du théâtre mène parfois à la vérité. •
Source : Vincent Tremolet de Villers

Par Arnaud Guyot-Jeannin, Journaliste et essayiste*
Soljenitsyne, prophète de la tradition : l'essentiel est excellemment dit, ici, sur cet anniversaire. Rappelons que vous trouverez dans Lafautearousseau, dans notre catégorie Grands Textes, deux discours d'Alexandre Soljenitsyne : son discours aux Lucs-sur-Boulogne pour l'inauguration de l'Historial de Vendée, le samedi 25 septembre 1993, et son très célèbre discours d'Harvard, le 8 juin 1978.
 Disparu le 3 août 2008, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, Alexandre Soljenitsyne représente un modèle d’humanité, de courage et de lucidité dans l’histoire contemporaine. Le septième anniversaire de sa mort a été ignoré avec une vacuité révélatrice d’un Occident amnésique. Hormis l’excellent article de Mathieu Slama paru dans Le Figaro du 3 août dernier (« Ce que nous devons à Soljenitsyne »), les grands esprits de l’Hexagone ont pris des vacances avec leur mémoire. D’autres n’ont pas évoqué cette grande figure par sectarisme. Le soleil de la pensée n’a pas beaucoup éclairé les consciences françaises. Une habitude !
Disparu le 3 août 2008, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, Alexandre Soljenitsyne représente un modèle d’humanité, de courage et de lucidité dans l’histoire contemporaine. Le septième anniversaire de sa mort a été ignoré avec une vacuité révélatrice d’un Occident amnésique. Hormis l’excellent article de Mathieu Slama paru dans Le Figaro du 3 août dernier (« Ce que nous devons à Soljenitsyne »), les grands esprits de l’Hexagone ont pris des vacances avec leur mémoire. D’autres n’ont pas évoqué cette grande figure par sectarisme. Le soleil de la pensée n’a pas beaucoup éclairé les consciences françaises. Une habitude !
Quelques piqûres de rappel sont donc nécessaires. Autant de clairvoyance – prophétique, notamment – force l’admiration. Après avoir été incarcéré dans les goulags, puis exilé de son pays – l’Union soviétique qu’il ne confondait pas avec la Russie – durant de longues années, Soljenitsyne condamne le totalitarisme communisme avec vigueur et pertinence. En octobre 1970, le prix Nobel de littérature lui est attribué depuis Stockholm. Il ne peut s’y rendre, de peur que le KGB l’empêche de passer la frontière à son retour. Trois ans plus tard, il publie L’Archipel du goulag (1973). Un testament politique et historique d’où il ressort également que la souffrance humaine offerte à Dieu débouche sur la rédemption d’un point de vue spirituel. Soljenitsyne revient alors à la foi chrétienne de son baptême.
En 1976, Soljentsyne émigre à Cavendish, dans un village montagneux du Vermont, au nord-est des États-Unis. En compagnie de son épouse et de ses enfants, il est comme retiré du monde. C’est deux ans plus tard, en 1978, qu’il prononce son fameux discours de Harvard. Ayant vitupéré contre le communisme soviétique en le qualifiant de « bazar idéologique », il n’épargne pas le modèle américano-occidental en l’identifiant à un « bazar mercantile ». Il avertit du danger qui pèse sur la Russie : « Après avoir souffert pendant des décennies de violence et d’oppression, l’âme humaine aspire à des choses plus élevées, plus brûlantes, plus pures que celles offertes aujourd’hui par les habitudes d’une société massifiée, forgées par l’invasion révoltante de publicités commerciales, par l’abrutissement télévisuel, et par une musique intolérable. »
En 1990, alors que l’URSS vit sa dernière année, Soljenitsyne publie un essai au titre programmatique, Comment réaménager notre Russie ? Il propose la mise en place d’une « démocratie des petits espaces : […] petite ville, bourg, bourgade cosaque, canton (groupe de villages), et jusqu’aux limites d’un district. C’est uniquement sur un territoire de cette ampleur que les gens pourront déterminer, sans se tromper, leurs élus […] On pourrait dire : à partir des “États” [soslovia]. Ce sont là les deux principes naturels les plus habituels de collaboration et de coopération entre les hommes : d’après le territoire commun sur lequel ils vivent et selon leur genre d’occupation, la direction de leur activité. ». Soit une démocratie locale et organique pour une Russie indépendante et souveraine.
Soljetnitsyne demeure toujours très actuel lorsqu’il rappelle que les Petits-Russiens (Ukrainiens), les Blancs-Russiens (Biélorusses) et Grands-Russiens (Russes) appartiennent à un même peuple et donc à un même pays : la Russie traditionnelle. Mort d’un grand vivant ressuscité par l’Histoire en cours…
*Arnaud Guyot-Jeannin - Boulevard Voltaire

Un court récit de l’un des plus beaux voyages ferroviaires d’Asie : depuis 1993, au départ de Singapour, l’Eastern & Oriental Express parcourt la Malaisie et la Thaïlande en passant des sites mythiques… 2000 kms de rêves et de dépaysement.
Plus qu’un voyage en train, c’est une véritable croisière ferroviaire, avec ses « escales », que nous propose l’Eastern & Oriental Express. On y retrouve même l’ombre d’Agatha Christie.
Nous laissons Singapour et ses gratte-ciels aux formes extravagantes et toujours plus nombreux, mais aussi son charmant quartier administratif, très vieille Angleterre, construit par son 1er gouverneur, Sir Stamford Raffles.
Après avoir contemplé les paysages malais de forêts primaires et de rizières, nous nous arrêtons pour visiter le Palais de Kuala Kangsar, capitale d’un des 9 Etats dont les Sultans sont, à tour de rôle et pour 5 ans, Roi de la Fédération de Malaisie.
Passage de la frontière thaïlandaise et arrivée le lendemain au célèbre Pont de La Rivière Kwaï. Pendant que nous naviguons sur le fleuve Mae Klaung et sous le pont, un très bon conférencier nous explique qu’en raison de la maîtrise des mers par les Alliés, les Japonais avaient besoin d’une voie ferroviaire pour approvisionner cette partie du monde, qu’ils occupaient depuis 1942.
Plus de 10 000 prisonniers de guerre sont morts entre 1942 et 1943, victimes de la sous-alimentation, de conditions de travail inhumaines et des maladies tropicales. Un musée et le cimetière militaire en témoignent.
Cette « croisière » se termine à Bangkok, où règne depuis 1946, l’excellent Roi Bhumibol, Rama IX. •
Infos et réservations : Eastern & Oriental Express ou Compagnie des chemins de fer malais.


Par Péroncel-Hugoz
 Durant le récent Ramadan, j’ai eu l’occasion de rencontrer un ancien haut fonctionnaire marocain, installé à Nice. Prié à son ftour, je fus surpris de l'austérité de sa table, et je crus bon d’en féliciter mon hôte, en évoquant les buffets pantagruéliques de ftours auxquels je participais naguère...
Durant le récent Ramadan, j’ai eu l’occasion de rencontrer un ancien haut fonctionnaire marocain, installé à Nice. Prié à son ftour, je fus surpris de l'austérité de sa table, et je crus bon d’en féliciter mon hôte, en évoquant les buffets pantagruéliques de ftours auxquels je participais naguère...
Durant le récent Ramadan, j’ai eu l’occasion de rencontrer un ancien haut fonctionnaire marocain, installé à Nice, pays de son épouse. Prié à son ftour, rupture vespérale du jeûne, je fus surpris de la relative austérité de sa table, et je crus bon d’en féliciter mon hôte, en évoquant les buffets pantagruéliques d’autres ftours auxquels je participai naguère. Ce qui m’attira la réponse suivante de ce musulman pratiquant : «Mais, monsieur, je suis simplement fidèle à nos propres traditions et je ne suis pas de ces Arabes ayant transposé chez eux les avalanches de plats, de sucreries, de cadeaux de vos fêtes de Noël qui du coup n’ont plus grand-chose de chrétien… ». Et toc ! Impossible de le contredire. Je voulus aussi savoir ce qui, en Ramadan, changeait dans les pratiques intellectuelles de ce sage : « Ne croyez pas que je me plonge chaque soir dans nos textes sacrés, non je les ai assez pratiqués dans mon jeune temps, je les connais, je m’y réfère parfois mais je ne les ressasse pas. Tenez, regardez ce que je suis en train de lire », et il me tendit quelques feuillets intitulés, à ma surprise, « Le Maroc dans la Première Guerre mondiale ». L’auteur ? L’historienne Bahija Simou, par ailleurs directrice des Archives royales à Rabat. La lecture de Ramadan de notre Marocain était une communication énoncée par Lalla Bahija, en juin 2015, à Paris, devant l’Académie des sciences d’outre-mer dont l’intervenante est le seul membre marocain actuel. Cette institution, fondée en 1922, est un peu le pendant exotique de l’Académie française même si elle est bien moins connue, étant plus studieuse que mondaine…
Parmi les fondateurs ou les membres fameux de cette ASOM, on compte aussi bien Lyautey que les frères Tharaud, Léopold Senghor, Félix Houphouët-Boigny, deux rois des Belges, un ex-président portugais, etc.
Ma curiosité étant piquée, dès le lendemain du ftour, je me procurai la communication de Mme Simou sur cette période cruciale si peu étudiée sous son angle spécifiquement marocain. Mon « coup de chapeau » va bien sûr à l’historienne et mon « coup de dent » à ces chercheurs marocains penchés sur des sujets encombrés et «historiquement corrects » : naissance de l’Istiqlâl ; révolte de l’émir Abdelkrim ; rôle de Ben-Barka dans le mouvement tiers-mondiste, etc. La geste des guerriers arabo-berbères lancés dans la Grande Guerre en Europe suscite peu de curiosité au XXIe siècle (avec quelques exceptions comme ce groupe d’élèves du Lycée Lyautey, à Casablanca, ayant travaillé à un album sur le rôle de ces preux de jadis). Ecoutons donc quelques-unes des découvertes de Lalla Bahija :
- En 1912, l’Armée chérifienne ne comptait plus que 1.400 soldats en état de combattre.
- Le sultan Moulay-Youssef, le 20 août 1914, durant la Nuit sacrée de Ramadan, incita ceux de ses sujets volontaires pour aller se battre en Europe, à se manifester. Avec l’accord des oulémas, le monarque décréta une amnistie en faveur des déserteurs ou réfractaires qui s’engageraient. L’Empire chérifien allait bientôt disposer de 40. 000 combattants dont 33. 000 furent dirigés vers le front franco-germanique.
- Dès l’été 1914, la bataille de Penchard, près de Meaux, fut gagnée au corps à corps par des Marocains novices contre les forces aguerries de l’Empire allemand. Le futur maréchal Juin écrivit : « Jamais les Marocains ne m’ont semblé plus confiants qu’à la veille de la grande bataille de la Marne où ils stoppèrent l’avance allemande ». A quel prix ! 1.150 victimes marocaines autour de Meaux. L’état-major français décrivit alors les fantassins de Chérifie comme « intelligents, manœuvriers, courageux, passionnément guerriers, résistants, sobres et bons marcheurs. Ils sont meilleurs tireurs que les Algériens, etc. ».
- Des spahis marocains furent envoyés dans l’Armée d’Orient du général Sarrail, contre l’Empire ottoman : en Macédonie, Bulgarie, Serbie et Albanie ; ces spahis eurent 140 tués.
- Lyautey, résident général de France à Rabat de 1912 à 1925, voulut plus tard faire participer le Maroc en tant qu’Etat à la Conférence de la Paix mais le gouvernement français refusa de peur que les autres protectorats dans sa mouvance (Tunisie, Annam, Tonkin, Cambodge, Laos) ne réclament plus d’autonomie. Lyautey obtint seulement la création de l’Ecole militaire de Dar-Beïda à Meknès, qui allait être « le Saint-Cyr marocain » et d’où sortiraient, après l’indépendance, les Forces armées royales qui s’illustreraient notamment en Syrie, en Afrique noire ou au Sahara marocain. •
Péroncel-Hugoz - Le 360

Marée humaine en rouge et blanc
Les participants aux Fêtes de Bayonne 2015 n'auront sans doute été que bien peu impressionnés par l'article des Inrocks intitulé : « Fêtes de Bayonne, la célébration du mauvais goût ». Orfèvres en cette matière, leur objectivité sera jugée plus que douteuse à Bayonne...
Les Fêtes de Bayonne, c'est, sur près d'une semaine, un million et demi de personnes qui se côtoient, se retrouvent et fraternisent, joyeusement, dans le bonheur de la Fête et aussi - et surtout - la pleine conscience et la fierté légitime d'appartenir à un peuple, à une nation, héritiers d'une authentique culture, d'une riche et belle civilisation, de traditions plus que millénaires...
Tout a commencé en 1932 : cette année-là, une quinzaine d'amis bayonnais sont à Pampelune, où ils découvrent le concept de la « fête de rue » en assistant aux traditionnelles Sanfermines, les fêtes de la Saint Firmin, et leurs lâchers de taureaux dans les rues de la vieille ville (les encierros). Enthousiasmés, ils décident d'importer chez eux, à Bayonne, en l'adaptant, ce qu'ils viennent de vivre dans la ville navarraise. La couleur traditionnelle, et officielle, en Navarre, est le « rouge et blanc » : au début, à Bayonne, ce fut bleu et blanc, mais, très vite, le rouge et blanc s'imposa. On peut porter l'écharpe rouge avant 22 heures, ouverture officielle de la fête, par exemple au poignet; mais ce n'est qu'à partir de l'ouverture officielle de la fête que l'on peut porter l'écharpe autour du cou, ce qui rappelle le martyre de Saint Léon, décapité à Bayonne vers 890...
A Reims et à Orléans, à Beauvais, les Fêtes Johanniques et celles de Jeanne Hachette exaltent l'Histoire de France, la formation du territoire, en même temps qu'elles permettent de rendre hommage, à travers deux héroïnes majeures, à toutes ces femmes d'exception, si souvent présentes à des moments cruciaux de notre Histoire.
En Provence, les deux pèlerinages annuels aux Saintes Maries de la Mer sont un témoignage vivant de nos Racines chrétiennes, comme le sont les deux Tours de Ville du Saint Cordon de Valenciennes, les Ostensions du Limousin, les processions de la Sanch à Perpignan, le Catenacciu de Sartène et tant d'autres encore...
Et ainsi de suite, dans toutes les Provinces de France, ces Fêtes qui font, qui sont la France parsèment l'année de leurs manifestations colorées, qui sont autant de manifestations de l'existence d'un Peuple français, d'une Nation française, n'en déplaise aux idéologues.
Un peuple, une Nation, qui se sont lentement cimentés sur le socle commun que représente le peuplement et la culture Celtique : le Festival interceltique exalte, comme son nom le proclame fièrement, les traditions de ce peuple Celte qui est comme le socle sur lequel est venu se former, peu à peu, notre Nation, et qui est bien le fondement connu le plus ancien de ce qui allait devenir la France.
A une exception près, et de taille : le peuple et la culture basques.
Les Basques constituent, en effet, une population autochtone pré-indoeuropéenne, remontant au néolithique, implantée principalement au Sud-ouest de la France et au Nord de l’Espagne, dans le Pays Basque, précisément. Et la langue basque est l’unique isolat européen et la seule langue non indo-européenne d’Europe de l’Ouest (en linguistique, un isolat est une langue dont on ne peut démontrer de filiation - ou "relation génétique" - avec d'autres langues vivantes : la langue basque, le coréen, le japonais sont des isolats).
C'est à cette langue basque, à cette culture, à cette terre, à ce peuple... que sont dédiées, depuis 1932, les Fêtes de Bayonne : en rouge et blanc, pendant cinq jours, les festayres sont si nombreux (probablement plus d'un million de personnes) qu'ils font de cet évènement l'une des fêtes les plus suivies, non seulement de France, mais même dans le monde...
Site officiel : http://www.fetes.bayonne.fr/

Par Charles Rouvier, étudiant
 La bonne nouvelle de l’été est le succès constant et toujours plus grand du Puy du Fou, et parallèlement l’appauvrissement des autres grands parcs d’attractions débilitants comme Disneyland. Phillipe de Villiers sera peut-être plus connu pour avoir créé, fait prospérer et même exporté (en Russie) l’année dernière Le Puy du Fou, que pour sa carrière politique… et c’est bien mieux. Car c’est une belle œuvre, que le Puy du Fou, un « opus bonum » qui plaît à Dieu.
La bonne nouvelle de l’été est le succès constant et toujours plus grand du Puy du Fou, et parallèlement l’appauvrissement des autres grands parcs d’attractions débilitants comme Disneyland. Phillipe de Villiers sera peut-être plus connu pour avoir créé, fait prospérer et même exporté (en Russie) l’année dernière Le Puy du Fou, que pour sa carrière politique… et c’est bien mieux. Car c’est une belle œuvre, que le Puy du Fou, un « opus bonum » qui plaît à Dieu.
Ils doivent être bien malheureux, ceux qui nous gouvernent. Les gens ne vont plus faire des pirouettes sur des trains ni trembler dans des maisons hantées, et pourtant la mine comme la maison sont à deux pas de chez eux, près des grandes agglomérations, bien desservies par le RER. Les infrastructures sont modernes et un maximum d’amusement y est garanti pour les grands et les petits, notamment grâce aux subventions du département, de la région, de l’État, de l’Europe, peut-être même de l’ONU. Sans compter les 50 partenaires officiels, le Qatar ou les entreprises de sodas qui écoulent alors plus de sucre en un an que la Compagnie des Indes ne le le fit en trois siècles.
Non, au lieu de cela, les gens font des heures de trajet en voiture pour s’enfoncer dans la campagne vendéenne, au milieu des chemin creux et des sous-bois. Ils vont voir un parc où l’on raconte l’histoire de ce bout de terre, qui devient vite l’histoire de leur pays, puis de leur civilisation. Ils y voient les préfets romains donnant les chrétiens à manger aux lions, les Vikings se faisant baptiser, un seigneur égayant ses gens avec un spectacle d’oiseaux et, lorsque la nuit tombe, une reconstitution grandeur nature des batailles, des grands événements et, bien sûr, des guerres de Vendée. Ils en repartent tout émus et édifiés, fiers de leurs ancêtres et d’eux-mêmes.
Le Puy du Fou est la preuve la plus spectaculaire (au propre comme au figuré) que la France est en vie. Pas la République avec ses drapeaux, ses guillotines, ses grèves, ses instituteurs, ses Gay Pride et plugs anaux en tous genres, mais la France, ce pays glorieux dont le roi guérissait les malades, où chaque heure qui passe est saluée par un clocher millénaire, à qui l’homme offrit le roman, à qui la terre offre le vin et le blé, à qui le ciel offrit les cathédrales. Cette France, bien qu’ensevelie sous les cendres de la propagande, de la répression, de l’argent infini de ses ennemis, brûle encore et n’attend qu’un souffle d’air sur ses braises pour briller à nouveau. Et nous, qu’attendons-nous ? •
Charles Rouvier - Boulevard Voltaire

Par Damien TOP*
Connaissez-vous l’histoire de Louis Fruchart, brave paysan de l’Alleu, qui, à la tête de l’insurrection royaliste des Flandres, remporta quelques victoires sur les troupes républicaines provoquant un vif émoi dans la capitale ?
Dans les provinces du nord, majoritairement fidèles à Dieu et au Roi, les actes de résistance se multiplièrent à la suite de la Révolution. Reflets de ces troubles, Le Sentier de briques, paru en 1953, comporte sept récits s’appuyant sur des anecdotes familiales au moment de la Terreur. Leur intérêt demeure bien plus historique que littéraire. à travers le personnage d’Adélaïde de Chevry, Pierre de Mouveaux illustre le dévouement à la cause royale des aristocrates de la région lilloise et met l’accent sur des évènements que l’historiographie républicaine s’efforce d’occulter. . Une grande partie de la population de ces contrées tenta de s’opposer à l’idéologie du nouveau régime. On se demande cependant ce que viennent faire les dessins vendéens de Daniel Lordey dans cette flamanderie.
La révolte des conscrits
Sous l’Empire, l’impôt et la conscription avaient dévasté et rendu exsangues les campagnes du nord. Les Flamands, choqués par l’arrestation de prêtres des Deux-Nèthes et de la Dyle en 1810, maudissaient l’« Antéchrist » excommunié par Pie VII. L’exaspération enflait dans les chaumières. Après l’hécatombe de la retraite de Russie et la défaite de Leipzig, un sénatus-consulte décrétant une nouvelle levée de près de trois cent mille hommes mit le feu aux poudres et raviva les tensions entre Jacobins et royalistes. Louis Fruchart, brave paysan de l’Alleu, d’une force athlétique et d’une intrépidité hors du commun, catholique fervent et ardent royaliste, incita bon nombre de jeunes gens à se rebeller.
Le lundi 22 novembre 1813 resta gravé dans les mémoires sous le nom de « Stokken maendag ». Les conscrits firent leur entrée à Hazebrouck, vociférant et frappant le pavé de leurs bâtons noueux. L’hôtel de la sous-préfecture fut mis à sac et le préfet Deghesquières malmené. Informé de cette rébellion, le général Lahure envoya de Lille troupe et canonniers qui mirent leurs pièces en batterie sur la Grand-Place pour rétablir l’ordre. Les révoltes s’étendirent à toute la Flandre et se muèrent en un soulèvement rural antinapoléonien d’envergure. Les insurgés se retirèrent en forêt de Nieppe et dans les impénétrables marécages des environs.
Le 16 décembre, sur le marché d’Estaires, le solide gaillard de vingt deux ans, une paire de pistolets à la ceinture, vêtu d’une blouse bleue et coiffé d’un large chapeau orné d’une cocarde blanche – sur laquelle se détachaient les mots « Je combats pour Louis XVII » surmontés de trois fleurs de lys –, apostropha la foule : « Mes amis, les puissances coalisées ne se battent contre la France que pour la délivrer de Bonaparte et rétablir les Bourbons, nos seuls souverains légitimes; ne rejoignons plus les armées du tyran ; ne lui payons plus aucune espèce de contributions; armons-nous, unissons-nous pour chasser les troupes envoyées contre nous ! […] Un meilleur avenir nous attend ; mais pour l’obtenir, prenons les armes contre celui qui nous gouverne injustement et qui nous prouve, tous les jours, qu’il est capable de sacrifier à son ambition le dernier des Français. » Le chef de bande rameutait les insoumis. Le 24 décembre, près de deux mille insurgés et déserteurs l’avaient rejoint. Le 26, ils affrontèrent à Merville un détachement militaire envoyé de Lille pour réprimer la sédition. La révolte des paysans débutait par une victoire qui provoqua un vif émoi dans la capitale.
Le soulèvement des paysans
Le 1er janvier 1814, l’Empereur chargea le général Boyer d’arrêter les séditieux et de fusiller les hommes armés. Mais les rebelles s’étaient dispersés, gagnant le département de la Lys (Bruges, Courtrai). Maître du pays, l’audacieux Fruchart assaillait les détachements impériaux qui traversaient la contrée et paralysait les opérations de la soldatesque et de la gendarmerie. Echappant à la capture, il semblait se multiplier en tous lieux. S’il inspirait de l’effroi à ses ennemis, il traitait les prisonniers avec humanité. Arrêtant un convoi de grains destiné à Dunkerque, il les fit distribuer au nom du Roi aux indigents alentour. La rébellion s’étendit à la quasi totalité du Nord, aux arrondissements de Saint-Pol, Béthune et St-Omer et jusqu’à la Somme. De succès en succès, « Louis XVII Fruchart » devint une légende. On rapporte qu’un jour, deux gendarmes demandèrent à un paysan s’il pouvait leur indiquer sa retraite : « Je puis vous le faire voir, répondit-il, suivez-moi. » Et les attirant à l’écart : « Ce Louis XVII que j’ai promis de vous montrer, le voici. En garde ! » à ces mots, il fondit sur eux, les mit hors de combat et rejoignit paisiblement ses compagnons.
Louis Fruchart surnommé louis XVII
Le baron de Geismar, colonel russe, aide de camp du duc de Saxe-Weimar, commandant un corps de cavalerie légère de six à sept cents hommes, vint prêter son appui aux conscrits insurgés et opéra la jonction avec Fruchart à Hazebrouck le 18 février 1814. Il destina aux habitants cette proclamation : « On fait savoir que tous les conscrits et tous autres qui voudront se battre pour la cause des Bourbons seront commandés par Louis Fruchart surnommé Louis XVII, qui marche avec un corps de troupes alliées. Ils seront bien nourris, habillés et payés ». Symbole de l’insurrection des campagnes contre la guerre perpétuelle, la colonne guidée par Fruchart se mit en branle dès le 19 février. Ils livrèrent une bataille difficile à Doullens, dont ils conquirent la citadelle. Les opérations des Alliés se poursuivirent courant mars dans l’Aisne, la Somme et l’Oise. Le 28 mars, ils franchirent la Marne et Paris capitula le 31. Fruchart obtint la décoration du Lys et regagna ses pénates.
Lors des Cent-Jours, le vaillant flamand se mit au service du Roi à Gand, secondé par ses deux frères Célestin et Benoit. En juin 1815, les anciens soldats de Fruchart arborèrent de nouveau leur drapeau blanc. Ils participèrent à la campagne de Belgique et armèrent une compagnie de volontaires. Placés sous les ordres du général de Bourmond, commandant la 16e division militaire, portant le nom de volontaires royaux, ils cernèrent Béthune, et le 28 investirent Arras, forçant les troupes impériales au retrait.
Louis XVIII indemnisa Fruchart des pertes subies dans sa ferme, pillée par le général Vandamme, lui octroya une rente et le fit sous-lieutenant porte-drapeau dans la lère légion départementale du Nord. Il fut élevé au grade de chevalier de la Légion d’Honneur en 1815 et nommé lieutenant, garde du corps du comte d’Artois, frère du roi, en 1822. Charles X, qui l’appréciait, reconduisit en 1824 Louis Fruchart dans son grade de garde du corps, mais cette fois du Roi. En revanche, Louis Philippe, insensible à ses sollicitations, le mit en réforme en 1837. Désabusé par cette ingratitude, le flamand rentra au pays et reprit un emploi à la Brasserie du Pont Riqueult. Le 8 janvier 1851, Louis Fruchart s’éteignait à 59 ans, célibataire, à Lestrem, chez sa sœur Catherine où il s’était retiré. •
A lire : Le Sentier de briques, de Pierre de Mouveaux, Via Romana, réédition 2014, 15 euros & Une chouannerie flamande au temps de l’Empire, de Paul Fauchille, Pedonne, 1905.

Les fameux selfies offrent le plus spectaculaire échantillon du narcissisme. Ici, à Vilnius (Lituanie), le 1er août. AFP PHOTO / PETRAS MALUKAS
C'est un tableau très exact et très complet de la société et de l'homme postmodernes que brosse ici Alain de Benoist. Il en résulte que cette sorte de révolution liquide à laquelle nous sommes confrontés ou affrontés dépasse largement le strict terrain du politique et que pour l'inverser ou la supplanter, il faudra bien plus qu'une transformation institutionnelle ou politique. Sans-doute y faudra-t-il cette métanoïa éthique, anthropologique et, bien-sûr, politique que Pierre Boutang - et André Malraux - évoquaient en leur temps. LFAR
 Modernité… Tous les médias n’ont plus que ce mot à la bouche. Il faut être moderne, nous dit-on, « parce qu’on n’arrête pas le progrès ». Au fait, ça veut dire quoi, la « modernité » ?
Modernité… Tous les médias n’ont plus que ce mot à la bouche. Il faut être moderne, nous dit-on, « parce qu’on n’arrête pas le progrès ». Au fait, ça veut dire quoi, la « modernité » ?
La modernité est une des catégories fondamentales de la sociologie historique et de la politologie contemporaines. Étudiée par une multitude d’auteurs, elle va très au-delà de ce qu’on appelle en général la modernisation (industrielle et postindustrielle). Elle trouve ses racines à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, et s’épanouit à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Elle se caractérise par la montée des classes bourgeoises, qui imposent progressivement leurs valeurs au détriment des valeurs aristocratiques et des valeurs populaires, et par la naissance de l’individualisme.
Sous l’influence de l’idéologie du progrès, rendue possible par l’essor des sciences et des techniques, s’affirme à l’époque moderne une confiance de principe dans les capacités de l’homme à gérer « rationnellement » son destin. Le passé et la tradition perdent dès lors leur légitimité, de même que les formes sociales d’appartenance traditionnelle et communautaire. L’hétéronomie par le passé est remplacée par l’hétéronomie par le futur, c’est-à-dire la croyance que demain sera nécessairement meilleur (les « lendemains qui chantent »). C’est l’époque où se déploient à la fois les philosophies du sujet et les grands systèmes historicistes, qui prétendent déceler un « sens de l’Histoire » assuré dont l’accomplissement mènerait le monde à son idéal. Sur le plan politique, le grand modèle est celui de l’État-nation, qui s’affirme au détriment des logiques féodale et impériale. Les frontières suffisent à garantir l’identité des collectivités, et servent de tremplin à des tentatives d’universalisation des valeurs occidentales, par le biais notamment de la colonisation. L’Église, de son côté, perd peu à peu le pouvoir de contrôle de la société globale qu’elle possédait autrefois.
Mais cette modernité, on y est toujours ou on en est sortis ? Quid de la « postmodernité » ?
La postmodernité ne s’oppose pas à la modernité, mais la dépasse tout en la prolongeant sur certains plans (on parle alors d’« ultra-modernité » ou encore d’« hypermodernité », au sens où l’on parle aussi d’hyperterrorisme, d’hyperpuissance, d’hypermarchés, etc.). Son avènement, à partir des années 1980, s’explique par le désenchantement du monde engendré par la désagrégation des « grands récits » historicistes, elle-même consécutive à l’effondrement des dogmes religieux et à l’échec des utopies révolutionnaires du XXe siècle.
Dans le monde postmoderne, on assiste à une dissolution généralisée des repères traditionnels, qui entraîne une fragmentation, voire une atomisation de la société civile, en même temps qu’une fragilisation des identités individuelles et collectives, elle-même génératrice de comportements anxiogènes et de poussées de « phobies » paniques. L’individualisme se mue en égocentrisme narcissique, tandis que les rapports humains extra-familiaux se réduisent à la concurrence ou à la compétition régulée par le contrat juridique et l’échange marchand. L’hédonisme s’appuie sur la consommation de masse (on consomme d’abord pour se faire plaisir plutôt que pour rivaliser avec autrui) pour viser avant tout au bien-être et à l’épanouissement personnel. Les disciplines contraignantes et les normes prescriptives s’effondrent, l’autorité sous toutes ses formes est discréditée, et l’art s’émancipe des règles de l’esthétique. On assiste aussi à un éclatement des cadres temporels, qui se traduit par le culte du présent au détriment de toute volonté de transmettre. Sur le plan politique, la gouvernance se ramène de plus en plus à la gestion, l’État-nation est débordé par le haut (emprises planétaires) et par le bas (renaissance des communautés locales), et les frontières ne garantissent plus rien.
La postmodernité correspond à ce monde « liquide » théorisé par Zygmunt Bauman, où tout ce qui était durable et solide semble se désagréger ou se liquéfier. C’est un monde de flux et de reflux, un monde de mouvances migratoires néo-nomades, caractérisé par le désinstitutionnalisation et la déterritorialisation des problématiques. Sous l’effet d’une logique économique qui a balayé tout idéal de permanence s’instaure le règne de l’éphémère et du transitoire, dans la production et la consommation des objets, tout comme dans les comportements, comme en témoignent la fin des engagements politiques de type sacerdotal, la désaffection des églises, des syndicats et des partis. La foi religieuse est privatisée, on se compose des croyances à la carte, et tous les modes de vie deviennent socialement légitimes. La vogue de l’idéologie des droits de l’homme et la croyance au pouvoir régulateur du marché se conjuguent pour légitimer la promotion des droits et l’affirmation de la « liberté des choix », tandis que l’explosion de la logique du marché entraîne la commercialisation de tous les modes de vie. Deux mots anglo-saxons résument bien cette tendance générale : le « selfie » et le « zapping », autrement dit l’obsession de soi et la volatilité des comportements, qu’ils soient électoraux ou amoureux.
Avec l’actuelle réforme de l’école, l’éternelle querelle entre les « Anciens » et les « Modernes » reprend du poil de la bête. L’enseignement du grec et du latin, c’est moderne, postmoderne ou archaïque ?
Ce n’est rien de tout cela. Car le grec et le latin, tout comme ce qui est de l’ordre de la culture authentique, ne sont ni d’hier ni de demain, mais de toujours ! •

Entretien réalisé par Nicolas Gauthier - Boulevard Voltaire

L’acteur de cinéma égyptien Omar Sharif, né Michel Demitri Chalhoub le 10 avril 1932 à Alexandrie est mort au Caire le 10 juillet 2015 à l’age de 83 ans.
Le Shérif Ali ibn el Kharish, galope sur son chameau, il vient des confins du désert, on ne sait s’il surgit du sable ou de la mer, il va à l’encontre de l’officier anglais qui vient de boire impunément l’eau du puits qui lui appartient. Personnage mythique, il est le symbole du prince Bédouin. A-t-il existé ? Seul le vent des légendes, le Shamal qui souffle sur la contrée de Rub al-Khali, dans le grand désert d’Arabie, pourrait nous répondre.
Quant au lieutenant de sa Gracieuse Majesté de Grande Bretagne, Sir Lawrence, il deviendra l’ami indéfectible du prince bédouin. Leurs incarnations furent imprimées sur la pellicule. Le Lieutenant-Colonel du Cinéma, Peter O’Toole a faussé compagnie à son partenaire, le 14 décembre 2013. Le Prince l’a rejoint le 10 juillet 2015 au Caire. Il s’appelait Omar Sharif.
Les deux mythes s’étaient croisés, ils se rejoignent pour toujours.
Acteur polyglotte
Il étudie au Collège britannique Victoria d’Alexandrie où il pratique le français ainsi que cinq autres langues : l’arabe, l’anglais, le grec, l’italien et le turc, ce qui lui permettra de doubler lui-même nombre de ses films.
Diplômé en mathématiques et physique, il va à Londres pour apprendre son métier d’acteur à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art, la même qui reçut Peter O’Toole au cours des mêmes années.
En 1954, il est de retour en Égypte et débute dans Le démon du désert de son compatriote le cinéaste Youssef Chahine. ll enchaînera avec lui Les Eaux noires, où il rencontrera la star égyptienne de l’époque Faten Hamama qu’il épousera. Lorsqu’en 1962, il joue le rôle du prince du désert Ali Ibn Kharish, dans Lawrence d’Arabie de David Lean, aux côtés de Peter O’Toole, il est déjà une vedette du cinéma égyptien après avoir tourné 26 films.
Ce rôle lui vaut une célébrité mondiale immédiate, ainsi qu’un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle 1963 et une nomination pour l’Oscar du Meilleur Second Rôle 1963.
Une carrière menée tambour battant
Omar Sharif joue alors dans plus de 60 films américains et européens avec de prestigieux metteurs en scène dont Anthony Mann, Francesco Rosi, Henri Verneuil, Sidney Lumet, Andrzej Wajda. Ses nombreux partenaires appartenaient au Gotha des grands acteurs, James Coburn et Anita Ekberg, Anthony Quinn, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Sophia Loren, Barbra Streisand, Michael Caine, Gregory Peck, Julie Andrews, Claudia Cardinale, Ingrid Bergman, Anouk Aimée, Jane Seymour, Lea Massari, Antonio Banderas, et à la télévision Jeanne Moreau et Ava Gardner…
Attiré par les grands personnages historiques, il interprète au cinéma et à la télévision, Genghis Khan, Che Guevara, Nicolas II de Russie, le capitaine Némo, Saint Pierre. Ces fresques et légendes étaient pour la plupart des adaptations de célèbres romanciers dont Joseph Kessel, James Hadley Chase, Jean-Paul Sartre, Fedor Dostoïevski…
En 1965, il rejoint son metteur en scène fétiche, David Lean, pour un triomphe mondial avec Le Docteur Jivago. Il obtient pour ce rôle le Golden Globe Award du Meilleur Acteur.
Quelques grands succès
Il participa aussi à de grands succès que furent La Nuit des généraux d’Anatole Litvak (1967) Mayerling de Terence Young (1968), Les Cavaliers de John Frankenheimer (1971), Le Casse d’Henri Verneuil (1971), Les Possédés d’Andrzej Wajda (1988) et à de nombreuses fictions et épopées à la télévision. On notera avec un immense plaisir sa participation en 1990, dans le rôle du Consul d’Aninot, au téléfilm Le Roi de Patagonie de Stéphane Kurc et Georges Campana adapté d’un roman de Jean Raspail.
On ne saurait omettre ses interprétations pleines de sensibilité et de profondeur comme celles du père attentionné dans Mayrig d’Henri Verneuil, tourné en 1992, et son rôle d’humaniste dans Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, de François Dupeyron en 2003, pour lequel il sera récompensé par le César du meilleur acteur, film nommé au Golden Globe Award du Meilleur Film Étranger.
Cette grande carrière sera accompagnée par plus de quinze récompenses et nominations dont trois Golden Globe, Trois Laurel Award, un Oscar et un Lion d’or pour sa carrière à la Mostra de Venise.
Tout au long de sa vie riche en péripéties il pratiqua l’art du bridge, jeu qui ne cède en rien au hasard mais qui exige un grand sens de la tactique. Il participa aux Olympiades de Bridge de Deauville, représentant l’équipe d’Égypte, et devint vice-champion de France open en 1971, puis vice-champion d’Europe seniors par équipes en 1999 à Malte. Il était aussi passionné par les courses hippiques.
Le 12 juillet 2015, dans une mosquée du Caire, ses obsèques ont été célébrées. Il a été inhumé au cimetière Sayyeda Nefissa, au sud de la ville.
Chaque témoin a pu jeter trois poignées de terre sur le corps. Selon la loi musulmane, il a été enveloppé d’un linceul dont les nœuds ont été préalablement dénoués. Ses pieds orientés vers la Mecque. Son regard, lui, en direction du Saint Sépulcre. Il était le fils de Joseph Chalhoub. Elevé par son père dans le rite grec-catholique melkite, il s’était converti à l’islam pour épouser l’actrice musulmane égyptienne Faten Hamama. Après leur divorce, il ne se remariera jamais : elle était la femme de sa vie. •
Bruno Stéphane-Chambon - Politique magazine