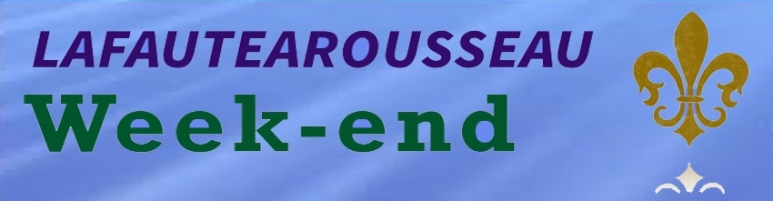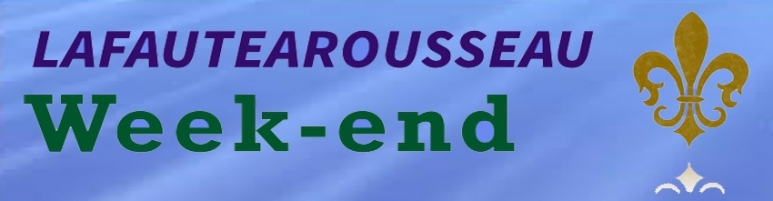Atlantico : Entretien avec Jacques Charles-Gaffiot
 Plus de trois milliards de personnes ont regardé à la télévision le mariage du prince Harry samedi dernier 19 mai à Windsor. Est-ce seulement pour ses aspects people ? L'auteur Jacques Charles-Gaffiot a décrypté pour Atlantico ce qui, derrière les ors et le cérémonial, fait en profondeur la spécificité de la monarchie, du principe dynastique, et qui n'a pas été dit. C'est en cela que cet entretien qui ne manque pas de profondeur, nous a intéressés. LFAR
Plus de trois milliards de personnes ont regardé à la télévision le mariage du prince Harry samedi dernier 19 mai à Windsor. Est-ce seulement pour ses aspects people ? L'auteur Jacques Charles-Gaffiot a décrypté pour Atlantico ce qui, derrière les ors et le cérémonial, fait en profondeur la spécificité de la monarchie, du principe dynastique, et qui n'a pas été dit. C'est en cela que cet entretien qui ne manque pas de profondeur, nous a intéressés. LFAR
 Atlantico - Le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle aura lieu ce 19 mai dans la chapelle Saint Georges du château de Windsor. Derrière l'aspect frivole de l'événement, quelles sont les causes de l'engouement pour le mariage princier ? Faut-il y voir une référence dans les mots de Winston Churchill à la jeune Reine Elizabeth, reprenant ce que Walter Bagehot percevait comme crucial au sein de la Constitution, entre « the efficient » (l'efficient) et « the dignified » (solennel, honorable), séparant ainsi l’action du gouvernement du rôle de la Monarchie ?
Atlantico - Le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle aura lieu ce 19 mai dans la chapelle Saint Georges du château de Windsor. Derrière l'aspect frivole de l'événement, quelles sont les causes de l'engouement pour le mariage princier ? Faut-il y voir une référence dans les mots de Winston Churchill à la jeune Reine Elizabeth, reprenant ce que Walter Bagehot percevait comme crucial au sein de la Constitution, entre « the efficient » (l'efficient) et « the dignified » (solennel, honorable), séparant ainsi l’action du gouvernement du rôle de la Monarchie ?
Jacques Charles-Gaffiot - Votre question résume assez bien toute la problématique dans laquelle se meuvent dans l’exercice de la souveraineté non seulement la monarchie anglaise mais également les différents Etats du monde, quel que soit finalement le régime auxquels ils appartiennent. Effectivement, derrière un aspect purement mondain qui demeure le prisme à travers lequel les médias scruteront dans ses moindres détails le mariage princier du 19 mai, se trouve exprimée une nouvelle fois la séduction exercée sur les gouvernés par le bon usage de l’autorité. Car il ne faut pas s’y tromper, si le côté « glamour » de cette union peut séduire le bon peuple par son aspect romantique et faire verser dans les chaumières des larmes d’ivresse, il faut donner une autre explication à cet engouement quasi universel suscité par ce mémorable événement.
Nous ne parlons pas ici du « pouvoir » exercé par les gouvernants qui peut aller jusqu’à s’appliquer de manière coercitive sur leurs inférieurs, mais de « l’autorité », c’est à dire de ce penchant naturel qui pousse les gouvernés à reconnaître dans la personne investie de la souveraineté, une allégeance assumée, reconduite au fil des années et voire même au-delà.
Comment donc se fait-il que des millions de téléspectateurs ou que des centaines de milliers de spectateurs acceptent de suivre bouche bée la retransmission d’une festivité familiale unissant deux personnes qu’ils ne rencontreront pour la plupart sans doute jamais ?
Certains parleront de la fascination exercée par un spectacle aussi chamarré que suranné :
Le luxe, la grandeur ou « l’esprit de magnificence » pour reprendre l’expression chère à Madame de Genlis, gouvernante des princes de la Maison d’Orléans au milieu du XVIIIe siècle, peuvent à juste titre séduire une foule. Mais la pompe déployée au château de Windsor n’est en rien une pure ostentation. Cela serait du plus mauvais goût. Mais comme le note Félicité de Genlis, partie se réfugier en Angleterre durant la Terreur, « l’esprit de l’étiquette » … « paraît avoir toujours été de ménager avec un art infini et d’accorder les droits les plus étendus de la souveraineté avec la dignité de l’homme, accord délicat et difficile, mais qui peut seul donner au trône la majesté et tout l’éclat qu’il peut avoir ». C’est ainsi qu’il faut-il tout d’abord comprendre le minutieux bal paré organisé aujourd’hui tout au long de la journée. Chacun pourra percevoir, pour autant que les yeux sachent voir et les oreilles entendre, que la véritable grandeur sait naturellement élever tout ce qui l’approche et, qu’à l’inverse, chercher à rabaisser revient à détruire en manifestant un emploi des plus malheureux et des moins nobles de l’apanage de la puissance.
Ainsi des millions de spectateurs sont-ils conviés à sentir en eux-mêmes cette sorte d’élévation, comme s’ils étaient invités à se rapprocher des acteurs de la scène. Mais au milieu de tant d’honneurs, de marques d’attention, ils observeront également l’énorme distance à laquelle se tient le souverain.
Aussi captivante soit-elle, la fascination exercée par ces fastes royaux n’explique pas tout. Il faut oser le dire, la famille royale d’Angleterre et la Reine en particulier, sont aimées… dans les proportions dépassant largement civilités, déférences ou considération.
Or, l’amour ne se force pas. Il convient donc de chercher à l’engouement de ce mariage princier une autre explication plus satisfaisante.
On approchera plus facilement d’une réponse en considérant ce qui se passe chez nous, en France.
Certes, Emmanuel Macron a donné à sa fonction une grandeur qui avait été bien mise à mal depuis longtemps, et que les médias, l’intelligentia post soixante-huitarde ont contribué à vilipender et à conspuer également durant des lustres.
Même en faisant montre de réelles compétences, les chefs d’Etat français, à part peut-être le Général, n’ont jamais suscité pareille adulation. En France, tout au moins depuis la Ve République, les titulaires de la souveraineté se sont plu, en fait, à n’exprimer de leur personnage placé au sommet de la hiérarchie, que la moitié des qualités données à leur fonction, celle touchant à l’exercice du pouvoir en délaissant volontairement l’incarnation de l’autorité, assimilée à une forme déguisée de l’autoritarisme. Non par un choix délibéré, mais davantage parce que chefs de parti politique, aux regards de leurs administrés, il est devenu de plus en plus difficile de voir en nos Présidents de la République de véritables arbitres disposés à sacrifier l’ensemble de leurs intérêts personnels ou de leurs préjugés idéologiques dans le but de préserver les intérêts de la Nation et de garantir le règne de la Justice.
On pourra en rire ou même s’en moquer. Mais que l’on s’attache un instant à observer l’attitude de la souveraine anglaise durant la cérémonie organisée ce matin. Comme elle en a fait la promesse en accédant au trône, toute sa personne et mise au service de la fonction qu’elle exerce. Toute sa personne… jusqu’au terme de son existence. Il ne s’agit pas là d’un don de soi fantaisiste pouvant être repris selon certaines convenances pour succomber au découragement ou se livrer à d’inavouables débordements.
A une époque où le relativisme est de règle, l’exemple anglais force l’admiration et fait converger vers lui la masse des suffrages. Devant les caméras du monde entier, tout au long de cette nouvelle journée (comme hier et assurément comme demain) Elisabeth II accomplit son « métier » de Reine. Mieux, elle s’y consacre.
Voilà le mot lâché… Les nombreux commentateurs du mariage de Harry et de Meghan, trop aveuglés par les feux de la rampe, ne diront rien sur le sens le plus profond de ce spectacle offert au monde entier. Elisabeth II est un personnage sacré. Depuis son couronnement, autour d’elle, se déploie une véritable liturgie qui ne s’estompe qu’en privé. Ce cérémonial singulier s’exprime aujourd’hui et se déploie depuis les premiers préparatifs jusqu’au terme de l’événement : les ors, le faste, le rituel si achevé concourent à la beauté de la cérémonie. Mais comme l’enseigne Platon puis à sa suite Thomas d’Aquin, ce beau relatif conduit au Beau lequel conduit au Vrai. Pareille affirmation n’est plus dans l’air du temps. Et l’on entend déjà les rumeurs des contestataires, héritiers de 68, les indignations des sceptiques professionnels, les moqueries de la bien-pensance !
Quant à la foule qui se bouscule à Windsor, comme tous ceux suspendus à leur poste de télévision ou devant leur tablette numérique, ils ont pressenti sans trop y réfléchir qu’il se passe, à l’occasion de ce mariage, quelque chose d’exceptionnel. D’instinct, ils ont mesuré qu’une dose de transcendance s’exhale dans l’exercice de la souveraineté. Et s’ils se comptent ce matin en millions d’individus n’est-ce pas parce que dans leur univers quotidien cette aspiration semble pouvoir renaître après son soigneux effacement et la tentative de son remplacement par l’instauration de pseudo principes qui au final demeurent vides de sens malgré tous les efforts déployés pour les faire apparaître comme des universaux.
Une fois de plus, dans la chapelle de Windsor, l’authentique fidélité d’un souverain à son serment solennel conjugué à l’acte consécratoire reçu, contribue à faire avancer la construction de l’humanité d’une manière sûre et sereine.
Dans quelle mesure cette référence au « Dignified » peut-elle se conjuguer avec la personnalité de Meghan Markle, non pas en tant que roturière mais en tant que célébrité ? Quelles sont les conséquences d'un tel mariage entre famille royale et la célébrité ?
Jacques Charles-Gaffiot - Les ailes du papillon se consument toujours au contact du feu ! Il faut sans doute à Meghan Marke beaucoup d’efforts ou une prédisposition exceptionnelle pour évoluer dans la position qui est désormais sienne. On l’a vu avec Diana, l’échec est toujours possible. La fonction commande beaucoup de sacrifices. Cependant, arrivant à la sixième place dans la succession au Trône, le prince Harry peut « prendre le risque » de choisir une épouse selon son cœur. La « célébrité » toute factice de l’actrice de second plan peut disparaître rapidement pour donner naissance à une « célébrité » plus authentique, reposant sur des actes méritoires renouvelés.
« Noblesse oblige » dit le dicton. L’obligation se mue en devoirs en face d’une noblesse aussi neuve. La nouvelle duchesse devra faire ses preuves. En s’aventurant sur des sentiers incertains, son époux, les membres de sa nouvelle famille et plus encore Elisabeth II sauront sans doute l’avertir à temps des dangers encourus.
Sur un temps plus long, qu'est-ce que la nouvelle génération a pu apporter à la famille royale ? Inversement, quelles sont les fragilités que cette nouvelle génération aurait pu provoquer ?
Jacques Charles-Gaffiot - Ces fragilités sont bien sûr celles de la génération actuelle qui recherche la satisfaction immédiate de ses désirs en considérant de surcroît que tout étant relatif plus aucune valeur ne saurait s’imposer.
L’héritage de 68, la vacuité de certains systèmes de pensée très en vogue, le désir de tenter toutes les expériences, une conception fallacieuse de la notion de liberté, le consumérisme sous toutes ses formes compulsives, la jouissance sans entrave sont de véritables écueils.
Mais la nouvelle génération peut apporter avec elle et insuffler au sein de la famille royale une série de forces nouvelles permettant une heureuse transmission de la charge détenue depuis trois siècles. Le long règne d’Elisabeth II a pu apporter avec le temps un certain conformisme dont les petits-enfants de la souveraine pourront s’affranchir tout en sachant garder à l’esprit la hauteur de la charge qu’ils doivent incarner. Le principe monarchique ne saurait s’affranchir de cette médiation qui lui est sans doute spécifique. La souveraineté s’incarne dans une personne. Il est heureux qu’elle puisse se manifester à travers un jeune couple entouré d’enfants. Mais en l’absence d’adéquation, le principe s’effondre rapidement et bientôt n’a plus de raison d’être. Dans ce cas, comme le mentionne Louis XVI dans son Testament, « n’inspirant plus le respect le monarque est plus nuisible qu’utile ».
Enfin, la jeune génération a su acquérir une expérience sans doute plus diversifiée et plus riche qu’autrefois. Voilà un véritable atout pouvant permettre à ces jeunes princes et princesses de parvenir à rester fidèle à leur vocation dynastique tout en sachant mettre un pied dans l’avenir. •
Jacques Charles-Gaffiot est l'auteur de Trônes en majesté, l’Autorité et son symbole (Édition du Cerf), et commissaire de l'exposition Trésors du Saint-Sépulcre. Présents des cours royales européennes qui fut présentée au château de Versailles jusqu’au 14 juillet 2013.
atlantico


 Que fera le président de la République lorsque ses grandes conceptions – l’européenne et la mondialiste - finiront par buter sans retour contre le mur des réalités ? S'obstinera-t-il à courir après des solutions impossibles et caduques ou sera-t-il capable de tirer les conséquences de la situation telle qu'elle est vraiment ? Sera-t-il suffisamment souple d'esprit, aura-t-il assez de lucidité et de volonté réunies,
Que fera le président de la République lorsque ses grandes conceptions – l’européenne et la mondialiste - finiront par buter sans retour contre le mur des réalités ? S'obstinera-t-il à courir après des solutions impossibles et caduques ou sera-t-il capable de tirer les conséquences de la situation telle qu'elle est vraiment ? Sera-t-il suffisamment souple d'esprit, aura-t-il assez de lucidité et de volonté réunies,
 Plus de trois milliards de personnes ont regardé à la télévision le mariage du prince Harry samedi dernier 19 mai à Windsor. Est-ce seulement pour ses aspects people ? L
Plus de trois milliards de personnes ont regardé à la télévision le mariage du prince Harry samedi dernier 19 mai à Windsor. Est-ce seulement pour ses aspects people ? L Atlantico - Le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle aura lieu ce 19 mai dans la chapelle Saint Georges du château de Windsor. Derrière l'aspect frivole de l'événement, quelles sont les causes de l'engouement pour le mariage princier ? Faut-il y voir une référence dans les mots de Winston Churchill à la jeune Reine Elizabeth, reprenant ce que Walter Bagehot percevait comme crucial au sein de la Constitution, entre « the efficient » (l'efficient) et « the dignified » (solennel, honorable), séparant ainsi l’action du gouvernement du rôle de la Monarchie ?
Atlantico - Le mariage du Prince Harry et de Meghan Markle aura lieu ce 19 mai dans la chapelle Saint Georges du château de Windsor. Derrière l'aspect frivole de l'événement, quelles sont les causes de l'engouement pour le mariage princier ? Faut-il y voir une référence dans les mots de Winston Churchill à la jeune Reine Elizabeth, reprenant ce que Walter Bagehot percevait comme crucial au sein de la Constitution, entre « the efficient » (l'efficient) et « the dignified » (solennel, honorable), séparant ainsi l’action du gouvernement du rôle de la Monarchie ?


 économique de l’Union a aussitôt fait comprendre par la bouche même de Mme Merkel qu’il y a des limites et qu'elle préférera toujours un compromis avec celui qui est désormais son partenaire privilégié. Concernant l’Iran, c’est bien une illusion de penser que l’Union puisse avoir une véritable « capacité d’initiative diplomatique » (Le Monde, vendredi 18), le risque étant que son impuissance naturelle ne profite en fin de compte à d’autres, comme la Russie qui, elle, a forcément cette capacité-là : M. Riabkov, vice-ministre des Affaires étrangères russe a immédiatement approuvé le projet européen d’une très prochaine réunion à Vienne, confirmant ainsi les prétentions de Moscou.
économique de l’Union a aussitôt fait comprendre par la bouche même de Mme Merkel qu’il y a des limites et qu'elle préférera toujours un compromis avec celui qui est désormais son partenaire privilégié. Concernant l’Iran, c’est bien une illusion de penser que l’Union puisse avoir une véritable « capacité d’initiative diplomatique » (Le Monde, vendredi 18), le risque étant que son impuissance naturelle ne profite en fin de compte à d’autres, comme la Russie qui, elle, a forcément cette capacité-là : M. Riabkov, vice-ministre des Affaires étrangères russe a immédiatement approuvé le projet européen d’une très prochaine réunion à Vienne, confirmant ainsi les prétentions de Moscou.