Société • Ça doit être sympa, d’être de gauche…

Par Gabrielle Cluzel
Une excellente chronique qu'on ne peut qu'approuver, parue dans Boulevard Voltaire du 23.10.
Rappelons pour ceux qui l'ignoreraient que Gabrielle Cluzel a participé - d'ailleurs brillamment - au colloque du Cercle de Flore « Refonder le bien commun », du 13 mai dernier, à Paris (Illustration ci-dessous). LFAR
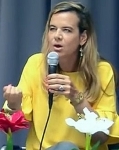 Ça doit être sympa, d’être de gauche. D’être du côté des gentils, des bons, du bien, de ceux qui ont toujours raison.
Ça doit être sympa, d’être de gauche. D’être du côté des gentils, des bons, du bien, de ceux qui ont toujours raison.
Christine Boutin vient de se retirer de la politique. Beaucoup de remerciements, bien sûr, mais il faut lire, aussi, les injures que cette annonce suscite. Il faut voir les seaux d’immondices que des anonymes, bien planqués derrière les volets occultants des réseaux sociaux, lui déversent sur la tête. Comme à chacune de ses interventions, d’ailleurs. Et elle, stoïque, ne répond rien. Peu ou prou comme Ludovine de La Rochère, et avec le même flegme, elle subit quotidiennement les flèches hargneuses, graveleuses, misogynes, ordurières, insultantes… de ceux-là qui arborent, deux tweets plus bas, le plus sérieusement du monde, le hashtag #BalanceTonPorc. Si Christine Boutin devait balancer tous les porcs qu’elle a, malgré elle, côtoyés, il ne suffirait pas d’une journée.
C’est chouette, d’être de gauche. On peut être schizophrène, de la plus grossière mauvaise foi… et se sentir dans son bon droit.
On dénonce, donc, le harcèlement sexuel, avec des airs douloureux de rosière outragée, mais – on ironise – « faut-il que vous ayez le front bas et l’esprit puritain ! » – on s’indigne avec effroi – « Goebbels, va ! » – si vous suggérez qu’on pourrait commencer par balancer (à la poubelle ou, en tout cas, hors de l’espace public) ces « œuvres d’art » autoproclamées imposant au passant un regard aussi poétique sur la femme et la sexualité que le « vagin de la reine », le plug anal ou, récemment, devant Beaubourg, « Domestikator » (sic).
C’est bien, d’être de gauche. On peut mettre ses neurones sur off, son cerveau en vacances, déserter toute réflexion critique en laissant simplement une alarme qui détecte les effractions dans la maison pensée unique : elle fonctionne avec quelques mots clés, s’appelle réductio ad hitlerum (ou, variante, ad FNum, ad LMPTum, ad SensCommunum) et, quand elle couine, fait un boucan de tous les diables. Aucune chance que le brigand téméraire – suicidaire ? – tente une nouvelle incursion.
C’est commode, d’être de gauche, parce qu’on fait sa propre loi. Robin de La Roche l’évoquait, hier, avec l’éloquence qu’on lui connaît : on peut publier, à l’instar d’Europe 1 sur l’Action française, les plus grossières Fake News – imaginons, mutatis mutandis, un fiché S soupçonné de passer à l’action qui aurait un court moment fréquenté telle mosquée, puis l’aurait quittée ne la trouvant pas assez « radicalisée »… que dirait-on du journal qui oserait titrer : « Enquête sur cette mosquée islamiste qui fomentait un attentat » ? – et continuer à plastronner sans complexe, auréolé du Décodex.
Ça fait rêver, d’être de gauche. Ou pas. Le joker permanent qu’est l’anathème est mère de l’indigence intellectuelle la plus crasse. Plus besoin de réfléchir, de justifier, de traquer in petto ses propres incohérences avant de s’exprimer, puisqu’on ne démontre plus : on assène. On tient les autres licou serré, mais on se laisse aller, pour soi, avec paresse – qui jugerait les juges ? – à la pensée relâchée.
Leur tyrannie intellectuelle aura eu cet effet purificateur de forcer le camp qu’ils exècrent à l’exigence, l’honnêteté, la rigueur, car observé, surveillé, matraqué, celui-ci n’a pas le droit à l’erreur. Et c’est sans doute le meilleur service qu’ils lui auront, involontairement, rendu. •
Ecrivain, journaliste

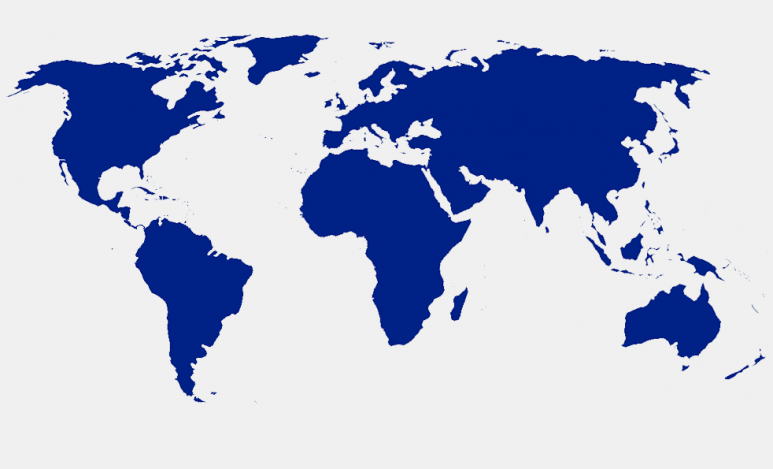
 Le monde a déjà connu des phénomènes en partie comparables à ce que l'on nomme aujourd'hui la mondialisation. L'empire romain dans l'Antiquité, l'expansion européenne et la première épopée coloniale à la Renaissance, la seconde épopée coloniale et la domination économique et financière du Royaume-Uni à l'ère de la Révolution industrielle et jusqu'en 1914.
Le monde a déjà connu des phénomènes en partie comparables à ce que l'on nomme aujourd'hui la mondialisation. L'empire romain dans l'Antiquité, l'expansion européenne et la première épopée coloniale à la Renaissance, la seconde épopée coloniale et la domination économique et financière du Royaume-Uni à l'ère de la Révolution industrielle et jusqu'en 1914.


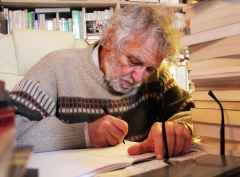

 C'est un torrent qui emporte tout. Qui dévaste tout, qui détruit tout, qui ravage tout. Qui envahit tout. Le torrent de la parole libérée. La parole qui dénonce, la parole qui accuse, la parole qui menace. L'incroyable tsunami de « Balance ton porc » nous plonge soudain dans le monde décrit il y a des années par l'écrivain Philippe Muray qui avait prophétisé que le temps du néopuritanisme féministe succéderait à celui de la libération sexuelle des années 1970, et qu'il s'achèverait dans une fureur répressive et inquisitoriale : « A l'envie de pénis, succédera l'envie de pénal. »
C'est un torrent qui emporte tout. Qui dévaste tout, qui détruit tout, qui ravage tout. Qui envahit tout. Le torrent de la parole libérée. La parole qui dénonce, la parole qui accuse, la parole qui menace. L'incroyable tsunami de « Balance ton porc » nous plonge soudain dans le monde décrit il y a des années par l'écrivain Philippe Muray qui avait prophétisé que le temps du néopuritanisme féministe succéderait à celui de la libération sexuelle des années 1970, et qu'il s'achèverait dans une fureur répressive et inquisitoriale : « A l'envie de pénis, succédera l'envie de pénal. »
 A l'heure du hashtag mobilisateur et des indignations électroniques , on permettra à quelqu'un qui ne marche au pas cadencé des modes hystériques et des pauses avantageuses de choisir ses causes.
A l'heure du hashtag mobilisateur et des indignations électroniques , on permettra à quelqu'un qui ne marche au pas cadencé des modes hystériques et des pauses avantageuses de choisir ses causes.
 Le maréchal Sissi qui a sauvé l'Egypte d'une dictature islamique et se trouve être notre allié contre le terrorisme, a quitté Paris après trois jours de critiques médiatiques incessantes, universelles, fatigantes par leur uniformité, leur répétitivité et finalement leur sottise. Une autre dictature en quelque sorte qui ne dit pas son nom et dont pour l'heure personne ne nous a sauvés.
Le maréchal Sissi qui a sauvé l'Egypte d'une dictature islamique et se trouve être notre allié contre le terrorisme, a quitté Paris après trois jours de critiques médiatiques incessantes, universelles, fatigantes par leur uniformité, leur répétitivité et finalement leur sottise. Une autre dictature en quelque sorte qui ne dit pas son nom et dont pour l'heure personne ne nous a sauvés.
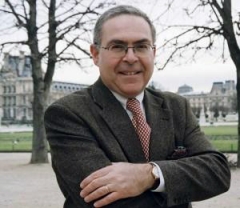 Un peu éclipsé, dimanche soir*, par l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, le résultat des élections législatives autrichiennes a provoqué des commentaires prouvant la méconnaissance ou l'incompréhension du système politique de ce pays.
Un peu éclipsé, dimanche soir*, par l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, le résultat des élections législatives autrichiennes a provoqué des commentaires prouvant la méconnaissance ou l'incompréhension du système politique de ce pays.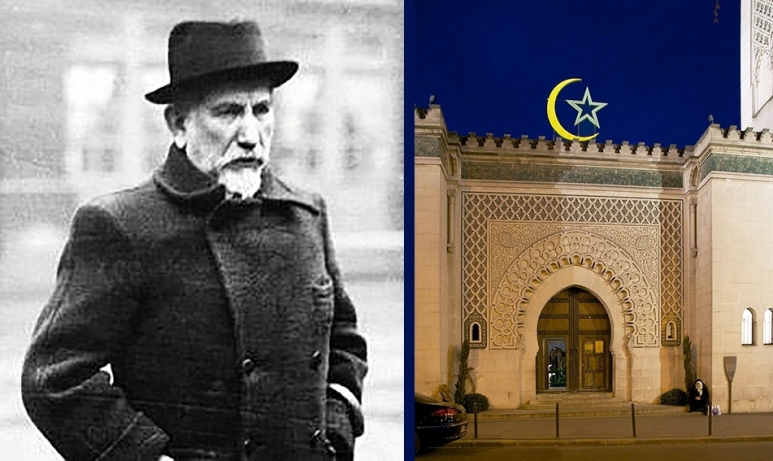
 On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays.
On sait que la décision de construire la Mosquée de Paris, première mosquée construite en France métropolitaine, fut prise après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de confession musulmane ayant combattu pour la France. Et manifester aux survivants la reconnaissance de leur sacrifice par le pays.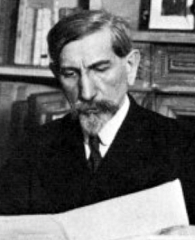 « Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir...
« Mais s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas que l’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte-Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir... 




 Cette fois, les bien-pensants de la presse, des o.n.g. et des « associations » n’ont pas obtenu gain de cause. Mis en demeure de « ne pas rester silencieux » face au maréchal Sissi sur la répression que le pouvoir égyptien exerce(rait) non seulement contre ses opposants démocrates ou islamistes mais aussi contre les homosexuels et surtout contre la sacro-sainte presse, M. Macron a déclaré : « Je n'accepte pas que d'autres dirigeants me donnent des le
Cette fois, les bien-pensants de la presse, des o.n.g. et des « associations » n’ont pas obtenu gain de cause. Mis en demeure de « ne pas rester silencieux » face au maréchal Sissi sur la répression que le pouvoir égyptien exerce(rait) non seulement contre ses opposants démocrates ou islamistes mais aussi contre les homosexuels et surtout contre la sacro-sainte presse, M. Macron a déclaré : « Je n'accepte pas que d'autres dirigeants me donnent des le