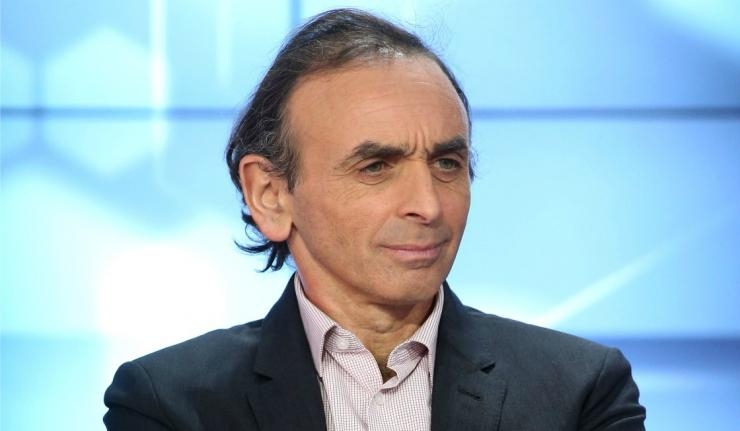Ras-le-bol des partis ! Par Bernard Pascaud *
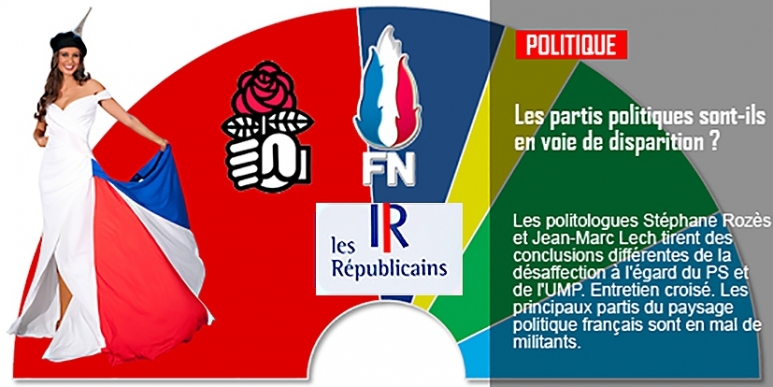
 Les fesses encore rougies des coups de pieds qui l’ont chassé de l’Élysée, Sarkozy préfère croire qu’on le pousse en avant pour y revenir. Faut-il s’en indigner, ou même en être surpris ? Surtout, faut-il s’en réjouir ? En tout cas, pour se tordre de rire il n’est que de lire la « Lettre aux Français » qu’il a adressée aux militants de sa famille politique (montrant en cela qu’il confondait les Français avec ses soutiens partisans, à l’instar des socialistes avec le PS). Il y justifie la nouvelle appellation du parti : « Les Républicains ». A vrai dire, quelle vacuité ! UMP ou Républicains, peu importe, on a beau le changer de bocal, un cornichon reste un cornichon. On trouve dans le texte des lapalissades du genre : « Nos victoires électorales futures dépendront de notre capacité à réunir autour de nos idées le plus grand nombre de Français »… Certes ! Quelles idées ? On s’attend à quelque révélation sur un nouveau projet collectif ou de nouvelles ambitions nationales. Mais la réponse est : « Celles de la République ». Nous voilà rassurés ! En réalité, la République est à l’électoralisme ce que la sexualité est à la publicité : la tentative de ratisser large, chaque électeur, comme chaque consommateur, pouvant se sentir concerné. Mais la ficelle est un peu grosse, grosse comme une corde à pendu.
Les fesses encore rougies des coups de pieds qui l’ont chassé de l’Élysée, Sarkozy préfère croire qu’on le pousse en avant pour y revenir. Faut-il s’en indigner, ou même en être surpris ? Surtout, faut-il s’en réjouir ? En tout cas, pour se tordre de rire il n’est que de lire la « Lettre aux Français » qu’il a adressée aux militants de sa famille politique (montrant en cela qu’il confondait les Français avec ses soutiens partisans, à l’instar des socialistes avec le PS). Il y justifie la nouvelle appellation du parti : « Les Républicains ». A vrai dire, quelle vacuité ! UMP ou Républicains, peu importe, on a beau le changer de bocal, un cornichon reste un cornichon. On trouve dans le texte des lapalissades du genre : « Nos victoires électorales futures dépendront de notre capacité à réunir autour de nos idées le plus grand nombre de Français »… Certes ! Quelles idées ? On s’attend à quelque révélation sur un nouveau projet collectif ou de nouvelles ambitions nationales. Mais la réponse est : « Celles de la République ». Nous voilà rassurés ! En réalité, la République est à l’électoralisme ce que la sexualité est à la publicité : la tentative de ratisser large, chaque électeur, comme chaque consommateur, pouvant se sentir concerné. Mais la ficelle est un peu grosse, grosse comme une corde à pendu.
« En proposant de nous appeler « Les Républicains », nous voulons montrer la volonté de ne céder en rien face à ce qui, au quotidien, affaiblit la République ». On eût préféré l’expression d’une volonté de lutter contre l’affaiblissement de la France. Mais son bilan d’ancien président l’aurait mis en porte-à-faux sur ce point (il fut celui qui trahit les Français à Lisbonne et arrima davantage notre pays à la politique américaine). En lieu et place d’un dessein alternatif on ne trouve que de la surenchère. Dans toute la classe politicienne chacun y va de son couplet, mais c’est toujours la même rengaine sur les « valeurs républicaines ». Ils devraient se grouper en chorale, ça gagnerait du temps, mais chacun veut paraître plus républicain que l’autre ! Chacun prétend incarner le sauveur de la République, être son rempart, son gardien du Temple. Quelle mascarade ! « Moi ou le chaos », disait De Gaulle ! « Moi ou Le Pen » disait Chirac ! Moi ou la fin de la République, suggère Sarkozy ! Mais aussi Hollande, Valls, et bien d’autres encore, tous !
Venons-en au passage prétendument le plus consistant : « La République, c’est la liberté, ce n’est pas la contrainte. La République, c’est l’autorité, ce n’est pas le laxisme. La République, c’est le mérite, ce n’est pas le nivellement. La République, c’est l’effort, ce n’est pas l’assistanat. La République, c’est la laïcité, ce n’est pas le prosélytisme et l’intégrisme. La République, c’est l’unité, ce n’est pas l’addition des communautarismes. La République, c’est un combat permanent, ce n’est pas un recul de tous les jours. La République, c’est la France, la République, c’est la Nation. » La réfutation argumentée de ce texte serait un bel exercice pour nos jeunes amis de l’Université d’été royaliste (certes exercice un peu facile, je vous l’accorde !). Faisons ici seulement deux remarques.
1) Selon ce texte, ce que la République ne doit pas être, la République peut néanmoins permettre que cela soit, puisque la longue définition le dénonce comme un constat navré ! Aveu qu’elle est le contraire de ce qu’elle voudrait être. On est dans l’utopie.
2) Ce constat navré laisse penser qu’il y a dérive des valeurs républicaines, sous entendu à cause d’un personnel mauvais qu’il faut donc remplacer par un personnel vertueux. Suivez mon regard… Autrement dit, la République est en danger… en danger de subversion par des hommes pervertis. Est-ce si sûr ? On sait depuis belle lurette que la République a toujours eu un fonctionnement oligarchique à tendance totalitaire. Sa pratique relève de ce qu’on pourrait appeler l’esprit de marché accouplé à un ordre moral autoritaire. Détailler serait facile. C’est toute notre actualité. Il est ainsi emblématique que ce soit Une Cour Européenne dites des Droits de l’Homme qui juge licite d’interrompre les soins pour un homme handicapé, mais nullement malade ou en fin de vie. Tout aussi archétypale est la réforme du collège, imposée par une ministre inculte, mais justifiée par la valeur d’ "Égalité". Dès lors la mégère-ministre ose tout, jusqu’à traiter à sa façon de pseudo Z-intellectuels ceux qui y trouvaient à redire. "Égalité" !, "Égalité" !, scandaient les députés au moment du vote du mariage unisexe. Toute opposition devient intolérable puisque tout est démocratiquement respecté : la procédure majoritaire et la référence aux valeurs.
De gauche ou de droite la République ne sera jamais la solution. Ses sous-valeurs qui en sont l’alpha et l’oméga ont présidé à toutes les déconstructions. Elles ne sont qu’un énorme abus de parole creuse et servent aujourd’hui de cadre à la mise en place progressive du meilleur des mondes. Pour y résister et monter à l’assaut de l’avenir rien n’est plus urgent que de se détourner de la logique partisane. Plusieurs affluents ont fait le fleuve républicain mais c’est toujours la même eau d’égout, toujours plus nauséeuse. Le mieux est de s’en détourner. Deux façons d’agir sont alors possibles : le mode de rayonnement, comme le dit Fabrice Hadjadj, c’est-à-dire en consolidant les corps sociaux dans lesquels on vit quotidiennement. En même temps, résister au meilleur des mondes, dit Eric Letty, exige « de réintroduire de la politique à l’échelon nationale et, donc, de restaurer la souveraineté car la nation demeure le degré raisonnable d’organisation d’une société. »** Pratiquons cela et expliquons-le autour de nous ■
* Président de la Restauration Nationale
** Résistance au meilleur des mondes, Guillaume de Prémare et Eric Letty éd. Pierre-Guillaume de Roux, 213p, 19 euros.

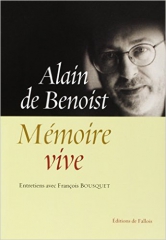
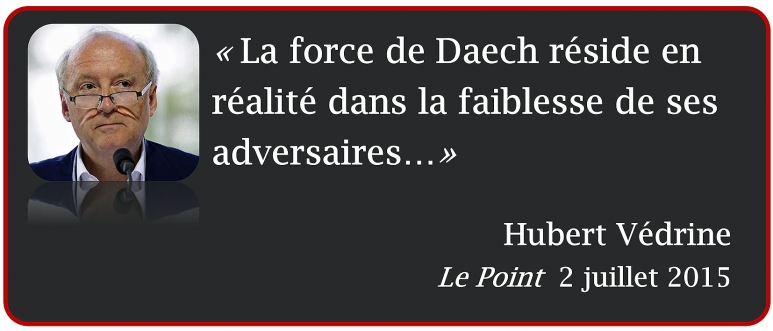

 Vaincue, pire que vaincue, défaite, occupée, ravagée, humiliée, haïe, morcelée, mise au ban de l’humanité, tandis que la France, après avoir été admise in extremis à la table des vainqueurs, prenait rang parmi les Cinq Grands, qui, en 1945, aurait parié un mark sur le retour de l’Allemagne dans le concert des nations ?
Vaincue, pire que vaincue, défaite, occupée, ravagée, humiliée, haïe, morcelée, mise au ban de l’humanité, tandis que la France, après avoir été admise in extremis à la table des vainqueurs, prenait rang parmi les Cinq Grands, qui, en 1945, aurait parié un mark sur le retour de l’Allemagne dans le concert des nations ?


 Alors que François Hollande, apprenant l’attentat terroriste commis vendredi 26 juin à côté de Grenoble contre une usine chimique, n’a su qu’ânonner « la nécessité de porter des valeurs et de ne pas céder à la peur, jamais »,...
Alors que François Hollande, apprenant l’attentat terroriste commis vendredi 26 juin à côté de Grenoble contre une usine chimique, n’a su qu’ânonner « la nécessité de porter des valeurs et de ne pas céder à la peur, jamais »,...

 Un observateur attentif des réalités françaises ne manquerait pas de remarquer que plusieurs éléments, et non des moindres, des problèmes de notre pays, montrent qu'on est arrivé à la fin d'une époque, sur le plan des institutions, sur le plan économique et sur celui de la politique étrangère.
Un observateur attentif des réalités françaises ne manquerait pas de remarquer que plusieurs éléments, et non des moindres, des problèmes de notre pays, montrent qu'on est arrivé à la fin d'une époque, sur le plan des institutions, sur le plan économique et sur celui de la politique étrangère. 
 Votre livre s'intitule Le mur de l'ouest n'est pas tombé. Comment analysez-vous l'affaire Franceleaks ?
Votre livre s'intitule Le mur de l'ouest n'est pas tombé. Comment analysez-vous l'affaire Franceleaks ?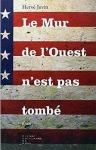
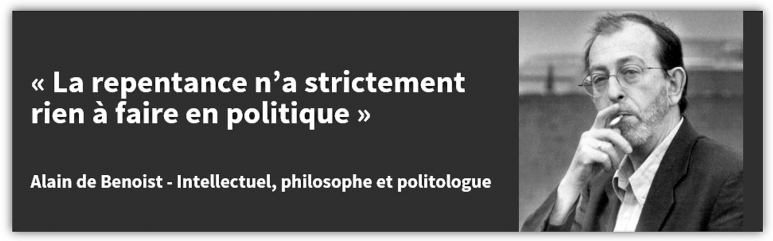

 « Guerre de civilisation » : les mots du premier ministre claquent de leur force belliqueuse et transportent
« Guerre de civilisation » : les mots du premier ministre claquent de leur force belliqueuse et transportent