A la Une du Figaro d'hier jeudi ...

Lire dans Lafautearousseau ...
Le « scandale Facebook » - dit aussi « scandale des données »
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Lire dans Lafautearousseau ...
Le « scandale Facebook » - dit aussi « scandale des données »

Trio infernal ?
Par Antoine de Lacoste

Les deux dernières nominations de Donald Trump à la Maison Blanche rappellent les pires heures de l’ère Bush et de la criminelle invasion de l’Irak.
La promotion de John Bolton comme conseiller à la sécurité nationale est à cet égard particulièrement symbolique. Il avait en effet milité, avec ses amis du courant néoconservateur, pour cette « invasion préventive ». Il était alors membre important du département d’Etat, l’équivalent de notre ministère des Affaires étrangères. Très proche du vice-président Cheney, chef de file de ces faucons qui parviendront à convaincre l’opinion américaine que l’Irak disposait d’armes de destructions massives.
Cette nomination est tout à fait surprenante car le candidat Trump, n’avait pas eu de mots assez durs contre la destruction de l’Irak : « La pire des pires décisions jamais prises », « Nous avons rendu un très mauvais service au Moyen-Orient et à l’humanité ».
Depuis, jamais John Bolton n’a émis le moindre regret sur ce mensonge d’Etat qui a directement engendré l’Etat islamique.
L’autre nomination n’est pas moins surprenante : il s’agit du patron de la CIA, Mike Pompeo, qui sera nommé Secrétaire d’Etat, dès que le Sénat aura ratifié la décision de Trump. Quand on sait que la CIA a livré de nombreuses armes aux islamistes syriens, dont certaines se sont retrouvées entre les mains de Daesh et d’Al Nosra…
Ces deux nominations semblent liées à l’accord nucléaire iranien que Trump veut dénoncer, malgré l’opposition très forte de ses alliés européens et, bien sûr, de la Russie. Trop de conseillers du Président étaient hostiles à cette dénonciation, notamment Rex Tillerson, qui s’est, semble-t-il fait limoger pour cela.
Avec Bolton et Pompeo, Trump aura deux alliés de poids, deux faucons revendiqués.
Mais nous ne sommes jamais au bout de nos surprises avec Donald Trump : quelques jours après, il annonçait, à la stupéfaction des deux faucons en question, qu’il fallait « quitter la Syrie. Laissons d’autres s’en occuper maintenant. »
Toutefois, bien malin qui peut dire si cette annonce va se concrétiser. Il se pourrait en effet que ce soit une menace envoyée à l’Arabie Saoudite, qui veut que les Américains restent en Syrie pour contrer l’Iran. Et pour cela Trump veut de l’argent : 4 milliards sont demandés à Ryad qui, jusqu’à présent, rechigne.
On croit rêver ? Pas tant que cela.
Trump n’est pas un homme politique : c’est un homme d’affaires qui a décidé de devenir président. Il a su parler à ses clients, les petits blancs d’Amérique qui l’ont élu. Il a ses filiales, l’Europe notamment. Et ses concurrents : la Russie et la Chine. Un ami, Israël et donc un ennemi l’Iran. L’Arabie Saoudite est une filiale, bien sûr : elle doit faire remonter des dividendes, c’est la règle.
Il ne faut donc pas analyser les décisions ou les annonces de Trump en fonction de nos habituels critères géopolitiques ce qui rend toute prévision très aléatoire. •
Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.

Mark Zuckerberg

Le « scandale Facebook » - dit aussi « scandale des données » - fait la « une « des médias du monde entier. L'indignation est générale.
Comme si l'objet du scandale était une surprise. Alors que de fait l'exploitation commerciale des informations personnelles ou non imprudemment mises en ligne sur Facebook par des multitudes d'internautes des cinq continents est au principe même de ce réseau mondial tentaculaire. C'est d'ailleurs là aussi son principe financier qui a produit ses profits colossaux et engendré sa puissance, égale ou supérieure à nombre d'États ...
Autour de deux milliards d'utilisateurs se sont ainsi vautrés dans l'étalage vulgaire de leur intimité, de leur mode de vie, de leurs opinions, de leurs comportements privés, et même de leurs pulsions les plus diverses, voire les plus scabreuses, abandonnant cette pudeur ancestrale, ce silence jaloux sur les « misérables petits tas de secrets* » qui avaient prévalu depuis la nuit des temps. Comme si, dans le monde virtuel, l'homme de l'ère numérique s'était senti soudain libéré de cette sorte de retenue qui est naturelle aux rapports humains, charnels, du monde réel. Retenue qui est pourtant l'un des fondements de la vie en société, de la civilisation elle-même.
Facebook a vendu très cher ces données. Elles seraient « le pétrole » de l'ère postmoderne, la richesse immatérielle de cette société liquide, cette « civilisation » de l'impudeur où ne subsistent plus que l'individu réduit à l'état de consommateur hyperconditionné, et le marché qui l'encadre et l'exploite. Cette emprise d'un 3e ou 4e type s'exerce notamment grâce à la maîtrise sophistiquée d'une masse considérable de données sans qualités autres que mercantiles. Ses champions d'origine US sont les GAFA.
Et voici que le scandale Facebook s'amplifie. Qu'il prend des proportions inouïes. Que son titre perd 15% à Wall-Street. Qu'il est introduit dans l'aire politique et judiciaire. En France, des caisses de retraite ou de Sécurité Sociale ferment leurs pages Facebook - et / ou leurs comptes Twitter. Nombre de particuliers ou d'institutions en font autant. De multiples plaintes sont déposées. Notamment auprès de la CNIL. Aux Etats-Unis le Congrès est saisi de la question et doit procéder aujourd'hui à l'audition de Mark Zuckerberg. Il ne faut pas trop s'attendre, nous semble-t-il, à ce que, malgré les quatre-vingt sept millions de membres américains de Facebook lésés par ses pratiques, les Institutions fédérales états-uniennes s'aventurent à porter sérieusement atteinte à la puissance et à la richesse de ce fleuron hégémonique de leur « industrie » numérique.
La repentance tardive de Mark Zuckerberg, son actuel président, égal ou supérieur à nombre de chefs d'État, semble activer l'incendie plutôt que de l'éteindre, au point que son prédécesseur, Sean Parker vient d'accuser le Facebook de Mark Zuckerberg d'exploiter « la vulnérabilité humaine ». C’est parler d'or.
Mais il y a plus grave, nous semble-t-il que le dévoilement mercantile de ces millions de « misérables petits tas de secrets » dont seuls les intéressés s'imaginent qu'ils ont un intérêt.
En premier lieu, l'affaire Facebook met en marche, par réaction, une volonté affichée de reprise en mains et de contrôle par la police de la pensée, des espaces de vraie liberté qui ont pu se développer sur Internet. Gare aux sites, blogs et autres qui divergeront avec le politiquement correct ! Gare aux fermetures à venir. Sur Facebook et ailleurs. Le moment est peut-être venu pour la cléricature des systèmes dominants de réduire les insupportables médias qui échappent encore à son contrôle.
Il y a en second lieu, s'agissant de l'addiction d'un grand nombre de gens, surtout jeunes, â la fréquentation trop exclusive de Facebook et des réseaux parents, le reformatage débilitant de nos catégories mentales et intellectuelles. A la fois cause et symptôme, parmi d'autres, du terrible affaissement culturel de nos sociétés. Sommes-nous condamnés à n’être plus qu’un peuple d'ilotes ? C'est une grande question. ■
* Expression de François Mauriac reprise par André Malraux dans les Antimémoires.
Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien suivant ...

La fin de l'Histoire et le dernier homme selon Francis Fukuyama
par Louis-Joseph Delanglade
 Un brin méprisant, M. Guetta semble reprocher à certains pays « de ne pas avoir encore admis de ne plus être ce qu’ils avaient été « (France Inter, 5 avril).
Un brin méprisant, M. Guetta semble reprocher à certains pays « de ne pas avoir encore admis de ne plus être ce qu’ils avaient été « (France Inter, 5 avril).
Et de nommer, croyant se montrer convaincant, Hongrie, Turquie et Russie. Ce faisant, il nous incite plutôt à penser le contraire. Qu’en 2018, un petit pays d’Europe centrale ne se résolve toujours pas à l’amputation des deux tiers de son territoire et des trois quarts de sa population, suite au Traité de Trianon du … 4 juin 1920, voilà qui illustre, au rebours de la pensée idéologique du chroniqueur Guetta, la mémoire longue des peuples et des nations. Même constat pour la Russie et a fortiori pour la Turquie, chacune « dépossédée » de son empire multiséculaire, celle-ci au début, celle-là à la fin du siècle dernier. Est donc flagrante ici l’opposition entre deux démarches politiques, l’une fondée sur l’héritage de l’Histoire, l’autre sur l’idéologie, en l’occurrence, et à titre d’exemple, celle qui a présidé au dépeçage de la Double monarchie austro-hongroise.
M. Fukuyama peut bien expliquer dans Le Figaro (6 avril) qu’on s’est mépris sur le sens véritable de son ouvrage La fin de l'histoire et le dernier homme, publié en 1992 au moment de l’effondrement de l’Union soviétique. Il ne fallait pas comprendre qu’il n’y aurait plus d’événements historiques mais qu’existait désormais un type de société satisfaisant pour tous, la société démo-libérale. Peu nous chaut qu’il se soit, ou pas, voulu le prophète d’une « mondialisation heureuse » : tout le monde sait aujourd’hui que cette dernière n’est qu’une utopie de plus, dangereuse comme toutes les utopies. D’ailleurs, même s’il persiste à considérer la démocratie libérale comme le modèle indépassable, « largement préférable à ses principaux concurrents », M. Fukuyama reconnaît son incomplétude essentielle, « liée au confort matériel et à la liberté personnelle dont on profite ». Il cite volontiers l’Europe, en fait l’Union européenne aux fondements mercantiles et financiers. Or, on peut se demander qui sera(it) prêt à mourir pour la grande démocratie libérale qu’est cette Europe « posthistorique », laquelle nie la dimension tragique de l’Histoire et propose à ses « citoyens » le seul bien-être personnel comme philosophie de l’existence.
Volens nolens, M. Fukuyama, loin de prophétiser un monde apaisé, annonce la pire des catastrophes pour une Europe menacée de submersion migratoire alors même qu’elle est anesthésiée par les utopies mortifères de la démocratie libérale. Il rejoint d’une certaine façon, et bien malgré lui sans doute, M. de Benoist (Boulevard Voltaire, 26 mars) qui constate que nous sommes « face à un nouveau tsar en Russie, à un nouvel empereur en Chine, à un nouveau sultan en Turquie, tous trois au summum de leur popularité ». La faiblesse de la démocratie libérale européenne constitue dans le contexte international un handicap que vient cependant dénoncer, même de façon diffuse et inconsciente, la montée des populismes. Réalisme et Histoire contre utopie et idéologie, l’alternative a le mérite d’être claire. Il est clair que la dynamique politique sera de fait toujours du côté des héritiers, quel que soit le jugement de valeur que l’on s’arroge le droit de porter sur eux. Et quand l’héritage est d’une telle valeur, pensons à la France, pensons à toute l’Europe, ceux qui nous en détournent sont soit des traîtres soit des fous furieux. ■
* Aragon, « L’Étrangère »

Par Antoine de Lacoste

Depuis que l’armée syrienne a libéré la quasi totalité du territoire de la Ghouta, cette vaste banlieue Est de Damas, on en sait un peu plus sur les méthodes de « gouvernement » des différentes milices islamistes.
La population se taisait par peur des représailles, l’ineffable OSDH (Observatoire syrien des Droits de l’Homme) n’était sans doute pas au courant, donc les médias non plus.
Et pourtant. Des milliers d’hommes ont été, pendant des années, réduits en esclavage par les islamistes pour construire leur arme de guerre favorite : les tunnels.
On sait que ces tunnels, qui peuvent s’étendre sur des dizaines de kilomètres, ont été largement utilisés par les islamistes depuis le début du conflit. Afin de parfaire leur technique, les dirigeants de Daesh avaient même fait venir en Syrie des spécialistes reconnus : des militants du Hamas palestinien qui avaient bâti un réseau remarquable dans la bande de Gaza.
Depuis, l’ensemble des groupes islamistes utilisaient cette méthode afin de se protéger des bombardements, de ravitailler des zones encerclées ou de monter des embuscades dans le dos de l’armée syrienne.
Seulement, creuser des tunnels, c’est long et fatigant. Et puis les combattants ont mieux à faire. Alors quoi de mieux que de rafler les hommes en état de creuser, tout en assurant la subsistance de leurs familles, étroitement surveillées comme il se doit.
La main d’œuvre n’étant pas toujours suffisante, Jaych al-Islam, le groupe salafiste qui tenait Douma jusqu’à présent, s’est livré à de nombreux enlèvements en zone loyaliste. L’opération la plus spectaculaire a eu lieu en 2013 à Adra : des dizaines de fonctionnaires, et de civils pris au hasard ont été enlevés, certains avec leurs familles. Les prises les plus intéressantes ont été incarcérées, les autres envoyées dans les tunnels. On les a appelés « les kidnappés d’Adra ». La plupart sont alaouites, la confession de la famille Assad. Rappelons que cette incursion à Adra s’est accompagnée de massacres épouvantables, mais cela n’a pas beaucoup intéressé l’OSDH.
Plusieurs de ces esclaves ont disparu. Leurs familles n’ont aucune nouvelle et, depuis que la Ghouta est progressivement libérée, de nombreuses mères ou épouses font le guet. En effet, des dizaines de prisonniers ont déjà été libérés à la faveur des négociations menées par les Russes et chacun espère voir réapparaître les siens.
D’autres prisonniers ont été vus récemment : afin d’empêcher les bombardements, les islamistes les mettaient dans des cages qu’ils disposaient au milieu de la chaussée…
Les familles sont également sans nouvelles de plusieurs dizaines de femmes, et le pire est à craindre pour elles.
Tous ces prisonniers, dont on ignore le nombre exact, ont été au cœur des négociations de ces derniers jours qui vont aboutir à la libération totale de l’est de la Ghouta. •
Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.

Par Mathieu Bock-Côté
 Dans cette tribune du Journal de Montréal [7.04] Mathieu Bock-Côté traite du voile comme provocation. Une provocation qui correspond à un programme politique. C'est vu du Québec mais c'est tout aussi applicable à la France et à l'Europe. Et tout aussi vrai. LFAR
Dans cette tribune du Journal de Montréal [7.04] Mathieu Bock-Côté traite du voile comme provocation. Une provocation qui correspond à un programme politique. C'est vu du Québec mais c'est tout aussi applicable à la France et à l'Europe. Et tout aussi vrai. LFAR

Avant-hier, Le Devoir consacrait un papier incroyablement louangeur, presque une infopub, à Eve Torres, une militante que plusieurs jugent islamiste, mais qui cherche à se faire passer pour féministe. Elle sera candidate pour Québec solidaire.
Islamisme
La dame est voilée et on comprend bien que jamais elle ne se dévoilera. C’est une question de principe. Très bien. Mais ce qui est amusant, c’est qu’elle présente cela comme un non-enjeu. Elle veut se voiler à tout prix, mais nous interdire de réfléchir à la signification politico-culturelle de son geste.
Mieux : elle a le culot de nous dire qu’elle veut en finir avec la question identitaire dans le débat public. Comme si le fait de revendiquer le droit au voile en toutes circonstances et de militer pour cela n’avait rien « d’identitaire ». Comme si cela ne consistait pas à faire la promotion active du multiculturalisme, une idéologie soutenant que la société d’accueil doit s’effacer pour accueillir la diversité.
On l’oublie souvent, mais le voile, loin d’être une stricte marque de spiritualité personnelle, est un symbole utilisé par les islamistes pour marquer leur présence dans l’espace public et l’occuper selon le principe de la visibilité maximale.
Étrangement, derrière la promotion du voile, les médias ne veulent pas voir une stratégie identitaire militante, mais le simple éloge de la « diversité ». Les minorités ont toujours raison ! En d’autres termes, nos élites médiatiques ne peuvent pas s’imaginer de « crispation » identitaire ailleurs que dans la société d’accueil.
Hypocrisie
C’est toujours elle qu’on suspectera de fermeture à l’autre. On se pose trop rarement la question suivante : est-ce que l’autre veut s’ouvrir à nous ? S’il ne le veut pas, sommes-nous en droit de manifester notre insatisfaction ?
Qu’on en soit bien conscient : vouloir imposer le voile à tout prix dans l’espace public n’est pas anodin. Cela correspond à un programme politique. La moindre des choses est de le reconnaître. •

Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) de La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007), de Le multiculturalisme comme religion politique (éd. du Cerf, 2016) et de Le Nouveau Régime (Boréal, 2017).

Par Alain de Benoist
 Cet entretien donné à Boulevard Voltaire [26.03] est intéressant à divers titres. Notamment parce qu'il traite de plusieurs sujet avec justesse, lucidité et pertinence. Il relève à juste titre la généralisation des régimes autoritaires, nationalistes et en un sens traditionalistes. Chacun selon sa tradition, naturellement. Et ceci, parmi les pays les plus puissants du monde. Les systèmes politiques faibles et sans réel soutien populaire d'Europe de l'Ouest - dont le nôtre - font seuls exception, ce qui explique leur déclin. Nous partageons globalement l'analyse d'Alain de Benoist sur ce point. Reste sa prise de position in fine pour l'indépendance de Mayotte. Au risque de choquer certains lecteurs, nous dirons que ce n'est pas pour nous une solution frappée d'interdit. Le patriotisme français a aujourd'hui de tout autres priorités que la défense de Mayotte. Donc, selon nous, cela se discute. LFAR
Cet entretien donné à Boulevard Voltaire [26.03] est intéressant à divers titres. Notamment parce qu'il traite de plusieurs sujet avec justesse, lucidité et pertinence. Il relève à juste titre la généralisation des régimes autoritaires, nationalistes et en un sens traditionalistes. Chacun selon sa tradition, naturellement. Et ceci, parmi les pays les plus puissants du monde. Les systèmes politiques faibles et sans réel soutien populaire d'Europe de l'Ouest - dont le nôtre - font seuls exception, ce qui explique leur déclin. Nous partageons globalement l'analyse d'Alain de Benoist sur ce point. Reste sa prise de position in fine pour l'indépendance de Mayotte. Au risque de choquer certains lecteurs, nous dirons que ce n'est pas pour nous une solution frappée d'interdit. Le patriotisme français a aujourd'hui de tout autres priorités que la défense de Mayotte. Donc, selon nous, cela se discute. LFAR
Une fois n’est pas coutume, il s’agit d’un tour d’horizon de l’actualité et non point d’un sujet spécifique. Que penser de la triomphale réélection de Vladimir Poutine, avec 76,6 % des voix dès le premier tour ?
Je m’en réjouis, bien entendu. Mais le plus important, c’est de constater que les seuls concurrents de Poutine étaient les communistes de Pavel Groudinine (11,7 % des voix) et les ultra-nationalistes de Vladimir Jirinovski (5,6 %), tandis que l’unique candidat libéral, Ksenia Sobtchak, a décroché le score mirobolant de 1,6 % des suffrages : à peu près le score de Philippe Poutou à la présidentielle de 2017 ! Pour les libéraux « occidentalistes », c’est donc plus que jamais la Bérézina. Emmanuel Macron (24 % des voix au premier tour, trois fois moins que Poutine) se trouve maintenant face à un nouveau tsar en Russie, à un nouvel empereur en Chine, à un nouveau sultan en Turquie, tous trois au summum de leur popularité. Partie inégale.
La tentative d’assassinat de l’ex-agent double Sergueï Skripal, dont les Anglais, immédiatement soutenus par Macron et par Donald Trump, ont immédiatement attribué la responsabilité à la Russie, n’a apparemment pas nui au maître du Kremlin ?
Elle a, au contraire, encore renforcé sa popularité. Les Russes savent mieux que personne que si Poutine a sans doute des défauts, il est difficile de le considérer comme un idiot. J’ai, pour ma part, beaucoup de mal à imaginer que Vladimir Poutine n’avait vraiment rien de plus pressé, à la veille d’une élection présidentielle (pour ne rien dire de la Coupe du monde de football), que d’aller faire tuer un individu inactif depuis plus de cinq ans, en utilisant un gaz neurotoxique pointant vers le Kremlin. Comme l’a écrit Slobodan Despot, autant laisser sur place sa carte d’identité ! Je comprends, en revanche, fort bien comment pareil coup monté pouvait être utilisé contre lui, afin de servir la russophobie des gouvernements et des médias. Quant au sort de Sergueï Skripal, il m’indiffère : je n’ai pas de sympathie pour les traîtres.
Nicolas Sarkozy mis en examen dans l’affaire d’un présumé financement libyen de sa campagne électorale ?
Sarkozy s’est, à mon avis, déjà déshonoré deux fois : la première en réintégrant la France dans le giron de l’OTAN, dont le général de Gaulle l’avait fait sortir, la seconde en déclenchant contre la Libye une guerre criminelle dont nous n’avons pas fini de subir les conséquences. Sur l’affaire dont vous parlez, je ne suis pas dans le secret de l’instruction. Je ne ferai donc de procès d’intention à personne, non par respect de la présomption d’innocence (ainsi dénommée par antiphrase, puisque c’est au contraire quand on est suspecté d’être coupable que l’on est mis en examen), mais parce que je n’ai qu’une confiance très mesurée dans la Justice de mon pays. En tout état de cause, si les charges étaient avérées, ce serait un scandale d’État sans précédent.
Le projet de réforme de la SNCF, incluant la remise en cause des privilèges des cheminots, et l’imposant programme de grèves annoncé par les syndicats ?
Les grèves des transports ne sont jamais très populaires, ce que l’on peut comprendre. Mais arrêtons de prendre pour boucs émissaires des cheminots dont les « privilèges » ne sont qu’une goutte d’eau face à ceux des grands patrons du CAC 40 ! Ce n’est pas la faute des cheminots si les trains n’arrivent plus à l’heure et si les lignes de chemin de fer ne sont plus entretenues. Ce ne sont pas eux qui sont responsables de la gestion désastreuse qui a transformé la SNCF en tonneau des Danaïdes (47 milliards de dettes). La seule vraie question qui se pose dans cette affaire est de savoir si la SNCF va rester un service public au service de tous les usagers, où qu’ils habitent, ou si l’on va s’orienter progressivement vers une privatisation dont les conséquences inéluctables seront une hausse des tarifs (+27 % en Angleterre depuis dix ans) et la suppression programmée de centaines de petites lignes à la rentabilité insuffisante, ce qui accentuera encore la coupure entre les métropoles et la France périphérique.
Macron n’aurait jamais été élu sans le soutien massif des retraités et des fonctionnaires, deux catégories l’une et l’autre protégées jusqu’ici des effets de la mondialisation. Dès son élection, il s’est attaqué aux premiers, il s’attaque maintenant aux seconds, qui représentent 22 % du salariat. Il scie donc lui-même la branche sur laquelle il est assis. Le jour où la classe moyenne, qui se trouve déjà en état d’insécurité culturelle, se retrouvera en état d’insécurité sociale, les choses basculeront.
Les dernières élections italiennes ont vu la victoire massive des populistes de tous bords. Pour le moment, seule la France semble « résister » à cette vague en Europe. Pourquoi ?
Elle n’y résiste pas tant que ça, puisque les grands partis de gouvernement ont déjà presque disparu, et que c’est pour faire face à la déferlante populiste que Macron a saisi cette occasion d’engager une recomposition générale du paysage politique. Mais vous avez raison : la déferlante en question pourrait être plus ample. Ce qui manque, c’est un homme (ou une femme) susceptible de l’incarner.
Mayotte se trouve en première ligne face à l’immigration clandestine. Que faire ?
L’indépendance me semble être une bonne solution. •
Intellectuel, philosophe et politologue
A lire aussi dans Lafautearousseau ...

Par Antoine de Lacoste

En un mois l’armée turque est donc parvenue à ses fins et a pris l’enclave kurde d’Afrine. Ses pertes ont été minimes (moins d’une cinquantaine de morts), mais il est vrai qu’elle a utilisé les hommes de l’ASL (Armée syrienne libre) comme fantassins de première ligne. Ces ex-djihadistes reconvertis en supplétifs turcs ont eu en revanche plusieurs centaines de morts.
Les Kurdes ont résisté un certain temps puis ont été écrasés par les bombardements turcs. Dans cette guerre, la maîtrise de l’air est, plus que jamais, décisive.
Les combattants kurdes ont ensuite choisi de ne pas défendre Afrine. On peut supposer qu’ils ont voulu s’épargner des pertes excessives pour un combat perdu d’avance.
Les deux mille combattants kurdes partis de la rive gauche de l’Euphrate (sans l’accord de leur parrain américain) n’ont pu participer à cette bataille: ils ont été bloqués par l’armée syrienne, probablement sur ordre de Moscou.
Beaucoup se sont lamentés sur l’abandon des Kurdes par les Occidentaux. Ils ont en effet été lâchés par leur allié américain, mais il n’y a là rien de surprenant. Depuis 1975 et la chute de Phnom Penh et de Saïgon, la politique interventionniste américaine est un vaste cimetière d’alliés ou de supplétifs sacrifiés sur l’autel de la géopolitique.
Il faut aussi souligner que les Kurdes ont été avant tout victimes de leur intransigeance. En effet, pour éviter l’entrée de l’armée turque dans Afrine, les Russes ont proposé un marché aux Kurdes : ils abandonnaient l’autonomie d’Afrine et laissaient entrer l’armée syrienne. Ils auraient pu ainsi rester et éviter l’immense exode des habitants, très majoritairement kurdes. Ils ont refusé et les Russes, qui ne doivent rien aux Kurdes, ont laissé les mains libres à Erdogan.
Les Kurdes ont toujours été de piètres politiques et cela explique bien des choses.
Que va faire Erdogan maintenant ?
Il a, dans l’immédiat, deux sujets prioritaires à régler.
Tout d’abord Afrine. La ville est quasiment vidée de ses habitants et occupée, très brutalement, par les djihadistes de l’ASL. La Turquie ayant des millions de réfugiés syriens sur son sol, la tentation est grande d’en installer à Afrine. Ce serait ni plus ni moins qu’une opération de nettoyage ethnique, mais les Turcs réfléchissent sérieusement à cette éventualité.
Ensuite le reste du territoire autonome kurde qui court, plus à l’est, tout le long de la frontière turque. Il commence par la ville de Manbij qu’Erdogan a juré de prendre. Le problème c’est que plusieurs dizaines de soldats américains y stationnent… On voit mal l’armée turque se lancer dans une telle opération !
Pour Erdogan, le problème kurde reste donc entier, et pour la Syrie c’est une occasion perdue de reconquérir en douceur un territoire qui lui appartient.
Quant aux Américains, leur stratégie est toujours aussi floue, tandis que les Russes, méthodiquement, poursuivent la reconquête progressive des dernières poches islamistes. •
Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.


Par Antoine de Lacoste

L’armée syrienne a reconquis 90% du territoire de la Ghouta.
Après avoir divisé le secteur islamiste en trois enclaves, elle a alterné assauts et négociations, sous la direction des Russes. Lorsqu’elle se heurtait à une fin de non recevoir ou lorsque Damas essuyait une nouvelle pluie d’obus, l’aviation russe intervenait avec l’efficacité qu’on lui connait.
Un des tournants de cette délicate reconquête, fut la réussite des corridors humanitaires pouvant permettre la fuite des civils.
Ces corridors furent très difficiles à mettre en place : les snipers islamistes tuaient impitoyablement les habitants qui essayaient de fuir, bravant les consignes de rester chez soi. De nombreux civils ont ainsi trouvé la mort.
Profitons-en pour admirer encore l’incroyable désinformation dont nous gratifient nos médias : pas une fois, sur aucune chaîne, n’a été dit que tous les snipers qui tuaient les civils étaient islamistes…
L’armée syrienne a alors entrepris de sécuriser ces corridors au prix de sanglants combats. Des dizaines de milliers de civils ont enfin pu s’enfuir et rejoindre les zones contrôlées par l’armée.
Les vidéos disponibles montrant ces fuites d’habitants remerciant l’armée de les avoir sauvés, ont eu des effets ravageurs sur le moral des combattants. Plusieurs se sont rendus, et d’autres ont finalement accepté de négocier.
Les premiers étaient pourtant les plus durs : les djihadistes d’Ahrar al-Cham, successeurs d’Al Nosra. Environ 1500 combattants et leurs familles, soit 6000 personnes au total, ont été évacués par cars vers la province d’Idleb, la dernière aux mains des islamistes. Comme toujours, les combattants ont pu garder leurs armes légères et ont dû laisser le reste.
La deuxième évacuation, qui a commencé samedi, concerne le groupe Faylak al-Raman, mouvement proche des Frères musulmans et soutenu par le Qatar. 7000 personnes seraient concernées par cette évacuation, qui se fait également en direction d’Idelb. Décidément, cette province est en passe de devenir un invraisemblable chaudron islamiste…
Les négociations sont en cours avec le troisième et dernier groupe, Jaich al-Islam, d’obédience saoudienne. Bien qu’il compte plus de 10000 combattants, on voit mal comment ses chefs pourraient refuser une offre de repli, tant la victoire syrienne est maintenant certaine.
C’est donc la ville de Douma, occupée par ce groupe qui sera la dernière libérée.
Ainsi la reconquête de la Ghouta est en passe de s’achever, et ce sera un tournant militaire aussi important que ceux d’Alep et de Deir ez-Zor.
La désinformation du burlesque OSDH (Observatoire syrien des droits de l’homme) sur les prétendues attaques chimiques de l’armée n’a cette fois pas fonctionné et les occidentaux n’avaient aucun prétexte pour intervenir malgré les menaces des Américains et du Président Macron.
Toutefois, les Damascènes ne seront pas encore tout à fait hors de danger : il reste, au sud de Damas, une poche de Daesh, qu’il faudra anéantir. Une attaque surprise et nocturne jeudi dernier a surpris l’armée qui a eu plus de 50 tués.
La tâche est loin d’être terminée pour l’armée syrienne. •
Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.


Sachant qu’en dépit d’un désintérêt apparent, les Français sont attachés à la dimension internationale de leur langue, en raison même du statut que celle-ci a acquis autant dans la définition de leur identité que dans le prestige de leur pays, Macron ne pouvait faire autrement que de donner un lustre particulier à la première journée internationale de la francophonie de son mandat, le 20 mars.
Aussi est-il allé prononcer à l’Académie française un discours sur la place du français dans le monde et son avenir, devant les académiciens et 300 jeunes choisis on ne sait comment. Peu importe. Invité, le matin même, dans la matinale d’Europe 1, l’académicien Jean-Christophe Rufin s’est amusé des digressions de langage habituelles du président, héritage de son passé professionnel : « Comme beaucoup, il est prisonnier du fait que dans certains milieux — notamment la banque et l’Internet —, l’anglais a pris une place considérable. Il vient de ces mondes, et forcément, il en est marqué », ajoutant, non sans ironie : « Toutes les conversions sont à prendre en compte, même si elles sont tardives », et de saluer le « sincère désir du président d’avoir une grande politique de francophonie ».
Des mensonges éhontés
Y croit-il vraiment ? Il est à craindre au contraire que la francophonie ne fasse particulièrement les frais de la vraie nature du « en même temps » présidentiel — un faux pragmatisme cachant un cynisme foncier et totalement déshinibé. Car les annonces présidentielles, en vue de faire du français la troisième langue internationale (après l’anglais et l’espagnol) la plus parlée au monde en 2050, dissimulent mal un statut de soumission par rapport à l’anglais qui demeure, pour Macron, la seule langue ayant droit au statut international en ce que c’est la langue du mondialisme et que le mondialisme est l’horizon indépassable de notre golden boy. Il a avalisé le recul du français non seulement dans les domaines économique et scientifique – si bien que le français ne peut plus apparaître comme langue de l’innovation – mais également au sein des instances internationales et de l’Union européenne, tout en encourageant même sa disparition comme langue diplomatique par sa pratique indigne de l’anglais dans les visites officielles. Pour Macron — nous retrouvons le « en même temps » et son cynisme —, parler anglais aiderait même la francophonie ! « Je n’hésite jamais à m’exprimer à la fois en français et en anglais, sur des scènes internationales, devant des milieux d’affaires. Je pense que ça renforce la francophonie de montrer que le français n’est pas une langue enclavée, mais une langue qui s’inscrit dans le plurilinguisme. Je considère que c’est la bonne grammaire pour défendre le français partout dans les enceintes internationales », assure-t-il, avant d’ajouter : « Je ne fais pas partie des défenseurs grincheux ». Ne cherchez pas à savoir ce que signifie ici « grammaire », dernier mot à la mode pour dire « méthode ». Mais oser affirmer que le simple fait de parler français, c’est enclaver notre langue et que pratiquer le tout-anglais favoriserait … la place du français dans le monde en faisant preuve de plurilinguisme — un plurilinguisme dont ne se soucient guère les anglo-saxons qui semblent tout à fait satisfaits de l’enclavement de leur langue —, seul Macron pouvait oser une telle énormité, assénée avec un toupet aussi candide. Il ne recule devant aucun mensonge, fût-il le plus éhonté : c’est malheureusement sa force. C’est aussi sa faiblesse pour qui perce à jour son cynisme.
Un statut de langue régionale
C’est en fait un statut de langue régionale que Macron destine au français Car cet ambassadeur de la langue de l’oligarchie — il n’a cure également de l’anglais : c’est le patois du monde des affaires qui l’intéresse — n’a qu’un seul objectif : endormir l’égo des Français en faisant du français la première langue africaine — et par contrecoup favoriser l’africanisation à venir de la France — tout en réservant, dans le reste du monde, le français aux classes moyennes supérieures qui verront son apprentissage par leurs rejetons comme un « plus » qu’elles ne favoriseront que tant que ce sera à la mode. Sa volonté de doubler le nombre d’élèves en écoles françaises à l’étranger manque d’ambition tout en couvrant un mensonge : jamais ces écoles n’ont vu leurs moyens fondre autant que depuis l’arrivée de Macron à l’Elysée ! Une politique offensive ne consisterait pas à y doubler mais à y décupler le nombre d’élèves, tout n’étant qu’une question de priorité. Mais la francophonie, pour Macron, qui a supprimé tout poste ministériel afférent, doit surtout viser à favoriser l’invasion migratoire. D’où les moyens promis, et on peut supposer que cette promesse-là sera tenue, améliorant l’apprentissage du français par de pseudo-réfugiés qui n’ont pourtant pas vocation à rester sur le territoire.
Défendre le français contre l’Élysée
Par ailleurs il serait temps que nous cessions de nous disculper de mener, via la francophonie, une politique coloniale et de justifier la défense du français par celle du plurilinguisme ! Je ne sache pas que les Britanniques s’excusent à tout bout de champ de la place de l’anglais dans leurs anciennes colonies, ou dans les instances internationales, même celles qu’ils s’apprêtent à quitter ! La défense du français se suffit à elle-même. La francophonie va souffrir davantage encore durant les prochaines années car, à l’indifférence de Sarkozy ou de Hollande, a succédé, à l’Elysée, une hostilité déclarée au statut international de notre langue. Il convient de lutter pied à pied pour la place du français dans le monde, quitte à paraître grincheux ou enclavés. •

Par Marc Rousset
En matière de prévision économique, une bonne dose de prudence s'impose. Bernard Maris disait qu'un économiste est un monsieur qui est capable d'expliquer le lendemain pourquoi il s'est trompé la veille. Une addition de principes de bon-sens et de connaissance des dossiers conduit toutefois à envisager sérieusement ce qui peut attendre nos sociétés dans un avenir plus ou moins proche. C'est l'exercice auquel Marc Rousset se livre ici pour nous au fil d'une analyse documentée qui intéressera ce qu'on appelait jadis les pères de famille aussi bien, d'ailleurs, que les patriotes. La racine est la même ! ... LFAR
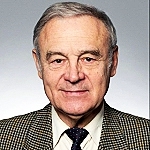
Jeff Gundlach, lors de la Strategic Investment Conference 2018, a déclaré que « la situation devrait exploser en 2019 ». Il estime que les fondamentaux de l’immobilier sont « plutôt horribles » alors que les taux immobiliers commencent à augmenter, que les déficits américains par rapport au PIB sont trop élevés et que tous les indicateurs pointent vers la hausse de l’inflation. Les avantages sociaux du gouvernement américain qui n’atteignaient pas 5 % du revenu disponible des Américains dans les années 70 atteignent, aujourd’hui, 25 %.
Quant au très célèbre gestionnaire de fonds d’investissement Paul Tudor, il a déclaré à Goldman Sachs que les seules choses qui valent la peine d’être détenues sont les matières premières, les actifs tangibles ou du liquide. Il critique les baisses d’impôts, les dépenses généreuses du Congrès américain et prédit une augmentation de l’inflation qui provoquera la panique sur les marchés actions. Il a comparé le président de la Fed Jerome Powell au général Custer dans les dernières heures de la bataille de Little Big Horn, « cerné par une horde de guerriers menaçants » : bulles, dettes des entreprises, marché des changes, tribu des cryptos, taux réels négatifs et, derrière lui, le peuple de l’inflation qui l’empêche de battre en retraite !
La BCE de Mario Draghi se renie, suite à la revalorisation de l’euro et à l’insuffisante inflation en Europe. Draghi remet en question la date butoir d’octobre 2018 ; il vient de déclarer que les achats d’actifs par la BCE cesseront seulement quand l’inflation sera jugée suffisante….
Si l’on considère les graphiques de la dette mondiale, du Dow Jones, de l’or et des obligations, on constate que la folie douce a commencé à s’emparer des esprits dans les années 1994-1995, avec des courbes qui grimpent à la verticale à une vitesse hallucinante. La dette mondiale était de 30.000 milliards de dollars en 1994 ; elle s’élève, aujourd’hui, à 230.000 milliards de dollars. Le PIB de l’économie réelle est le seul graphique qui se traîne lamentablement vers le bas à un rythme trop lent. Cela sent donc à plein nez le chaos et l’écroulement des actions à venir.
Le journal The Economist du 10 février 2018 pressent également un krach financier. Il s’étonne des bulles sur les actions Tesla et Uber car les marchés se refusent à tirer les conséquences de l’envolée des pertes en 2017. Il remarque que l’euro a progressé de 17 % en un an sans que cela inquiète les dirigeants européens. Il est préoccupé par le parcours du bitcoin, passé de moins de 1.000 dollars, début 2017, à près de 20.000 dollars, en décembre, et 6.000, début février 2018, tout comme par l’effondrement d’un fonds de 1,9 milliard de dollars du Crédit suisse indexé sur la volatilité dont la valeur s’est effondrée de 92 %, le 6 février 2018, quand le Dow Jones a perdu 4,6 %.
Pour The Economist, le niveau du Dow Jones est 60 % plus haut qu’avant le précédent krach de 2008 et les seules questions en suspens sont le moment du prochain krach (2019, 2020 ou 2021 ?) ainsi que le facteur déclenchant (Tesla ou Uber, hausse du pétrole et regain de l’inflation, avec hausse des taux, ou crise financière en Italie ?).
L’Italie, avec sa dette publique de 2.200 milliards d’euros (132 % du PIB) et son système bancaire malade (263 milliards d’euros de créances douteuses) ne pourra pas supporter la remontée des taux d’intérêt. Si la Bundesbank se retrouve avec une créance excédentaire « Target 2 » de 800 milliards d’euros, la Banque centrale d’Italie se retrouve avec une dette de 400 milliards d’euros envers la BCE. L’Italie est dans une situation financière gravissime et intenable.
Pour couronner le tout, il suffit de penser aux risques géopolitiques avec la révolte électorale des Italiens contre l’invasion migratoire, à la nomination du faucon Mike Pompeo comme nouveau secrétaire d’État de Trump qui rêve, comme Israël et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, d’en découdre avec l’Iran.
Enfin (cerise sur le gâteau), il est tout à fait probable que Trump va engager une violente guerre commerciale avec la Chine pour la punir de ses infractions aux lois sur la propriété intellectuelle ainsi que pour son excédent, en 2017, de 342,8 milliards de dollars avec les États-Unis. •

Économiste
Ancien haut dirigeant d'entreprise

Bachar al-Assad auprès de ses troupes dans la Ghouta orientale
Par Antoine de Lacoste

Les jours passent et l’étau de l’armée syrienne se resserre inexorablement sur les 20 000 combattants islamistes de la Ghouta orientale.
Après deux semaines de bombardements puis deux semaines d’assauts terrestres, les positions islamistes sont aujourd’hui coupées en trois, c'est-à-dire en autant de groupes islamistes.
Ces trois tendances ne s’aiment guère et se sont même violemment affrontées à de nombreuses reprises pour la suprématie de la Ghouta.
De cela les médias occidentaux ne parlent guère préférant, à l’unisson, dénoncer par une obligatoire litanie, « les crimes de l’armée de Bachar », comme si ce n’était pas l’armée syrienne ! On se demande à quoi sert la pluralité de la presse en France, tant celle-ci ne parle que d’une seule voix, avec les mêmes bilans non vérifiés de l’OSDH (Observatoire syrien des Droits de l’Homme), les mêmes slogans (Bachar, « l’homme qui tue son propre peuple ») et les mêmes indignations de circonstance.
Aujourd’hui, les trois groupes islamistes rivaux tiennent chacun leur ville : Douma pour l’armée de l’islam, soutenue par l’Arabie Saoudite, Arbine pour Faylak al-Rahmane, soutenue par le Qatar et Harasta pour le Front al-Nosra, que plus personne ne soutient.
Depuis cinq ans, ces groupes tenaient un territoire en continu qui a compté jusqu’à 15 000 km2. Aujourd’hui, ils se partagent à peine 50 km2. Le morcellement de ce territoire en trois parties, empêche maintenant toute alliance, même de circonstance, entre islamistes. Elle rend également vaine toute contre-attaque éventuelle.
L’issue est donc inéluctable.
Pour l’assaut final, les Russes ont fait venir des renforts : des Palestiniens favorables à Bachar, issus des camps de réfugiés, et des chiites afghans, rapatriés du front de Deir ez-Zor. Les Iraniens sont tenus à l’écart : ils sont trop autonomes, et les Russes ne veulent pas s’en embarrasser. Ils veulent garder la main pour d’éventuelles négociations suivies de redditions et d’évacuations qui éviteraient plusieurs jours de sanglants combats.
D’ailleurs, une dizaine de combattants d’Al-Nosra, se sont rendus avec leurs familles le 10 mars, et ont été, comme d’habitude, évacués vers la province d’Idleb, le grand fief islamiste, au Nord-Ouest de la Syrie.
Quant aux civils, ils sont toujours pris en otage par les islamistes. Plusieurs ont été tués ces derniers jours en tentant de s’enfuir et de forcer les barrages des combattants. D’autres sont passés et ont pu témoigner de leur quasi impossibilité de quitter la Ghouta, tant les tirs des snipers sont redoutables.
Le rétrécissement du territoire tenu par les islamistes, ne les empêche cependant pas d’envoyer quotidiennement des obus sur Damas. Une dizaine de morts sont à déplorer ces derniers jours.
Mais ce ne sont pas des « rebelles », alors cela n’intéresse pas nos médias. •
Retrouvez l'ensemble des chroniques syriennes d'Antoine de Lacoste dans notre catégorie Actualité Monde.

Marché aux esclaves noirs en Libye
Par
CHRONIQUE - Gilles-William Goldnadel évoque le racisme anti-blanc, dont très peu de médias ou d'associations osent parler. Selon lui, c'est ce tabou qui explique le silence médiatique autour du scandale d'abus sexuels révélé à Telford. Cette chronique [Figarovox,20.03] dit avec force et un courage certain un grand nombre de simples vérités ! LFAR

Le racisme antiblanc est le trou le plus noir de l'information comme de la réflexion. Si vous aimez la tranquillité, évitez donc de le nommer. Ou utilisez si possible une circonlocution. Essayez plutôt « détestation anti-occidentale ».
Vous éviterez ainsi le chromatisme gênant. On peut parler des noirs, davantage encore du racisme qui les frappe. Mais évoquer le blanc, sauf de manière négative, voilà qui est gênant. Et très inélégant. En parler le moins possible. J'ai connu une époque, pas très lointaine, où les organisations antiracistes autoproclamées contestaient l'existence même de l'aversion du blanc. Lorsqu'on la leur mettait juste dessous leurs yeux, elles la reconnaissaient du bout des lèvres pincées en alléguant le fait que seules des organisations « d'extrême droite » se souciaient de cette question très secondaire. Bref, une pirouette assez primaire. De nos jours, lorsque le temps est clair, certaines condescendent toutefois à se saisir de cas emblématiques, pourvu que le traitement soit discret et homéopathique.
L'actualité récente me permet, à travers deux exemples, l'un en creux, l'autre en plein, de faire sonder du doigt le trou noir maudit.
Prenez Mayotte. On a tout dit sur les dernières manifestations d'exaspération de la colère populaire des Mahorais à propos de l'immigration massive et invasive.
On a dit que cette colère était légitime. On a dit que cette immigration était insupportable pour la population autochtone. On a reconnu sans barguigner le lien entre immigration excessive, illégale et criminalité. On a convenu également qu'elle était facteur de misère sociale, médicale et d'appauvrissement. On a accepté sans pousser de hauts cris de questionner la légitimité du droit du sol. On a reconnu qu'il existait effectivement « des Français de papier » qui avaient indûment instrumentalisé le droit du sol français pour devenir nos concitoyens pour de pures questions d'opportunité financière. On a tout dit, sauf que les Mahorais qui se plaignaient légitimement mais parfois violemment seraient des racistes, des xénophobes ou des populistes extrémistes.
On voudra bien à présent se donner la peine de comparer le regard compréhensif et même empathique porté par le monde médiatique et politique à l'égard des Mahorais exaspérés avec celui qui embrasse, si l'on ose dire, la population métropolitaine qui, aujourd'hui majoritairement, considère l'immigration illégale et massive comme un facteur d'inquiétude majeure. Encore que les réactions de celle-ci soient infiniment plus calmes que celle de la population mahoraise, qui peut honnêtement nier que le jugement médiatique et politique soit dans le meilleur des cas condescendant et dans le pire haineux et méprisant ? Pour ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui explique cette différence de regard, je vais leur mettre crûment la réalité sous les yeux. La population française métropolitaine, à la différence des Comoriens musulmans de Mayotte, est majoritairement chrétienne, blanche et occidentale. Par conséquent plus facilement soupçonnable de racisme, précisément par un préjugé raciste insoupçonné et indicible.
Mais que j'ose nommer et que j'ai déjà expliqué par l'Histoire.
À présent, passons au second exemple explicite et extérieur à la France.
L'excellente revue National Geographic s'est livrée récemment à une autocritique en règle en examinant de quelle manière, au siècle dernier, elle était restée indifférente à la réalité et à la souffrance noires.
D'un siècle l'autre, d'un excès l'autre, et, parfois, d'une souffrance l'autre. Je ne crains pas en effet d'appliquer cette saine autocritique au présent et à la souffrance blanche que l'on cache, que l'on tait ou que l'on ne veut pas voir.
C'est ainsi que les exactions contre les fermiers blancs en Afrique australe font partie des territoires occultés de l'information. Au Zimbabwe, la quasi-totalité des fermiers blancs ont été expulsés. De très nombreux fermiers massacrés. L'ex-dictateur Mugabe, récemment déchu, refusait de répondre à un journaliste parce qu'il était blanc. C'est dans ces conditions que la revue Jeune Afrique (et non un journal occidental) a écrit : « Les abus et les erreurs commis par Londres, les colons britanniques et leurs descendants, pour beaucoup restés fidèles à Ian Smith, ont été nombreux. Mais en répliquant avec une politique aussi inconséquente, Mugabe aura surtout ajouté de la souffrance à l'injustice. » De la souffrance blanche. Selon la BBC, cette politique a détruit l'économie du Zimbabwe basée sur l'agriculture, qui est dans une situation catastrophique avec une hyperinflation et une réapparition du choléra.
Qui pourrait prétendre honnêtement que ce racisme-là a été condamné par la classe médiatique antiraciste ?
En République Sud-Africaine, la situation n'est aujourd'hui pas meilleure. De très rares articles dans la presse écrite française s'en saisissent pour décrire « le massacre oublié des fermiers blancs ». Les télévisions françaises s'en désintéressent complètement.
Plus indiscutable et plus récemment encore, le 22 février 2018, l'agence Reuter, dans une indifférence totale, annonçait que « dans un souci de soigner les divisions du passé, le président sud-africain fraîchement élu Cyrille Ramaphosa avait annoncé que l'expropriation de terres sans compensation était envisagée pour accélérer leur redistribution aux Sud-Africains noirs ».
Si les mots ont un sens, cette annonce aurait dû plonger tous les hommes de bonne volonté, sincèrement désireux d'harmonie entre les peuples, dans un état de consternation ou d'hébétude.
Si cette mauvaise décision est en effet menée à bien, elle tournera définitivement le dos à la politique de pardon et de réconciliation chère à Mandela et à Declercq. Elle signifiera la fin du pays « arc-en-ciel ». Plus désespérément encore, elle signifiera qu'un règlement politique pacifique basé sur la concorde et non le rapport de force est une chimère. Elle donnera raison aux pessimistes et aux cyniques.
Mais il y a peut-être encore pire: l'incroyable omerta qui couvre pour l'heure en France les crimes sexuels autour des filles blanches ayant été découverts dans la commune anglaise de Telford.
Près de mille jeunes filles ont fait l'objet de viols collectifs et de trafic de proxénétisme violent de la part d'hommes issus principalement de la communauté pakistanaise. L'affaire connue depuis plusieurs mois, vient de prendre désormais une dimension extravagante et met en cause la police et les médias.
À l'époque de « Balance ton porc », où les violences faites aux femmes font l'objet d'une attention obsessionnelle permanente, le silence qui entoure ce drame immonde prend un tour invraisemblablement obscène et scandaleux.
Je renvoie notamment aux articles du Birminghammail et du Mirror du 11 mars 2018 ainsi qu'à la note Wikipédia en français issue de la note anglaise qui vient d'être complétée: « Suite aux nouvelles révélations en mars 2018 dans le Sunday Mirror, la journaliste Johanna Williams du magazine Spiked, s'émeut que ce qui semble être le pire scandale d'abus sexuels sur des enfants de Grande-Bretagne ait reçu relativement peu de couverture et ne fasse pas la une de journaux tels que le Guardian ou le Times , alors que depuis plusieurs mois, le harcèlement des femmes est dénoncé comme par exemple par le mouvement Me Too dont elle dénonce l'hypocrisie et le silence assourdissant ». Comme de nombreux journalistes anglais le reconnaissent désormais, ces nouvelles révélations sont issues d'enquêtes du Daily Mirror et ont montré que l'étendue des abus était beaucoup plus vaste que ce qui avait été révélé auparavant.
« Comme dans les autres affaires similaires, les auteurs étaient très majoritairement d'origine pakistanaise et bangladaise et de religion musulmane. Par crainte d'être considérées comme racistes, les autorités ont longtemps refusé d'enquêter » (Steve Bird The Télégraph du 9 décembre 2017).
Pendant ce temps, les pseudo-antiracistes hystériques et les néo-féministes frénétiques à moralisme chromatiquement variable restent calmes.
La souffrance, quand elle est blanche, demeure une zone noire interdite de visite. •
Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain.
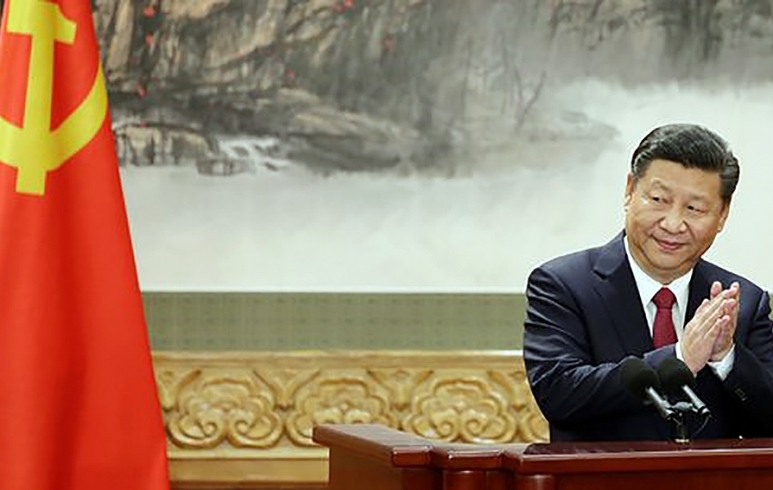
Xi Jinping, nouvel empereur de Chine ?

La langue française s'enrichit d'un néologisme porteur de sens. Et d'un sens politique qui en dit long sur l'évolution du monde. C'est le mot « démocrature ».
Il s'oppose à démocratie qui a rapport avec le camp du Bien, le nôtre. Il désigne des régimes qui n’ont que les apparences d'une démocratie. Ils en respectent les rites et les pratiques. Mais ils flirtent avec la dictature. Ce sont des régimes autoritaires. Ils confinent avec le pouvoir d'un seul. Un pouvoir personnel. Y en a-t-il jamais eu d'autre ? Ils organisent un certain culte de la personnalité. La liberté d'expression n'y est qu'apparente. Les grands médias appartiennent à l'État ou à quelques oligarques. La corruption y est courante jusqu'aux marches du Pouvoir. Parfois jusqu'en son sommet. Ces régimes dits « sulfureux » appartiennent au camp du mal. On parle avec eux, au besoin on coopère, parce qu'il le faut bien. Comme l'Allemagne qui confirme la construction de son gazoduc avec la Russie malgré l'état de tension. Il faut bien s'éclairer, se chauffer, faire sa cuisine et approvisionner les entreprises. Mais on le fait du bout des lèvres et du bout des doigts.
L'ennui est que ces régimes prolifèrent. Ils sont légion. Les démocraties paisibles, les États dits de droit se font rares. Sont-ils en voie de disparition ?
Il y a d'abord l'Afrique, comme il est (presque) naturel. Les tyranneaux s'y ébattent à peu près partout en liberté ou presque. Mais il faut y ajouter l'Amérique centrale et du Sud où dictatures, guérillas et pronunciamientos sont simplement de tradition. Une habitude. Et puis les monarchies pétrolières dans le Golfe. La démocratie n'y signifie rien. Cela fait déjà une bonne partie du monde. Mais par-dessus tout il y a la Russie et Vladimir Poutine, pour qui le mot « démocrature » a été expressément forgé. Peu importe qu'il soit porté aux nues par une large majorité de Russes pour avoir refait la grandeur de leur pays humilié. C'est qu'il tient l'opinion d'une main de fer. Et il y a la Chine. Elle vient de consacrer la présidence à vie de son grand dirigeant, Xi Jinping. Lui aussi afin qu'il dispose d'assez de temps pour refaire de la Chine une grande nation. C’est ce qu’il a lui-même expliqué, hier matin. Et puis il y a même les Etats-Unis dont l'autoritaire et imprévisible président nomme et limoge comme Staline au temps des purges.
Au temps de la république en Angleterre, en Hollande, à Venise, Gênes et autres lieux, Louis XIV disait : « Je montrerai qu'il reste encore un roi en Europe ».
Restera-t-il encore demain sur la planète beaucoup de démocraties à la mode de l'Europe de l'Ouest où elles semblent s'être comme réfugiées ? Peut-être mais ce n'est même pas sûr.
La France elle-même s'est dotée d'un président jupitérien qui décide de tout, restaure la verticalité du Pouvoir, rétablit les symboles monarchiques : le Louvre, Versailles, Chambord, hier l'Académie française ...
Quant à la liberté française des grands médias, faut-il en rire ? Ils appartiennent à neuf oligarques macroniens.
La corruption d'État propre aux démocratures ? Hier nous apprenions que l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy se trouvait en garde à vue dans l'affaire du financement de sa campagne électorale de 2007 par la Libye du colonel Kadhafi ...
Faut-il s'étonner ? Y eut-il jamais, hors d'une protection dynastique, de véritables démocraties ?
Les temps qui courent ne leur sont guère favorables. « Madame se meurt, Madame est morte » … C'est un peu cela. •
Retrouvez l'ensemble de ces chroniques en cliquant sur le lien ci-dessous