Les dirigeants de la zone euro ont imposé un accord aux conditions encore plus dures, presque punitif, aux Grecs. Mais la défaite d'Alexis Tsipras résonne comme une défaite pour toute la zone euro.
Jamais, dans le jargon européen, le terme de « compromis » n'aura semblé si peu adapté. « L'accord » atteint au petit matin du 13 juillet entre la Grèce et le reste de la zone euro a désormais des allures de déroute pour le gouvernement grec. Une déroute qui a un sens pour le reste de l'avenir de la zone euro.
Erreur stratégique
Avant d'en venir aux conséquences, il faut expliquer cette défaite d'Athènes. Le gouvernement grec avait accepté jeudi soir le plan des créanciers présenté le 26 juin. Un plan déjà extrêmement difficile à accepter pour la majorité parlementaire grecque. Cette dernière s'était d'ailleurs fissurée vendredi soir dans le vote à la Vouli, le parlement grec. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, pouvait cependant alors prétendre pouvoir arracher un accord sur la dette comme « compensation. » Malheureusement pour lui, les créanciers ont alors immédiatement compris le message : l'exécutif grec craignait davantage la sortie du pays de la zone euro que l'abandon de son propre programme. On aurait pu s'en douter dès le 22 juin lorsqu'Athènes avait déjà présenté un plan d'austérité. Mais le « non » au référendum avait été une contre-offensive qui, compte tenu du résultat, pouvait donner un mandat implicite au premier ministre pour réaliser le Grexit. Il n'en a pas jugé ainsi. En grande partie parce qu'il a commis l'erreur de ne pas le préparer.
La curée
Dès lors, la position grecque était extrêmement fragile. En effet, pour un petit pays aussi affaibli et endetté que la Grèce, la seule force dans les négociations était la menace de la sortie de la zone euro. Menace que, sans doute, il fallait éviter de mettre en oeuvre si c'était possible, mais qu'il fallait brandir assez sérieusement pour faire douter le camp d'en face. Dès lors que cette menace était levée, Athènes n'avait aucun moyen de pression. La position grecque s'était alors entièrement découverte. Et les créanciers ont pu, sans crainte d'une rupture, augmenter leurs exigences. Pour cela, le moyen était fort simple : il suffisait de menacer la Grèce d'une sortie de la zone euro. Comme cette dernière n'en voulait à aucun prix, il était simple de lui faire accepter d'autres conditions et d'annuler ainsi une partie des succès obtenus durant six mois de négociations, notamment le retour des « revues » de la troïka, l'instauration du travail du dimanche et la mise en place d'un fonds de 50 milliards d'euros issus des privatisations pour recapitaliser les banques, rembourser la dette et faire des investissements productifs. Et pour bien faire comprendre à la Grèce qu'elle devait filer droit cette semaine et voter les « réformes » souhaitées, le premier ministre néerlandais Mark Rutte a prévenu que le « Grexit n'était pas encore exclu. »
Quelques succès ?
Les créanciers ont donc tellement tourmenté Alexis Tsipras que ce dernier a pu présenter quelques concessions sur les exigences nouvelles de ce week-end comme des succès : l'absence de Grexit, le maintien du Fonds en Grèce (et non son transfert au Luxembourg comme l'Eurogroupe l'avait demandé) ainsi que le report d'un quart de son montant sur des investissements productifs (autant que la part réservée aux créanciers et moitié moins que celle réservée pour les banques). Mais son seul vrai succès est d'avoir obtenu l'ouverture d'une discussion sur un « reprofilage » de la dette, autrement dit sur un nouvel échéancier. Mais il faut se souvenir que ce plan va encore augmenter la dette et qu'un rééchelonnement risque simplement de « lisser » les effets de cette augmentation. Et, comme on a pu le constater, Athènes est tout sauf en position de force pour bien négocier ce rééchelonnement. Encore une fois, les créanciers - et Angela Merkel l'a confirmé explicitement - restent attachés au mythe de la viabilité de la dette publique grecque. Un mythe qui va continuer de coûter cher à la Grèce qui va ployer pendant des décennies sous le poids absurde de cette dette, la condamnant à une austérité sans fin et à la méfiance des investisseurs.
Prélude à la chute d'Alexis Tsipras ?
Alexis Tsipras va devoir désormais faire accepter ce plan à son parlement. Or, ce plan n'est rien d'autre qu'une négation explicite des deux votes grecs du 25 janvier et du 5 juillet. Les créanciers avaient pour but, d'emblée, d'obtenir l'annulation de fait de ces votes. Ils sont en passe de l'obtenir. Les parlementaires de Syriza ont désormais le choix entre provoquer une crise politique en désavouant Alexis Tsipras et adoptant un programme basé sur la sortie de la zone euro ou devenir un nouveau Pasok, un parti qui tente de « réduire l'impact » des mesures des créanciers sans avoir aucune certitude d'y parvenir. Face à un tel choix, Syriza pourrait se scinder, comblant les vœux des créanciers et de Jean-Claude Juncker qui souhaitait, en janvier, « revoir des têtes connues. » Car, avec de nouvelles élections, qui semblent désormais inévitables, les perdants des 25 janvier et 5 juillet pourraient profiter de cette division pour remporter le scrutin. Quoi qu'il en soit, si le Syriza « modéré » d'Alexis Tsipras l'emporte, sa capacité de résistance est désormais très faible. Le « danger politique » est écarté, comme le voulaient les dirigeants de la zone euro.
La victoire de Tsipras : un révélateur de la nature de la zone euro
Il est cependant un point sur lequel Alexis Tsipras a clairement gagné : il a mis à jour par ses six mois de résistance et ce déchaînement de « vengeance » comme le note ce lundi matin le quotidien britannique The Guardian en une, la nature de la zone euro. Ce lundi 13 juillet, on y voit plus clair sur ce qu'est la zone euro. A l'évidence, les gouvernants européens ont agi comme aucun Eurosceptique n'aurait pu l'espérer.
L'imposition de la logique allemande
D'abord, on a appris que l'euro n'était pas qu'une monnaie, mais aussi une politique économique particulière, fondée sur l'austérité. Le premier ministre grec avait fait le pari que l'on pouvait modifier la zone euro de l'intérieur et réaliser en son sein une autre politique économique. Preuve est désormais faite de l'impossibilité d'une telle ambition. Les créanciers ont clairement refusé une réorientation de la politique d'austérité budgétaire qui, pour un pays comme la Grèce, n'a réellement plus aucun sens aujourd'hui et l'empêche de se redresser. On a continué à imposer cette logique qui fonde la pensée économique conservatrice allemande : la réduction de la dette et la consolidation budgétaire ont la priorité sur une croissance économique qui ne peut être le fruit que « d'efforts douloureux » appelés « réformes. » Même dans un pays économiquement en ruine comme la Grèce qui a démontré empiriquement l'échec de cette logique. Si Alexis Tsipras a perdu son pari, il n'est pas le seul fautif. Les Etats européens comme la France et l'Italie le sont aussi, qui en validant les réformes engagées depuis 2011 dans la zone euro (Two-Pack, Six-Pack, MES, semestre européen, pacte budgétaire) ont assuré la prééminence de cette logique.
Français et Italiens ne peuvent donc pas s'étonner de la radicalisation de l'Allemagne et de ses alliés. Ils l'ont préparée par leur stratégie de concessions à Berlin, se trompant eux-mêmes sur leur capacité future de pouvoir ainsi « infléchir » la position allemande dans le futur.
Gouvernance économique aveugle
La gouvernance économique de la zone euro - jadis tant souhaitée par les gouvernements français - existe donc bel et bien, et ne souffre aucune exception, fût-elle la plus modérée. Aussi, qui veut la remettre en cause devient un adversaire de l'euro. La diabolisation de Syriza pendant six mois l'a prouvé. Ce parti n'a jamais voulu renverser l'ordre européen, le gouvernement grec a rapidement fait de larges concessions (que l'on songe à l'accord du 20 février). Mais sa demande d'une approche plus pragmatique dans le traitement du cas grec conduisait à une remise en cause de la vérité absolue de la logique "austéritaire" décrite plus haut. Il fallait donc frapper fort pour faire cesser à l'avenir toute velléité de remise en cause de l'ordre européen établi. Il y a dans cette Europe un air de « Sainte Alliance » de 1815, révélé désormais au grand jour. Comment autrement expliquer cet acharnement face à Athènes ce week-end, cette volonté de « vengeance » ? Alexis Tsipras avait cédé sur presque tout, mais ce n'était pas assez, il fallait frapper les esprits par une humiliation supplémentaire.
Identification entre euro et austérité
Le problème, c'est que, désormais, l'identification entre l'euro et l'austérité est totale. Le comportement des dirigeants de la zone euro avant et après le référendum pour faire du « non » aux mesures proposées un « non » à l'euro le prouvent aisément. La volonté explicite de durcir les conditions imposées à la Grèce pour rester dans la zone euro ce week-end enfonce le clou. Aujourd'hui, c'est bien la question de la « réforme de la zone euro » et de sa gouvernance qui est posée. C'est un cadeau magnifique fait en réalité aux Eurosceptiques qui auront beau jeu désormais de fustiger la faiblesse d'Alexis Tsipras et de faire de la sortie de la zone euro la condition sine qua non d'un changement, même modéré, de politique économique. Cette fin de semaine, une certaine idée, optimiste et positive, de la zone euro a perdu beaucoup de crédibilité.
Grexit ou pas, le précédent existe désormais
Du reste, ceux qui se réjouissent d'avoir sauvé l'intégrité de la zone euro se mentent à eux-mêmes. Pour la première fois, l'impensable a été pensé. L'irréversibilité de l'euro est morte au cours des deux dernières semaines. Grexit ou pas, la possibilité d'une sortie de la zone euro est désormais établie. La BCE l'a reconnue par la voix de deux membres de son directoire, Benoît Coeuré et Vitor Constancio, et l'Eurogroupe en a explicitement menacé la Grèce. Dès lors, la zone euro n'est plus un projet politique commun qui supposerait la prise en compte des aspirations de tous ses Etats membres par des compromis équilibrés. Elle est un lieu de domination des forts sur les faibles où le poids de ces derniers ne comptent pour rien. Et ceux qui ne se soumettent pas à la doctrine officielle sont sommés de rendre les armes ou de sortir. On accuse Alexis Tsipras d'avoir « menti » à son peuple en prétendant vouloir rééquilibrer la zone euro. C'est faux, car il ne connaissait pas alors la nature de la zone euro. Maintenant il sait, et les Européens aussi.
C'est la réalisation du projet « fédéral » de Wolfgang Schäuble : créer une zone euro plus centralisée autour d'un projet économique accepté par tous, ce qui suppose l'exclusion de ceux qui le remettent en cause. Angela Merkel s'est ralliée à ce projet parce qu'elle a compris qu'Alexis Tsipras ne sortirait pas de lui-même. Elle a donc pensé pouvoir obtenir la discipline et l'intégrité de la zone euro. Mais elle se trompe, elle a ouvert une boîte de Pandore qui pourrait coûter cher à l'avenir au projet européen. De ce point de vue, peu importe que le Grexit n'ait pas eu lieu : sa menace suffit à modifier la nature de la zone euro.
La nature de l'euro
L'euro devait être une monnaie qui rapprochait les peuples. Ce devait être la monnaie de tous les Européens. Or, cette crise a prouvé qu'il n'en est rien. On sait que, désormais, on peut priver certains habitants de la zone euro de l'accès à leur propre monnaie. Et que cette privation est un moyen de pression sur eux. Il sera donc bien difficile de dire encore « l'euro, notre monnaie » : l'euro est la monnaie de la BCE qui la distribue sur des critères qui ne prennent pas en compte le bien-être des populations, mais sur des critères financiers dissimulant mal des objectifs politiques. L'euro est, ce matin, tout sauf un instrument d 'intégration en Europe. En réalité, on le savait depuis la gestion de la crise de Chypre en 2013, qui, on le comprend maintenant, n'était pas un « accident. »
Le choc des démocraties réglé par le protectorat
La résistance d'Alexis Tsipras et l'accord obtenu mettent également à jour le déséquilibre des légitimités démocratiques. Longtemps, l'argument a été que les Grecs ne pouvaient pas imposer leurs choix démocratiques aux autres démocraties. Ceci était juste, à condition que ce soit réciproque.
Or, ce lundi 13 juillet, la démocratie grecque a été fragilisée et niée par ses « partenaires » européens. On a ouvertement rejeté le choix des Grecs et imposé à la place celui des autres gouvernements démocratiques. Le débat ne se tenait pas entre démocraties mais entre créanciers et débiteurs. Jamais la zone euro n'a voulu prendre au sérieux les choix grecs. Et toujours on a cherché à se débarrasser de ceux qui étaient issus de ces choix. Il est donc possible de faire d'un pays de la zone euro une forme moderne de protectorat financier. C'est là encore un dangereux cadeau fait aux Eurosceptiques qui auront beau jeu de venir se présenter en défenseurs de la souveraineté populaire et de la démocratie.
Plus d'intégration ?
François Hollande a promis « plus d'intégration » dans la zone euro les mois prochains. Ceci ressemble dangereusement à une fuite en avant. Angela Merkel a prouvé qu'elle avait choisi le camp de Wolfgang Schäuble, de concert avec la SPD. On ne peut donc que s'inquiéter de cette promesse de l'hôte de l'Elysée qui ne peut aller que dans le sens des erreurs commises. Enivrée par leurs victoires sur un peuple déjà à genoux, les dirigeants de la zone euro doivent prendre garde de ne pas aggraver encore un bilan qui, au final, est aussi négatif pour les vainqueurs que pour les vaincus. •
Romaric Godin - La Tribune 13.07.2015

 Au printemps 1989, j'étais en maîtrise d'histoire à l'université Rennes2, plus communément appelée Villejean, et je hantais quotidiennement ses couloirs, passant d'un amphi à l'autre, de la cafétéria du grand hall à la bibliothèque universitaire, mais aussi les cafés du centre-ville, particulièrement La Paix que je fréquente toujours, y compris pour rédiger les articles de ce site... Militant royaliste d'Action Française, j'avais fort à faire en cette année du bicentenaire de 1789, et les affichages précédaient les réunions, tandis que, dans le même temps, je travaillais sur mon mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine portant sur les royalistes d'AF de Mai 68 au printemps 1971. Pourtant, l'heure était surtout aux cours, colloques, débats et commémorations autour de la Révolution française, et je dévorais tout, ou presque, de ce qui sortait sur ce thème, avec un farouche appétit et une envie non moins grande d'en découdre avec les conformismes du moment...
Au printemps 1989, j'étais en maîtrise d'histoire à l'université Rennes2, plus communément appelée Villejean, et je hantais quotidiennement ses couloirs, passant d'un amphi à l'autre, de la cafétéria du grand hall à la bibliothèque universitaire, mais aussi les cafés du centre-ville, particulièrement La Paix que je fréquente toujours, y compris pour rédiger les articles de ce site... Militant royaliste d'Action Française, j'avais fort à faire en cette année du bicentenaire de 1789, et les affichages précédaient les réunions, tandis que, dans le même temps, je travaillais sur mon mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine portant sur les royalistes d'AF de Mai 68 au printemps 1971. Pourtant, l'heure était surtout aux cours, colloques, débats et commémorations autour de la Révolution française, et je dévorais tout, ou presque, de ce qui sortait sur ce thème, avec un farouche appétit et une envie non moins grande d'en découdre avec les conformismes du moment... 





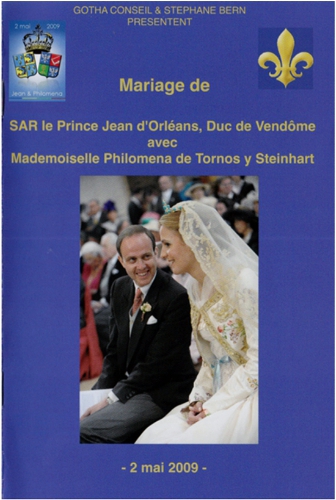
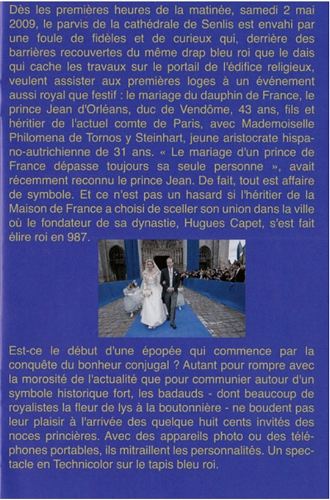







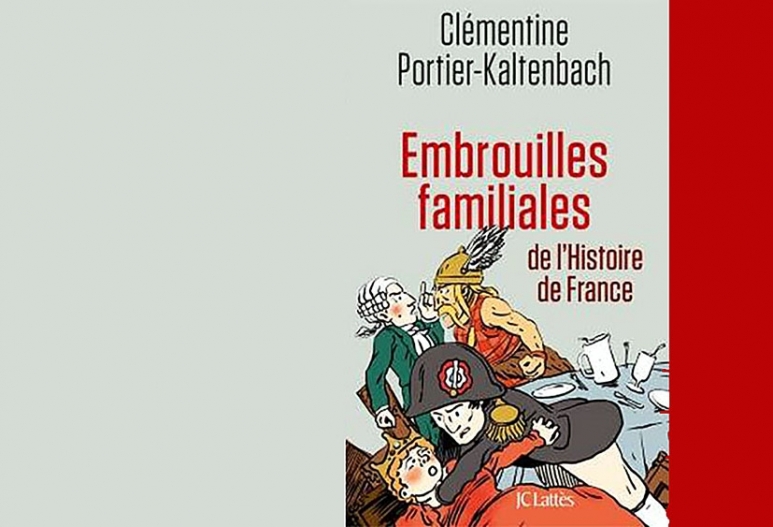

 « Cette fois l’euro est sauvé, la crise grecque est terminée ». Un concert de satisfaction a salué, tant dans les sphères du pouvoir que dans la sphère médiatique, l’accord qui a été trouvé le 13 juillet à Bruxelles entre le gouvenrment Tsipras et les instances européennes – et à travers elles, les grands pays, Allemagne en tête.
« Cette fois l’euro est sauvé, la crise grecque est terminée ». Un concert de satisfaction a salué, tant dans les sphères du pouvoir que dans la sphère médiatique, l’accord qui a été trouvé le 13 juillet à Bruxelles entre le gouvenrment Tsipras et les instances européennes – et à travers elles, les grands pays, Allemagne en tête.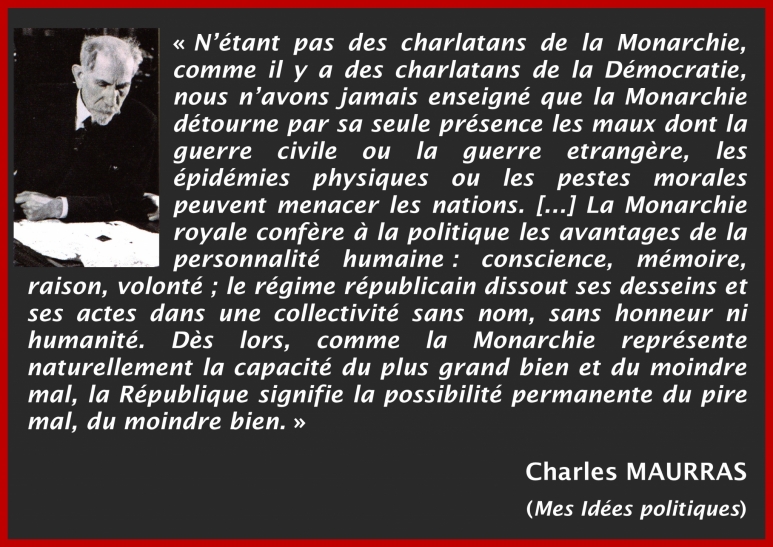

 Le feuilleton grec risque de s'achever en drame et chacun sait qu'une tragédie grecque est d'allure cosmique et de sens universel. Encore faut-il en comprendre la portée !
Le feuilleton grec risque de s'achever en drame et chacun sait qu'une tragédie grecque est d'allure cosmique et de sens universel. Encore faut-il en comprendre la portée !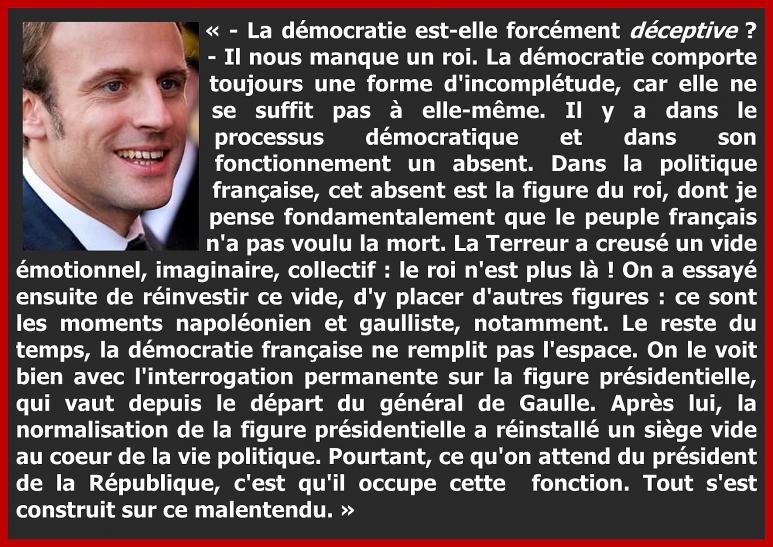



 "Les ridicules légendes de la Bastille"
"Les ridicules légendes de la Bastille"