Les mérites du rapport de Malek Boutih sur la « génération radicale »
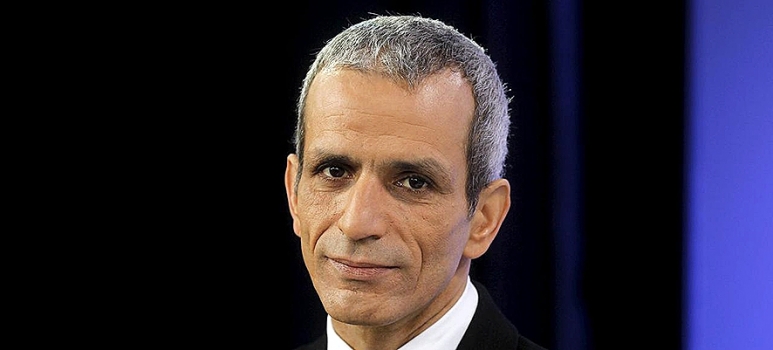
Nous avons déjà évoqué (vendredi 10 juillet) les analyses de la radicalisation islamiste de Malek Bouth, en publiant le fort pertinent article que Pascal Bories leur a consacré dans Causeur. Un autre commentaire s'y ajoute aujourd'hui : celui de Chantal Delsol.
Le point de vue de Chantal Delsol
 L'ancien président de SOS-Racisme ne craint pas d'arriver aux mêmes conclusions que des observateurs classés à droite, d'où la hargne qu'il suscite dans sa famille politique, explique Chantal Delsol*.
L'ancien président de SOS-Racisme ne craint pas d'arriver aux mêmes conclusions que des observateurs classés à droite, d'où la hargne qu'il suscite dans sa famille politique, explique Chantal Delsol*.
Le rapport Malek Boutih pose le problème des causes émotionnelles et sociales des phénomènes extrémistes : les fanatiques du djihadisme (on pourrait dire aussi bien: du nazisme et du communisme) sont-ils de véritables croyants, ou plutôt des gens mal à l'aise dans leur propre vie ? Nous savons bien que les sentiments et les émotions jouent un rôle dans les engagements. Pourtant, la frustration sociale, l'échec personnel peuvent-ils suffire à expliquer le succès de Daech dans les pays occidentaux ? Et peut-on nier qu'il s'agisse là d'un courant de pensée, même s'il nous apparaît incroyablement fruste et barbare ? Au début, quand Daech s'appelait al-Qaida, nos observateurs avaient tendance à voir dans ses adeptes des gens analphabètes frustrés de n'avoir pas fait d'études - tant est grand chez nous le préjugé selon lequel seul l'ignorant est intolérant. Mais on s'est aperçu que les poseurs de bombes et autres kamikazes étaient souvent des gens tout à fait évolués intellectuellement - ce que corrobore la grande maîtrise de la communication et de l'informatique dont ils font preuve. Et puis quelques-unes de nos certitudes sont encore tombées quand nous avons vu que les candidats au djihad peuvent partir avec bien peu de connaissances de l'islam, comme s'il ne s'agissait là que d'une occasion.
Malek Boutih met en valeur autre chose encore que la rancœur personnelle d'un élève en échec, autre chose encore que le fanatisme religieux : la rupture avec la culture ambiante, le désaveu de la société républicaine à laquelle la foi ne s'attache plus. « Monsieur, j'ai écouté votre cours et l'ai appris soigneusement pour obtenir une bonne note, mais tout ce que vous avez dit était faux » : voici ce qu'entend, effaré, cet enseignant du secondaire dans un lycée difficile. Signe qu'une partie de la jeunesse a littéralement mis les voiles. Et, dès lors, tout est possible.
De notre côté, la stupéfaction est totale : comment peut-on ne pas aimer d'amour pur la république et la démocratie, parangons de l'égalité et de la liberté, désirables sur toute la terre ? C'est que le jeune lycéen voit la réalité là où nous vivons sur la fiction. Il voit que le discours officiel - l'épanouissement et le bien-être pour tous - ne s'applique à aucun moment, et qu'il lui faut non seulement subir les portes fermées et la galère, mais en plus entendre toute la journée des discours flamboyants sur les bienfaits du système. En lieu et place de cette utopie inappliquée et tributaire du mensonge, on lui propose un bon vieux rêve qui ne risque pas l'affrontement au réel, et dans lequel il jouera au moins un vrai rôle, fût-il barbare. C'est l'occasion d'exister.
Le rapport Boutih indique que les deux tiers des personnes impliquées dans les filières jihadistes ont moins de 25 ans. Naturellement, un chœur bien-pensant s'écrie : en disant cela, on discrimine la jeunesse ! (Sous-entendu : dissimulez cette vérité insupportable.) Pourtant, cela peut servir pour mieux comprendre, d'autant que ce ne serait pas la première fois. L'histoire montre que les terroristes révolutionnaires, ceux qui détruisaient le vieux monde avec allégresse et qui tuaient le mieux, étaient souvent des hommes jeunes. L'instauration de la première terreur d'État, dans la France de 1793, s'organise par la main de fanatiques qui ont à peine plus de 30 ans, voire moins. Au XIXe siècle en Russie, ces jeunes hommes en rupture de ban étaient les « hommes de trop » qui jetaient des bombes noires sur les calèches des ministres. Pour le XXe siècle, Stéphane Courtois dressait dans un de ses ouvrages une liste impressionnante, qui commence ainsi : Heydrich avait 35 ans au début de la guerre et Himmler, 39 ; le fondateur et premier chef du goulag, Matveï Berman, avait 28 ans ; le maître d'œuvre de la Grande Terreur, Nicolas Ejov, était âgé de 35 ans, etc. Le désespoir et l'utopie font bon ménage avec la barbarie, qui n'est autre qu'une abolition des limites, et réclame pour ses basses œuvres des êtres incomplets encore, qui n'ont pas dressé la carte du réel. Il faut être jeune et fou pour marcher sur une plage avec sous le bras la tête de son ennemi. Et nous savons que les vieux idéologues sont en réalité de vieux bébés.
Comment manifester sa colère contre Malek Boutih et son enquête si peu conforme aux exigences républicaines ? En récusant sa méthode. Une partie de la presse s'indigne aussitôt de voir figurer parmi la trentaine de personnes interrogées l'éducateur Jean-Paul Ney (trop à droite pour pouvoir réclamer une quelconque légitimité à parler) ou encore Frigide Barjot, organisatrice il y a deux ans de la Manif pour tous (trop catholique pour avoir droit de cité). Boutih est-il assez naïf pour croire qu'il faut interroger tous ceux qui ont réfléchi au sujet ? N'a-t-il pas compris que certaines personnes sont satanisées et donc personae non gratae ? On a plutôt envie de croire qu'il a l'esprit libre à l'égard de son propre camp, ce qui le rend bien sympathique: on comprend qu'il cherche la vérité.
Boutih, qui est à la fois socialiste et d'origine algérienne (double légitimité pour parler de ce sujet), dérange les préjugés et tabous de la gauche, et surtout déstabilise cette volonté permanente de la gauche de taire les vérités élémentaires. Si l'on veut qu'un rapport de ce genre soit à la solde d'un courant politique, au fond le rapport Boutih est fait pour un courant de droite, puisqu'il ose annoncer que la menace est réelle et importante, ce qui est peu prisé par son camp - d'où le mécontentement de ceux auxquels il s'adresse.
Alors on l'accuse de généraliser. Tous les jeunes de banlieues « issus de la diversité », comme on a le droit de dire pudiquement, ne sont pas destinés au djihad ! Tous les jeunes interdits de boîtes de nuit ne finiront pas jihadistes ! Et ce n'est en aucun cas ce qu'il a dit. Il met en garde contre la montée importante, et préoccupante, du nouvel extrémisme dont nos gouvernants prétendent qu'il ne touche qu'une petite poignée. Il écrit que la barbarie est une offre intéressante quand on est jeune et qu'on déteste la société dans laquelle on vit - les jeunes ancêtres de Kouachi, qui il y a si peu de temps portaient tantôt un brassard à croix gammée et tantôt la casquette étoilée des komsomols, avaient compris cela. •
* Membre de l'Institut.
Chantal Delsol - Le Figaro


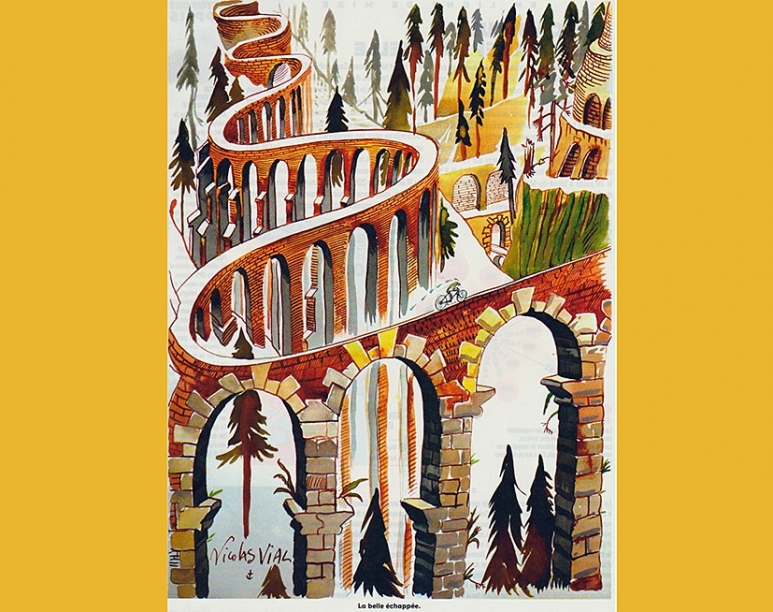
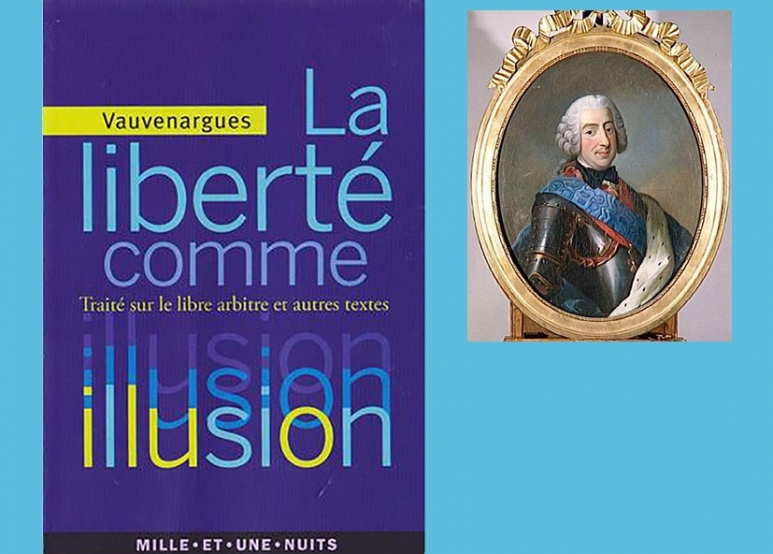
 Il est né quelques jours après la mort de Louis XIV. Il a 22 ans, et s'ennuie dans le fort de Besançon. Il attend non l'ennemi qui le fera héros, mais le livre qui le rendra célèbre. Il rédige, entre deux corvées militaires, un bref et incisif Traité sur la liberté comme illusion ; mais cet ouvrage ne sera publié qu'en 1806, l'année de la victoire d'Iéna. Trop iconoclaste, trop dangereux. Vauvenargues ne renonce pas. Il deviendra l'ami de Voltaire, qui l'encourage à achever ses Réflexions et Maximes, qui feront de lui l'un des trois plus grands moralistes français, avec La Rochefoucauld et Chamfort ; mais la postérité injuste le traitera toujours comme le cadet des deux autres. Il meurt à 37 ans. Descartes, Pascal, Vauvenargues : les génies mouraient jeunes à l'époque: mais ils avaient quand même le temps de laisser une empreinte profonde. Les Éditions Mille et Une Nuits ont eu la bonne idée de rééditer ce petit bijou. Avec un travail éditorial impeccable pour mieux sertir cette langue magnifique, vive et sans graisse, qui virevolte, caracole à bride abattue, comme un mousquetaire du roi, toujours élégant, même lorsqu'il use de sa rapière pour fendre l'adversaire. Vauvenargues reprend l'éternelle question du libre arbitre, et la règle d'un coup sec: tout n'est qu'illusion. « Nul n'est libre, et la liberté est un mot que les hommes n'entendent point.»
Il est né quelques jours après la mort de Louis XIV. Il a 22 ans, et s'ennuie dans le fort de Besançon. Il attend non l'ennemi qui le fera héros, mais le livre qui le rendra célèbre. Il rédige, entre deux corvées militaires, un bref et incisif Traité sur la liberté comme illusion ; mais cet ouvrage ne sera publié qu'en 1806, l'année de la victoire d'Iéna. Trop iconoclaste, trop dangereux. Vauvenargues ne renonce pas. Il deviendra l'ami de Voltaire, qui l'encourage à achever ses Réflexions et Maximes, qui feront de lui l'un des trois plus grands moralistes français, avec La Rochefoucauld et Chamfort ; mais la postérité injuste le traitera toujours comme le cadet des deux autres. Il meurt à 37 ans. Descartes, Pascal, Vauvenargues : les génies mouraient jeunes à l'époque: mais ils avaient quand même le temps de laisser une empreinte profonde. Les Éditions Mille et Une Nuits ont eu la bonne idée de rééditer ce petit bijou. Avec un travail éditorial impeccable pour mieux sertir cette langue magnifique, vive et sans graisse, qui virevolte, caracole à bride abattue, comme un mousquetaire du roi, toujours élégant, même lorsqu'il use de sa rapière pour fendre l'adversaire. Vauvenargues reprend l'éternelle question du libre arbitre, et la règle d'un coup sec: tout n'est qu'illusion. « Nul n'est libre, et la liberté est un mot que les hommes n'entendent point.»
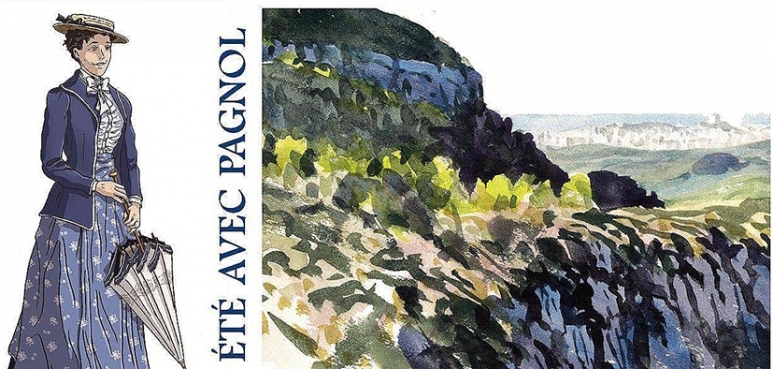


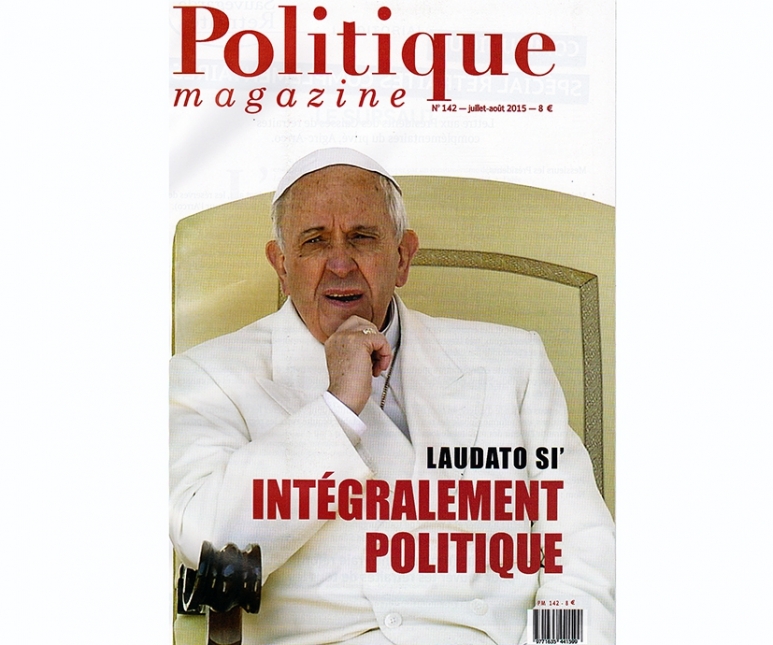
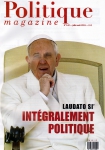

 Dans nos mythologies contemporaines, le touriste occupe une place toute particulière, parce qu'il est possible de lui assigner les rôles les plus divers suivant le point de vue que l'on décide d'adopter, suivant que l'on a décidé de rappeler à l'ordre des Français trop fiers et oublieux de leur statut désormais acquis de nation subalterne ne pouvant vivre que du tourisme ou de s'insurger contre les mauvaises manières des adeptes de la canne à selfie. Le touriste, notre nouveau miroir déformant.
Dans nos mythologies contemporaines, le touriste occupe une place toute particulière, parce qu'il est possible de lui assigner les rôles les plus divers suivant le point de vue que l'on décide d'adopter, suivant que l'on a décidé de rappeler à l'ordre des Français trop fiers et oublieux de leur statut désormais acquis de nation subalterne ne pouvant vivre que du tourisme ou de s'insurger contre les mauvaises manières des adeptes de la canne à selfie. Le touriste, notre nouveau miroir déformant.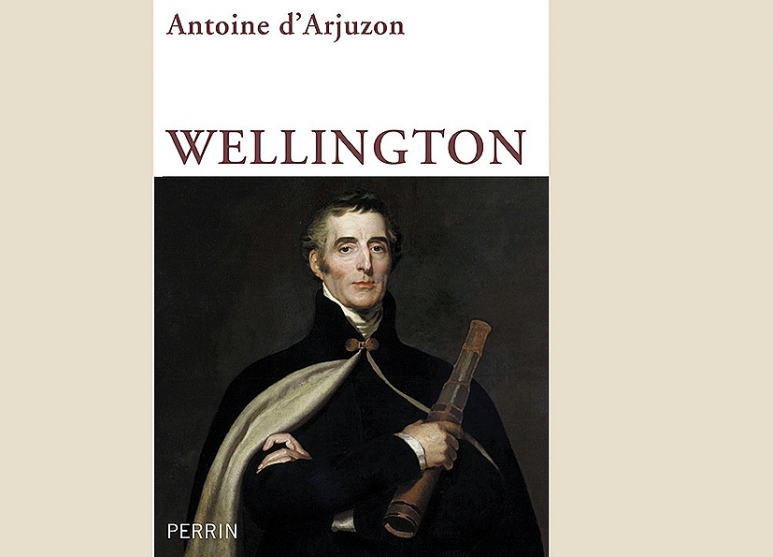

 La semaine dernière, Malek Boutih rendait
La semaine dernière, Malek Boutih rendait 
