“Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l’eau de toutes parts. Et dans ton champ, nous voyons plus d’ivraie que de bon grain. Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient. Mais c’est nous-mêmes qui les salissons ! C’est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Église… »
C’était en mars 2005. Jean-Paul II était mourant. Le cardinal Joseph Ratzinger présidait à la place du pape le chemin de croix qui se déroule traditionnellement au Colisée. Nul doute aujourd’hui, pour qui cerne l’histoire de cette période de l’Église, que celui qui était alors encore le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pensait, en prononçant ces mots terribles, d’abord et surtout, aux crimes d’homosexualité, de pédophilie et d’abus sexuels de toutes sortes perpétrés dans un cadre ecclésiastique au cours des quarante précédentes années et dont s’étaient rendus coupables des membres du clergé à tous les niveaux. Les scandales commençaient à éclater un peu partout sur tous les continents et éclaboussaient jusqu’aux sommets de la hiérarchie qui se taisait.
Le temps de Jean-Paul II
Jean-Paul II avait exercé son charisme personnel dans sa fonction pour redynamiser une Église qui en avait bien besoin après les années dites « conciliaires » dont le pape Paul VI, sur la fin de son pontificat, effrayé de résultats qui n’étaient, certes, pas prévus, s’affligeait lui-même. Il en était quelques autres qui avaient joué un rôle important lors du Concile, comme théologiens ou experts, et qui, eux aussi, étaient consternés par une évolution en forme de dégradation doctrinale, morale et liturgique qui n’avait plus rien à voir avec le renouveau souhaité ou imaginé. En étaient, entre autres, le Père de Lubac, le Père Daniélou, promus cardinaux par Jean-Paul II ; Joseph Ratzinger aussi. D’où leur volonté de réformer la réforme afin de l’inscrire dans la continuité de l’Église en éliminant peu à peu les herméneutiques de la rupture.
Jean-Paul II, en lutteur polonais qui s’était exercé avec succès contre le communisme athée, avait parcouru le monde à grandes enjambées et rassemblé les foules – et surtout les jeunes – pour leur rendre confiance et leur rappeler – pour les catholiques – les articles de la foi et les principes de la morale. De grands textes, souvent, d’ailleurs, inspirés par son cardinal théologien Ratzinger, ponctuaient ce parcours, de Veritatis splendor à Fides et ratio, ainsi que toute une série d’exhortations et d’admonestations. Ce qui ne l’avait pas empêché, en faisant fi de toutes les contradictions, de persévérer, tout autant, dans un œcuménisme sans frontière et dans une vision des droits de l’Homme qui lui servait depuis toujours de fer de lance et qu’il prétendait ramener dans une direction divine en l’incluant dans une vaste conception théologique, philosophique et éthique. Sa philosophie inspirée de la phénoménologie moderne lui permettait des synthèses surprenantes. Joseph Ratzinger ne pouvait s’empêcher sur ces points d’avoir, sinon de manifester, des réticences malgré toute l’admiration, voire la dévotion que portait à son pape le cardinal théologien : en particulier les réunions d’Assise qui, du strict point de vue de l’affirmation de la foi catholique, n’étaient pas acceptables.
Toujours est-il que Jean-Paul II, tout donné à son lien direct avec le peuple fidèle et à sa relation personnelle avec le monde, ne se préoccupait pas du gouvernement de l’Église. Les services de la curie fonctionnaient par eux-mêmes selon les directions des cardinaux concernés et des autres prélats curiaux laissés à leur jugement… et à leurs calculs ou ambitions. Et de même les Églises locales sous la houlette de leurs conférences épiscopales, leurs bureaux, leurs commissions et on sait ce que ces mots veulent dire. Tout cela est certain et n’a pas manqué d’être noté par les historiens et les essayistes les plus sérieux. Est-il permis de le dire ? Le clergé, du bas en haut et du haut en bas, était livré à lui-même et il n’y a rien de pire. Surtout dans les exaltations malsaines de prétendus changements radicaux qui devaient tout bouleverser ! Et pourquoi pas, après la doctrine, les mœurs ? Précisons qu’il n’y a pas que ce qu’on appelle « la gauche » qui se livrait à ce genre de libération… théologique et éthique. D’autres qui seraient qualifiés « de droite », pouvaient aussi bien tomber dans le même piège de l’autosuffisance et du narcissisme doctrinal et moral. Tout est permis à qui se croit au-dessus.
En raison de son expérience polonaise dans un régime qui tentait par tous les moyens de la calomnie de déstabiliser l’Église, Jean-Paul II refusait d’envisager la responsabilité pénale du clergé et, mis devant des accusations, les traitait de rumeurs. C’est ainsi qu’il avait soutenu et promu Marcial Maciel, fondateur des Légionnaires du Christ, dont il louait les œuvres, en effet, impressionnantes alors que des faits certains commençaient à être communiqués au Saint-Siège. La secrétairerie d’État opposait la plus grande inertie. Le cardinal Sodano, tout à sa politique, ne traitait pas les vrais problèmes. L’institution occultait et faisait semblant de tout ignorer. « Et ce n’est pas pécher que pécher en silence… » !
C’est dans ces circonstances que, sans porter de jugement sur les personnes en responsabilité, avec la discrétion requise, Joseph Ratzinger de sa propre initiative décida d’attraire devant son dicastère les cas qui lui étaient signalés. Il savait donc. Pas tout. À cette époque, loin de là ; mais il fut atterré. La perversité des ecclésiastiques lui était intolérable. Il ne la comprenait même pas ! D’où cette prière d’épouvante lors du Chemin de Croix de mars 2005. Ce ne fut que le début d’une longue agonie. Coepit contristari et maestus esse, pavere et taedere.
Le temps de Benoît XVI
Le 2 avril suivant, Jean-Paul II mourait. Doyen du Sacré-Collège, Joseph Ratzinger prépara le conclave. Il en sortit pape. Des indiscrétions – qui, d’ailleurs, peinèrent Ratzinger- –, donnèrent à savoir le nom de son principal concurrent : Jorge Mario Bergoglio.
Une fois sur la chaire de saint Pierre, celui qui était devenu Benoît XVI mesura peu à peu toute l’ampleur du problème. C’est lui et lui seul qui résolut la terrible affaire des Légionaires du Christ, en sauvant les âmes et en préservant les œuvres bonnes, car l’homme de foi était aussi un homme de charité. Cependant, les faits dénoncés et les plaintes émises se multipliaient de tous côtés ; c’est encore lui qui prescrivit alors les règles de la plus stricte vérité et de la plus rigoureuse justice, y compris devant les institutions civiles. Cependant il s’avéra qu’il avait dans son propre entourage de cardinaux et de prélats des hommes qui par suffisance ou insuffisance – prétention souvent doublée d’incompétence – ne voulaient pas comprendre. Inutile ici de donner des noms : tout est maintenant parfaitement connu des personnes averties. C’est comme si tout avait été fait pour écœurer, pire encore, pour faire tomber Benoît XVI ; aucun mauvais procédé ne lui aura été épargné : stupidité, immoralité, désir de vengeance ; et ce besoin de couvrir les réseaux et de se couvrir soi-même. Il ne s’agissait plus que de l’accabler.
Toutefois, la gravité extrême des faits posait une question plus profonde. Les dérives des mœurs sont les signes des déviations de la foi. Il est toujours possible pour un catholique de se reconnaître pécheur et donc d’essayer de s’amender. Le mal est sans recours quand on s’accorde la facilité de se faire un Dieu et une religion à sa façon. Le mot « amour » mis à toutes les sauces suffit à justifier tout et n’importe quoi, y compris le pire, en échappant aux vérités de la nature et aux dogmes de la foi. Charles Maurras – eh oui ! – qui a tout vu, de son regard aigu, dès le début du XXe siècle, des conséquences des erreurs progressistes et modernistes dont l’Église allait pâtir pendant plus d’un siècle, écrivait en 1905 : « Dieu est tout amour, disait-on. Que serait devenu le monde si retournant les termes de ce principe, on eût tiré de là que tout amour est Dieu ? »
C’est exactement la question. Ces messieurs ont tout simplement décidé de justifier toutes leurs amours : l’homme, le monde, leurs choix idéologiques et tout aussi bien, leurs amours irrégulières ou singulières. Or, le problème commence quand on fait la théorie de son cas, pensées, mœurs, passions, goût du pouvoir. Quand on se fait soi-même sa propre théorie du salut, quand on estime qu’on n’a pas besoin de salut ou qu’on est au-dessus, c’est fini. Le salut peut être devant soi, on ne le voit pas, on le méprise, on le dénigre, on le traite de Satan. C’est le péché contre l’Esprit.
Benoît XVI a donc tenté un redressement de la foi pour opérer un redressement de la barque de Pierre. Et avec quel enseignement de la plus grande précision ! il en a été traité à plusieurs reprises dans ces colonnes. Ce n’est pas le lieu ici d’y revenir. Il voulait renouer tous les fils rompus. Penser juste et vrai, prier en beauté et en conscience aiderait à agir en conformité avec l’Évangile de Jésus-Christ. Eh bien, l’homme qui ne voulait pas être pape,– pour reprendre le titre du beau livre de Nicolas Diat – a pris finalement et personnellement la décision de renoncer au ministère d’évêque de Rome, successeur de saint Pierre ; il arguait de son manque de force. Après tant d’épreuves !
Le temps de François
C’est ainsi que le cardinal Bergoglio fut élu. Jésus, le diable et, à l’appui, citation de Léon Bloy, on crut à ses premiers propos aux cardinaux qu’il allait proposer une radicalité évangélique de bon aloi. Il s’y mêla très vite d’autres ingrédients. L’Église eut droit, en plus d’une dialectique sur les pauvres qui prit la forme d’unique spiritualité et qui tourna à la mystique des migrants et, pour parler comme Péguy, à la politique de la migration universelle, à une autre dialectique dite de « l’ouverture » qui devint un système de gouvernement, une méthode politique d’exercice du pouvoir. Tout ce qui s’opposait aux projets pontificaux étaient mis sur le compte d’un esprit de « fermeture », d’obstination dans des doctrines passées et donc dépassées.
Tout y passa, en effet : cela alla de l’éloge incon-sidéré de Luther qui mettait à mal la foi catholique, aux subtiles transformations de la règle morale par toutes sortes de procédés prétendument démocratiques et évidemment abusifs. Les quelques jésuites sans foi ni loi, et connus comme tels, qui ont tout oublié de saint Ignace et bafouent les Exercices spirituels qui devraient être leur règle de vie, gravitant dans l’entourage du pape, menaient la danse : une casuistique invraisemblable, à faire frémir Pascal, autorisait toutes « les ouvertures ». Cependant le pape se créa à la Maison Sainte-Marthe son propre appareil de gouvernement avec ses hommes à lui, ses cardinaux nommés par lui, en doublon de la curie qu’il se contentait d’invectiver chaque année régulièrement.
Le dernier voyage de François à Dublin en Irlande, les samedi 25 et dimanche 26 août, fut typique de cette manière de faire. Il écrit, la semaine précédente, une Lettre au peuple de Dieu qui, devant la montée des scandales, dénonce avec une extrême vigueur les abus sexuels sur mineurs, mais ce sont des mots, car la Lettre ne vise jamais le péché en tant que tel des pratiques de l’homosexualité et de la pédérastie ; et il se rend ensuite à la 9e Rencontre mondiale des familles à Dublin dans une Irlande catholique blessée par ces horribles comportements. Là, tout est arrangé pour orienter cette rencontre qui concerne la famille dans sa sainteté, sur « l’accueil des divorcés remariés selon Amoris laetitia » et sur « l’accueil et le respect dans les paroisses des LGBT et leurs familles ». Il fallait l’oser ! Alors à quoi sert de demander pardon, de se lamenter en fustigeant toute l’Église qui n’en peut mais, en dénonçant dans les crimes perpétrés, non pas le péché en lui-même que constitue l’abus sur mineurs, mais ce qui est requalifié de cléricalisme ! Ah, si ce n’est pas précisément du cléricalisme, cette manière de procéder…
François pour ces journées s’est fait accompagner, comme par hasard, de ceux qui participent du même système : le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, Oscar Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa au Honduras, membre de son C9, Blase Cupich, créé cardinal par lui, archevêque de Chicago, des noms qui ont été cités – à tort ou à raison – dans des affaires de ce genre, comme ceux de Wuerl, archevêque de Washington, et de O’Malley, archevêque de Boston, qui aussi étaient invités et qui ne sont pas venus, car ils doivent faire face eux-mêmes à la tourmente ! Le jésuite américain, James Martin, directeur de la revue America, connu pour ses positions ouvertement LGBT, était bien là, lui aussi, chargé de faire sa propagande ignoble. Et François, là-dessus, au retour dans l’avion essaya de noyer la question en parlant de psychiatrie. Il n’y a donc aucune autorité dans l’Église pour dire : ça suffit ! Alors que tout le monde sait que le mal a ravagé des églises entières, que le procureur de l’État de Pennsylvanie, Josh Shapiro, vient de faire savoir que le Vatican et les autorités ecclésiastiques connaissaient les ignominies commises sur des enfants par près de 300 prêtres dans ce seul État, qu’il en est de même au Chili, en Australie, en Irlande, et encore, et encore…Même s’il s’agit d’une minorité, c’est bien trop ! Ne serait-ce que pour que l’Église hiérarchique et l’ensemble des prêtres qui ont donné leur vie au Christ, ne soient pas compromis dans cet affreux trafic d’influence. Car qu’est-ce d’autre ?
Il est donc compréhensible que Mgr Carlo Maria Vigano ait cru bon d’écrire sa lettre ouverte au pape. Ancien Délégué aux représentations pontificales auprès de la secrétairerie d’État, puis nonce apostolique à Washington, il fut par ses fonctions informé de suffisamment de faits à la suite de ses prédécesseurs pour se croire obligé d’en référer aux plus hautes autorités, en particulier s’agissant des abus sexuels perpétrés par l’ancien archevêque de Washington, le cardinal McCarrick, doublés de sollicitatio ad turpia et de sacrilèges eucharistiques. Sa lettre est parfaitement documentée, précise ; et les faits monstrueux de perversion sont connus et sont si avérés qu’à la demande de François McCarrick a été obligé de présenter sa démission du collège cardinalice en juillet dernier. Mais, auparavant, qu’en était-il, s’il est vrai que, de fait, Benoît XVI avait déjà pris des décisions à son encontre ?
Ce n’est pas tout, car Mgr Vigano dénonce tout un système de connivences, de nominations, de réseaux homosexuels qui contamine l’Église. Combien d’autorités impliquées ? Et jusqu’où…
Le pape François ne saurait d’aucune manière et à aucun titre couvrir de son autorité de telles turpitudes : c’est une évidence. Il en va du respect de sa propre fonction que tout catholique est tenu de respecter, à commencer par lui-même. Le pape est souverain ; il a le droit de ne pas répondre et, bien sûr, de ne pas se plier aux injonctions et aux supplications de Mgr Vigano ; il ne peut pas ne pas en tenir compte.
Mgr Vigano sera vraisemblablement décrié. On cherchera à anéantir son témoignage qui, comme tout témoignage, a nécessairement des aspects très personnels et donc sujets à contestation. C’est si facile ! Les personnes concernées vont faire front. Il lui sera opposé des haussements d’épaule ou un silence méprisant comme le silence qui voile la honte…
Il n’est pas bon dans l’Église d’aujourd’hui d’avoir du courage. Pas plus que dans la société civile! Quelques évêques dans le monde, heureusement, américains en particulier, mais pas seulement, ont compris l’importance d’un tel acte qui pourrait devenir salutaire s’il aboutissait à une nécessaire cure de vérité dont l’Église, à l’évidence, a le plus grand besoin. À ceux qui s’affoleraient, car la crise, est de fait, d’une violence inouïe, pourquoi ne pas rappeler la pensée de Pascal : « Bel état de l’Église quand elle n’est plus soutenue que de Dieu ». ■
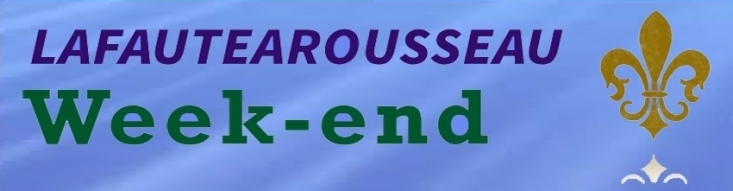



 de cette intervention se trouve dans la sanglante répression de la manifestation des sections royalistes parisiennes du 5 octobre 1795, qui n’est pas, comme on la présente généralement, un coup d’arrêt à une tentative de prise de pouvoir, mais bien la suppression à coup de canon d’une revendication démocratique et une véritable « école du coup d’Etat ».
de cette intervention se trouve dans la sanglante répression de la manifestation des sections royalistes parisiennes du 5 octobre 1795, qui n’est pas, comme on la présente généralement, un coup d’arrêt à une tentative de prise de pouvoir, mais bien la suppression à coup de canon d’une revendication démocratique et une véritable « école du coup d’Etat ».

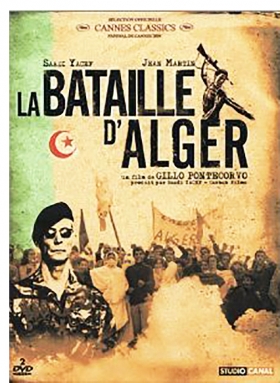 Cinquante-cinq ans après l'indépendance, acquise en 1962, je ne me suis toujours pas remis de la tragédie, mais je ne puis que constater et me rendre compte que la coupure était irrémédiable et impossible à empêcher. C'est bien de cela que rend compte le film de Pontecorvo. Nullement œuvre de propagande, mais constat froid et désolant de l'inéluctabilité des choses.
Cinquante-cinq ans après l'indépendance, acquise en 1962, je ne me suis toujours pas remis de la tragédie, mais je ne puis que constater et me rendre compte que la coupure était irrémédiable et impossible à empêcher. C'est bien de cela que rend compte le film de Pontecorvo. Nullement œuvre de propagande, mais constat froid et désolant de l'inéluctabilité des choses. Le film de Pontecorvo est admirable en ceci qu'il pose ces vraies questions, sans angélisme et sans niaiserie. Le parti pris est clair, mais le constat est froid.
Le film de Pontecorvo est admirable en ceci qu'il pose ces vraies questions, sans angélisme et sans niaiserie. Le parti pris est clair, mais le constat est froid.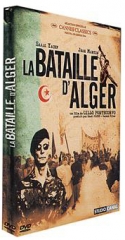
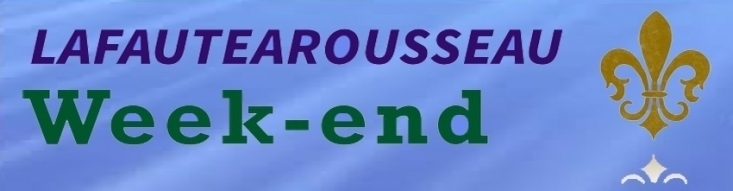

 Le rideau est tombé. La scène est vide. Jean Piat est parti. Comme pour Gérard Philippe ou quelques autres célébrités artistiques qui étaient entrées dans les paysages de nos mémoires intimes, nous ressentons un grand trouble au plus profond de nos cœurs ; quelque chose de la Création s'en est allé.
Le rideau est tombé. La scène est vide. Jean Piat est parti. Comme pour Gérard Philippe ou quelques autres célébrités artistiques qui étaient entrées dans les paysages de nos mémoires intimes, nous ressentons un grand trouble au plus profond de nos cœurs ; quelque chose de la Création s'en est allé.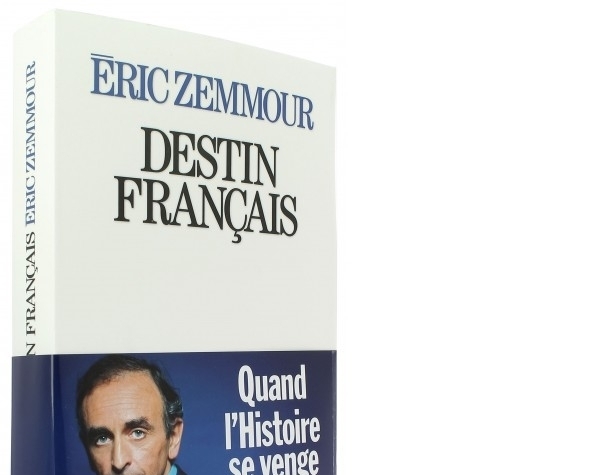



 Dommage, d'ailleurs, qu'au lieu de la conclusion qui sent son « politiquement correct », les réalisateurs, et Lambert Wilson qui leur « prête » sa voix, n'aient pas entonné le Cantique des Créatures de Saint François d'Assise :
Dommage, d'ailleurs, qu'au lieu de la conclusion qui sent son « politiquement correct », les réalisateurs, et Lambert Wilson qui leur « prête » sa voix, n'aient pas entonné le Cantique des Créatures de Saint François d'Assise :

 Mathieu Bock-Côté montre ici comment la gauche n'aime pas débattre avec la droite. Elle préfère la dénoncer, examinant à la loupe tout dépassement des lignes du politiquement correct pour mieux s'en offusquer et disqualifier le « fautif ».
Mathieu Bock-Côté montre ici comment la gauche n'aime pas débattre avec la droite. Elle préfère la dénoncer, examinant à la loupe tout dépassement des lignes du politiquement correct pour mieux s'en offusquer et disqualifier le « fautif ». 







