Rire ou sourire un peu ... même s'il n'y a pas vraiment de quoi

Choisi par Ariane
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Choisi par Ariane

Manuel Valls à Vauvert, le 11 août 2015. Crédits photo : PASCAL GUYOT/AFP
Ce n'est pas sur un sujet politique, encore moins politicien, que nous sommes d'accord ici avec Manuel Valls. C'est sur sa défense des traditions taurines. Et sur les arguments qu'il utilise. Bien-sûr, l'on peut diverger. Nos lecteurs jugeront. Ils se partageront sans-doute à leur gré entre partisans et adversaires de la corrida, dite espagnole ou camarguaise. Mais nous avons assez souvent répété ici que « tout ce qui est racines est bon » - ce qui n'est que relativement vrai et non absolument - pour que l'auteur de ces lignes se sente autorisé à dire tranquillement toute sa sympathie - une fois n'est pas coutume - pour la position de Manuel Valls sur ce brûlant sujet. D'autres s'aligneront sur les combats de Brigitte Bardot. Et qu'en pensera-t-on au Grand-Orient, où racines et traditions ne sont pas forcément, si l'on peut dire, en odeur de sainteté ? Bref, pour l'instant, quant à nous, nous donnerons raison à Manuel Valls. Cela fera plaisir - ce qui n'est pas rien - à nos amis du Languedoc et aux aficionados de toutes régions. LFAR •
Ce qu'en a dit Arthur Berdah, journaliste au Figaro
En déplacement dans le Gard, le premier ministre a loué mardi les qualités de la course camarguaise. « Un équilibre qu'il faut garder », a même plaidé ce fervent amateur de tauromachie.
 La condition animale nouvel atout des politiques pour capitaliser en sympathie ? Très peu pour Manuel Valls. Après la proposition de loi du député LR Frédéric Lefebvre contre les abandons d'animaux et la mobilisation de 36 parlementaires contre le broyage des poussins, le premier ministre a, lui, pris le contre-pied en s'exprimant en faveur de la tradition taurine. « C'est une belle habitude », s'est-il réjoui auprès du quotidien régional Midi Libre.
La condition animale nouvel atout des politiques pour capitaliser en sympathie ? Très peu pour Manuel Valls. Après la proposition de loi du député LR Frédéric Lefebvre contre les abandons d'animaux et la mobilisation de 36 parlementaires contre le broyage des poussins, le premier ministre a, lui, pris le contre-pied en s'exprimant en faveur de la tradition taurine. « C'est une belle habitude », s'est-il réjoui auprès du quotidien régional Midi Libre.
« Moi je suis français, il y a les traditions catalanes et il y a les traditions camarguaises, il faut les respecter, elles vivent ensemble. C'est ça la France, être capable de faire vivre toutes ses traditions. Et j'aime beaucoup la Camargue parce que c'est ce mélange, cette capacité à avoir plusieurs cultures différentes qui se complètent », a encore estimé, très politique, le natif de Barcelone interrogé sur sa préférence entre la corrida espagnole et la course camarguaise.
Le chef du gouvernement en a profité pour rappeler son attachement aux traditions taurines: « Il faut la garder parce que c'est un équilibre, pour la nature, pour le territoire, pour l'économie et pour l'homme », a-t-il ainsi martelé, depuis le Gard, au micro du journal local. Un éloge qui rappelle celui de 2012, quand le ministre de l'Intérieur d'alors était monté au créneau pour défendre la corrida quelques heures avant l'examen par le Conseil constitutionnel d'un recours présenté par deux associations anti-tauromachie.
Une sortie qui lui avait à l'époque valu les foudres de nombreux opposants à la « torture animale », Brigitte Bardot en tête. L'actrice s'était alors insurgée, dans une lettre ouverte à la garde des Sceaux Christiane Taubira, qu'un « lobby gouvernemental », emmené par un « afficionado catalan », «empêche tout débat démocratique en bloquant les initiatives parlementaires visant à abolir la corrida ». Initiative qui avait poussé l'hôte de Matignon à sommer ses ministres de se tenir à l'écart des arènes et de leurs spectacles tauromachiques durant l'été 2014. •

Une remarquable chronique de Jérôme Leroy, écrivain et rédacteur en chef culture de Causeur.
 On réédite un Michel Déon pour l’été. C’est toujours une bonne idée de rééditer un Déon, surtout avec un joli bandeau de Loustal. Déon nous rappelle l’époque, pas si lointaine, où le succès public n’était pas forcément contradictoire avec la qualité littéraire. Et comme tout allait ensemble, cela donnait de très bons films quand on adaptait au cinéma un roman de Déon: Un taxi mauve de Boisset avec Noiret, Rampling, Fred Astaire et l’Irlande dans le rôle principal, vous vous souvenez? En plus, il y avait quelque chose de plaisant à voir un cinéaste de gauche adapter un écrivain de droite. Si vous voulez trouver l’équivalent aujourd’hui, vous pouvez toujours chercher. Le goût vécu comme manière de dépasser les clivages politiques, c’est une idée qui a dû mourir à l’orée des années 80, la décennie où tout le monde est devenu très moral tout en choisissant le pognon et la réussite comme valeurs cardinales.
On réédite un Michel Déon pour l’été. C’est toujours une bonne idée de rééditer un Déon, surtout avec un joli bandeau de Loustal. Déon nous rappelle l’époque, pas si lointaine, où le succès public n’était pas forcément contradictoire avec la qualité littéraire. Et comme tout allait ensemble, cela donnait de très bons films quand on adaptait au cinéma un roman de Déon: Un taxi mauve de Boisset avec Noiret, Rampling, Fred Astaire et l’Irlande dans le rôle principal, vous vous souvenez? En plus, il y avait quelque chose de plaisant à voir un cinéaste de gauche adapter un écrivain de droite. Si vous voulez trouver l’équivalent aujourd’hui, vous pouvez toujours chercher. Le goût vécu comme manière de dépasser les clivages politiques, c’est une idée qui a dû mourir à l’orée des années 80, la décennie où tout le monde est devenu très moral tout en choisissant le pognon et la réussite comme valeurs cardinales.
Les gens de la nuit, à l’origine, est un roman de 1958. Longtemps, sa première phrase nous a hantés, nous qui sommes insomniaques comme pas deux: «Cette année-là, je cessai de dormir. » C’est ce qui donne ce caractère d’hallucination précise au livre qui se déroule pour l’essentiel entre le coucher du soleil et l’aube ; dans le périmètre de Saint-Germain-des-Prés, celui que continuent à rechercher les touristes des années 2010 alors qu’il est devenu un continent disparu aussi improbable que l’Atlantide.
Le narrateur des Gens de la Nuit a trente ans. c’est un fils de bonne famille: la preuve, son père va être élu à l’Académie Française. Cela fait un peu ricaner le fils. Michel Déon, dans la préface qu’il donne pour l’occasion, se moque gentiment de son propre revirement sous l’habit vert.
Le fils sort de trois ans de Légion et pour s’occuper fait un métier tout neuf. Avec deux amis, il a monté ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui une agence de com’. Dans les années 50, on disait relations publiques. Son activité consiste surtout à promener des clients étrangers dans le « gay paris ». C’est ennuyeux mais ça le distrait d’un chagrin d’amour, un vrai chagrin d’amour, celui qui vous dévaste et vous transforme en fantôme de vous-même.
Comme chez tous les gens pudiques, le narrateur en souffre d’autant plus qu’il en parle peu et seulement à lui-même. On retrouve là, si vous voulez, cette esthétique éminemment française de la retenue qui commence avec Madame de Lafayette et s’arrête avec les Hussards dont Michel Déon fut un éminent représentant. Depuis, on hurle, on pleure, on éructe, on se lamente, dans le roman comme ailleurs, ce qui est encore plus fatigant, à la longue, que de passer ses nuits de bar en bar et de manger des pieds de porcs à l’aube du côté des Halles.
Pour s’occuper le narrateur fait des rencontres dans les caves de jazz et les bistrots ouverts très tard. Il a une liaison avec Gisèle qui est comme lui un oiseau de nuit, mais du genre bohème. Elle vit à l’hôtel avec Maggy, elle porte des pantalons fuseaux, elle aime faire l’amour et à l’occasion, quand elle n’a pas de papier pour prendre une adresse, elle remonte son chandail pour qu’on écrive sur sa peau nue.
On n’est pas très loin de l’Occupation, non plus. Le narrateur devient l’ami d’un peintre très doué qui ne veut plus peindre et qui est un ancien de la Légion Charlemagne puis il sauve de la bastonnade une étudiante communiste, Noire de surcroît. Il se débarrasse avec l’aide du peintre du buste de son aïeul qu’il trouve aussi pompeux que son père dans le bois de Boulogne et il découvre que le peintre et l’étudiante sont amants.
Bref, il fait un peu n’importe quoi, ses amis aussi, mais ce n’importe quoi enchante. Extrait d’un dialogue avec l’étudiante communiste:
« - C’est merveilleux, dit-elle, je ne pensais pas que nous étions si bien organisés. Il y a longtemps que tu surveilles le coin?
- J’y arrivais à la minute. Et pourquoi me tutoyez vous?
- Tu n’es pas un camarade?
Elle s’était rejetée contre la portière, le regard soudain dur.
- Non.
- Alors pourquoi m’avoir tirée de là?
- Pour rien. Pour le plaisir. Pour l’honneur. »
La dernière réplique pourrait faire une belle devise, comme celle du Prince de Ligne
qui avait répondu, quand on lui demandait les raisons de son exil au moment de l’Empire: « L’honneur. L’humeur. L’horreur. »
Ce qui est amusant, en plus, avec le recul, c’est que l’on s’aperçoit que dans ces années-là, et dans les mêmes parages bistrotiers, les personnages des Gens de la Nuit auraient pu croiser la bande de Debord et des premiers situs qui dérivaient sur le mode « psychogéographique » afin de réenchanter la ville. Ainsi, cette scène où le peintre fait découvrir au narrateur à l’aube le ballet purement gratuit des arroseuses municipales devant l’Hôtel de Ville avant qu’elles ne se mettent au travail.
Pour le reste, est-il utile de savoir que le narrateur guérira de son chagrin d’amour un peu à la manière de Swann ou de Frédéric Moreau, que le comportement erratique et angoissé de nombre de personnages est dû à la « poudre » qui fait son apparition dans Paris et qu’il y a du roman noir dans Les gens de la nuit ?
Sans doute, mais le plaisir donné par ce roman est ailleurs, dans quelque chose qui ne vieillit pas, qui ne vieillira jamais et qui s’appelle la mélancolie : « Nous ne sommes pas nombreux à connaître ses secrets, pas nombreux mais inguérissables. »
Les gens de la nuit de Michel Déon (édition revue et corrigée, La Table Ronde) 5,93 €

C’est au cœur des Corbières, région de l’ancienne hérésie cathare, qu’une très vieille abbaye reprend vie. Voyage à la découverte de Lagrasse et de ses coriaces chanoines.
Quand on parvient à Lagrasse, on est mis en condition. Sur l’autoroute, on aperçoit l’impressionnante cité de Carcassonne entourée de ses fiers remparts, érigés à la demande de saint Louis au XIIIe siècle et restaurés par Viollet-le-Duc six cents ans plus tard. Puis on emprunte la voie des Corbières, antichambre des montagnes pyrénéennes, avec ses petites vallées encaissées, ses versants brûlés par le soleil en été et, partout, ses vieilles bâtisses en pierres jaunies qui respirent l’histoire. Un peu plus loin, ce sont les châteaux cathares, forteresses exceptionnelles qui semblent tout droit sorties des pics rocheux sur lesquelles elles ont été construites. Dans ce beau pays sauvage et séditieux qui a vu surgir l’hérésie cathare vers 1200 ou encore la célèbre révolte fiscale des vignerons en 1907, se trouve un havre de paix : Lagrasse. Comme beaucoup d’autres villages de la région, la commune peut se targuer de protéger des maisons du XIVe et du XVe siècle classées aux Monuments historiques, un vieux pont dont les soubassements datent de 1300 ou encore une halle de marché initialement aménagée en 1315. Mais le village dispose d’un plus unique : une abbaye dynamique qui rayonne sur toute la région.
Partir de zéro
L’abbaye de Lagrasse, c’est 35 chanoines au service de la vie monastique et de l’apostolat. C’est un lieu de retraite et de méditation théologique, mais aussi une zone de production avec ses vergers qui rendent le monastère relativement autosuffisant. C’est une vieille aventure, débutée au VIIIe siècle au moins (voir notre encadré) et relancée en 2004, lorsque les Chanoines réguliers de la Mère de Dieu, qui suivent la règle de saint Augustin, s’installent dans ses murs. à l’époque, l’endroit n’avait plus été habité depuis quinze ans et tout était à refaire. « Il n’y avait pas d’eau courante, les circuits électriques étaient délabrés et les toitures fuyaient », se souvient l’un des habitants de Lagrasse. Animés par la foi et la volonté, les chanoines s’attellent à la tâche mais ils passent leur premier hiver sans chauffage. Leur histoire se répand dans toute la France et les dons affluent. Des entreprises comme Lafarge livrent du ciment à l’abbaye. Contemplatifs et célébrants, les abbés se font aussi ouvriers. Quand les réfections sont trop spécialisées, des entreprises locales sont mandatées. Des bénévoles aident quand ils le peuvent à refaire la vieille toiture en tuiles. L’abbaye reprend vie.
Un département pas content
Dès 2006, le prieuré peut accueillir des retraitants. Et les chanoines peuvent enfin manger au chaud – et en silence – dans l’immense salle de réfectoire, au son de la lecture des Actes des Apôtres, de textes philosophiques du XXe siècle ou de réflexions relevées dans des journaux comme… Politique magazine ! Dans la région, ces premières années sont marquées par le retour d’une population curieuse, qui se prend à apprécier la messe chantée à Lagrasse. L’office public est aujourd’hui assuré tous les jours. Très demandés, les chanoines parcourent le pays, de pèlerinages en vacances « scouts ». On les retrouve avec des familles sur les sables du Mont Saint-Michel ou avec des jeunes catholiques sur les pentes enneigées des Alpes. Tout le monde est content… ou presque. Car la revivification de Lagrasse n’est pas acceptée par des cénacles locaux. « A notre arrivée, nous n’avons pas été très bien vus par certaines autorités », souffle calmement le père Théophane. à la mairie de Lagrasse, on a plutôt tendance à se féliciter de la dynamisation inespérée de la commune. Mais au conseil départemental très socialiste de l’Aude, propriétaire d’une partie des murs depuis décembre 2004, on grince des dents. Et on joue à faire concurrence à l’activité monacale par murs interposés. Inexistant sur les lieux à l’arrivée des chanoines, le département a par la suite entrepris de vastes travaux destinés à recevoir du public pour des visites guidées dans la partie lui appartenant. Il a également installé un « café littéraire » et une librairie au nom évocateur : « Le nom de l’homme ». Dans le pays de la croisade papale contre le catharisme, on cherche aujourd’hui à contrarier les paisibles Chanoines réguliers de la Mère de Dieu… Tout un symbole. Mais la sauce a du mal à prendre. Les jeunes ne se pressent pas aux dites « discussions philosophiques » organisées par le département tandis que les moines n’hésitent pas à faire découvrir le christianisme aux touristes, trop heureux d’apprendre que l’abbaye respire encore. Les chanoines ont décidément la peau dure… •
L’histoire de l’abbaye de Lagrasse ? Si vous voulez la lire, cliquez sur Lire la suite.
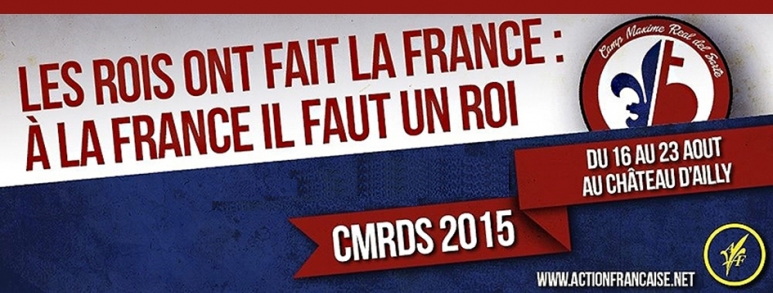
Le Camp Maxime Real del Sarte 2015 (16 - 23 août) est une université d’été d’Action française, surtout destinée à la formation de jeunes Français soucieux de l'avenir de leur pays.
A travers les générations, l'A.F. n’a jamais cessé de remplir cette fonction. L’on serait en effet étonnés si l’on dressait la liste des personnalités du monde politique, économique, littéraire ou médiatique d’aujourd’hui qui y sont passées, et qui, même si elles ont parfois gagné d’autres rivages, y ont forgé des liens, des amitiés et des convictions restés toujours vivaces.
La réflexion précède l’action mais aussi elle s’en nourrit et c’est de leur perpétuelle interaction que naissent les œuvres du long terme. L’Action française, dans sa meilleure tradition, a, ainsi, toujours su tout à la fois maintenir sa ligne fondatrice et l’actualiser suivant les réalités de chaque époque, de même que ses méthodes d’action.
Ainsi, après le colloque du 9 mai dernier, dont le thème, heureusement formulé était Dessine-moi un roi, le Camp Maxime Real del Sarte 2015 s'est logiquement donné pour sujet : Les rois ont fait la France, à la France il faut un roi.
Les jeunes qui s’y réuniront cette année seront invités à combiner étude, réflexion, sport, détente et un grand fond d'amitié. Il leur faudra, sans-doute, beaucoup de lucidité et de courage pour affronter les difficultés du monde qui vient. Il faut les leur souhaiter. •

Le Camp Maxime Real del Sarte 2014

Madone de Bruges ou Vierge et l'Enfant, statue en marbre réalisée par Michel-Ange vers 1501-1504
A l'heure où, pour les chrétiens ...
« La mortelle au regard divin triomphe des déesses sans regard.»
André Malraux, discours de Washington à l'occasion du prêt de la Joconde. Le 9 janvier 1963

Après la survenue des déclarations surprise d'Emmanuel Macron, paraît maintenant cette chronique de Maxime Tandonnet, de droite quant à lui et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et voici du même coup relancé ce qui aura été le débat de cet été - que Le Figaro résume en titrant : « La France, République ou monarchie ? ». Débat ouvert par Emmanuel Macron début juillet et que Péroncel-Hugoz a caractérisé de façon simple : « Soudain le mot magique de « Roi » est réapparu comme une grosse pierre jetée dans la mare politique parisienne… Il a suffi de quelques propos du plus en vue des ministres socialistes actuels… » Maxime Tandonnet réitère ce geste, un mois plus tard. La droite n'est désormais plus en reste dans la remise en cause du régime républicain. Et voici de nouveau le mot magique de « Roi » qui réapparaît dans la mare politique parisienne… L'ensemble est d'importance. Il sera temps d'y revenir. LFAR
Alors que l'on fête les trois cents ans de la mort de Louis XIV, Maxime Tandonnet estime que la France souffre de n'avoir pas su choisir entre République et monarchie.
 Ailleurs en Europe, de ce que je vois ou entends dire, la vie politique ne donne pas ce sentiment de vaudeville, d'impuissance et de prétention tournant au ridicule, qui se dégage de la situation en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, par exemple, la vie publique fonctionne, tourne plus ou moins bien mais avance, des décisions sont prises, des choix parfois douloureux accomplis, un gouvernement existe. Les citoyens n'éprouvent pas cette sensation d'une fuite des dirigeants dans l'imposture de la communication à outrance, les polémiques, les manipulations, postures, mises en scène dans la seule perspective de la préservation ou de la conquête des postes.
Ailleurs en Europe, de ce que je vois ou entends dire, la vie politique ne donne pas ce sentiment de vaudeville, d'impuissance et de prétention tournant au ridicule, qui se dégage de la situation en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, par exemple, la vie publique fonctionne, tourne plus ou moins bien mais avance, des décisions sont prises, des choix parfois douloureux accomplis, un gouvernement existe. Les citoyens n'éprouvent pas cette sensation d'une fuite des dirigeants dans l'imposture de la communication à outrance, les polémiques, les manipulations, postures, mises en scène dans la seule perspective de la préservation ou de la conquête des postes.
La France souffrirait-elle de n'avoir pas choisi entre République et Monarchie ?
La République idéale confie le pouvoir aux citoyens. Elle a été définie dans la Constitution de 1793, restée lettre-morte. Ce texte, rédigé par les Girondins, mérite d'être relu. Il rejette la personnalisation ou l'accaparement durable du pouvoir. Celui-ci est impersonnel au sens où il n'existe pas de détenteur nominatif permanent de l'autorité (une exception est possible en période de crise). Le seul souverain est le peuple. Toutes les décisions importantes sont prises par référendum populaire. Des assemblées de citoyens dans les quartiers effectuent les choix locaux. Les députés sont élus pour un an renouvelable, donc sous le contrôle étroit des citoyens. Le pouvoir exécutif est responsable devant les citoyens qui peuvent destituer les ministres par une pétition. « La France n'a jamais eu qu'une bonne Constitution, celle de 1793, qui malheureusement n'a jamais été appliquée » a pu dire un professeur de droit public. Utopique ? Sans doute en partie, mais l'esprit de ce texte est intéressant.
La Monarchie constitutionnelle est aussi une possibilité. Après tout, nous sommes un pays européen et plusieurs grandes nations européennes de tradition démocratique sont des monarchies : le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique… Ce n'est pas un régime honteux dès lors que la réalité du pouvoir au quotidien incombe à une assemblée élue au suffrage universel et un Premier ministre responsable devant elle. Une famille incarne la continuité nationale. Un souverain héréditaire est placé au sommet de l'Etat, même s'il n'est pas en charge de l'exercice du pouvoir au quotidien, sa mission étant avant tout symbolique. Cette formule à l'avantage d'éviter le basculement de la vie publique dans la frénésie mégalomaniaque : la place au sommet est déjà occupée, quoi qu'il arrive et elle n'est donc plus à prendre…
La France a un système hybride, ni République, ni monarchie. Elle n'est pas une République, au sens de la Constitution de 1793, dans la mesure où sa vie publique échappe aux citoyens et à la recherche du bien commun pour devenir l'otage des calculs carriéristes et narcissiques d'une poignée d'individus qui l'ont ainsi confisquée. Mais elle n'est pas non plus une monarchie car ces personnages sont en concurrence permanente, ce qui vaut au pays une surenchère dans la démagogie et l'imposture. En outre, faute d'un roi incontesté - qu'il soit le peuple souverain ou le monarque héréditaire - des roitelets ou postulants roitelets, médiocres sur le plan humain comme intellectuel, sont animés avant tout par une vanité aveugle, et non par des sentiments d'honneur et de dévouement au bien commun.
L'ère du général de Gaulle a permis de masquer ces contradictions pendant une décennie. Lui bénéficiait d'une légitimité historique, issue du 18 juin 1940, lui conférant un statut particulier de personnage de l'histoire, comme il en vient un tous les deux siècles. Mais lui une fois parti, ce système bancal ne pouvait que sombrer dans le chaos et la comédie grotesque qui devient un monstrueux boulet pour notre pays. •
Maxime Tandonnet décrypte chaque semaine l'exercice de l'État pour FigaroVox. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Histoire des présidents de la République, Perrin, 2013. Son dernier livre Au coeur du Volcan, carnet de l'Élysée est paru en août 2014. Découvrez également ses chroniques sur son blog.

A comparer, rapprocher du propos que Maxime Tandonnet vient de publier sur le même grand sujet :
Le 9 juillet
Décidément, nous aurons tout lu, tout vu, tout entendu ces temps-ci ! La voie est libre !
Le 10 juillet
Le 16 juillet
Le 20 juillet
Le réalisme commande le Roi [François Marcilhac]
Le 27 juillet
Royaliste, Emmanuel Macron ? Ce qu'en pense Bertrand Renouvin
Le 10 août
Un royaliste dans le gouvernement français [Péroncel-Hugoz]
Bonne lecture ! •

Par Christian Combaz*
Christian Combaz juge que l'opération préservatifs « merci pour ce moment » lancée par les jeunes Républicains qui font la tournée des plages, illustre que la démocratie en ce moment ne vole pas très haut. Il a raison. Sauf que « en ce moment » nous paraît un peu restrictif et exagérément optimiste ou, si l'on préfère, trop indulgent pour les périodes précédentes. Et ce depuis fort longtemps ...
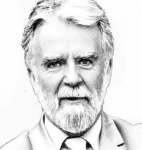 La distribution de préservatifs par une formation politique, quel que soit le slogan imprimé sur le sachet, entrera dans les manuels d'histoire comme un symptôme de la médiocrité démocratique au temps de la publicité triomphante, c'est à dire dans les dernières années de la Cinquième république.
La distribution de préservatifs par une formation politique, quel que soit le slogan imprimé sur le sachet, entrera dans les manuels d'histoire comme un symptôme de la médiocrité démocratique au temps de la publicité triomphante, c'est à dire dans les dernières années de la Cinquième république.
Pour commencer, le mot de caravane appliqué à ce genre de distribution sur les plages rappelle ces arrivées du tour de France où les bannières du Conseil général se mélangent à celles du supermarché local au milieu d'une procession de 2CV Cochonou, de chars Pneus Kléber et de camions Vittel. L'habitude est de lancer de menus cadeaux le long du parcours afin d'infantiliser la foule, tous âges confondus, à travers une course effrénée au «truc gratuit», course dont les préservatifs républicains ne sont même pas l'objet puisqu'on trouve leur équivalent partout dans les boîtes de nuit.
Ensuite il faut croire que si l'intérêt de la gratuité ne joue pas, c'est donc le message qui est censé attirer le passant. Et là quand on lit, d'un œil navré, les explications des responsables de l'opération on s'aperçoit que le message est inexistant. Il s'agit d'attirer l'attention en affirmant que le projet politique est original, tout en utilisant des moyens éculés pour le faire. Il est probable que s'il y avait eu, au sein de l'équipe qui a imaginé cette campagne, deux ou trois vieux routiers de la propagande , ils auraient sonné le tocsin en affirmant que tout cela ne volait pas assez haut, mais personne ne les a invités pour éviter de l'entendre. Pendant la réunion, l'un d'entre eux aurait souligné que distribuer des préservatifs au nom d'un parti, c'est associer à son message l'idée de stérilité, d'absence de fécondité. A quoi l'un des jeunes aurait sans doute répondu: «peut-être, mais il y a aussi là-dedans l'idée de convivialité, de fête, de plaisir!». Le vieux aurait conclu: « de plaisir sans lendemain, c'est bien ce que je dis ».
Difficile de ne pas lui donner raison.
Finalement cette opération dont les auteurs se justifient piteusement aujourd'hui en rappelant qu'elle n'est pas la première, et qu'ils avaient fait la même chose il y a dix ans, tend à prouver que la tolérance à la sottise recule, alors que la sottise ne cesse de gagner du terrain. Du coup, ceux dont la patience est excédée chaque jour par ce genre d'initiatives finissent dans une sorte de faux-plafond de la politique où ils restent invisibles aux instituts de sondage jusqu'à ce que le faux-plafond s'effondre un soir d'élections. •
* Christian Combaz est écrivain et essayiste, auteur des Gens de Campagnol (Flammarion). Son prochain livre, Les Ames douces, paraîtra aux éditions Télémaque à la rentrée. Lire également ses chroniques sur son blog.

C'est un fait important que Gabriel Robin signale judicieusement dans un billet pour Boulevard Voltaire : selon un sondage Eurobaromètre, les Européens estiment, désormais, que l’immigration est le problème numéro 1 auquel ils sont confrontés. Et c’est un sujet de conflit supplémentaire, un fossé de plus, entre l'idéologie européo-mondialiste qui prévaut à Bruxelles en matière d'immigration - souhaitée, encouragée, présentée comme positive - et ce qu'en pensent les peuples eux-mêmes de plus en plus fortement. Cette conjonction des opinions européennes finira-t-elle par produire une sorte de politique migratoire unitaire, une réaction coordonnée au phénomène migratoire ou, au contraire, sera-ce du chacun pour soi ? Ou, pire encore, les peuples européens, comme on commence à le voir, vont-ils s'opposer pour la répartition de la charge des contingents d'arrivants dont ils ne veulent plus ? Ce peut être le tout ensemble. La France, quant à elle, n'a pas de politique de l'immigration. Ni de doctrine, ni de discours sur l'immigration. Elle ne fait qu'y réagir par des mesures ponctuelles. Des mesures de circonstance, la plupart du temps pelliculaires et souvent contradictoires. Or, sans une politique de l'immigration de grande ampleur, à la hauteur des mouvements migratoires de notre époque, qui ne font peut-être que commencer, la société française, en la matière comme en d'autres, va droit dans le mur. LFAR
 L’an dernier, au moins d’août, Le Figaro révélait l’existence d’une note confidentielle de la police aux frontières, alertant sur l’entrée en France, par la frontière italienne, de nombreux immigrés illégaux originaires d’Érythrée. Les services de la police aux frontières, le préfet des Alpes-Maritimes et des responsables locaux de la gendarmerie, des douanes ou de la SNCF avaient alors tenu une réunion exceptionnelle. Leur conclusion était sans appel : le flux de l’immigration clandestine devenait insoutenable pour la France et l’Italie (entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, 61.951 migrants irréguliers avaient débarqué en Italie, quand ils n’étaient « que » 7.913 en 2013).
L’an dernier, au moins d’août, Le Figaro révélait l’existence d’une note confidentielle de la police aux frontières, alertant sur l’entrée en France, par la frontière italienne, de nombreux immigrés illégaux originaires d’Érythrée. Les services de la police aux frontières, le préfet des Alpes-Maritimes et des responsables locaux de la gendarmerie, des douanes ou de la SNCF avaient alors tenu une réunion exceptionnelle. Leur conclusion était sans appel : le flux de l’immigration clandestine devenait insoutenable pour la France et l’Italie (entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, 61.951 migrants irréguliers avaient débarqué en Italie, quand ils n’étaient « que » 7.913 en 2013).
Où en sommes-nous un an après ? Rien n’a changé. La situation s’est même aggravée. Le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour régler ce problème gravissime et, osons le dire, ce fléau qui met en péril l’avenir des Français. Au contraire, le gouvernement a multiplié les mesures pour aspirer l’immigration, notamment en passant une loi accordant des privilèges exorbitants aux étrangers, lesquels bénéficiaient pourtant déjà des largesses d’un système très accommodant.
C’en est presque désespérant. Récemment, Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris, disait tout haut ce que François Hollande pense tout bas : « La vague migratoire subsaharienne va s’intensifier dans les mois à venir, je demande la réquisition des bâtiments vides. Nous n’envisageons pas d’expulsion, même si les locaux ne sont pas adaptés. » En somme, la mairie de Paris appliquera la préférence étrangère. Etudiants, familles pauvres et travailleurs précaires : perdez vos papiers et déclarez-vous « migrants » ! Ainsi, peut-être, bénéficierez-vous d’une aide de la mairie de Paris pour vous loger dans cette ville hors de prix. Bruno Julliard s’apparente à Jean-Claude Juncker : privilégier le peuple revient, pour eux, à s’abandonner à la « pensée populiste ».
Nos dirigeants gouvernent à rebours des aspirations populaires et s’en font une fierté. Parfois, les débats politico-médiatiques sur cette question fondamentale semblent n’opposer que des immigrationnistes acharnés à des immigrationnistes forcenés. Le phénomène migratoire n’est présenté que sous un angle mensonger et sentimentaliste. Le peuple n’est néanmoins pas aveugle, il n’a pas besoin de sociologues et de statisticiens pour constater les conséquences dramatiques qu’entraîne cet exode africain vers l’Europe. Selon un sondage Eurobaromètre, les Européens estiment, désormais, que l’immigration est le problème numéro 1 auquel ils sont confrontés. C’est une première. C’est logique. C’est heureux.
Quelques esprits avisés semblent désormais sortir de leur torpeur et emprunter le chemin du « bon sens populaire ». C’est le cas, par exemple, de Jean-Pierre Chevènement, qui a récemment déclaré dans la presse : « La menace pour l’Europe n’est pas à l’Est, mais au Sud. » Oui, la menace qui pèse sur l’Europe, et au premier chef sur la France, est celle de l’invasion migratoire. Il faut avoir le courage de le dire, et de le répéter sans cesse. •
Gabriel Robin - Boulevard Voltaire

Au cœur de la traque, dans la campagne picarde, après la tuerie à Charlie Hebdo
Nous n'avons malheureusement rien à changer à ce que nous avons publié le 8 janvier 2014 au matin :
« Quand on laisse entrer chez soi, en un laps de temps relativement court, des millions d’immigrés venus d’un autre continent, nés d’une civilisation radicalement différente, guidés par les mirages d’un niveau de vie que leur misère originelle rend terriblement attrayants et qui n’ont que peu de sens et de respect de ce que sont les mœurs, les lois, les traditions du pays où ils arrivent, quand on en a soi-même largement perdu l’amour et la pratique, il n’ya pas de quoi être étonnés des troubles et des violences qui se produisent inéluctablement. C’est la première réflexion qui nous vient à l’esprit après les évènements tragiques d’hier, à Paris. Il y a longtemps, ici, en effet, que nous mettons en garde contre la politique d’immigration de la France, devenue plus périlleuse encore du fait de la crise économique et du laxisme de nos gouvernants. Du fait, aussi, d’un certain nombre de nos erreurs - de graves erreurs - en matière de politique étrangère. Il y a longtemps que nous signalons à quel point notre République vit sur une poudrière et qu’il peut arriver un temps où le travail de nos services de sécurité ne suffira plus à empêcher la multiplication des violences et des attentats. Ce temps est peut-être arrivé et il ne faut pas manquer d’en rechercher les causes, d’en marquer les responsabilités. Certes, tous les musulmans de France ne sont pas des terroristes. Loin de là. Nombre d’entre eux sont probablement en voie d’intégration. Et le réalisme devrait conduire, si nous en sommes capables, à les y aider, à les y encourager. Mais les risques de l’immigration massive demeurent ; elle est un terreau porteur de terribles dangers. Et, en tout cas, tous les terroristes qui menacent aujourd’hui la France le font au nom de l’Islam. » •
Lafautearousseau
8 janvier 2014
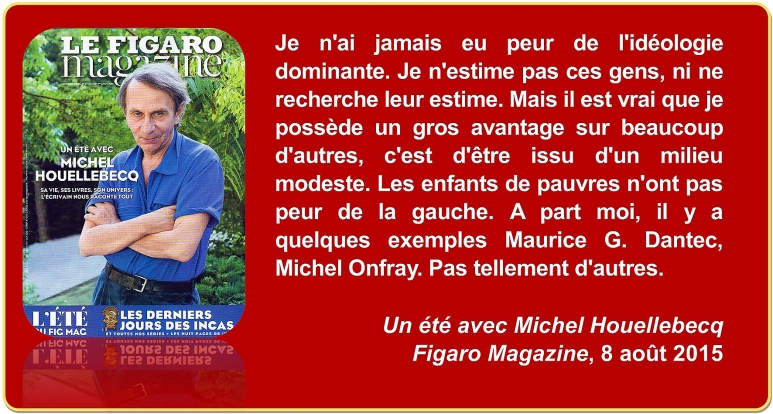
Cliquer ici pour lire

 « Nous rejetons l'universalisme du modèle occidental et affirmons la pluralité des civilisations et des cultures. Pour nous, les droits de l'homme, la démocratie libérale, le libéralisme économique et le capitalisme sont seulement des valeurs occidentales, en aucun cas des valeurs universelles. » L'homme qui a prononcé ces mots est Alexandre Douguine, intellectuel néo-eurasiste de la droite radicale russe, dans un entretien accordé à la revue Politique internationale en 2014. Au fil des années, il s'est lié d'amitié avec un certain nombre de dignitaires du Kremlin et de la Douma. Depuis le déclenchement de la crise ukrainienne, il est omniprésent dans les médias, appelant ni plus ni moins à « la prise de Kiev » et à la guerre frontale avec l'Ukraine. « L'Ukraine de l'Est sera russe », assure-t-il. Contrairement à ce qu'affirment certains intellectuels anti-Poutine en France (Bernard-Henri Lévy notamment), Douguine n'est pas « le penseur de Poutine », la relation directe entre les deux hommes étant difficile à établir. Cependant, force est de constater qu'on retrouve, dans certains discours du président russe, une même vision du monde qui est celle d'un monde multipolaire, où la dimension cardinale est la souveraineté nationale et où « universalisme » est l'autre mot pour désigner l'ambition hégémonique occidentale.
« Nous rejetons l'universalisme du modèle occidental et affirmons la pluralité des civilisations et des cultures. Pour nous, les droits de l'homme, la démocratie libérale, le libéralisme économique et le capitalisme sont seulement des valeurs occidentales, en aucun cas des valeurs universelles. » L'homme qui a prononcé ces mots est Alexandre Douguine, intellectuel néo-eurasiste de la droite radicale russe, dans un entretien accordé à la revue Politique internationale en 2014. Au fil des années, il s'est lié d'amitié avec un certain nombre de dignitaires du Kremlin et de la Douma. Depuis le déclenchement de la crise ukrainienne, il est omniprésent dans les médias, appelant ni plus ni moins à « la prise de Kiev » et à la guerre frontale avec l'Ukraine. « L'Ukraine de l'Est sera russe », assure-t-il. Contrairement à ce qu'affirment certains intellectuels anti-Poutine en France (Bernard-Henri Lévy notamment), Douguine n'est pas « le penseur de Poutine », la relation directe entre les deux hommes étant difficile à établir. Cependant, force est de constater qu'on retrouve, dans certains discours du président russe, une même vision du monde qui est celle d'un monde multipolaire, où la dimension cardinale est la souveraineté nationale et où « universalisme » est l'autre mot pour désigner l'ambition hégémonique occidentale.
On peut reprocher beaucoup de choses à Vladimir Poutine, mais il y a une chose qu'il est difficile de lui contester, c'est son intelligence et l'imprégnation qu'il a de la culture et de l'âme russes.D'un côté la démocratie libérale et universaliste ; De l'autre, la nation souveraine et traditionaliste. En cela, nous dit Hubert Védrine dans le dernier numéro du
magazine Society consacré à Poutine, il se distingue très nettement de ses homologues européens : « C'est un gars [sic] très méditatif, qui a énormément lu. Vous ne pouvez pas dire ça d'un dirigeant européen aujourd'hui. Il y a une densité chez Poutine qui n'existe plus chez les hommes politiques. » Dans un discours absolument fondamental d'octobre 2014 devant le Club Valdaï, réunion annuelle où experts, intellectuels et décideurs viennent parler de sujets liés à la Russie, Poutine a brillamment exposé
l'essentiel de sa doctrine. Morceaux choisis : « La recherche de solutions globales s'est souvent transformée en une tentative d'imposer ses propres recettes universelles. La notion même de souveraineté nationale est devenue une valeur relative pour la plupart des pays » ; « Un diktat unilatéral et le fait d'imposer ses propres modèles aux autres produisent le résultat inverse. Au lieu de régler les conflits, cela conduit à leur escalade ; à la place d'Etats souverains et stables, nous voyons la propagation croissante du chaos ». Difficile de ne pas voir l'influence, même indirecte, d'Alexandre Douguine dans un tel discours. Poutine situe son combat contre l'Occident non pas sur la seule question ukrainienne, mais sur quelque chose de bien plus fondamental et décisif. Poutine et l'Occident, ce sont deux visions du monde irréconciliables qui s'affrontent, la démocratie libérale et universaliste, d'un côté, face à la nation souveraine et traditionaliste, de l'autre.
La différence entre Douguine et Poutine est cependant de taille. Là où le premier défend une vision idéologique et quasi eschatologique de la mission russe - « La crise ukrainienne n'est qu'un petit épisode d'une confrontation très complexe entre un monde unipolaire et multipolaire, entre la thalassocratie [civilisation de la mer, l'Amérique] et la tellurocratie [la civilisation de la terre, la Russie] », Libération du 27 avril 2014 -, le second reste un homme d'Etat pragmatique qui sait qu'on gagne d'abord les batailles par l'habileté dans la négociation et la recherche de compromis politiques. Là où Douguine rejette en bloc le libéralisme, Poutine y voit, notamment dans sa dimension économique, un moyen d'accroître la prospérité de la Russie. Raison de plus, pour l'Europe, d'éviter l'escalade et d'adopter une diplomatie un peu plus indépendante des Etats-Unis vis-à-vis de la Russie. Dans le cas contraire, la prophétie de Douguine d'un nouveau « choc des civilisations » risque fort de se réaliser. •

Le point de vue de Philippe Bilger
Très finement psychologique, l'analyse de Philippe Bilger nous paraît parfaitement pertinente. Notamment lorsqu'il pointe en conclusion le comportement du Chef de l'Etat lui-même. Sa fonction n'est pas remplie et c'est au fond, sous un angle plus politique, plus institutionnel, ce que constate aussi Emmanuel Macron, curieusement son ministre de l'Economie. Nous faisons cordialement observer à Philippe Bilger que Macron, lui, en désigne la cause, lorsqu'il dit qu'il manque un Roi. Peut-être Philippe Bilger, comme bien d'autres ces temps-ci, voudra-t-il bien y réfléchir ? LFAR
 Il y a un climat général, politique, médiatique, et des attitudes qui laissent, en effet, penser qu’il y a de l’enfance attardée dans notre démocratie. Je ne méconnais pas, cependant, le caractère artificiel de quelques rapprochements mais ils me semblent tout de même révélateurs d’une tonalité dominante.
Il y a un climat général, politique, médiatique, et des attitudes qui laissent, en effet, penser qu’il y a de l’enfance attardée dans notre démocratie. Je ne méconnais pas, cependant, le caractère artificiel de quelques rapprochements mais ils me semblent tout de même révélateurs d’une tonalité dominante.
On entend souvent des humoristes se plaindre, parfois drôlement, du fait que des politiques empiétant de plus en plus sur leur domaine, ils allaient, eux, être obligés de faire de la politique. Derrière la boutade, il y a l’intuition que la dérision et la futilité sont devenues si également réparties qu’en réalité, on ne peut plus départager les activités et que toutes sont gangrenées par une démission de l’intelligence, théorisée en conquête du rire et en apothéose du sarcasme.
Par exemple, ce Petit Journal qu’on vante tant et qui, paraît-il, sera même amplifié – Vincent Bolloré s’est arrêté à mi-chemin ! -, offre cette particularité d’être insupportable à cause du ton autosatisfait de son présentateur et de dénoncer des ridicules dans lesquels il tombe lui-même avec la mise en pièces facile et démagogique d’un monde politique résumé à des séquences caricaturales.
Et il me semble qu’il a fait école, tant le culte de la superficialité et la chasse forcenée à la gravité ont dépassé les frontières qui auraient dû les enfermer.
Ainsi les réactions qui, à droite, ont accueilli, après la mort du maire de Dijon, le choix de François Rebsamen de prendre sa relève avec pour conséquence, à une date encore indéterminée, l’abandon du ministère du Travail si important en cette période où le chômage ne baisse pas et où le président de la République, pour amuser la galerie, prétend lier son sort à la réduction de ce fléau social (Le Figaro).
J’admets, certes, que l’opposition a ses contraintes et qu’elle ne peut se permettre d’user de répliques tellement châtiées qu’elles effaceraient la contradiction, mais on avait le droit d’attendre autre chose que ces railleries, ces plaisanteries, ces puérilités comme s’il ne s’agissait que « d’un casse-tête » pour le pouvoir et non d’une tragédie nationale à partager, à gauche et à droite, par tous. J’ai été effaré par la médiocrité rigolarde de cette riposte et par sa nature, pourtant, tristement partisane et politicienne.
De grands enfants qui s’ébattent et pour lesquels la politique offre le prétexte à des débordements qui fuient les comportements adultes comme la peste.
Venons-en, pour finir, au président de la République lui-même, dont ce n’est pas la première fois que je remarque l’appétence pour la pédagogie souriante et basique. Il adore retomber en adolescence et, pour le responsable qu’il est, c’est véritablement du prépubère !
Ce n’est pas un « capitaine de pédalo » mais une forme de scoutisme à la mode politique : donc à peu près rien par rapport au destin de la France.
Je ne pensais pas qu’un jour je serais contraint de contredire Jacques Brel pour lequel « il faut bien du talent pour être vieux sans être adulte ». •
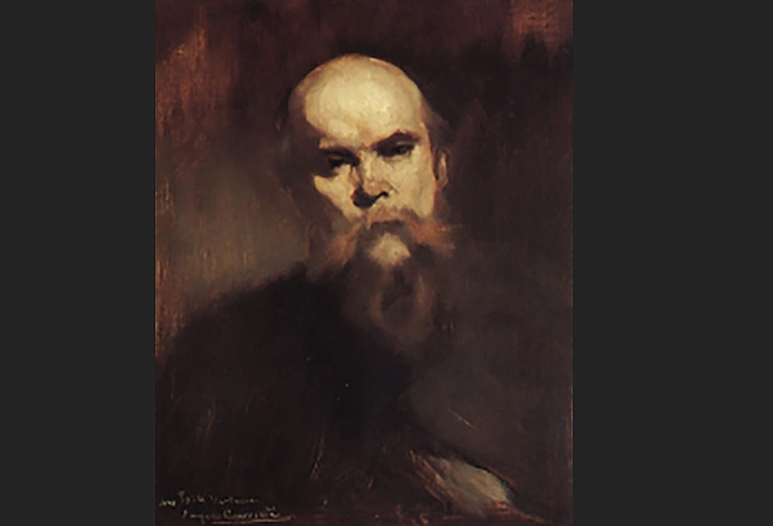
Philippe Bilger peint notre République sous les traits d'une « ado attardée ». Une République qu'il nomme aussi prépubère. Nous ne le contredirons pas. Il a raison.
Verlaine, lui, l'avait vue au contraire déchue, en immonde vieillarde lui inspirant un terrible sonnet qui insulte Marianne dans des termes fort gaillards, comme seul un poète y est autorisé. Poème, en effet, antirépublicain à l'extrême.
« Ado attardée », République prépubère ou immonde vieillarde ? On peut sans-doute l'envisager sous l'un ou l'autre aspect.
Voici, en tout cas, la vision de Paul Verlaine. Iconoclaste, il est vrai, mais dont l'auteur n'en est pas moins l'un des plus grands poètes français. •
Buste pour mairies
Marianne est très vieille et court sur ses cent ans,
Et comme dans sa fleur ce fut une gaillarde,
Buvant, aimant, moulue aux nuits de corps de garde,
La voici radoteuse, au poil rare, et sans dents.
La bonne fille, après ce siècle d’accidents,
A déchu dans l’horreur d’une immonde vieillarde
Qui veut qu’on la reluque et non qu’on la regarde,
Lasse, hélas ! d’hommes, mais prête comme au bon temps.
Juvénal y perdrait son latin, Saint-Lazare
Son appareil sans pair et son personnel rare,
A guérir l’hystérique égorgeuse des Rois.
Elle a tout, rogne, teigne… et le reste et la gale !
Qu’on la pende pour voir un peu dinguer en croix
Sa vie horizontale et sa mort verticale.
Paul Verlaine, sonnet, Invectives, Buste pour mairies (1881)