Une humeur d'Alexandra Laignel-Lavastine, dans Figarovox
Il s'agit, en effet, d'une humeur, d'un coup de gueule, sur lequel on peut discuter. L'ensemble comme le détail nous paraissent très bien vus. On a aussi parfois l'impression de quelque démesure, mais il s'agit d'un coup de gueule. Après l'attaque terroriste contrée du Thalys, Alexandra Laignel-Lavastine estime que les autorités d'Europe ne prennent pas les mesures adéquates pour enrayer le phénomène djihadiste. Mais de quelles autorités européennes pourraient-elles bien venir ? il n'y a aucune chance que ce soit du côté des Institutions Européennes : elles sont immigrationnistes. Pourrait-il y avoir un réveil, une coordination, une conscience commune des peuples européens face à la menace djihadiste et se pourrait-il qu'alors des mesures adéquates soient enfin prises ? A notre sens, ce ne pourrait être que par les Etats, sous la pression de la menace, de son extension, de ses violences et, du coup, des opinions publiques. Ce qui n'interdirait ni aux Etats, ni aux opinions européennes de se coordonner. LFAR
Ayoub El Khazzani, le sinistre individu qui a bien failli provoquer un bain de sang dans le Thalys Amsterdam-Paris ce vendredi 21 août — n'eût été le courage de trois jeunes Américains, dont deux militaires chevronnés —, fêtera ses 26 ans le 3 septembre. Encore « un enfant perdu du djihad » victime du racisme, de l'exclusion et de l'islamophobie ?
Probable. D'ici quelques jours, il est à parier que nous verrons fleurir quelques fines « analyses » de ce genre. Dans l'effrayant climat de déni bien-pensant qui continue d'entourer l'ampleur du danger islamiste en Europe — car c'est un fait, l'ennemi est désormais intérieur autant qu'extérieur —, rappelons en effet que la plupart de nos journaux se complaisaient, il y a encore un an, à reprendre en chœur cet euphémisme rassurant. Pieuse sidération. Un « enfant perdu », c'est mignon, cela suscite la bienveillance et la compassion. Et l'endormissement des consciences au passage, de quoi prolonger l'interminable sieste européenne. Du reste, un grand quotidien a choisi de traiter ce « fait divers » (?) en « société » et non dans ses pages internationales. Comme si nous n'avions pas affaire à un fléau désormais planétaire ; comme si Ayoub El Khazzani ne revenait pas de Syrie ; comme si quelque 10 000 jeunes musulmans d'Europe n'étaient pas désormais concernés par le djihadisme ; et comme si leurs mentors leur conseillaient à leur retour d'aller à la plage (encore que depuis la tuerie de Sousse…), au lieu de commettre des attentats contre un Occident honni et mécréant — aurait-on déjà oublié le décapité de l'Isère de la fin juin ?
Et dans une semaine? On ne voit aucune raison pour que nos belles âmes n'accordent pas le statut de « victime » à ce terroriste-là aussi, muni d'une kalachnikov, de neuf chargeurs bien garnis, d'un pistolet automatique Luger, d'un chargeur neuf mm et d'un cutter, un fanatique prêt, autrement dit, à assassiner des centaines de passagers. Une « victime » ? Cela ne fera aucun doute puisque l'homme, un ressortissant marocain doté d'une carte de séjour lui permettant de se déplacer librement en Europe, appartient à la catégorie « damné-de-la-terre », humilié par une Europe intrinsèquement coupable et post-coloniale. Ne demandons plus à nos bigots « progressistes » et définitivement aveugles — ceux que certains intellectuels d'origine musulmane laïcs et démocrates n'hésitent plus à qualifier de « collabos face aux islamistes » —, d'entrouvrir un œil et de mettre leur montre à l'heure. Plus leur sens moral se perd, plus leur catéchisme binaire se révèle obsolète, plus ils s'y enferrent. Leur cas est désespéré, mais leur capacité de nuisance intacte. On l'a vu au lendemain des tueries de janvier 2015 à Paris : voilà déjà que quelques semaines plus tard, il ne s'agissait déjà plus de combattre l'islamisme radical, mais le « laïcisme radical » (Todd) ou encore, sur Médiapart, « le triomphe du Parti de l'ordre » (le plan Vigipirate…). Car, cela va de soi, les bourreaux étaient en vérité les victimes (des discriminations et de la haine des Noirs et des Arabes) et les victimes de Charlie ou de la supérette casher des bourreaux : les premiers avaient offusqué les musulmans avec leurs caricatures du Prophète et les Juifs faisant leurs courses un vendredi après-midi devaient être les suppôts d'un Etat « nazi », à savoir Israël…
C'est dire si la maladie française et européenne est profonde. À se demander si elle n'est pas devenue incurable.
En outre, est-on bien certain que les droits de l'homme auront été respectés dans ce que l'on appellera bientôt « l'affaire du Thalys » — la menace terroriste la plus grave à laquelle l'Europe fait face depuis le 11 septembre 2001, selon Europol —, comme on parle désormais de « l'affaire Merah » pour désigner (et banaliser) un massacre d'enfants juifs ? À la réflexion, se précipiter sur le terroriste afin de le neutraliser et même, pour ce faire, le rouer de coups et le mettre torse nu comme à Abou Graib, n'est-ce pas extrêmement vilain ? Circonstance aggravante : c'est pour l'essentiel à deux jeunes soldats américains hyper-entraînés, au sang-froid remarquable, que l'on doit d'avoir évité un carnage étant donné la persistante nullité des services de sécurité européens. A-t-on par ailleurs conscience de l'extraordinaire professionnalisme requis pour immobiliser un homme surarmé dans un wagon bondé ? Mais non. Les Américains, on les connaît. Et de surcroît, ces deux-là revenaient d'Afghanistan: des « impérialistes » donc, des « terroristes » selon le livre de Noam Chomsky qui s'étale dans toutes nos librairies et, bien entendu, d'abominables « racistes ». Les mêmes âmes vertueuses qui, au mois de mai, s'insurgeaient contre la loi sur le Renseignement enfin votée par les députés français — une loi naturellement « liberticide » —, se pencheront à n'en pas douter, confortablement installés dans leur fauteuil et leur lâcheté, sur cette grave question.
Enfin, mais là inutile de parier tant la chose est courue d'avance, nous verrons ressurgir d'ici quelques jours l'inénarrable « loup solitaire » faute d'être capable d'appeler un chat un chat. Cette notion totalement absurde, nous lui vouons une affection toute particulière. Absurde, car si les nouveaux barbares peuvent passer à l'acte individuellement, ils y sont incités par leurs mentors tueurs et violeurs de masse de Syrie ou d'Irak, sans parler de la meute enragée qui se trouve de l'autre côté de leur écran. Qu'à cela ne tienne, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui semble particulièrement mal conseillé, nous l'avait ressorti lors de la tuerie perpétrée par Mehdi Nemmouche au Musée juif de Bruxelles en mai 2014 (quatre morts). Il faudra attendre le mois de novembre et la découverte tardive de Daech (L'Etat islamique) après la trêve estivale, pour que le premier flic de France se résigne enfin à parler « de terrorisme en libre accès sur Internet »… On aurait alors pu espérer que le « loup solitaire » allait définitivement rentrer dans sa tanière pour ne plus jamais pointer son museau. On avait tort : il a fait un retour triomphal sur les écrans de iTV comme de BMF TV à la fin juin 2015, après les crimes islamistes de l'Isère et de Tunisie.
Il est vrai que notre ministre de l'Intérieur n'en rate pas une. Au lendemain de la tuerie antisémite de Bruxelles, il avait ainsi déclaré — sans rire —, que le salafiste français de 29 ans avait été « neutralisé dès son retour en France ». À moins que Marseille (où il fut arrêté à la descente d'un bus) ne se soit miraculeusement transplanté, pour l'occasion, sur la frontière franco-belge… Cette fois, le voilà qui nous explique, toute honte bue, que le tueur du Thalys, un ressortissant marocain, avait été signalé par les autorités espagnoles (qui l'avaient repéré pour « des discours durs légitimant le djihad dans des mosquées d'Algesiras ») aux services de renseignement français en février 2014. Que depuis, la DGSI avait émis une fiche « S » à son encontre « afin de pouvoir le repérer dans le cas de son éventuelle venue sur le territoire national ». Très drôle. Une source de l'antiterrorisme espagnol a en effet déclaré à l'AFP que l'islamiste avait déménagé dans l'Hexagone après mars 2014, et après avoir quitté l'Espagne (où il résidait depuis sept ans et où il était également connu pour trafic de drogues). Mais respect des « droits humains » oblige, on l'avait gardé parmi nous. À ce stade, Madrid prévient Paris, mais l'individu n'est pas localisé. Encore un exploit. Le 10 mai dernier, c'est cette fois au tour des services allemands d'alerter leurs homologues français sur le fait qu'El Khazzani, qui se promenait entre temps en Belgique, était sur le point de quitter Berlin pour s'envoler vers Istanbul. Il ne sera toujours pas arrêté. Si ce tableau reste encore flou, une source de l'antiterrorisme espagnol affirme c'est une fois en France que ce terroriste fiché « S » (pour Sûreté de l'Etat) est parti faire le djihad en Syrie avant de rentrer tout aussi tranquillement dans l'Hexagone. Sans être inquiété.
Le ministre de l'Intérieur se sent-il vaguement concerné ? Aurait-il la conscience un peu lourde ? A-t-il songé à remettre sa démission au chef du gouvernement ? Après autant de bourdes, ce serait pourtant la moindre des choses.
Comment comprendre une telle faillite de la part de nos services ? « Nous ne laisserons plus rien passer », proclamaient à l'envi nos responsables politiques après Charlie en même temps qu'ils annonçaient toute une série de mesures, dont une coopération renforcée entre services européens et une surveillance renforcée des milieux fondamentalistes. Des mesures dont on se demandait par quelle aberration elles n'avaient pas été prises depuis belle lurette… Et à quoi bon un plan Vigipirate et des milliers de militaires français déployés sur le territoire national si c'est pour refuser de placer des portiques de sécurité et des agents bien formés à l'entrée des trains, des métros, des lieux publics, des salles de spectacles, des musées ? Car oui, nous en sommes là, il serait grand temps d'avoir le courage de le dire et de se le dire calmement à nous-mêmes. Et il faut n'avoir jamais vu des victimes déchiquetées par une bombe pour estimer que ce type de désagrément serait tout à fait intolérable aux Européens gâtés par le sort que nous sommes. De fait, notre ministre, décidément farceur, a choisi de mettre en place un numéro vert pour « signaler les situations anormales » sur notre réseau ferroviaire — on croit rêver.
Mais ce n'est pas tout. Car à quoi bon des soldats patrouillant dans nos rues et nos gares quand on sait qu'ils ne disposent que d'un fusil d'assaut, leur Famas, dont l'usage est rigoureusement impossible sans risquer d'atteindre au passage des dizaines de civils, que ce soit dans les couloirs du métro, dans une gare ou sur la promenade des Anglais à Nice ? Ce dispositif est dissuasif, rien de plus. Y compris à son niveau le plus écarlate. Et l'irresponsabilité de nos dirigeants patente. Il est temps de mettre les pieds dans le plat, d'autant qu'il s'agit là d'un secret de Polichinelle et que les terroristes, eux, n'en ignorent rien. Sait-on par ailleurs que ces mêmes soldats républicains ne cessent de réclamer à leur hiérarchie des armes de poing pour pouvoir défendre comme il conviendrait leurs concitoyens en cas d'attaque et neutraliser les éventuels agresseurs ? En vain. Trop cher, paraît-il. La France n'aurait pas le budget. Seuls ceux qui se lient d'amitié avec l'armurier de leur régiment parviennent, plus ou moins en douce, à se procurer, avec la complicité de celui-ci, un pistolet de façon à répliquer, le cas échéant, de façon efficace et adaptée.
Sait-on enfin que si un islamiste armé d'un cutter ou d'un couteau se précipite pour s'attaquer à l'un de nos jeunes militaires, garçon ou fille — cela est plusieurs fois arrivé —, son binôme est tenu de répliquer de manière « proportionnée» . Il est autrement dit censé courir vers son camarade pour s'en prendre à l'agresseur… à l'arme blanche ! Problème : il y a de fortes chances pour que son collègue soit déjà à terre, la gorge tranchée. Qu'attend au juste le ministère de la Défense pour réviser ce protocole scandaleusement daté et hors de saison ? Une mutinerie ? On se perd en conjectures. Et pour le reste, rendez-vous à la prochaine tuerie ?
Se pourrait-il qu'après ce nouvel attentat du Thalys, déjoué de justesse à l'instar de dizaines d'autres en France depuis janvier 2015, les gouvernements européens envisagent enfin de se rendre au réel et de sortir de leur somnambulisme ? Pour l'heure, ils ne se lassent manifestement pas d'avoir un train de retard. Enfin si l'on ose dire désormais… •

Alexandra Laignel-Lavastine, philosophe et historienne, a publié en mai 2015 La Pensée égarée. Islamisme, populisme, antisémitisme: essai sur les penchants suicidaires de l'Europe (Grasset, 220 pages, 18 €).

 Alain Vidalies, Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, aurait, si l'on en croit les réactions indignées d'un certain nombre de ses pairs, levé un gros poisson. L'un de ceux qui pourrissent par la tête. Il a, en effet, osé parler de contrôles discriminatoires, et partant, aux yeux des chevaliers blancs du camp du Bien, rappelant « les heures les plus sombres de notre Histoire ». Qu'un représentant officiel de la gauche gouvernante prononce un mot qui relève du vocabulaire néo-fasciste, suffit à répandre l'indignation.
Alain Vidalies, Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, aurait, si l'on en croit les réactions indignées d'un certain nombre de ses pairs, levé un gros poisson. L'un de ceux qui pourrissent par la tête. Il a, en effet, osé parler de contrôles discriminatoires, et partant, aux yeux des chevaliers blancs du camp du Bien, rappelant « les heures les plus sombres de notre Histoire ». Qu'un représentant officiel de la gauche gouvernante prononce un mot qui relève du vocabulaire néo-fasciste, suffit à répandre l'indignation.

 «
« 




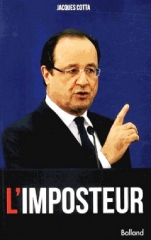 Quinze jours après le début de ce débat Outre-Manche, le président de la République française a déclaré, sans l’ombre d’un doute ni même d’une hésitation qu’il « continuerait » à baisser les impôts des Français en 2016… ajoutant, dans un premier temps, « si la croissance le permet ». Dans la présentation que les médias ont faite de son intervention, il n’est nulle part question d’imposture… et pourtant !
Quinze jours après le début de ce débat Outre-Manche, le président de la République française a déclaré, sans l’ombre d’un doute ni même d’une hésitation qu’il « continuerait » à baisser les impôts des Français en 2016… ajoutant, dans un premier temps, « si la croissance le permet ». Dans la présentation que les médias ont faite de son intervention, il n’est nulle part question d’imposture… et pourtant !


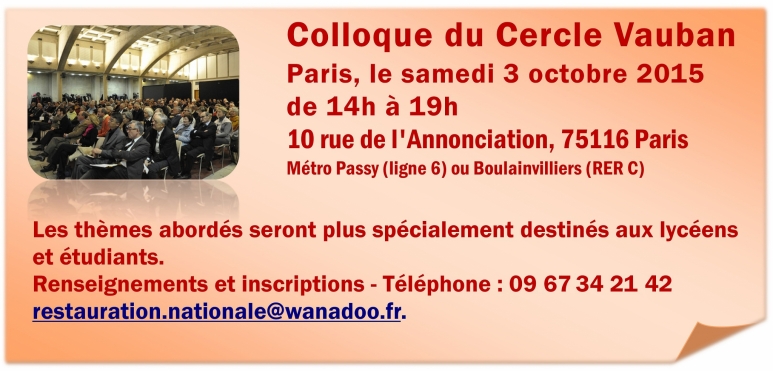


 Le lecteur me pardonnera, je l'espère, de lui assombrir ces belles journées d'été. Au-delà du drame humain qui se joue à Tianjin, je voudrais livrer quelques réflexions sur les conséquences du krach boursier qui frappe l'ensemble des marchés chinois depuis le mois d'avril. En l'espace de quelques semaines, ce sont près de 4 000 milliards de dollars de valeur qui sont partis en fumée. Comme pour l'heure cette déroute boursière est circonscrite à la Chine, et que, de surcroît, le régime communiste abreuve la terre entière de communiqués lénifiants pour assurer que la situation est sous contrôle, personne n'y prête plus grande attention, surtout dans la torpeur de l'été. Pire que cela, certains groupes occidentaux continuent même d'investir massivement en Chine.
Le lecteur me pardonnera, je l'espère, de lui assombrir ces belles journées d'été. Au-delà du drame humain qui se joue à Tianjin, je voudrais livrer quelques réflexions sur les conséquences du krach boursier qui frappe l'ensemble des marchés chinois depuis le mois d'avril. En l'espace de quelques semaines, ce sont près de 4 000 milliards de dollars de valeur qui sont partis en fumée. Comme pour l'heure cette déroute boursière est circonscrite à la Chine, et que, de surcroît, le régime communiste abreuve la terre entière de communiqués lénifiants pour assurer que la situation est sous contrôle, personne n'y prête plus grande attention, surtout dans la torpeur de l'été. Pire que cela, certains groupes occidentaux continuent même d'investir massivement en Chine.
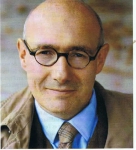 Pour Frédéric Rouvillois*, la probable installation d'une résidence hôtelière sur le domaine peut être un moyen astucieux de sauver des bâtiments en déshérence. Selon lui, « la muséification systématique du patrimoine a quelque chose de glaçant ».
Pour Frédéric Rouvillois*, la probable installation d'une résidence hôtelière sur le domaine peut être un moyen astucieux de sauver des bâtiments en déshérence. Selon lui, « la muséification systématique du patrimoine a quelque chose de glaçant ».
