Entretien par Jean-Baptiste d'Albaret
Déclin irréversible ou mutation en profondeur ? Dans un livre dont la riche iconographie donne à voir la multiplicité de ses visages, Jean Sévillia dresse le portrait d’une France catholique (Michel Lafon) héritière de deux mille ans d’histoire.
Parler du catholicisme aujourd’hui, c’est d’abord poser le constat d’une déchristianisation d’une nature inédite. Comment expliquez-vous un tel effondrement de la foi et des vocations religieuses ?
« L’homme moderne vit comme si Dieu n’existait pas », disait Jean-Paul II. Les causes de la crise spirituelle de l’Occident sont nombreuses. Pour la France, je retiens surtout la cause sociologique avec le passage, au xixe siècle, d’une civilisation rurale, socle populaire de l’Eglise de France pendant des siècles, à une civilisation urbaine au monde ouvrier très vite déchristianisé. Mais ce constat doit immédiatement être nuancé car, paradoxalement, c’est aujourd’hui dans les villes que l’Eglise se reconstruit. A Paris, à Lille, à Lyon, à Nantes, à Toulouse, un noyau actif de paroisses vivantes redonne au catholicisme français un dynamisme certain tandis qu’il continue de décroître dans les campagnes qui deviennent un véritable désert spirituel. Dans moins de dix ans, certains diocèses n’auront plus que dix prêtres en âge d’être en activité !
L’Eglise de France n’échappera pas à une réforme profonde de son organisation ecclésiale en tenant compte de ces nouvelles caractéristiques : elle est aujourd’hui moins populaire et plus citadine.
On entend souvent dire que l’Eglise de France manque de moyens…
Comparée à son homologue allemande et à ses 5 milliards d’euros de budget, elle paraît en effet presque misérable : 700 millions de budget, c’est peu ! Pour autant, taraudée par des questions existentielles et fragilisée par un nombre de vocations famélique, l’Eglise allemande est confrontée à de graves problèmes que la France semble avoir surmonté. La mobilisation contre le mariage homosexuel, même si elle se voulait aconfessionnelle, l’a suffisamment démontré : chez nous, les catholiques sont présents dans les débats de société.
Certes, la loi n’a pas été abrogée, mais les Manif pour tous ont soulevé un certain nombre de questions fondamentales qui travaillent désormais en profondeur l’ensemble de la société. Surprise ! à force d’entendre parler du déclin de la pratique religieuse, on avait fini par croire que le catholicisme français était en voie de disparition…
Ce qui est loin d’être le cas si on en croit votre livre…
Un certain discours médiatique fait tout ce qu’il peut pour effacer la dimension catholique de notre histoire et de notre culture. Mais malgré une conception de la laïcité particulièrement agressive à son égard, malgré le « fait musulman » qui tend à accaparer les esprits, le substrat chrétien de notre pays est encore solide. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil à la toponymie française… Et si les catholiques se sont longtemps auto-persuadés qu’ils étaient minoritaires, le fait est que 56 % des Français se réclament de cette confession. Il y a aujourd’hui 44 millions de baptisés en France, les deux tiers de la population. J’appelle cela une majorité ! Certes, beaucoup ne mettent jamais les pieds à la messe. Mais avec 3 millions de pratiquants réguliers et 10 millions de pratiquants occasionnels, les catholiques n’en constituent pas moins la première minorité religieuse du pays.
Peut-on dresser un portrait-robot du catholique français du XXIe siècle ?
Les travaux sociologiques menés sur le sujet témoignent d’une multiplicité de profils avec toute sorte de nuances intermédiaires. Mis à part le catholique d’éducation, peu ou pas pratiquant et modérément en phase avec le discours de l’Eglise, je pense pour ma part qu’il est possible de distinguer trois grandes catégories de catholiques.
La première regroupe les pratiquants irréguliers ou occasionnels, attentifs aux propos du pape mais revendiquant un point de vue critique et une liberté de conscience vis-à-vis du magistère. Ceux-là votent parfois à gauche mais plus souvent au centre ou à droite. Deuxième catégorie : une grosse minorité, vieillissante, qui a vécu dans sa jeunesse le concile Vatican II et son espérance d’un printemps de l’Eglise avec passion. Encore très présente dans les paroisses, cette génération décline cependant rapidement. Politiquement, elle penche plutôt à gauche. La troisième catégorie forme un noyau dur de fidèles totalement engagés dans l’Eglise de France. On l’a longtemps qualifiée de « génération Jean-Paul II » mais, en réalité, elle rassemble aujourd’hui au moins trois générations Jean-Paul II et une génération Benoît XVI. Celle-là regarde à droite ou préfère s’abstenir par défiance envers le personnel politique. à cette troisième catégorie peuvent être agrégés des profils aux sensibilités particulières, comme les charismatiques et les traditionnalistes.
Quelles sont les différences fondamentales entre ces deux dernières catégories de catholiques pratiquants ?
La première privilégie le rôle des laïcs dans l’Eglise : pour elle compte avant tout l’engagement social des chrétiens – terme qu’elle préfère à celui de catholique – et le dialogue avec le monde. La deuxième aborde sa foi comme une source spirituelle pouvant éventuellement conduire à un engagement temporel à condition qu’il soit en phase avec le discours de l’Eglise et de la papauté. L’une, pénétrée de la notion de « peuple de Dieu », se réclame de « l’enfouissement dans le monde » ; l’autre, pour qui la foi est une réalité prégnante de la vie personnelle, affiche sans complexe son catholicisme.
Il semble cependant que le temps a apaisé les conflits nés des évolutions internes que l’Eglise a connues depuis la guerre et les années 60. Êtes-vous sûr que cette catégorisation entre « progressistes » et « conservateurs », pour parler simplement, ait encore une consistance ?
Elle s’observe toujours, surtout dans les paroisses rurales. Mais, vous avez raison, les différences ont tendance à s’estomper. Le drame de la génération Vatican II, c’est que ses enfants ne vont plus à la messe et que ses petits-enfants ne sont même plus baptisés… Elle n’a pas su léguer un héritage. à côté de cette génération vieillissante et sans postérité, la génération dite « Jean-Paul II » a, au contraire, engendré une jeunesse qui tend à réaffirmer sa spécificité catholique, notamment au travers d’une pratique religieuse très importante. Une étude a montré que parmi les 50 000 jeunes français participant aux JMJ de Madrid en 2011, 6 % disaient aller à la messe… tous les jours ! C’est un pourcentage considérable, presque inimaginable même pour un catholique convaincu qui a eu 20 ans dans les années 70… L’avenir semble donc être à une Eglise plus resserrée et plus homogène : certes, des sensibilités différentes y cohabitent, mais de façon beaucoup moins conflictuelle qu’autrefois.
Vous insistez sur le poids et l’importance des communautés nouvelles. Est-ce particulier à la France ?
L’expression « communautés nouvelles » n’a plus tellement de sens dès lors que certaines d’entre elles ont plus de quarante ans d’ancienneté. Issues pour la plupart d’entre elles du Renouveau charismatique apparu en France à la fin des années 60, elles ont su enrichir l’Eglise de leur spiritualité propre. Un chiffre pour dire leur poids : depuis 1975, un million de personnes sont passées par les sessions de formation organisées par l’Emmanuel à Paray-le-Monial ! Toutes ces communautés ont aujourd’hui une présence internationale mais c’est en France qu’elles sont nées.
Et les traditionalistes ?
Le mouvement traditionaliste est également né en France où son influence est réelle. Il n’y a pas d’équivalent dans d’autres pays du pèlerinage de Chartres – relancé en 1983 par l’association traditionaliste Notre-Dame de Chrétienté – dont on sait qu’un tiers seulement des pèlerins sont des fidèles du rite extraordinaire. De ce point de vue, le monde de la tradition est missionnaire. Sa force vient de son réseau de familles, jeunes et nombreuses.
Finalement, le tableau que vous dressez est globalement positif et invite à l’optimisme…
Au Vatican, on observe ce qui se passe en France avec beaucoup d’attention. Et pas seulement en raison du succès des mobilisations de 2013 pour la défense de la famille. Que ce soit dans les communautés charismatiques, chez les fidèles de la forme extraordinaire et, plus généralement, dans la jeunesse des paroisses nourrie par la prière et qui a soif de formation, beaucoup de signes d’un renouveau du catholicisme occidental proviennent de notre pays. De jeunes prêtres charismatiques et de jeunes intellectuels originaux font entendre leur voix. Et nous avons des familles nombreuses – phénomène spécifiquement français – pourvoyeuses de vocations. Bref, il y a là comme un petit miracle français : dans la grave et profonde crise spirituelle traversée par l’Occident, notre patrie reste fidèle à sa vocation de « fille aînée de l’Eglise ». •
La France catholique, de Jean Sévillia, Michel Lafon, 237 p., 29,95 euros.
Jean-Baptiste d'Albaret
Rédacteur en chef de Politique magazine

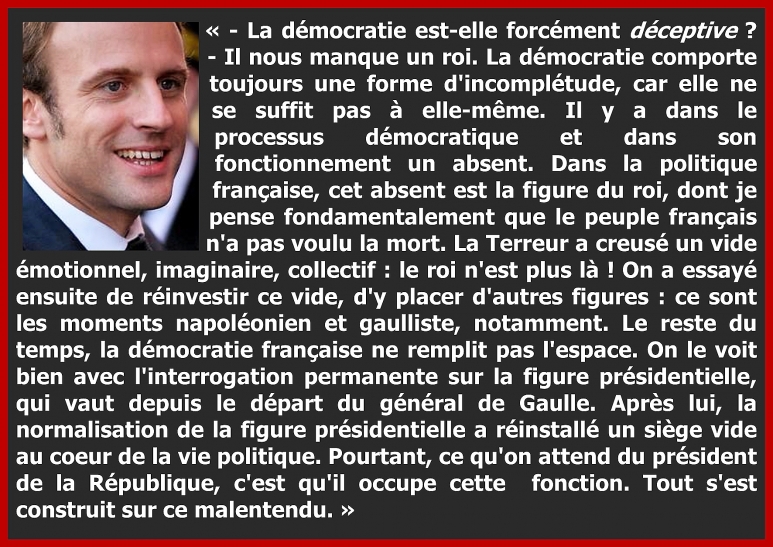







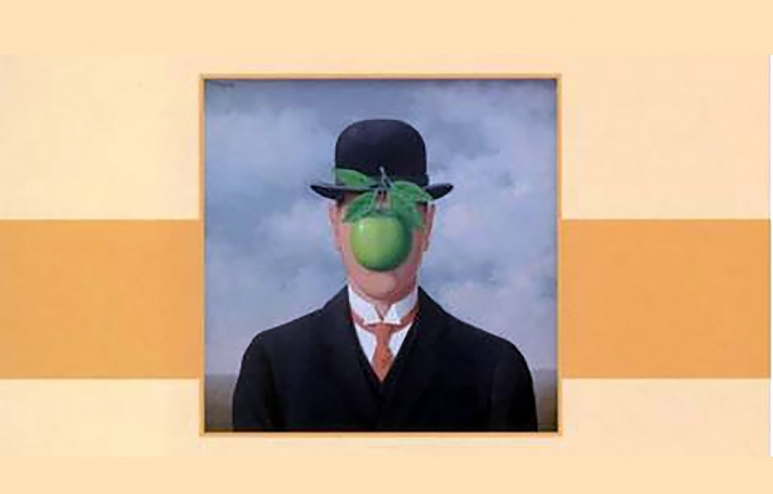
 Longtemps, pour moi, la Belgique d’abord a été une manière de province mentale, d’état d’esprit qui m’a révélé une certaine aptitude à la rêverie et même à la mélancolie. Cela a sans doute commencé avec les vignettes de certains albums d’Hergé, celles où justement on reconnaît des rues de villes belges. Elles ressemblent à des rues françaises et pourtant ce ne sont pas tout à fait les mêmes : l’uniforme des policiers, la couleur des boites postales, l’allure des magasins de quartiers. Ce décalage subtil me plongeait dans un ravissement légèrement anxieux. J’étais chez moi et j’étais ailleurs aussi, en même temps. J’étais belge sans le savoir, déjà.
Longtemps, pour moi, la Belgique d’abord a été une manière de province mentale, d’état d’esprit qui m’a révélé une certaine aptitude à la rêverie et même à la mélancolie. Cela a sans doute commencé avec les vignettes de certains albums d’Hergé, celles où justement on reconnaît des rues de villes belges. Elles ressemblent à des rues françaises et pourtant ce ne sont pas tout à fait les mêmes : l’uniforme des policiers, la couleur des boites postales, l’allure des magasins de quartiers. Ce décalage subtil me plongeait dans un ravissement légèrement anxieux. J’étais chez moi et j’étais ailleurs aussi, en même temps. J’étais belge sans le savoir, déjà.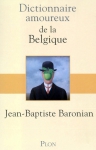

 Abder Phénix, voleur minable, ne croit en rien, sinon en l’immortalité que confère la gloire. Il rêve du gros coup qui ferait passer son nom à la postérité.
Abder Phénix, voleur minable, ne croit en rien, sinon en l’immortalité que confère la gloire. Il rêve du gros coup qui ferait passer son nom à la postérité.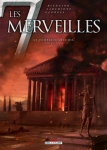
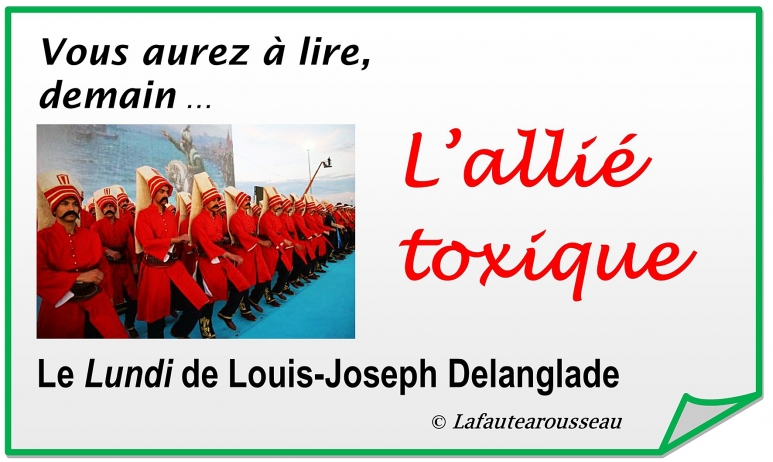



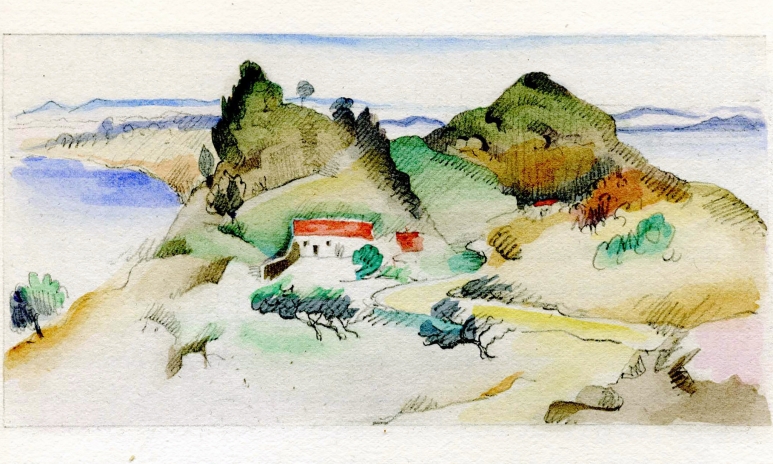

 Impossible de ne pas connaître leurs noms, leurs visages, leurs adresses, leurs habitudes, leurs vacances, les moindres méandres de leurs vies misérables. Les journaux leur consacrent des portraits à longueur de pages, avec interviews de la grand-mère et de l'ami d'enfance. On cite des textos de leur épouse restée en Syrie, toute fière de cette gloire soudaine. Les terroristes sont devenus des stars. Des stars du mal, mais des stars quand même. Malgré le travail de mémoire des réseaux sociaux, malgré la litanie du Président de la République dans la cour des Invalides, qui connaît l'identité de leurs victimes?
Impossible de ne pas connaître leurs noms, leurs visages, leurs adresses, leurs habitudes, leurs vacances, les moindres méandres de leurs vies misérables. Les journaux leur consacrent des portraits à longueur de pages, avec interviews de la grand-mère et de l'ami d'enfance. On cite des textos de leur épouse restée en Syrie, toute fière de cette gloire soudaine. Les terroristes sont devenus des stars. Des stars du mal, mais des stars quand même. Malgré le travail de mémoire des réseaux sociaux, malgré la litanie du Président de la République dans la cour des Invalides, qui connaît l'identité de leurs victimes?