Par Yves MOREL
Plus qu'aucune autre sans doute, l'actuelle campagne présidentielle met en pleine lumière l'hypocrisie de notre système politique.
L'Etat-PS cherche à se prolonger par la fausse alternative Macron
Considérons tout d'abord la situation singulière du candidat socialiste et la profonde division de son parti. Benoît Hamon — personnalité on ne peut plus insignifiante, soit dit au passage — a été élu en novembre dernier, par les adhérents et sympathisants du PS, candidat de ce dernier à l'élection présidentielle. Et ce, à la faveur d'une « primaire » expressément conçue pour permettre au bon peuple de gauche de désigner lui-même ce candidat, et qui obligeait les élus et les cadres du parti socialiste à soutenir ce candidat.
Or, à quoi assistons-nous ? A son lâchage général et sans vergogne par tous les caciques du PS, de Manuel Valls à Jean-Yves Le Driant en passant par Gérard Collomb, Bertrand Delanoé, et une palanquée d'autres, qui se rallient à Emmanuel Macron, dont ils supputent la victoire, en lequel ils voient le continuateur de leur politique, et dont ils espèrent obtenir quelque portefeuille ou autre gratification. Jamais on n'avait vu un candidat à l'élection présidentielle trahi par tous les notables de son parti, et ce au mépris de la base militante et du suffrage populaire. Les notables du PS nous donnent la preuve éclatante de leur mépris total du suffrage universel, théoriquement socle de la démocratie républicaine. Avec le plus profond cynisme, ils jettent aux orties leurs grands principes démocratiques et décident seuls, en fonction non de l'intérêt général, mais, en premier lieu de leurs intérêts de politiciens en quête de prébendes (ou soucieux de les conserver), en second lieu, de leurs propres conceptions de ce que doit être ou rester la France : une nation émasculée, puisqu'amputée officiellement de sa souveraineté et enchaînée à une Europe technobureaucratique néolibérale, mondialiste, multi-culturaliste, moralement décadente et pervertie, assise sur l'idéologie des droits de l'homme, de la femme et du mouflet. Et, dès lors que François Hollande ne peut ni ne souhaite solliciter le renouvellement de son mandat, et que Manuel Valls a été récusé par la base du PS, il ne reste d'autre solution que de se rabattre sur Emmanuel Macron, ex-socialiste, ex-ministre de l'Economie de Hollande, ex-cadre dirigeant de la banque Rotschild, pour continuer, avec quelques modifications, la politique du quinquennat qui s'achève.
La gauche, maîtresse absolue de la vie de la nation
Et là réside le secret (de Polichinelle, du reste) de notre république. Quoique théoriquement souverain, le peuple ne décide pas de son destin et ne choisit pas ses dirigeants. Ce sont la classe politique et les lobbies idéologiques, économiques et financiers, qui décident, et eux seuls. Ainsi que l'avait démontré Augustin Cochin, il y a un siècle, à propos des sociétés de pensée et des clubs révolutionnaires, le peuple n'intervient que pour approuver, pour plébisciter une politique conçue et décidée en dehors de lui, dont il ignore presque tout et à laquelle il ne comprend rien (et dont il est toujours — et fatalement — déçu). Cela n'est que trop connu, et aussi vieux que la démocratie elle-même.
Mais la présente campagne présidentielle présente une caractéristique nouvelle... et inquiétante. Il s'agit d'une évolution préoccupante, consistant dans le fait que la gauche — celle du PS, des lobbies, des clubs de réflexion et autres thinks tanks — interdit désormais toute alternance. A vrai dire, ce n'est pas aussi nouveau que cela, nous exagérons un peu. Car la gauche a toujours gouverné ce pays, fût-elle dans l'opposition. Elle a toujours imposé ses idées et ses réformes, même aux régimes et gouvernements de droite, et ce depuis la Révolution française. Les progrès de sa domination des esprits et de la vie politique ont été constants. Après la Révolution, les grandes étapes en ont été la IIe République (1848), l'Empire libéral (1866-1870), la conquête des institutions de la Ille République par les républicains (1879), la marginalisation définitive de la droite intellectuelle et politique à partir de 1945, la subversion morale de 1968, et la conquête du pouvoir par les socialistes (1981). Alors qu'elle se trouvait encore dans l'opposition, à la fin des années 70, la gauche affirmait haut et fort son intention de créer, une fois au pouvoir, « une situation irréversible », c'est-à-dire caractérisée par l'impossibilité, pour la droite, de revenir sur ses réformes et son oeuvre de subversion morale et sociale lorsqu'elle reconquerrait le pouvoir par la grâce du suffrage universel. Ce n'était pas là paroles en l'air. En effet, depuis 1981, aucun des présidents et gouvernements de droite que nous avons connus, ne sont revenus sur les « conquêtes » de la gauche, que ce soit en matière politique, économique et sociale. Sous peine de se voir vilipendée comme réactionnaire et confrontée à des manifestations quasi insurrectionnelles, la droite au pouvoir a dû renoncer à toutes ses velléités de mettre en oeuvre sa propre politique, et se résigner à conserver les « acquis » octroyés par ses adversaires, en raison de l' « effet cliquet » qui interdirait tout retour en arrière au nom des droits et des libertés garantis par la Constitution, droits et libertés ne pouvant évoluer que dans le sens d'une extension continue. C'est « l'effet cliquet » : une superstition fabriquée pour garantir les positions avancées de la gauche et tenir lieu d'alibi à toutes les lâchetés de la droite. Désormais, cette dernière n'était autorisée à revenir au pouvoir (le temps d'une législature, puis d'un quinquennat) que pour donner l'illusion d'une véritable possibilité de changement, pour donner à une gauche fatiguée et en difficulté le temps de pause nécessaire pour se mettre au vert et se requinquer, avant de revenir aux affaires. La droite devait se contenter de ce rôle de dupe et de faire-valoir démocratique qui la condamnait à l'inaction, à l'impuissance et à la défaite au nom de son adhésion aux « valeurs de la République », autrement dit aux valeurs de la gauche.
La présente campagne présidentielle nous donne l'occasion de vérifier l'exactitude de notre assertion. Pourquoi la gauche, à l'Elysée, à Matignon, à la Chancellerie, parmi les « poids lourds » du PS, dans les journaux et autres médias, au sein de l'intelligentsia, s'acharne-t-elle contre François Fillon, le candidat de « Les Républicains » à l'élection suprême ? Tout simplement parce que, tel qu'il se présente depuis sa campagne des « primaires » de novembre dernier, il apparaît comme celui qui entend rompre totalement avec l'orientation générale de gauche imprimée par le PS et ses satellites (PRG, EELV) à la politique française depuis 1981. Certes, il y a loin des paroles aux actes, des programmes à leur réalisation (c'est la règle, dans notre belle démocratie), et on peut gager qu'en cas de victoire en mai prochain, Fillon au pouvoir ne réalisera pas le tiers de son projet. Mais enfin, il se présente sous ce jour, et la gauche ne se sent pas rassurée car elle sait qu'il aura les coudées franches au Parlement (en cas de nette victoire), à défaut de les avoir dans la rue, et elle connaît sa détermination (attestée par ses passages aux Affaires sociales, à l'Education nationale et à Matignon). Elle redoute donc d'avoir non plus un faux adversaire en carton pâte, mais un ennemi résolu à défaire ce qu'elle a fait ; et sa réputation de conservateur catholique achève de nourrir l'inquiétude. Ce n'est pas qu'elle tienne absolument aux « conquêtes sociales » des « travailleurs » : elle-même n'a pas hésité à les rogner dans le passé (avec Bérégovoy) et plus récemment (avec Valls et la « loi Travail »). Mais elle s'estime seule qualifiée pour le faire, et elle entend le faire non suivant une orientation conservatrice, mais dans le cadre du mondialisme néolibéral et de son corollaire, la subversion des moeurs et de la société (loi Taubira, théorie du genre, réformes Vallaud-Belkacem en éducation).
Aussi s'emploie-t-elle à barrer la route de l'Elysée à FilIon. Et, puisque Hollande, Valls et consorts sont décriés et incapables de rester au pouvoir, et puisque, par ailleurs, Hamon ne convainc personne, elle jette son dévolu sur Macron, qui fut l'un de siens et qui apparaît comme le mieux à même de poursuivre sa politique. Si Macron n'avait pas existé, elle se serait doucement résignée à voir un Juppé entrer à l'Elysée ; ce dernier aurait géré mollement le pays sans écorner les acquis de la gauche ; mais les électeurs de droite lui ont préféré Fillon.
Ainsi donc, ce que nous montre cette campagne électorale, avec une lumière plus crue que d'habitude, avec une évidence criante, c'est que c'est la gauche qui commande, lors même qu'elle est discréditée dans l'opinion et désavouée par le suffrage universel. C'est elle, qui adoube ou tolère le candidat de la « droite républicaine » à la présidence de la République, conçu pour assurer un simple intérim.
L'illusion Le Pen
Mais, dira-t-on, quid de la probabilité de l'élection de Marine Le Pen ? Vétille ! La présidente du FN ne peut accéder au pouvoir : présente au second tour de la présidentielle, elle se briserait contre le mur d'airain du « front républicain ». Lors même qu'elle serait élue, le gouvernement qu'alors elle nommerait ne parviendrait jamais à réunir une majorité parlementaire pour le soutenir et voter ses lois.
Notre classe politique le sait, mais brandit l'épouvantail du « danger lepéniste », garant de la docilité de l'électorat. Les électeurs peuvent très théoriquement porter Marine Le Pen au pouvoir, mais celle-ci, à peine élue, serait frappée d'impuissance et contrainte à la démission.
Le procès de la République
En résumé, cette campagne présidentielle se présente comme aussi surréaliste et démentielle que cynique. Nos compatriotes vomissent Hollande, Valls et le PS, mais ils sont condamnés à l'avènement d'un président qui sera leur continuateur, et ce malgré la liberté du suffrage. Jamais la preuve de l'hypocrisie de notre système démocratique n'a été à ce point administrée. Du plombage de la candidature de Fillon à l'élection non certaine mais fort probable de Macron, tout, dans cette campagne, nous montre que ce n'est pas le peuple, théoriquement souverain, qui gouverne, mais la camarilla politicienne. Augustin Cochin, antirépublicain, l'avait compris il y a cent ans, et ses analyses furent confirmées, il y a quarante ans, par François Furet, républicain et homme du système, et par les très nombreux et convaincants éditoriaux d'Hilaire de Crémiers, dans Politique magazine. Cette campagne présidentielle, c'est le procès de la République. ■
Repris du n°48 de Restauration Nationale

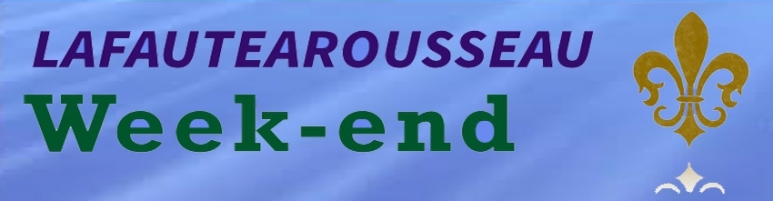



 Régis Debray s’avère un brillant pourfendeur du candidat d’En marche ! Emmanuel Macron. À l’occasion de la publication de son livre ce 4 mai, Civilisation – Comment nous sommes devenus américains (Gallimard), il commente l’actualité de l’élection présidentielle dans la presse.
Régis Debray s’avère un brillant pourfendeur du candidat d’En marche ! Emmanuel Macron. À l’occasion de la publication de son livre ce 4 mai, Civilisation – Comment nous sommes devenus américains (Gallimard), il commente l’actualité de l’élection présidentielle dans la presse.

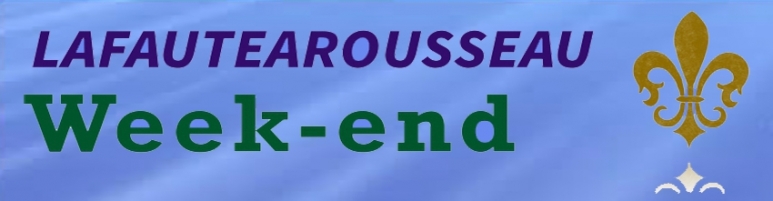

 Les noms d’oiseaux volent bas depuis quelques jours. Voter MLP, ce serait donc voter fasciste. Ou mieux : nazi. À point Godwin, point Godwin et demi. Et voter blanc c’est tout pareil — un demi-point de mieux !
Les noms d’oiseaux volent bas depuis quelques jours. Voter MLP, ce serait donc voter fasciste. Ou mieux : nazi. À point Godwin, point Godwin et demi. Et voter blanc c’est tout pareil — un demi-point de mieux !
 Dans des pages qu’il commença à rédiger dès 1937, le plus connu des chefs de gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, et qui fut toute sa vie un monarchiste de conviction, a choisi de distinguer, parmi une vingtaine de figures, seulement trois monarques, face à quatre présidents.
Dans des pages qu’il commença à rédiger dès 1937, le plus connu des chefs de gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, et qui fut toute sa vie un monarchiste de conviction, a choisi de distinguer, parmi une vingtaine de figures, seulement trois monarques, face à quatre présidents.






 Macron prétend qu’« il ne faut pas oublier », alors qu'il participe du crime de mémoricide du génocide vendéen.
Macron prétend qu’« il ne faut pas oublier », alors qu'il participe du crime de mémoricide du génocide vendéen.

