Par Mathieu Bock-Côté
A quoi sert l'histoire ? s'interroge Michel De Jaeghere dans La Compagnie des ombres. Le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté a lu le dernier essai du directeur du Figaro Histoire, une méditation autour de la permanence de l'homme à travers les siècles. Et il en tire lui-même une ample méditation d'où ni le legs de l'Histoire, ni le tragique de notre condition et de notre actualité ne sont absents. Mathieu Bock-Côté, parce qu'il nous paraît être, au sens de Baudelaire ou d'Edgar Poe, un antimoderne, nous est absolument proche. LFAR
 Journaliste de profession et historien de vocation, Michel De Jaeghere est une des plus belles plumes de la presse française. Auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-là, Enquête sur la christianophobie, La repentance, et plus récemment, du magistral Les derniers jours, qui revenait sur la chute de l'empire romain d'Occident, le directeur du Figaro-Histoire nous propose, avec La compagnie des ombres (éd. Belles Lettres, 2016), une méditation d'une érudition exceptionnelle sur un thème qui, manifestement, l'habite : à quoi sert l'histoire ? Au-delà de la simple passion encyclopédique qui pousse l'homme à accumuler les connaissances, que cherche-t-il en se tournant vers les époques passées, qu'elles soient très éloignées ou non dans le temps ? Qu'est-ce qui le pousse, inlassablement, vers des temps révolus qu'il ne connaîtra jamais que grâce au travail de son imagination ?
Journaliste de profession et historien de vocation, Michel De Jaeghere est une des plus belles plumes de la presse française. Auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-là, Enquête sur la christianophobie, La repentance, et plus récemment, du magistral Les derniers jours, qui revenait sur la chute de l'empire romain d'Occident, le directeur du Figaro-Histoire nous propose, avec La compagnie des ombres (éd. Belles Lettres, 2016), une méditation d'une érudition exceptionnelle sur un thème qui, manifestement, l'habite : à quoi sert l'histoire ? Au-delà de la simple passion encyclopédique qui pousse l'homme à accumuler les connaissances, que cherche-t-il en se tournant vers les époques passées, qu'elles soient très éloignées ou non dans le temps ? Qu'est-ce qui le pousse, inlassablement, vers des temps révolus qu'il ne connaîtra jamais que grâce au travail de son imagination ?
Michel De Jaeghere nous souffle la réponse dès le début de l'ouvrage mais il y reviendra sur 400 pages : l'histoire nous « fait lever des ombres venues de la profondeur des âges pour nous faire partager les leçons tirées de la pratique de notre condition » et nous permet « d'enrichir nos âmes blessées au milieu des vivants par un fructueux colloque en compagnie des ombres » (p.18). Mais cela implique de reconnaître une chose : d'un siècle à l'autre, l'homme demeure le même, même si chaque époque ne cultive pas les mêmes passions ou les mêmes facettes de l'âme humaine. Il y a une telle chose que la permanence de l'homme, quoi qu'en pensent les modernes. L'histoire est un réservoir d'exemples : elle montre à l'humanité ses grandeurs et ses misères et l'homme d'État, quoi qu'on en pense, ne maîtrisera jamais l'art de gouverner s'il ne sait pas entretenir un riche dialogue avec ceux qui se sont posé des questions semblables aux siennes. Quant au philosophe, quelle sera la valeur de son œuvre, s'il s'imagine ne rien devoir à la grande enquête qu'il reprend à son tour ?
Dans la première partie, consacrée à « la profondeur des âges », Michel De Jaeghere revient sur le monde antique, qu'il s'agisse de l'Égypte, du peuple juif, de la Grèce ou de Rome. Ces vieilles civilisations nous fascinent encore et on sait que Michel De Jaeghere a longuement médité sur le destin de la dernière, qu'on croyait éternelle et qui finalement, ne l'était pas. C'était longtemps la grande question des historiens : comment expliquer la grandeur et le déclin des civilisations ? Les choses humaines sont appelées à périr, même les plus belles, même si elles peuvent atteindre la relative immortalité qui vient avec leur remémoration. Autrement dit, à travers des formes historiques périssables, l'homme peut toucher certaines aspirations éternelles. Si une civilisation dure, nous dit-il, c'est parce qu'elle s'ouvre à certaines vérités éternelles qu'elle sait contempler. Cela, les Anciens le savaient, nous dit Michel De Jaeghere. Il n'en demeure pas moins qu'il y a là une réalité tragique : les hommes s'attachent à des réalités passagères, qu'ils voudraient immortaliser, et pour lesquelles ils sont prêts à donner leur vie, tout en sachant que le temps réduira à rien l'objet de leur sacrifice.
La chute de Rome obsède les hommes depuis toujours et ils ne cessent de se tourner vers ses causes pour comprendre le sort qui attend la leur. Que se passe-t-il quand un empire ne parvient plus à défendre ses frontières et tolère que des peuples s'installent chez lui sans s'assimiler à la civilisation qu'ils rejoignent ? Michel De Jaeghere, à sa manière, renouvelle notre rapport aux invasions barbares. Les barbares avaient beau s'installer dans l'empire pour des raisons humanitaires, ils n'en demeuraient pas moins des envahisseurs. D'ailleurs, c'est un des charmes de ce livre : si à plusieurs reprises, en lisant un chapitre, on est frappé par la ressemblance entre une époque et une autre, jamais Michel De Jaeghere ne pousse la comparaison jusqu'à dissoudre la singularité de chacune : la permanence de la condition humaine n'est pas simplement l'éternel retour du même. Deux situations semblables ne sont pas deux situations identiques. L'homme tel que le peint Michel De Jaeghere est libre, même s'il n'est pas tout puissant. Il peut faire dévier le cours des événements : il y a un « prix à payer pour la défaillance des volontés humaines » (p.72). Si on étudiait encore la biographie des grands hommes, on le saurait. On ne se surprendra pas que Michel De Jaeghere nous y invite.
Les civilisations meurent, mais d'autres naissent, comme le démontre éloquemment Michel De Jaeghere, dans la partie consacrée à « l'invention de l'Occident ». Évidemment, une civilisation naît dans la douleur, et par définition, pourrait-on dire, dans des temps sombres. La chute de Rome a créé les conditions d'un retour à la barbarie mais son souvenir a permis la naissance d'un nouveau monde, qui trouvera son « unité spirituelle » (p.124) dans le christianisme, notamment grâce à l'œuvre de Charlemagne. La leçon est forte : une civilisation qui ne s'ouvre pas à sa manière à la transcendance n'en est pas une. Un monde qui arrache ses racines et se ferme au ciel n'est pas un monde, mais un néant qui broie l'âme humaine. À plusieurs reprises, Michel De Jaeghere y revient : la civilisation européenne, et plus particulièrement, la nation française, sont indissociables de la religion chrétienne.
L'histoire a longtemps été liée à l'art du gouvernement. Machiavel avait relu Tite-Live pour en tirer une philosophie politique faite d'exemples à méditer. La compagnie des ombres s'inscrit à cette école, principalement dans la section consacrée aux « grands siècles ». On sent une tristesse chez Michel De Jaeghere : en passant d'Aristote à Machiavel, la politique moderne aurait renoncé à la quête du bien commun pour devenir une pure technique de domination (p. 176-179). La modernité marque l'avènement de la rationalité instrumentale. Mais la cité risque alors de mutiler l'homme, en renonçant à l'élever, à cultiver sa meilleure part. Disons le autrement : la cité a quelque chose à voir avec l'âme humaine et le fait de former une communauté politique traversée par l'élan du bien commun permet à un groupe humain de se civiliser en profondeur. La philosophie politique de Michel De Jaeghere croise ici celle d'un Pierre Manent, qui demeure lui aussi attaché à une forme d'aristotélisme politique.
De quelle manière gouverner les hommes ? En acceptant qu'ils ne sont ni anges, ni démons, et que la civilisation est d'abord une œuvre de refoulement de la barbarie. On aime chanter aujourd'hui les temps révolutionnaires : l'homme s'y serait régénéré en devenant maître de sa destinée. Après Soljenitsyne, Michel De Jaeghere nous met en garde contre cette illusion en revenant notamment sur les pages les plus sombres de la Révolution française : lorsqu'on fait tomber les digues qui contenaient les passions humaines les plus brutales et que le « fond de barbarie remonte » (p.221) au cœur de la cité. L'homme décivilisé n'est pas joyeusement spontané mais terriblement brutal. En fait, délivré de la culture, il s'ensauvage. Et il arrive aussi que le mal radical surgisse dans l'histoire, broie les hommes et pulvérise les peuples. Le vingtième siècle fut un siècle diabolique, qui a dévoré l'homme, le nazisme et le communisme étant chacun monstrueux et meurtriers.
Historien méditatif, Michel De Jaeghere, disions-nous. On pourrait aussi dire de l'histoire méditative qu'il s'agit d'une histoire philosophique, qui entend retenir quelques leçons. J'en retiens une particulièrement : une cité n'en est pas vraiment une si elle ne se présente pas comme la gardienne de quelque chose de plus grand qu'elle, si elle ne cherche pas à exprimer une culture touchant aux aspirations fondamentales de l'âme humaine. Il nous parle ainsi de « l'incroyable capacité de résistance que peut avoir la culture lorsqu'elle est enracinée dans l'âme d'un peuple, lorsqu'elle est parvenue à une maturité qui lui donne d'atteindre à l'expression de la beauté avec une efficacité singulière » (p.29). Un peuple peut mourir politiquement. Il pourra renaître s'il n'a pas renié son âme, nous dit Michel De Jaeghere, en prenant l'exemple du peuple juif, qui a survécu à sa disparition politique et à sa dispersion il y a deux mille ans en se consacrant « à l'étude de la Torah, à l'observation des commandements et au recueil de la tradition orale, afin de maintenir la pérennité de la culture juive à travers les siècles » (p.83).
Michel De Jaeghere comprend bien que l'homme ne comprendra jamais parfaitement le monde dans lequel il vit, que celui-ci n'est pas et ne sera jamais transparent. Le rationalisme militant des modernes prétend expliquer le monde mais l'assèche. Ils ont oublié la sagesse des Grecs qui « avaient compris que le mystère de la condition humaine laissait place à des questions auxquelles la réponse ne pouvait être donnée que sous le voile du mythe » (p.35). Que serait le travail de l'historien sans l'art de la métaphore, sans l'art du récit ? Il n'y a pas de transparence absolue du social, et une société n'est pas qu'un contrat rationnel à généraliser à l'ensemble des rapports sociaux. Son origine demeure toujours un peu mystérieuse, ce qui explique peut-être qu'on puisse toujours y revenir pour chercher à la comprendre et y trouver quelque inspiration.
Le crépuscule des ombres est un livre splendide qui invite à considérer l'homme dans sa grandeur propre, en ne cherchant plus à le réduire à ses petits travers quotidiens. C'est un grand bonheur que d'admirer ceux qui sont dignes d'admiration. En creux, on y retrouvera aussi une critique aussi sévère que nécessaire de la stupide ingratitude des modernes, qui se croient appelés à dissoudre le monde pour le recommencer à leurs conditions et le formater idéologiquement. La modernité laissée à elle-même veut abolir l'ancienne humanité pour en faire naître une autre, délivrée de ses vieilles entraves, à partir du vide. En cela, il y a une barbarie moderne qui s'alimente d'un fantasme d'autoengendrement qui pousse l'homme à détruire l'héritage. Il ne s'agit pas, dès lors, de se tourner vers le passé pour se réfugier dans un musée, mais pour découvrir les invariants, les permanences, et peut-être surtout, les questions existentielles que l'homme ne peut esquiver sans finalement se déshumaniser. •
« De quelle manière gouverner les hommes ? En acceptant qu'ils ne sont ni anges, ni démons, et que la civilisation est d'abord une œuvre de refoulement de la barbarie. »
Michel De Jaeghere, La Compagnie des ombres. À quoi sert l'histoire?, éd. Les Belles Lettres, 2016.
Mathieu Bock-Côté
 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.




 « La présence de Maurras étonne ; la séduction qu'il recommence d'exercer sur les jeunes esprits, ce second printemps de la génération spirituelle, plonge les puissants et les habiles dans la plus lourde, et plaisante, stupeur. De lui, de sa méthode, des belles harmonies qu'il a instituées, il recommence de naître un grand murmure, moins audible dans les lâches assemblées publiques ou les timides salles de rédaction, que dans les petites réunions, les pauvres chambres, où les étudiants se rassemblent, et se demandent : qu'en sera-t-il de nous, de la vérité et du pays ? »
« La présence de Maurras étonne ; la séduction qu'il recommence d'exercer sur les jeunes esprits, ce second printemps de la génération spirituelle, plonge les puissants et les habiles dans la plus lourde, et plaisante, stupeur. De lui, de sa méthode, des belles harmonies qu'il a instituées, il recommence de naître un grand murmure, moins audible dans les lâches assemblées publiques ou les timides salles de rédaction, que dans les petites réunions, les pauvres chambres, où les étudiants se rassemblent, et se demandent : qu'en sera-t-il de nous, de la vérité et du pays ? » 
 Journaliste de profession et historien de vocation, Michel De Jaeghere est une des plus belles plumes de la presse française. Auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-là, Enquête sur la christianophobie, La repentance, et plus récemment, du magistral Les derniers jours, qui revenait sur la chute de l'empire romain d'Occident, le directeur du Figaro-Histoire nous propose, avec La compagnie des ombres (éd. Belles Lettres, 2016), une méditation d'une érudition exceptionnelle sur un thème qui, manifestement, l'habite : à quoi sert l'histoire ? Au-delà de la simple passion encyclopédique qui pousse l'homme à accumuler les connaissances, que cherche-t-il en se tournant vers les époques passées, qu'elles soient très éloignées ou non dans le temps ? Qu'est-ce qui le pousse, inlassablement, vers des temps révolus qu'il ne connaîtra jamais que grâce au travail de son imagination ?
Journaliste de profession et historien de vocation, Michel De Jaeghere est une des plus belles plumes de la presse française. Auteur de nombreux ouvrages, parmi ceux-là, Enquête sur la christianophobie, La repentance, et plus récemment, du magistral Les derniers jours, qui revenait sur la chute de l'empire romain d'Occident, le directeur du Figaro-Histoire nous propose, avec La compagnie des ombres (éd. Belles Lettres, 2016), une méditation d'une érudition exceptionnelle sur un thème qui, manifestement, l'habite : à quoi sert l'histoire ? Au-delà de la simple passion encyclopédique qui pousse l'homme à accumuler les connaissances, que cherche-t-il en se tournant vers les époques passées, qu'elles soient très éloignées ou non dans le temps ? Qu'est-ce qui le pousse, inlassablement, vers des temps révolus qu'il ne connaîtra jamais que grâce au travail de son imagination ? Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'


 C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ; dans les grands textes du passé qu'on comprend le mieux la situation politique contemporaine. La dernière réédition du classique Réflexions sur la Révolution en France d'Edmund Burke l'atteste une nouvelle fois avec éclat. Il faut dire que le travail éditorial est admirable : préface brillante de Philippe Raynaud ; appareil critique exhaustif et passionnant ; sans oublier divers discours ou lettres de Burke qui attestent que, jusqu'à sa mort en 1797, celui-ci n'a jamais cessé de ferrailler contre notre Révolution.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ; dans les grands textes du passé qu'on comprend le mieux la situation politique contemporaine. La dernière réédition du classique Réflexions sur la Révolution en France d'Edmund Burke l'atteste une nouvelle fois avec éclat. Il faut dire que le travail éditorial est admirable : préface brillante de Philippe Raynaud ; appareil critique exhaustif et passionnant ; sans oublier divers discours ou lettres de Burke qui attestent que, jusqu'à sa mort en 1797, celui-ci n'a jamais cessé de ferrailler contre notre Révolution.


 « Nous sommes les enfants de personne » assenait il y a quelques années Jacques de Guillebon dans un livre qui se faisait fort de dénoncer le refus d’une génération de transmettre à l’autre l’héritage culturel et spirituel de notre civilisation, préférant se vautrer dans le relativisme et l’adulation de la transgression. Douze ans ont passé. Et de ce reproche, il n’y malheureusement rien à redire. Mais il y a à ajouter. Car la France a vu ressurgir les faits sociaux quand ce n’était pas la barbarie ; et c’est précisément à partir de ce postulat que le brillant journaliste et désormais essayiste Alexandre Devecchio a enquêté avec une rigueur qu’il convient de saluer.
« Nous sommes les enfants de personne » assenait il y a quelques années Jacques de Guillebon dans un livre qui se faisait fort de dénoncer le refus d’une génération de transmettre à l’autre l’héritage culturel et spirituel de notre civilisation, préférant se vautrer dans le relativisme et l’adulation de la transgression. Douze ans ont passé. Et de ce reproche, il n’y malheureusement rien à redire. Mais il y a à ajouter. Car la France a vu ressurgir les faits sociaux quand ce n’était pas la barbarie ; et c’est précisément à partir de ce postulat que le brillant journaliste et désormais essayiste Alexandre Devecchio a enquêté avec une rigueur qu’il convient de saluer.
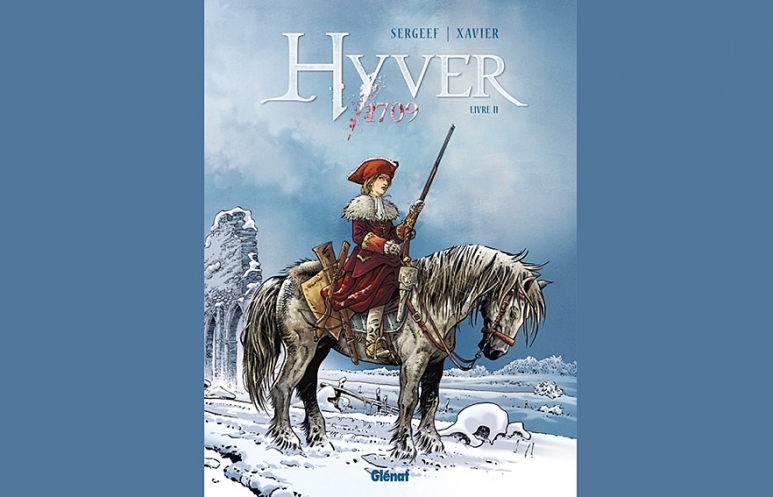

 Comme le dit justement Frédéric Rouvillois, dans sa tribune de Figarovox du 31 octobre : « Comparaison n'est pas raison, nous dit la sagesse des peuples. Ce qui n'empêche pas certains rapprochements troublants. Au printemps 1958, l'agonie piteuse de la IVe République avait été marquée par des manifestations de policiers ulcérés par l'impuissance de l'État, par des dissensions amères au sein du gouvernement et de la classe politique, par la perte de légitimité du système et par son incapacité visible à trouver des réponses aux questions les plus urgentes... »
Comme le dit justement Frédéric Rouvillois, dans sa tribune de Figarovox du 31 octobre : « Comparaison n'est pas raison, nous dit la sagesse des peuples. Ce qui n'empêche pas certains rapprochements troublants. Au printemps 1958, l'agonie piteuse de la IVe République avait été marquée par des manifestations de policiers ulcérés par l'impuissance de l'État, par des dissensions amères au sein du gouvernement et de la classe politique, par la perte de légitimité du système et par son incapacité visible à trouver des réponses aux questions les plus urgentes... » 
 Nul ne saurait se réjouir du nouvel abaissement de la fonction présidentielle dont François Hollande vient de se rendre coupable. On croyait avoir touché le fond entre 2007 et 2012 avec Sarkozy : on se trompait. Un fossoyeur a chassé l’autre : la république creuse toujours plus profond.
Nul ne saurait se réjouir du nouvel abaissement de la fonction présidentielle dont François Hollande vient de se rendre coupable. On croyait avoir touché le fond entre 2007 et 2012 avec Sarkozy : on se trompait. Un fossoyeur a chassé l’autre : la république creuse toujours plus profond. 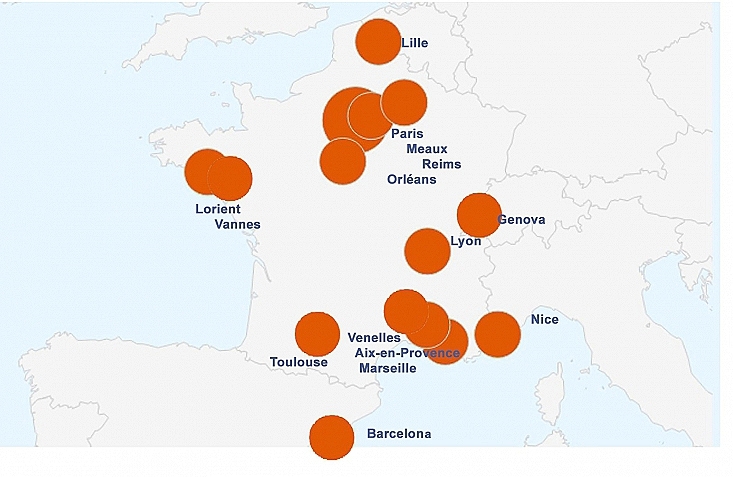


 Comparaison n'est pas raison, nous dit la sagesse des peuples. Ce qui n'empêche pas certains rapprochements troublants. Au printemps 1958, l'agonie piteuse de la IVe République avait été marquée par des manifestations de policiers ulcérés par l'impuissance de l'État, par des dissensions amères au sein du gouvernement et de la classe politique, par la perte de légitimité du système et par son incapacité visible à trouver des réponses aux questions les plus urgentes. Et même, par l'électrochoc suscité par la parution d'un livre événement, Les princes qui nous gouvernent, dans lequel un « homme de l'ombre », Michel Debré, consignait lucidement les indices de la phase terminale du régime. Soixante ans plus tard, c'est la Ve République, ou plutôt, ce qu'en ont fait les gouvernants depuis une trentaine d'années, qui se trouve sur la sellette. Et c'est un autre grand livre, La cause du peuple, de Patrick Buisson, qui se charge de dresser le constat, en confrontant le régime tel qu'il avait été conçu à l'origine, à l'ombre caricaturale et falote de ce qu'il est devenu.
Comparaison n'est pas raison, nous dit la sagesse des peuples. Ce qui n'empêche pas certains rapprochements troublants. Au printemps 1958, l'agonie piteuse de la IVe République avait été marquée par des manifestations de policiers ulcérés par l'impuissance de l'État, par des dissensions amères au sein du gouvernement et de la classe politique, par la perte de légitimité du système et par son incapacité visible à trouver des réponses aux questions les plus urgentes. Et même, par l'électrochoc suscité par la parution d'un livre événement, Les princes qui nous gouvernent, dans lequel un « homme de l'ombre », Michel Debré, consignait lucidement les indices de la phase terminale du régime. Soixante ans plus tard, c'est la Ve République, ou plutôt, ce qu'en ont fait les gouvernants depuis une trentaine d'années, qui se trouve sur la sellette. Et c'est un autre grand livre, La cause du peuple, de Patrick Buisson, qui se charge de dresser le constat, en confrontant le régime tel qu'il avait été conçu à l'origine, à l'ombre caricaturale et falote de ce qu'il est devenu.