
Journée d'espoir et, pour les moins optimistes, de confiance renaissante. On se bat sur l'Ourcq, sur la Marne, c'est vrai. Mais on se bat avec les meilleures chances de succès de notre côté. Joffre cunctator a eu raison. Les Allemands, qui ont reculé hier de quarante kilomètres, essaient bien de renouveler la tactique de l'écrasement et, quand dix-mille de leurs hommes ont échoué ou même ont été anéantis quelque part, d'en envoyer aussitôt quarante. Mais leurs réserves s'épuisent, leurs munitions aussi. Toutes les voies de communication ont été détruites (chemin de fer et routes) devant eux, et, au contraire, nos armées se ravitaillent avec la plus grande facilité, le reste de la France étant intact derrière elles. Voilà la très grande raison d'espérer... Il y a sans doute encore de grandes batailles en perspectives et de durs combats à affronter. Une nouvelle campagne sera nécessaire pour rejeter l'envahisseur au-delà de la frontière quand son échec sera confirmé. Et, en se retirant, il fera le désert derrière lui, comme nous-mêmes l'avons déjà fait. De nouvelles ruines s'entasseront dans l'Est et le Nord-Est. Dure nécessité. Mais le salut est à ce prix.
D'ailleurs, l'espérance qui revient peint tous les aspects de la situation des couleurs les plus favorables. Il n'est plus vrai, aujourd'hui, que tant de villes aient été brûlées. Senlis, notamment, n'a pas souffert de la présence de l'ennemi. "J'y étais voilà quatre jours", confirme un réfugié. Un autre dit que Fourmies n'est nullement détruite de fond en comble. Un troisième assure que l'incendie de Compiègne est une fable. Le bruit avait couru que les Allemands (pour donner une preuve de leur goût) avaient mis la main sur les incomparables pastels de La Tour à Saint-Quentin : Guillaume II, conformément à la tradition frédéricienne, se pique d'être amateur de l'art français du XVIIIème siècle. On annonce maintenant que les La Tour sont en lieu sûr. De même Lille, occupée à peine quelques heures, s'en est tirée avec une contribution de guerre de 500.000 francs, le bénéfice moyen d'un seul de ses grands industriels...
Devant cette marée de nouvelles heureuses, le gouvernement est un peu honteux de sa retraite précipitée sur Bordeaux. Marcel Sembat prépare ostensiblement son bagage pour retourner à Paris. Les autres ministres se tournent les pouces ou bien font la fête. Seuls Delcassé et Millerand travaillent quatorze heures par jour. "Millerand prend la figure du grand Carnot" me disait hier soir Alfred Capus... Oui, sans doute, on voit bien les Conventionnels. Mais on ne voit ni l'épuration ni la guillotine...
A la dernière heure, il paraît que la situation militaire est encore plus favorable que les communiqués officiels ne le disent. Le général Pau a totalement rétabli nos affaires sur l'aile gauche. Un combattant, revenu du front en mission, que j'ai rencontré hier, rapporte ceci : le général Pau aurait réussi à attirer l'ennemi dans les tourbières autour d'Amiens. 15.000 Allemands, cernés, exposés au feu de notre artillerie, demandent à se rendre à la tombée de la nuit. "Il est trop tard. Je n'ai plus le temps de parlementer", répond le général Pau. Et la canonnade continue.
Quant à Paris, dont les barbares se sont détournés, Paris, sauvé par miracle, Le Temps en donne cette image :
Paris, lundi 7 septembre.
Le brusque départ du Président et du gouvernement a surpris la population parisienne que rien n'avait préparée à cet évènement. Les commentaires les plus divers se produisent, mais on se dit que la victoire finale justifiera tout.
Les administrations civiles sont en plein désarroi, les fonctionnaires qui sont restés à Paris ayant été laissés sans ordres. Nulle instruction ne leur a été donnée. Mais la vie administrative est, pensons-nous, concentrée à Bordeaux.
A Parsi, il n'est plus question de politique.
Plus de couloirs ni d'antichambres d'où puissent sortir des bruits alarmants; partout le calme, la dignité, la confiance.
Gallieni travaille, on le sent, on le voit.
C'a même été une déception d'apprendre que les Prussiens négligeaient de nous faire une visite..."
Ces vingt lignes, tout en épigrammes, et qui ont paru dans Le Temps, donnent la mesure du discrédit dont les institutions sont frappées.






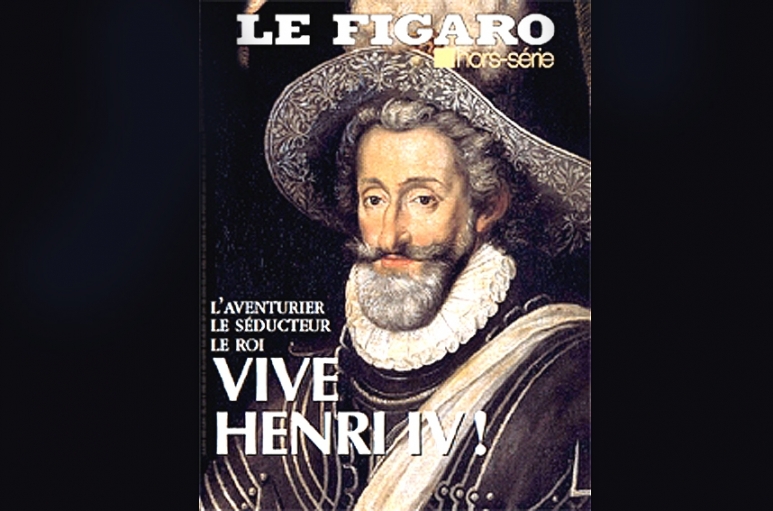

 La République est-elle en phase terminale ? M. Hollande pourra-t-il tenir ? Va-t-on vers la dissolution de l’Assemblée nationale ? La France peut-elle s’effondrer comme la Grèce ? Autant de questions que je ne cesse d’entendre depuis quelques jours, parfois sous la forme d’affirmations péremptoires, le point d’interrogation se transformant de plus en plus fréquemment en un point d’exclamation : au comptoir des cafés, dans la salle des professeurs, sur un bout de trottoir, dans une librairie encombrée où les clients demandent, d’une voix parfois forte, comme provocatrice, le livre de Mme Trierweiler, véritable succès – un peu ambigu et plutôt inattendu - de la rentrée littéraire 2014…
La République est-elle en phase terminale ? M. Hollande pourra-t-il tenir ? Va-t-on vers la dissolution de l’Assemblée nationale ? La France peut-elle s’effondrer comme la Grèce ? Autant de questions que je ne cesse d’entendre depuis quelques jours, parfois sous la forme d’affirmations péremptoires, le point d’interrogation se transformant de plus en plus fréquemment en un point d’exclamation : au comptoir des cafés, dans la salle des professeurs, sur un bout de trottoir, dans une librairie encombrée où les clients demandent, d’une voix parfois forte, comme provocatrice, le livre de Mme Trierweiler, véritable succès – un peu ambigu et plutôt inattendu - de la rentrée littéraire 2014…







