Mathieu Bock-Côté : de Nice à Berlin, scènes du terrorisme ordinaire

Par Mathieu Bock-Côté
« L'Etat islamique a revendiqué l'attaque terroriste contre le marché de Noël à Berlin. Le sociologue Mathieu Bock-Côté décrit cette scène d'attentat qui " avait quelque chose d'atroce et, en même temps, de terriblement banal". » [Figarovox, 21.12]. Mais les lecteurs de Lafautearousseau connaissent bien, désormais, Mathieu Bock-Côté, ils savent que ses analyses vont au fond des choses, à l'essentiel, et que sa pensée ne craint pas de transgresser la doxa dite de la modernité ou postmodernité. Il renvoie l'Europe à son identité la plus intime, à sa part chrétienne, même si elle en a perdu la conscience claire, à sa culture profonde, héritée de sa lointaine Histoire. Il ne voit guère d'autre solution que ce retour sur soi-même de la civilisation européenne, pour mener la bataille qui lui est, aujourd'hui, imposée. Ici, accord profond, une fois encore, avec Mathieu Bock-Côté. Lafautearousseau
 La scène avait quelque chose d'atroce et, en même temps, de terriblement banale. À quelques jours du 25 décembre, un camion se lance sur un marché de Noël de Berlin, tue une douzaine de personnes et en blesse une cinquantaine. On croit revivre les événements de Nice quand Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait frappé le soir du 14 juillet. Là aussi, il s'agissait de semer la terreur dans un moment de réjouissance et de traumatiser la population. On peut imaginer la suite médiatique : certains diront que l'événement demeure un incident isolé. On chantera en chœur « pas d’amalgame ». D'autres se demanderont encore une fois si l'Occident ne l'a pas cherché, bien qu'on se demandera de quelle manière l'Allemagne a bien pu se rendre coupable d'une forme plus ou moins intransigeante de laïcité néocoloniale, pour emprunter le jargon à la mode. Le système médiatique, devant l'islamisme, cultive l'art du déni. Il déréalise les événements, les égrène en mille faits divers et empêche de nommer la guerre faite à l'Occident.
La scène avait quelque chose d'atroce et, en même temps, de terriblement banale. À quelques jours du 25 décembre, un camion se lance sur un marché de Noël de Berlin, tue une douzaine de personnes et en blesse une cinquantaine. On croit revivre les événements de Nice quand Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait frappé le soir du 14 juillet. Là aussi, il s'agissait de semer la terreur dans un moment de réjouissance et de traumatiser la population. On peut imaginer la suite médiatique : certains diront que l'événement demeure un incident isolé. On chantera en chœur « pas d’amalgame ». D'autres se demanderont encore une fois si l'Occident ne l'a pas cherché, bien qu'on se demandera de quelle manière l'Allemagne a bien pu se rendre coupable d'une forme plus ou moins intransigeante de laïcité néocoloniale, pour emprunter le jargon à la mode. Le système médiatique, devant l'islamisme, cultive l'art du déni. Il déréalise les événements, les égrène en mille faits divers et empêche de nommer la guerre faite à l'Occident.
Il faudra quand même réinscrire l'événement dans la séquence terroriste associée aux événements du Bataclan. Le terrorisme islamiste veut montrer qu'il peut frapper partout. Il ne vise plus seulement des « institutions », comme c'était le cas avec Charlie Hebdo, mais entend imposer sa loi n'importe où, en transformant un simple camion en bélier. N'importe qui peut être ciblé dans ces frappes aveugles. Dans la guerre totale menée contre la civilisation occidentale, il suffit d'appartenir à cette dernière pour être jugé coupable et condamné à mort. À Berlin, nous venons en fait d'assister à une scène de terrorisme ordinaire. Encore une fois, l'État islamique a revendiqué l'attentat. Qu'il ait été programmé de loin ou qu'il soit le fruit d'une initiative plus ou moins spontanée, on peut être certain d'une chose : la propagande islamiste hante la civilisation européenne et est capable d'exciter les passions mortifères des uns et des autres.
Et pourtant, cette attaque n'est pas absolument aveugle. La frappe d'un marché de Noël ramène l'Europe à une part d'elle-même dont elle ne sait que faire : sa part chrétienne. C'est dans son identité la plus intime qu'on veut la frapper, ce sont ses racines les plus profondes qu'on veut toucher. Les symboles chrétiens sont de plus en plus souvent visés. On se rappellera que le communiqué de l'État islamique qui avait suivi les attentats du 13 novembre mentionnait que les Français étaient visés en tant que « croisés ». De même, l'assassinat rituel du père Hamel, en juillet 2016, ne laissait pas d'ambiguïté sur sa signification. Pour reprendre une formule convenue, c'est moins pour ce qu'ils font que ce qu'ils sont que les Européens sont mitraillés, égorgés ou écrasés. Sauf qu'ils ne sont plus trop conscients de cette part d'eux-mêmes. Ou du moins, lorsqu'ils en sont conscients, on le leur reproche et on les accuse de s'enfermer dans une identité étriquée, inadaptée à la diversité. Nos élites médiatiques ne tolèrent le procès de l'islamisme qu'à condition de le mener en parallèle avec celui de l'islamophobie.
Car le monde occidental veut croire qu'on l'attaque parce qu'il est démocratique, moderne et libéral. Il s'empêche de comprendre ainsi qu'il existe une telle chose qu'une tension entre les cultures, entre les civilisations et même entre les religions : elles ne sont pas toutes faites pour cohabiter dans une même communauté politique. Le rôle du politique, dans ce monde, n'est pas de verser dans un irénisme multiculturel où tous devraient se réconcilier sous le signe d'une diversité heureuse mais bien de bâtir, de conserver et de protéger les frontières protectrices permettant aux peuples de persévérer dans leur être historique sans pour autant s'empêcher de multiplier les interactions fécondes entre eux. Avec raison, on refusera de réduire les affrontements du monde actuel à un choc de civilisation. À tort, on refusera de voir qu'ils relèvent au moins partiellement de cette logique. Ceux qui cherchent à penser à nouveaux frais la pertinence des frontières ne sont pas des vautours ou des démagogues instrumentalisant le malheur des peuples pour les replier sur eux-mêmes.
L'Allemagne voit se retourner contre elle-même les conséquences prévisibles d'un humanitarisme débridé. On s'est moqué, au moment de la crise des réfugiés, de ceux qui redoutaient que parmi les convois de malheureux, ne se glissent des djihadistes attendant ensuite le bon moment pour frapper. Ce moment est peut-être arrivé. Mais les dérives de la politique des portes ouvertes ne sauraient se laisser définir uniquement par le terrorisme islamiste. Il suffit de garder en mémoire les événements de Cologne, en début d'année, pour qu'on comprenne les nombreuses dimensions d'une crise qui n'est pas à la veille de se résorber. L'époque des grandes invasions militaires a beau être terminée, il n'en demeure pas moins que les islamistes sont habités par un sentiment de conquête et croient pouvoir miser sur l'immigration massive pour s'imposer en Europe. Comment la civilisation européenne peut-elle réagir à cette mutation imposée si elle en relativise la portée ?
Il ne sert à rien d'imaginer en un paragraphe ce que pourrait être une riposte à ce terrorisme ordinaire appelé à durer. Mais le monde occidental aurait tort de croire qu'il saura résister à sa dissolution culturelle ou politique en se contentant de répéter de manière rituelle ses prières pour chanter la gloire de la diversité. Manifestement, elle n'est pas qu'une richesse. Toutes les différences ne sont pas également appréciables. En fait, c'est peut-être en assumant ce qu'on pourrait appeler leur identité de civilisation que les nations européennes seront à même de trouver la force de mener cette guerre pendant les longues années qu'elle durera. Il n'est pas insensé de penser que c'est en se tournant justement vers la part d'elle-même qui est attaquée que la civilisation européenne trouvera peut-être la force de mener la bataille. •
« La frappe d'un marché de Noël ramène l'Europe à une part d'elle-même dont elle ne sait que faire : sa part chrétienne. »
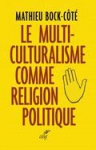 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.

 Le drame qui a endeuillé, lundi soir, Berlin et l’Allemagne toute entière, n’est sans doute pas intervenu par hasard dans un marché de Noël. Au surplus, dans un des lieux les plus significatifs de la capitale, presque au pied de l’église du souvenir, cette église bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et témoin de la détresse provoquée par la folie nazie. La correspondante du Monde parle à juste titre d’un monument emblématique comme prédestiné à pleurer les habitants de la ville. On présume, dans l’attente des résultats de l’enquête, qu’il s’est agi, pour les responsables et les auteurs de l’attentat, d’atteindre un pays dans sa chair vive, à un moment privilégié, là où s’affirment une culture et une forme de vie. Culture et vie stigmatisées au nom d’une conception contraire qui inspire un rejet radical et se justifie aussi par un énorme ressentiment.
Le drame qui a endeuillé, lundi soir, Berlin et l’Allemagne toute entière, n’est sans doute pas intervenu par hasard dans un marché de Noël. Au surplus, dans un des lieux les plus significatifs de la capitale, presque au pied de l’église du souvenir, cette église bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et témoin de la détresse provoquée par la folie nazie. La correspondante du Monde parle à juste titre d’un monument emblématique comme prédestiné à pleurer les habitants de la ville. On présume, dans l’attente des résultats de l’enquête, qu’il s’est agi, pour les responsables et les auteurs de l’attentat, d’atteindre un pays dans sa chair vive, à un moment privilégié, là où s’affirment une culture et une forme de vie. Culture et vie stigmatisées au nom d’une conception contraire qui inspire un rejet radical et se justifie aussi par un énorme ressentiment.
 Berlin est en deuil. Un lourd camion pris en main par un djihadiste a semé la mort le 19 décembre dernier dans le plus fameux marché de Noël de la ville. Un attentat islamiste qui est en lui-même un signe évident, signé Daech, revendiqué comme tel.
Berlin est en deuil. Un lourd camion pris en main par un djihadiste a semé la mort le 19 décembre dernier dans le plus fameux marché de Noël de la ville. Un attentat islamiste qui est en lui-même un signe évident, signé Daech, revendiqué comme tel.
 Le temps de Noël est ordinairement un temps de joie et de partage, mais le voilà aujourd'hui endeuillé par l'attentat survenu à Berlin et visant, explicitement, l'un des symboles même de notre civilisation : de la chaleur d'une étable et d'une famille aimante est née une certaine manière d'aborder le monde et ses périls, plutôt fondée sur l'amour et le don que sur ce que notre société de consommation en a fait désormais, entre envie et gaspillage.
Le temps de Noël est ordinairement un temps de joie et de partage, mais le voilà aujourd'hui endeuillé par l'attentat survenu à Berlin et visant, explicitement, l'un des symboles même de notre civilisation : de la chaleur d'une étable et d'une famille aimante est née une certaine manière d'aborder le monde et ses périls, plutôt fondée sur l'amour et le don que sur ce que notre société de consommation en a fait désormais, entre envie et gaspillage.  Il y aura encore des milliers de bougies allumées qui, sans forcément qu'on le sache, nous rattachent à une tradition ancienne et d'origine fort peu laïque ; il y aura ces dessins d'enfants en mémoire du petit camarade, d'un frère ou d'une mère, de toutes ces victimes venues fêter Noël et reparties sur un brancard ou, pire, dans un linceul ; il y aura ces discours émus et un peu fatigués des ministres et des diplomates, ces hommages venus de partout ; il y aura surtout ce chagrin qui, désormais, minera des familles entières...
Il y aura encore des milliers de bougies allumées qui, sans forcément qu'on le sache, nous rattachent à une tradition ancienne et d'origine fort peu laïque ; il y aura ces dessins d'enfants en mémoire du petit camarade, d'un frère ou d'une mère, de toutes ces victimes venues fêter Noël et reparties sur un brancard ou, pire, dans un linceul ; il y aura ces discours émus et un peu fatigués des ministres et des diplomates, ces hommages venus de partout ; il y aura surtout ce chagrin qui, désormais, minera des familles entières... 

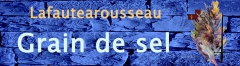 Daech a "revendiqué", le lâche assassin de Berlin est un demandeur d'asile : vous vous souvenez de ces photos de gares allemandes où des inconscients attendaient les dits réfugiés avec des pancartes « Willkommen ». En Allemagne, en France, partout en Europe, les agneaux ont invité les loups à souper ; et les loups sont entrés dans la bergerie ; et leur festin ne fait que commencer...
Daech a "revendiqué", le lâche assassin de Berlin est un demandeur d'asile : vous vous souvenez de ces photos de gares allemandes où des inconscients attendaient les dits réfugiés avec des pancartes « Willkommen ». En Allemagne, en France, partout en Europe, les agneaux ont invité les loups à souper ; et les loups sont entrés dans la bergerie ; et leur festin ne fait que commencer...
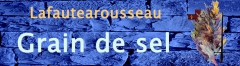 Les ennemis de nos ennemis sont-ils, forcément, nos amis ? Non, pas forcément et, du reste, ce n'est pas sur ce terrain des petites phrases contournées et des jeux de mots faciles que nous nous laisserons entraîner. Nous nous placerons du seul point de vue des intérêts nationaux français, en cette période de terrorisme islamiste latent. Et nous nous bornerons à constater la vraie nature de ceux qui se sont soulevés contre Bachar el Assad, et qu'il écrase aujourd'hui à Alep (et c'est tant mieux) : non, ce ne sont pas de gentils démocrates, bien comme il faut et propres sur eux ; non, ce ne sont pas des bisounours ou des GO du Club ‘Med, n'en déplaise à ce super-grand-mou de Hollande, qui joue d'autant plus les durs et la rodomontade qu'il est pathétiquement inexistant sur la scène internationale, que personne ne l'écoute, et qu'entre ce qu'il dit et rien, il est extrêmement difficile de trouver une différence.
Les ennemis de nos ennemis sont-ils, forcément, nos amis ? Non, pas forcément et, du reste, ce n'est pas sur ce terrain des petites phrases contournées et des jeux de mots faciles que nous nous laisserons entraîner. Nous nous placerons du seul point de vue des intérêts nationaux français, en cette période de terrorisme islamiste latent. Et nous nous bornerons à constater la vraie nature de ceux qui se sont soulevés contre Bachar el Assad, et qu'il écrase aujourd'hui à Alep (et c'est tant mieux) : non, ce ne sont pas de gentils démocrates, bien comme il faut et propres sur eux ; non, ce ne sont pas des bisounours ou des GO du Club ‘Med, n'en déplaise à ce super-grand-mou de Hollande, qui joue d'autant plus les durs et la rodomontade qu'il est pathétiquement inexistant sur la scène internationale, que personne ne l'écoute, et qu'entre ce qu'il dit et rien, il est extrêmement difficile de trouver une différence.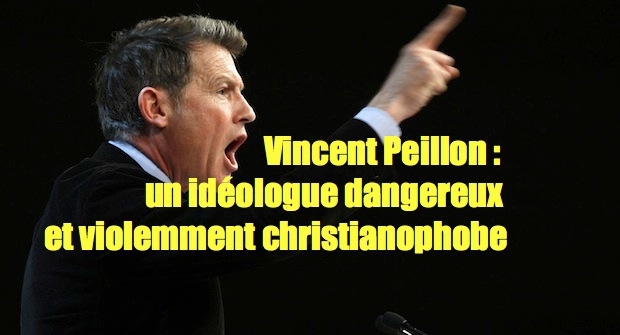
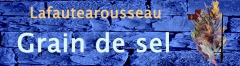
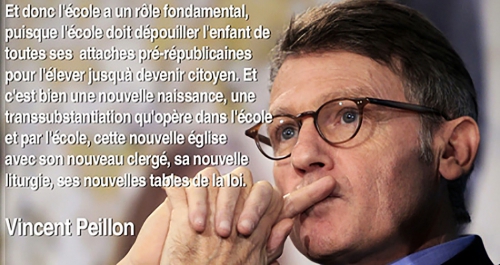

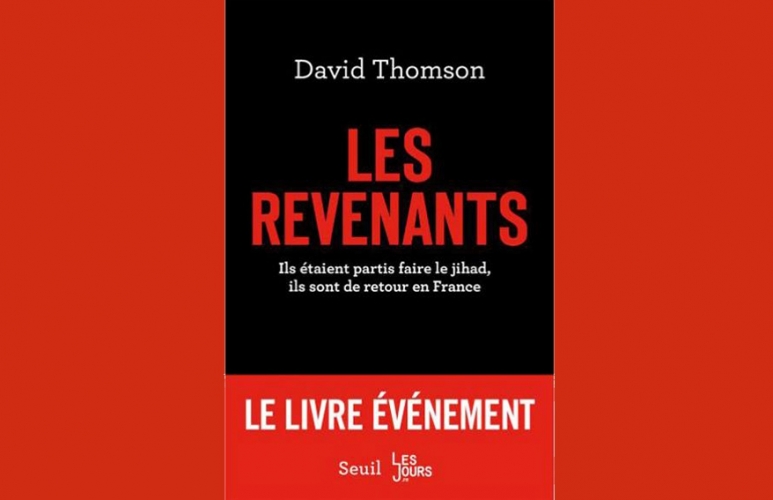
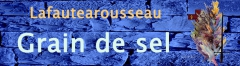
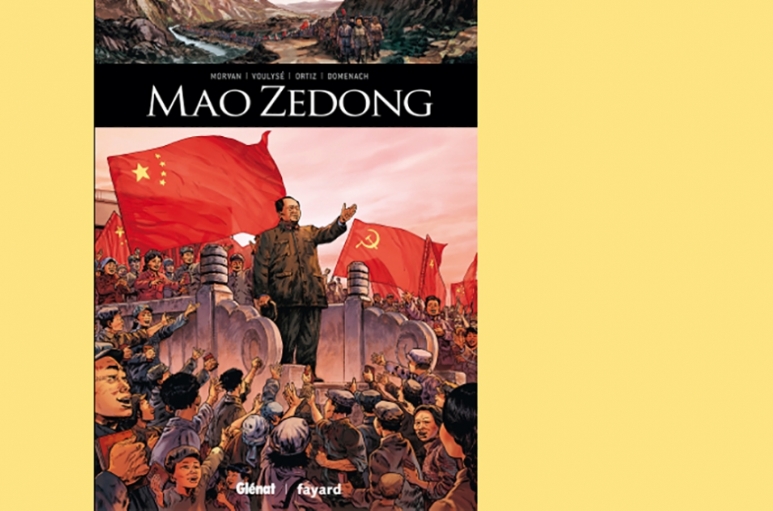
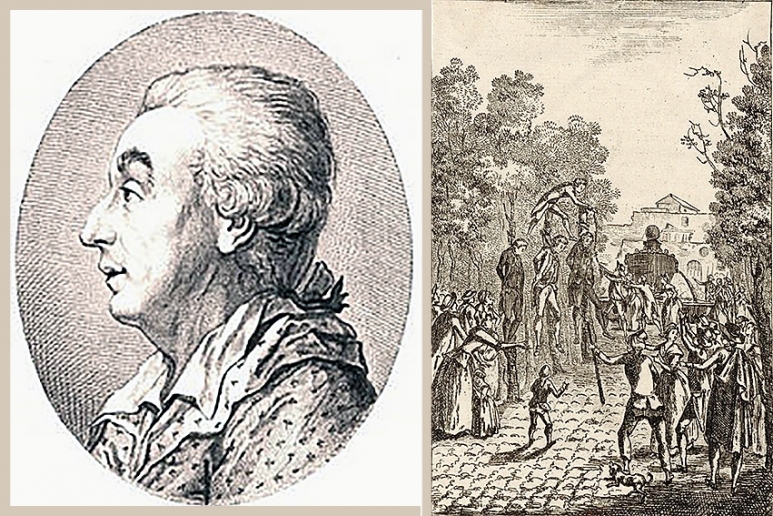
 En ce début décembre, il ne semble pas inopportun d’évoquer un personnage méconnu mais attachant, qui mérite la reconnaissance à la fois des royalistes et des Provençaux : Jean Joseph Pierre Pascalis qui naquit à
En ce début décembre, il ne semble pas inopportun d’évoquer un personnage méconnu mais attachant, qui mérite la reconnaissance à la fois des royalistes et des Provençaux : Jean Joseph Pierre Pascalis qui naquit à 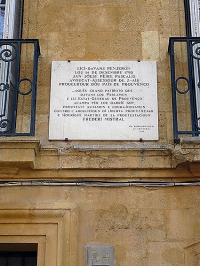

 M’étant abstenu d’évoquer jusqu’ici la mort de Fidel Castro, pensant qu’il était superflu de revenir sur cette formidable désillusion, consécutive à ce que Malraux appelait l’illusion lyrique, je suis rattrapé par la polémique suscitée par les propos de Ségolène Royal. Représentant la France aux obsèques du Lider Maximo, elle a cru devoir exalter l’œuvre du militant révolutionnaire : « Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la Terreur. » C’est un peu stupéfiant. Ségolène Royal serait-elle atteinte du syndrome Danielle Mitterrand, qui, elle aussi, ne pouvait s’empêcher de garder intacte l’icône qui enflamma toute une génération ? J’ai encore en mémoire les articles de Jean-Paul Sartre sur la fête cubaine publiés, me semble-t-il, par France Soir, le quotidien flamboyant de Pierre Lazareff.
M’étant abstenu d’évoquer jusqu’ici la mort de Fidel Castro, pensant qu’il était superflu de revenir sur cette formidable désillusion, consécutive à ce que Malraux appelait l’illusion lyrique, je suis rattrapé par la polémique suscitée par les propos de Ségolène Royal. Représentant la France aux obsèques du Lider Maximo, elle a cru devoir exalter l’œuvre du militant révolutionnaire : « Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la Terreur. » C’est un peu stupéfiant. Ségolène Royal serait-elle atteinte du syndrome Danielle Mitterrand, qui, elle aussi, ne pouvait s’empêcher de garder intacte l’icône qui enflamma toute une génération ? J’ai encore en mémoire les articles de Jean-Paul Sartre sur la fête cubaine publiés, me semble-t-il, par France Soir, le quotidien flamboyant de Pierre Lazareff.

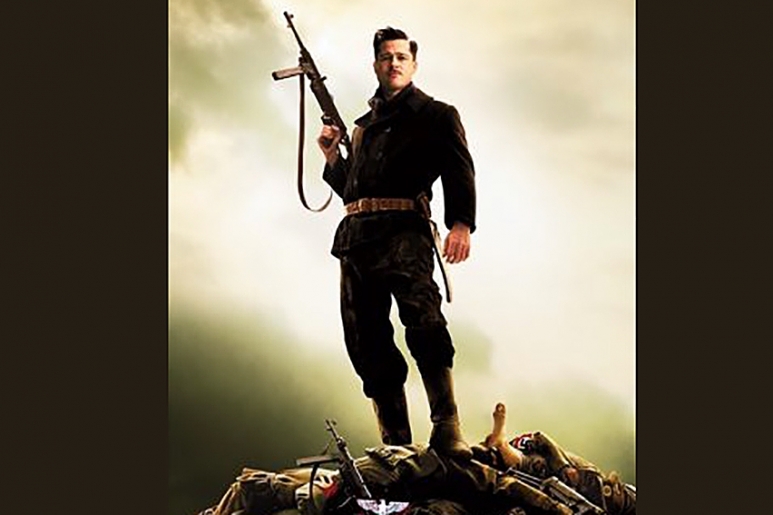
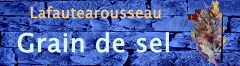 Dimanche soir, France 2 a diffusé le film de Quentin Tarantino « Le commando des bâtards » (en étatsunien : « Inglourious basterds »). On ne fera pas ici une critique cinématographique de l'œuvre, on se bornera seulement à s'arrêter sur un point bien précis.
Dimanche soir, France 2 a diffusé le film de Quentin Tarantino « Le commando des bâtards » (en étatsunien : « Inglourious basterds »). On ne fera pas ici une critique cinématographique de l'œuvre, on se bornera seulement à s'arrêter sur un point bien précis.
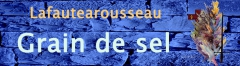 Déjà, le ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, était ce samedi à Santiago de Cuba le seul membre d'un gouvernement européen, avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras, à s'être rendue aux funérailles du dictateur communiste. Cela aurait dû, au moins, lui faire un peu honte, et l'inciter à la plus élémentaire des prudences. En l'occurrence, tout simplement, ne rien dire, attendre que « ça se passe ». Ce n'est pourtant pas très difficile, ne rien dire ! Eh, bien, non ! Il a fallu qu'elle parle :
Déjà, le ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, était ce samedi à Santiago de Cuba le seul membre d'un gouvernement européen, avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras, à s'être rendue aux funérailles du dictateur communiste. Cela aurait dû, au moins, lui faire un peu honte, et l'inciter à la plus élémentaire des prudences. En l'occurrence, tout simplement, ne rien dire, attendre que « ça se passe ». Ce n'est pourtant pas très difficile, ne rien dire ! Eh, bien, non ! Il a fallu qu'elle parle :