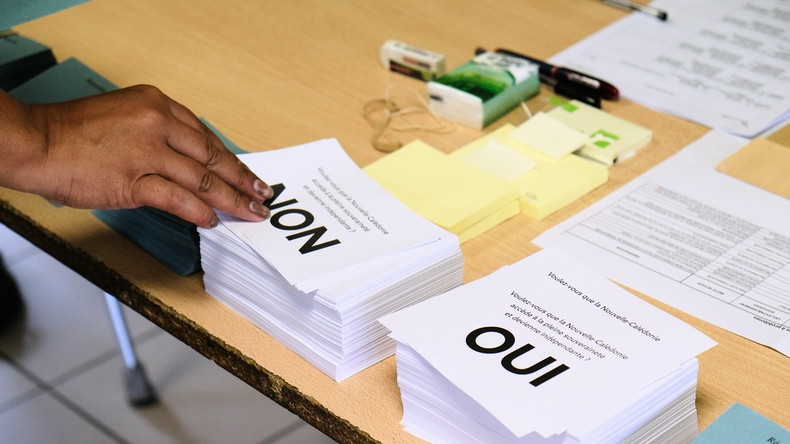Pédophilie : prudentes leçons, par Aristide Renou.
Illustration : Christine Ockrent et son fils Alexandre Kouchner. Hommage à la comédienne Marie-France Pisier lors d’une cérémonie en l’église Saint-Roch. Paris, 05/05/2011. © LE FLOCH/NIKO/SIPA
Les cris d’effroi accompagnent rituellement les dénonciations médiatiques de mœurs corrompus. On peut douter que la puissance publique aille véritablement à la racine du mal.
Nous avons eu, en moins d’un an, deux affaires d’abus sexuel sur mineurs extrêmement médiatiques, avec la parution des livres de Vanessa Springora et de Camille Kouchner.

Ces deux affaires présentent de nombreux points de ressemblance et pourraient nous apprendre – ou nous rappeler – bien des choses intéressantes sur un sujet censé nous tenir très à cœur : la lutte contre la pédophilie.
Mais allons-nous tirer les bonnes leçons de ces deux sordides histoires, emblématiques à plus d’un égard ? On peut en douter. Car certaines des conclusions évidentes qui découlent des récits de Vanessa Springora et Camille Kouchner (et de beaucoup d’autres, bien moins médiatiques) ne vont pas exactement dans le sens du politiquement correct.Commençons par énoncer les faits avant d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
Le caractère pathogène des familles décomposées
La première évidence est que les abus sexuels sur mineurs prolongés, et non ponctuels – comme dans les deux cas qui nous occupent –, ne sont pas une histoire qui se réduit aux deux protagonistes principaux, l’adulte et l’enfant ou l’adolescent. Ce sont des histoires de famille. Pour le dire simplement et brutalement : ce genre de crime se produit beaucoup plus souvent dans des familles recomposées ou décomposées que dans des familles intactes. Les statistiques sont impitoyables. Je vous en donne juste deux, venue des États-Unis, parce que je les ai sous la main : d’une part le taux d’infanticide augmente de 6000 %, et les abus sexuels augmentent d’un facteur de huit dans les familles recomposées par rapport aux familles traditionnelles. D’autre part, les jeunes filles ont plus de deux fois plus de chance (ou de risque) d’être sexuellement actives et de tomber enceinte avant l’âge de seize ans lorsque leur père a quitté le foyer avant leur sixième année. Le premier cas correspond à l’histoire des jumeaux Kouchner. Le second cas correspond à l’histoire de Vanessa Springora (ses parents se sont séparés l’année de ses six ans).
Le rôle des femmes
La seconde évidence, étroitement liée à la première est que si, presque toujours, les prédateurs sexuels sont des hommes, les femmes de l’entourage des victimes ne sont pas nécessairement innocentes pour autant, et plus particulièrement les mères. Lorsque son fils s’est ouvert à elle des agissements de son beau-père, Evelyne Pisier a pris la défense d’Olivier Duhamel et, semble-t-il, l’a défendu jusqu’à sa mort. Camille Kouchner lui prête les propos suivants : « Il regrette, tu sais, il n’arrête pas de se torturer… il a réfléchi, tu devais avoir déjà plus de 15 ans. Et puis, il n’y a pas eu sodomie. Des fellations, c’est quand même très différent. » Et on peut bien sûr se demander si Evelyne Pisier ignorait vraiment tout avant que son fils lui en parle. Cela semble très difficile à croire, surtout si l’on ajoute foi à cette autre déclaration rapportée par sa fille : « J’ai vu que vous l’aimiez, mon mec. J’ai tout de suite su que vous essayeriez de me le voler. C’est moi la victime. »
D’ailleurs Camille Kouchner n’a aucun doute : « Ma mère, ce n’est pas qu’elle n’a pas compris, elle a très bien compris. Ce n’est pas qu’elle a refusé, elle a tout à fait admis. C’est encore pire. Elle a minimisé. Elle s’est mise à le protéger lui, qui n’a même pas nié. » (Le Figaro).
À propos de sa mère, Vanessa Springora écrit : « ma mère a donc fini par s’accommoder de la présence de G. dans nos vies. Nous donner son absolution est une folie. Je crois qu’elle le sait au fond d’elle-même. (…) Parfois elle l’invite à dîner dans notre petit appartement sous les combles. À table, tous les trois, autour d’un gigot haricot-verts, on dirait presque une gentille petite famille, papa-maman enfin réunis, avec moi, au milieu, radieuse, la sainte trinité, ensemble, à nouveau. » Mais, bien sûr, la mère de Vanessa Springora sait que le monsieur qu’elle invite à partager le gigot dominical couche avec sa fille mineure, comme il a couché avec beaucoup d’autres avant elle et couchera avec beaucoup d’autres après. Et elle sait, en effet, au fond d’elle-même, que cela n’est ni normal ni bien. « Tes grands-parents ne doivent jamais savoir, ma chérie. Ils ne pourraient pas comprendre. »
Libération des déviances
Troisièmement, aucune famille n’est une île. Les lois, les mœurs et les opinions dominantes de la société dans laquelle se situent les familles ont toujours une grande importance sur le comportement de leurs membres, y compris, bien sûr, sur leur comportement sexuel. Dans le cas des deux affaires qui nous occupent, il est clair comme de l’eau de roche que ces abus sexuels ont été grandement facilités par ce que l’on peut appeler l’idéologie de la libération sexuelle. Ce sont ces opinions dominantes, au moins dans le milieu social où opéraient Duhamel et Matzneff, qui les ont aidés à se persuader qu’ils ne faisaient rien de mal et surtout à persuader leurs victimes qu’il ne leur arrivait rien de mal. Ce sont également ces opinions acceptées qui ont contribué à ce que, pendant si longtemps, tant de gens aient pu comprendre ce qui se passait sans s’en offusquer. Bref, l’idéologie de la libération sexuelle a grandement contribué à la bonne conscience des prédateurs, à la confusion des victimes et au silence de l’entourage.
« Est-ce mal » ? ce que fait leur beau-père, se demandaient les jumeaux Kouchner : « Ben non, puisque c’est lui. Il nous apprend, c’est tout. On n’est pas des coincés ! » Être « coincé », c’est considérer la sexualité comme une affaire morale, c’est affirmer qu’il existe en la matière des interdits et aussi des conduites plus ou moins honorables. Mais les désirs sexuels ne sont-ils pas essentiellement innocents et tous les plaisirs ne sont-ils pas également respectables ?
« Dans les années 70 », explique Vanessa Springora, « au nom de la libération des mœurs et de la révolution sexuelle, on se doit de défendre la libre jouissance de tous les corps. Empêcher la sexualité juvénile relève donc de l’oppression sociale et cloisonner la sexualité entre individus de même classe d’âge» Or « dans le courant des années quatre-vingt, le milieu dans lequel je grandis est encore empreint de cette vision du monde. Pour sa mère, ajoute-t-elle, “il est interdit d’interdire” est sans doute resté pour elle un mantra. »
Le bouclier d’une famille intacte
Tirons maintenant les conclusions qui s’imposent de ces faits. Tout d’abord, la meilleure protection contre les abus sexuels de ce genre, c’est une famille intacte, raisonnablement aimante et qui professe des opinions « conservatrices » en matière de sexualité, c’est-à-dire des parents qui apprennent à leurs enfants que, certes, la sexualité peut être une chose merveilleuse mais seulement si elle est vécue dans un cadre approprié, en ayant pleinement conscience de ses implications morales et sociales. Bref, idéalement, au sein du mariage, ou à défaut dans une relation qui s’en rapproche autant que possible.
Ensuite, les abus sexuels sur mineurs, ce n’est pas le grand méchant patriarcat ou la prétendue « culture du viol » si chers à nos féministes, c’est, plus banalement, la nature humaine dans toutes ses imperfections, imperfections auxquelles les femmes participent pleinement. Et le remède à une enfance ou une adolescence abimée par des agissements de cette nature, ce n’est pas de fuir loin des hommes et de la famille. Bien au contraire. Nombreuses sont celles à témoigner que c’est l’amour, et la maternité, qui les a sauvées des abus subis durant l’enfance.
Camille Kouchner : « Mes enfants m’ont donné le droit d’exister, ce qui est déjà beaucoup. Mais pour moi la réparation vient avant tout de l’intérieur. Le père de mes enfants m’a sauvé la vie […] »
Vanessa Springora : « Après tant d’échecs sentimentaux, tant de difficultés à accueillir l’amour sans réticences, l’homme qui m’accompagne dans la vie a su réparer beaucoup des blessures que je porte. Nous avons maintenant un fils qui rentre dans l’adolescence. Un fils qui m’aide à grandir. »
Ajoutons aussi le témoignage de la réalisatrice Andréa Bescons, qui a écrit et réalisé Les Chatouilles, violée dès l’âge de neuf ans par un ami très proche de ses parents : « De 26 à 28 ans, j’ai enchaîné les comportements à risque, les drogues, l’alcool… Si je ne rencontre pas mon compagnon Éric Métayer à 28 ans, je me jette sous un métro […] Dans les yeux d’Éric, j’ai trouvé quelqu’un qui enfin ne jugeait pas mes failles. »
Libération ou poison ?
Enfin, l’idéologie de la libération sexuelle est un poison, aussi bien pour les individus que pour le corps social. Un poison qui a abimé ou même détruit d’innombrables existences et qui a puissamment contribué à faire de la France ce corps politique débile qu’elle est devenue.
Je pourrais amplifier et ramifier ces considérations mais je m’arrêterais là, puisqu’aussi bien il suffit d’énoncer ce qui précède pour comprendre qu’aucune action sérieuse n’est à attendre pour diminuer ce qui est pourtant présenté comme un « fléau ».
En lieu et place de quoi, puisqu’il est impossible de rester sans rien faire face à un « fléau », nous devrions avoir une augmentation des lynchages médiatiques, dont certains, c’est fatal, toucheront des innocents, et des attaques répétées – et peut-être finalement victorieuses – contre des dispositions juridiques essentielles pour garantir la sureté de tous, comme le principe de la prescription ou celui de la présomption d’innocence. Nul besoin d’être grand clerc pour le prévoir : c’est déjà ce qu’on peut observer à propos des « féminicides », et pour des raisons très semblables.
Dieu étant par définition bon, je ne pense pas qu’il se gausse de nous voir chérir les causes des maux dont nous nous plaignons. Si la divinité est capable d’avoir des sentiments (ce qui, certes, peut se discuter), le plus approprié serait sans doute la pitié. Et peut-être, également, un peu de mépris.
Source : https://www.politiquemagazine.fr/





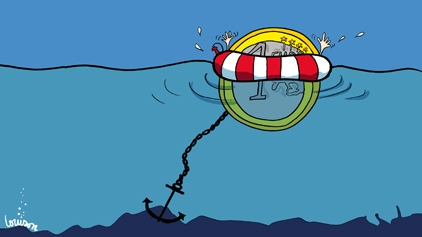
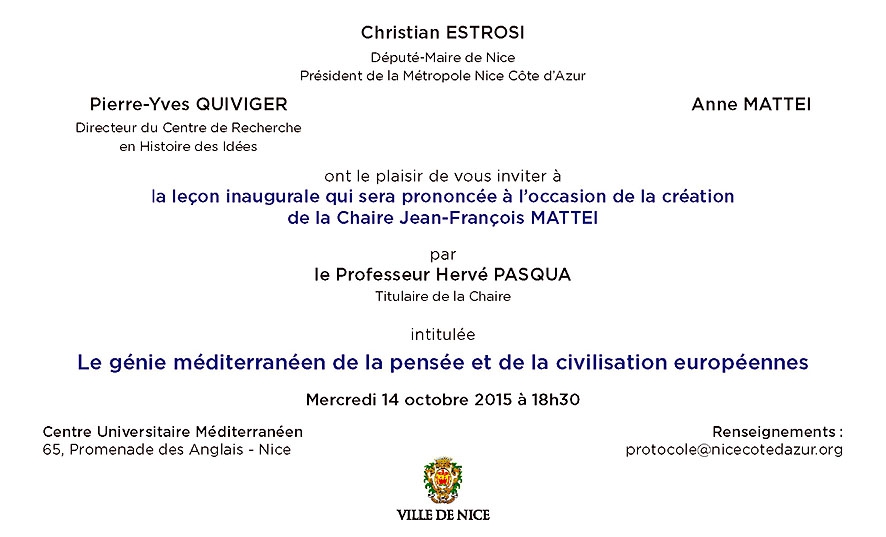









 Les chemins de la désespérance mènent droit à la lucidité. Gérard Depardieu en administre un éclairant exemple, ce mardi 16 juin, dans un entretien publié par le Figaro. Depardieu n’est pas qu’un acteur énorme qui profite de son immense popularité pour multiplier les provocations. Il est bien plus que cela, pour qui veut bien aller au-delà des sentences que les médias qui le sollicitent s’empressent de populariser pour les besoins de leur renommée.
Les chemins de la désespérance mènent droit à la lucidité. Gérard Depardieu en administre un éclairant exemple, ce mardi 16 juin, dans un entretien publié par le Figaro. Depardieu n’est pas qu’un acteur énorme qui profite de son immense popularité pour multiplier les provocations. Il est bien plus que cela, pour qui veut bien aller au-delà des sentences que les médias qui le sollicitent s’empressent de populariser pour les besoins de leur renommée.