LʼU.N.E.F.
La grande centrale du syndicalisme étudiant français, lʼU.N.E.F., entretenait des « relations bilatérales continues et cordiales »[1] avec lʼUnited National Student Association (U.S.N.S.A.), un syndicat étudiant américain né en août 1947 à Madison, dans le Wisconsin. Ses fondateurs, Alice Horton et Bill Ellis, lʼont créé en vue dʼen faire la branche américaine de lʼUnion internationale étudiante (U.I.E.), première organisation internationale étudiante à voir le jour, le 17 novembre 1946 à Prague, notamment sous lʼimpulsion de lʼU.N.E.F.
Or, suite au coup de Prague de 1948, Al Lovenstein, président de lʼU.S.N.S.A., organise à Stockholm une conférence qui amène à la création de la Conférence internationale étudiante (C.I.E.). Celle-ci devient ainsi lʼinternationale étudiante pro-américaine quand lʼU.I.E. tend à être son pendant pro-soviétique. À partir de ce moment-là lʼU.S.N.S.A. devient une antenne de la C.I.A., qui sʼen sert pour « obtenir des informations sur les activités internationales des syndicats étudiants »[2] LʼU.S.N.S.A. reçoit de généreux subsides de la part de la C.I.A. Le service de sécurité extérieure américain « finance secrètement une partie du programme de sa commission internationale. »[3] Son soutien financier sʼélève à 200 000 $ annuels.
Grâce à cette collaboration, lʼU.S.N.S.A et la C.I.E. disposent de « ressources financières importantes qui leur permettent dʼêtre omniprésentes sur la scène internationale »[4]. Mais cette collaboration suscite un scandale quand elle est révélée publiquement. Jean Lamarre évoque « la divulgation en 1967 par la revue Ramparts du soutien financier que la Central Intelligence Agency (CIA) accordait à lʼU.S.N.S.A depuis le début des années 1950 »[5].
Dans les années 1960, lʼU.N.E.F., en situation de crise aiguë, avait précisément besoin dʼargent. Ses effectifs avaient fondu, ce qui avait provoqué une situation de banqueroute. Elle était en outre minée par des jeux dʼappareil, entre une aile modérée – lʼentrisme du Parti socialiste unifié (P.S.U.) – et une aile radicale – lʼentrisme trotskiste –.
La Fédération des étudiants révolutionnaires (F.E.R.) sʼingénia à « provoquer une certaine terreur dans la direction, en faisant, de temps à autre irruption à son siège, 15, rue Soufflot, pour menacer, et parfois molester, ses dirigeants. Peu avant Pâques, la situation est telle que la direction de lʼU.N.E.F. est obligée de se réunir à Bois-Colombes, cité universitaire et à municipalité communiste. Venus saboter la réunion et prendre de force la direction de lʼU.N.E.F., les militants de la F.E.R. tombèrent à la fois sur un service dʼordre policier classique et les ʽʽgros brasʼʼ du P.C.F. La F.E.R. bat en retraite […]. Quelques jours plus tard, à Pâques, la F.E.R. se venge à la Sorbonne, en contraignant Perraud, président de lʼU.N.E.F., à démissionner, ʽʽà cause de sa mollesse, de son incapacité et de ses échecs.ʼʼ À cette occasion, Jacques Sauvageot, vice-président, prend la tête de lʼU.N.E.F., en attendant le prochain congrès prévu alors pour juillet à Caen. »[6]
Entre temps eurent lieu les événements de Mai 1968, où Sauvageot occupa un rôle majeur puisquʼil fit partie du groupe assurant la direction du mouvement. Il avait obtenu son poste à la tête de lʼU.N.E.F. suite à un coup de pression des trotskistes de la F.E.R., le mouvement de jeunesse de lʼOrganisation communiste internationaliste (O.C.I.), fondé et dirigé par lʼouvrier du livre encarté à F.O. Pierre Lambert (son vrai nom étant Boussel).
À la fin du mois de mai, la veille du meeting du stade Charléty, F.O., ce syndicat piloté par les Américains, avait participé à la coalition qui avait tendu la main aux trotskistes de la direction du mouvement de contestation dans le but de soutenir le projet de remplacer de Gaulle par lʼ « atlantiste »[7] Pierre Mendès France. Le 27 mai « des ambassadeurs du PSU, de la CFDT, de FO, des ʽʽpersonnalitésʼʼ se sont rencontrés en présence de Mendès. Krivine aurait reçu un carton dʼinvitation. À lʼordre du jour : un gouvernement de transition qui accorderait sa place au ʽʽcourant de maiʼʼ. »[8]
Alain Krivine appartenait à une autre obédience du trotskisme français que lʼO.C.I. Il animait la Jeunesse communiste révolutionnaire (J.C.R.), « quʼon prononce en Sorbonne la ʽʽJcreuʼʼ »[9], qui avait été fondée le 2 avril 1966. Dans une logique dʼouverture, la J.C.R. incitait ses militants à adhérer également au sein de lʼU.N.E.F. À Nanterre, dʼoù est parti Mai 68 avec le Mouvement-du-22-mars, son représentant est aussi membre de la J.C.R. : « Lʼannexe nanterroise du syndicat étudiant est à peu près aussi déliquescente que le bureau national et nʼattire que les mandataires de factions rivales qui sʼétripent en dʼinterminables assemblées générales où la victoire revient au plus endurant. Le bureau est ʽʽtenuʼʼ par un trotskiste mélomane, Jean-François Godchau, membre de la JCR dʼAlain Krivine. »[10]
En réalité, comme lʼaffirme Claude Paillat, durant la crise de Mai, celle-ci a occupé la fonction dʼinfrastructure organisationnelle de lʼU.N.E.F. « Il est évident quʼau cours des événements de mai-juin, lʼU.N.E.F. était tellement désorganisée, affaiblie par ses dissensions, ses dettes, son recul aux élections de facultés, quʼelle nʼétait plus capable dʼassurer la moindre action. Cʼest donc principalement la J.C.R. qui soutient, conseille, prépare le travail de lʼU.N.E.F. »[11] Lors de la création du Mouvement-du-22-mars, puis lors de la première émeute de grande ampleur, le 3 mai à la Sorbonne, J.C.R. et U.N.E.F. étaient effectivement présents.
On peut noter, enfin, quʼun syndicat étudiant américain autre que lʼU.S.N.S.A, le Students for a Democratic Society (S.D.S.), fondé par Tom Hayden, a concouru à lʼexaltation de la colère étudiante contre le gouvernement quand elle nʼétait quʼà ses prémices. Le 28 mars 1968, le doyen Grappin, à cause de lʼoccupation la tour de la faculté de lettres de Nanterre, décide de suspendre les cours et de fermer pour quelques jours lʼuniversité. Quand Nanterre est rouverte, ils sont mille deux cents jeunes à se rassembler pour écouter Karl Wolf, président de la branche allemande S.D.S., venu soutenir la contestation étudiante.
Les « enragés » de Mai 1968, qui se réclament du communisme le plus intransigeant, nʼeffrayent en rien les autorités américaines. Ce qui est pour le moins paradoxal. Au contraire elles voient dʼun bon œil cette révolte estudiantine contre le pouvoir gaulliste.
Vincent Nouzille écrit que « lʼambassadeur Shriver donne pour consigne à ses équipes dʼaller au contact de ce mouvement étudiant imprévisible. Lui-même, un libéral passionné par les courants de protestation aux États-Unis, se rend plusieurs fois rive gauche afin de prendre la mesure des manifestations. La résidence de lʼambassadeur, près de lʼÉlysée, se transforme en lieu de rencontres informelles, ouvert du matin au soir à de longues discussions entre professeurs, étudiants, fonctionnaires du ministère de lʼÉducation et diplomates. Un de ses conseillers, Robert Oakley, est chargé de monter un ʽʽcomité de jeunesseʼʼ parallèle à lʼambassade pour dialoguer avec des leaders étudiants ou politiques »[12]. En quelque sorte un comité de parrainage destiné à la jeunesse contestataire de France, si utile aux Américains, que de Gaulle exaspère au plus haut point.
Lʼextrême-gauche
Lʼalliance entre U.N.E.F. et révolutionnaires professionnels est visible durant la crise de mai-juin 1968. Par exemple, à lʼintérieur du Mouvement-du-22-mars ou lors de la première nuit dʼémeute dans le Quartier latin. Également, lorsque le mouvement sʼessouffle, suite à lʼannonce de la dissolution de lʼAssemblée nationale entraînant la tenue dʼélections législatives ainsi quʼà la grande marche pro-de Gaulle du 30 mai, le syndicat étudiant et les gauchistes entendent continuer les manifestations, dénonçant le principe du vote comme étant le moyen le plus efficace de museler les réelles aspirations populaires, un piège à cons en somme. « LʼUNEF est seule, le 1er juin, à organiser un défilé de Montparnasse vers Austerlitz. La CGT désavoue, le PC aussi, la CFDT sʼexcuse, le PSU se divise. Cohn-Bendit, Geismar, Sauvageot, Krivine, suivis de vingt mille obstinés, traversent le quartier Latin, drapeaux rouges et noirs en tête, et rodent leur nouveau slogan. ʽʽÉlections, tahisons !ʼʼ »[13] (Dossier à suivre) •
[1] Jean Lamarre, « Les relations entre les mouvements étudiants américain et français dans les années 1960. Une méfiance cordiale », Vingtième siècle, n° 129, janvier-mars 2016, p. 130.
[2] Ibid., p. 129.
[3] Idem.
[4] Idem.
[5] Ibid., p. 127.
[6] Claude Paillat, Archives secrètes. 1968/1969 : les coulisses dʼune année terrible, Paris, Denoël, 1969, p. 67.
[7] Hervé Hamon, Patrick Rotman, Génération. Les années de rêves, Paris, Seuil, 1987, p. 555.
[8] Ibid., p. 554.
[9] Ibid., p. 302.
[10] Ibid., p. 389.
[11] Claude Paillat, op. cit., p. 59-60.
[12] Vincent Nouzille, Des secrets si bien gardés. Les dossiers de la Maison-Blanche et de la CIA sur la France et ses présidents (1958-1981), Paris, Fayard, 2009, p. 199-200.
[13] Hervé Hamon, Patrick Rotman, op. cit., p. 560.
Retrouvez les articles de cette série en cliquant sur le lien suivant ...
Dossier spécial Mai 68




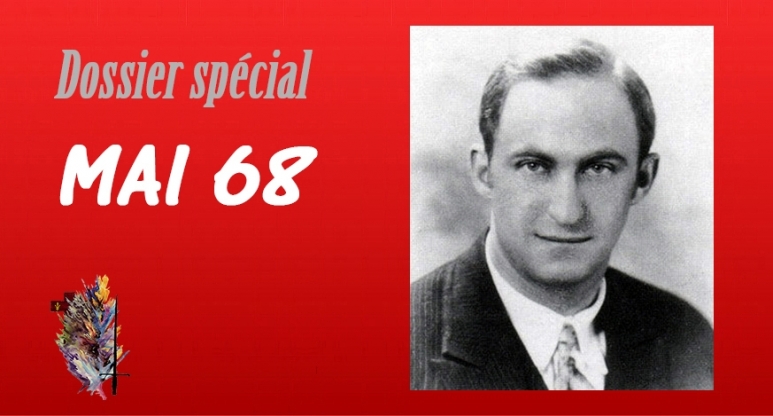






 Au fil de cet entretien avec Eugénie Bastié [
Au fil de cet entretien avec Eugénie Bastié [ Le climat est à la dénonciation d'un «retour du fascisme», notamment par des groupuscules d'extrême-gauche qui s'autoproclament « antifas ». Que vous inspire cette crainte ? Le fascisme en tant que mouvement politique est-il mort ou peut-il renaître de ses cendres ?
Le climat est à la dénonciation d'un «retour du fascisme», notamment par des groupuscules d'extrême-gauche qui s'autoproclament « antifas ». Que vous inspire cette crainte ? Le fascisme en tant que mouvement politique est-il mort ou peut-il renaître de ses cendres ?






