Rire ou sourire un peu ... même s'il n'y a pas vraiment de quoi

Signé BAUDRY
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Signé BAUDRY

Figure de la vie intellectuelle québécoise, Matthieu Bock-Côté exprime ici cette angoisse existentielle, cet esprit de résistance, cette redécouverte de la cause de la diversité des peuples, qui animent de plus en plus d'esprits face à la mondialisation se présentant comme une homogénéisation de la planète. Nous le rejoignons lorsqu'il affirme que l'avenir de la langue française serait dangereusement compromis si elle s'arrachait à sa littérature. Lafautearousseau •
Selon qu'il vienne du Québec ou de la France, l'éloge de la langue française n'a pas la même tonalité. Dans le premier cas, on célèbre et chante une langue fragile mais têtue, qui a survécu aux différentes tentatives pour l'effacer du continent nord-américain. Longtemps, les Québécois qui passaient par la France étaient émerveillés d'y voir une langue de pouvoir, nommant l'ensemble de la réalité. Dans l'autre, on célèbre le génie d'une langue à l'esprit universel, celle des écrivains et moralistes qui ont cartographié exceptionnellement au fil du temps les passions humaines en frappant des maximes de génie. Ces deux perspectives pourraient se féconder aujourd'hui.
Car chanter la langue française, désormais, consiste d'abord à célébrer une langue qui a été déclassée par l'anglais, apparemment seul idiome possible de la modernité. Les Québécois ont une longue expérience de cette résistance et portent à leur manière la cause des petites nations qui, devant le rouleau compresseur des empires, continuent d'avoir leur propre point de vue sur le monde. C'est ce qui avait poussé Alain Finkielkraut, dans L'Ingratitude, à dire qu'aujourd'hui, « nous sommes tous des Québécois ». Chaque nation sait aujourd'hui qu'elle peut se dissoudre et découvre une angoisse existentielle que seuls les sots traduiront dans le registre de la phobie.
Mais devant l'hégémonie anglophone, la France n'est pas n'importe quel pays. Quand les blocs s'affrontaient pendant la guerre froide, le général de Gaulle, sans renier l'attachement de la France au camp occidental, rappelait l'existence des peuples et leur souci d'indépendance. En 2003, au moment de la guerre d'Irak, c'est l'opposition de la France à l'entreprise américaine qui a sauvé l'honneur des démocraties occidentales. La France représente encore quelque chose de plus que la France dans le monde. C'est ce que le politologue québécois Christian Dufour a nommé « la résistance du numéro deux ». La France est peut-être seule capable d'inscrire la cause de la diversité des peuples au cœur de la vie internationale.
Surtout, la langue française, dans le monde occidental, par son prestige de civilisation et par la puissance politique qui pourrait encore être la sienne, en est venue à incarner le point de ralliement contre la domination de l'anglosphère. La langue française passe encore pour la grande langue de la culture. Il n'y a que la France et la francophonie qui peuvent faire de l'exception culturelle un projet politique à part entière. Encore faudrait-il qu'elle reconnaisse dans la francophonie davantage qu'une dimension tout à fait périphérique de sa politique étrangère et qu'elle ne se conçoive pas comme une province parmi d'autres de l'empire européen.
Une langue meurt lorsqu'elle ne parvient plus à traduire une nouvelle époque dans ses propres mots et lorsqu'elle emprunte systématiquement à une autre langue les termes pour nommer les réalités nouvelles. Il y a dans l'anglomanie qui a gagné la France depuis quelques années un zèle autodépréciateur inquiétant, comme si elle croyait que le vocabulaire de la mondialisation était nécessairement anglophone, qu'on évoque l'économie financière ou des nouvelles technologies. Start up, business, fashion week, lifestyle, smartphone, on pourrait aligner longtemps les mots servant à donner un cachet mondialisé à ceux qui entendent conquérir les marchés.
On se moque volontiers des Québécois qui maltraitent plus souvent qu'ils ne le devraient le français, tout en cherchant à l'imposer dans tous les domaines de l'existence. Ils sont pourtant fidèles ici à une exigence fondamentale: aucun domaine de l'existence ne saurait se soustraire à la langue française, qui peut tout nommer, tout traduire. Aucun État ne peut faire l'économie d'une politique linguistique à part entière, à moins de consentir à la provincialisation de sa langue, qui sera encore parlée dans les bourgades, mais qui renoncera à peser sur les affaires du monde.
Les modernes s'enthousiasment à l'idée de s'angliciser comme s'ils rejoignaient ainsi le petit club sélect des individus mondialisés, qui se croient capables de passer d'un pays à l'autre. D'autant qu'ils feront tout pour effacer l'originalité de chacun, la mondialisation se présentant comme une homogénéisation de la planète selon les exigences d'une culture globale. Inévitablement, ceux qui n'entrent pas dans le moule se font accuser de complaisance réactionnaire.
Mais on ne saurait défendre une langue sans célébrer son génie. Et c'est ici que l'éloge de la langue française se confond avec celui de la littérature française. Qui s'y plonge s'éduque. Encore doit-on y voir non pas seulement une série de fables amusantes pour distraire l'esprit mais bien une part vitale du patrimoine de l'humanité. Encore doit-on aussi la parler dans sa richesse et la sortir de la gaine étouffante de la langue des communicants. On n'en sort pas : une langue qui s'arrache à sa littérature se suicide. •
* Mathieu Bock-Côté est sociologue. Il est chargé de cours à HEC Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal ainsi qu'à la radio de Radio-Canada. Il est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels « Exercices politiques » (VLB, 2013), « Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois » (Boréal, 2012) et «L a dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire » (Boréal, 2007).

 Le Syndicat de la magistrature a encore frappé ! Avec le bon sens qu’on lui connaît, il rappelle urbi et orbi que le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles. Pour clôturer en beauté la campagne des départementales, il vient de rendre une décision qui, à n’en pas douter, enrichira les pages de jurisprudence placées sous l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 traitant de la diffamation.
Le Syndicat de la magistrature a encore frappé ! Avec le bon sens qu’on lui connaît, il rappelle urbi et orbi que le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles. Pour clôturer en beauté la campagne des départementales, il vient de rendre une décision qui, à n’en pas douter, enrichira les pages de jurisprudence placées sous l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 traitant de la diffamation.
Mais, qu’on me pardonne, je m’égare. Rien ne prouve, en effet, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 mars dernier soit l’œuvre du Syndicat de la magistrature. Si ce n’est lui, il l’a au moins inspiré. La justice française a si bien intégré le catéchisme républicain qu’il n’est plus nécessaire, à un syndicat gauchisant, de placer ses juges à chaque étage de l’édifice. Miracle de l’autodestruction d’une société analysée brillamment par Zemmour.
Mais de quoi s’agit-il, à la fin ? Simplement d’une injure publique. Celle d’un humoriste nommé Nicolas Bedos, sans doute un type très drôle comme son papa, une grande conscience de la République, un des gardiens du temple auréolé de respect par tout ce que la médiacratie compte de bien-pensants. Ce Nicolas Bedos écrivait, dans Marianne, en 2012 : « La droite entend ainsi lutter contre la montée de l’extrême droite. “Ne laissons pas le terrain à Marine, la VRAIE méchante” […]. Sauf que personne n’empêchera quelques idéalistes rigides de penser qu’à force de singer la salope fascisante, celle-ci est déjà au pouvoir : […] on l’appelle Claude Guéant. »
Marine Le Pen avait saisi le tribunal correctionnel uniquement sur le terme « salope ». Instruite par l’expérience, elle sait que l’adjectif « fascisant » est désormais admis – à son encontre – par la justice. Se faire traiter de « salope » reste, jusqu’à preuve du contraire, une injure, c’est-à-dire, selon la définition de la loi, « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Si quelqu’un veut tenter l’expérience à l’égard – par exemple – de madame Taubira, il comprendra rapidement la manière dont les juges apprécieront son sens de l’humour.
Mais n’est pas Bedos qui veut. Lui porte un si grand nom, qui plonge ses racines dans les tréfonds de l’histoire de France, qui évoque le sang versé pour la patrie, la grandeur de la nation et l’éminence des services rendus, qu’il peut se permettre de tels propos qui, d’injures, deviennent vérités, douloureuses mais pures. Surtout lorsque est revendiquée la liberté d’outrager, dès lors que les propos tenus émanent d’un « humoriste » engagé (à gauche). C’est ce qu’avait jugé le tribunal correctionnel. Pour lui, il était « parfaitement clair pour tout lecteur que la chronique en cause se situe dans un registre aux accents délibérément provocateurs et outranciers, revendiqué comme tel ». Saisie par Marine Le Pen, la cour vient de confirmer la relaxe, par des motifs qui ne sont pas encore connus, mais dont on doute qu’ils soient très différents.
Que signifie cette décision ? Tout simplement l’abandon du critère objectif de qualification de l’injure, appréciée en tant que telle. La justice ne dit pas (pas encore) que l’injure s’apprécie par rapport aux opinions politiques de la victime ou de l’auteur. Elle y viendra, car cette distinction illégale figure déjà en filigrane de toutes ses décisions depuis quelques années. Christiane Taubira en sait quelque chose.
Marine Le Pen peut se pourvoir en cassation. Dans l’immédiat, cette décision ouvre un grand espace de liberté pour l’entre-deux-tours. Et laisse présager à quel niveau le débat politique se situera en 2017. Nous en reparlerons… •
* Avocat, Boulevard Voltaire

Directeur du Figaro Hors-Série et du Figaro Histoire, Michel De Jaeghere nous livre avec Les derniers jours – la fin de l’empire romain d’occident une analyse éblouissante des causes qui entraînèrent la chute d’une civilisation qui se croyait, comme la nôtre, immortelle.
Peut-on dater précisément l’effondrement de la civilisation romaine ?
Les ruptures dans l’histoire ne sont jamais absolues. Pour marquer la fin de l’empire romain, on retient traditionnellement la date de 476, celle de la déposition du dernier empereur d’Occident. Pour autant, la civilisation gréco-romaine ne s’est pas effondrée du jour au lendemain. L’empire était en crise depuis le début du Ve siècle, et la romanité s’est perpétuée au vie, pour servir de matrice aux renaissances qui ponctueront le Moyen Âge. Il y aura encore pendant des décennies un sénat et des consuls à Rome, et l’aristocratie maintiendra longtemps les usages de la vie romaine en Italie, dans le sud de la Gaule ou en Espagne.
Contrairement à l’historiographie dominante, je me suis pourtant convaincu que 476 constituait une véritable rupture. La disparition de l’état romain n’a pas été sans conséquence. Elle a débouché sur un effondrement de la civilisation romaine. L’empire subsiste certes comme une prestigieuse fiction. Il y a toujours un empereur à Constantinople, et les références culturelles des rois barbares, comme Clovis, restent romaines. Beaucoup d’historiens en concluent aujourd’hui que la chute de l’état romain fut un détail sans importance puisque la romanité s’était maintenue sous une nouvelle forme. Je crois montrer à l’inverse que l’effondrement du pouvoir central a eu des conséquences catastrophiques du fait de l’interruption des échanges de longue distance, qui avaient été le vecteur de la prospérité romaine, de l’étiolement de la vie civique et de l’évergétisme (mécénat politique), qui avaient été au cœur de la civilisation antique – c’est par la carrière des armes qu’on s’élève désormais dans l’échelle sociale, non plus par la munificence dont on fait preuve à l’égard de ses concitoyens –, enfin de la disparition de la culture littéraire, qui réservera peu à peu l’usage de l’écriture aux clercs. à la fin du vie siècle, les grands seigneurs mérovingiens seront incapables de signer de leur nom, quand leurs homologues gallo-romains écrivaient, cent ans plus tôt, des vers précieux. Il s’était bien passé quelque chose entre temps.
L’assimilation des peuples étrangers, l’un des fondements de la civilisation romaine, cesse soudain… Pourquoi ?
Le ressort de la grandeur de Rome, comme l’a souligné Montesquieu, a été d’avoir su associer les vaincus à son destin. L’empire romain était depuis toujours un empire multiethnique et multiculturel, mais il avait fait l’objet d’une prudente et progressive politique de romanisation. La barbarie était aux yeux des Romains un état transitoire, dont il importait de faire sortir les peuples conquis en les faisant entrer dans la vie civique à quoi s’identifiait pour eux la civilisation. Après avoir humilié l’orgueil de leurs ennemis sur le terrain, leur avoir fait sentir leur domination en leur imposant de lourds tributs, ils favorisèrent, là où il n’existait pas, la mise en place d’un système d’administration municipale faisant prévaloir la discussion rationnelle sur la loi du plus fort. En même temps, ils encourageaient la diffusion de la culture littéraire par l’apprentissage du latin, et la diffusion de leurs mœurs par la construction de villes reprenant, avec leurs amphithéâtres, leurs aqueducs, leurs thermes, les canons de l’architecture romaine. Or, à la fin du IVe siècle, à la suite de la défaite d’Andrinople, marquée par la destruction d’une armée et la mort de l’empereur Valens sur le champ de bataille, Théodose est obligé de négocier une paix de compromis : il accueille les Goths dans l’empire sans les avoir soumis ; ils sont installés sur le sol romain dans le respect de leurs structures tribales. L’empereur espère faire d’eux des agriculteurs en même temps qu’une réserve de soldats, car l’armée comme la terre manquent de bras. On pense ainsi avoir trouvé une solution au changement de paradigme militaire : le passage de l’empire d’une guerre de conquête à une guerre défensive, qui mobilise des effectifs considérables, compte tenu de la longueur immense des frontières.
Et cette solution de court terme s’est retournée contre Rome…
En effet, les autorités romaines ont, sans s’en rendre compte, renié par là l’essence même de la romanité. Elles ont dans le même temps renoncé à leur rôle civilisateur et confié la guerre à des bandes étrangères. L’exemple n’en sera pas moins suivi tout au long du Ve siècle, débouchant sur la multiplication des enclaves étrangères, qui se considèreront peu à peu comme des principautés indépendantes. Les empereurs ont été condamnés à cet expédient par la faiblesse de la démographie romaine, le manque de ressources fiscales dans des provinces ravagées par les invasions, et par le peu d’appétence des populations de l’empire pour la carrière militaire. L’engagement dans les légions donnait traditionnellement accès à la citoyenneté romaine, mais, depuis l’édit de Caracalla (212), ce n’était plus un privilège puisque celle-ci avait été donnée à tous les habitants de l’empire. On manquait donc de candidats. La guerre défensive n’est pas très attirante, puisqu’elle vous condamne à partir loin de chez vous sans perspective d’amasser du butin. Les invasions qui se sont multipliées au ve siècle ont terrorisé les populations, renforcé leur sentiment d’appartenance à une romanitas opposée au barbaricum. Mais elles ne les ont pas conduites à s’engager en masse dans les légions. C’est peut-être là une leçon essentielle de l’histoire : les empires multinationaux sont très difficiles à défendre, car ils ne suscitent pas d’élan patriotique. Agrégat de peuples, ils ne sont pas une dilatation de la Cité. L’attachement que les populations leur portent est lié au fait que l’empire leur apporte paix et prospérité. Il ne crée pas le lien charnel qui justifie qu’on soit prêt à sacrifier sa vie, comme on le fait pour la défense de la terre de ses pères…
Vous terminez par un chapitre en forme d’avertissement pour le lecteur. Que devons-nous voir que nous ne pourrions comprendre sans l’histoire de Rome ?
Notre monde est ivre de sa prospérité, ivre de sa technologie qui lui procure une impression de toute puissance. Mon livre montre qu’il y a eu avant nous une civilisation qui était elle aussi extrêmement brillante et se croyait éternelle. Elle s’est effondrée sous le double jeu de l’immigration et des invasions, préludes à l’émergence de communautarismes qui la condamnèrent à la dislocation. Les barbares connaissaient suffisamment Rome pour avoir envie de profiter de ses richesses. On renonça à les coloniser car cela paraissait trop difficile et trop coûteux, sans penser que livrés à l’anarchie au-delà des frontières, ils seraient irrésistiblement attirés par les bienfaits de la civilisation. On les laissa s’installer sur le sol romain sans les avoir subjugués par la force, ni leur imposer le processus d’assimilation qui avait assuré, jusqu’alors, la romanisation des vaincus. Chacun est libre d’en tirer les conclusions qu’il veut pour notre temps. •
Dernier livre paru : Les derniers jours : La fin de l’empire romain d’Occident, les Belles lettres, 658 p., 26,90 euros.



En effet, Laurent Joffrin pourrait se reporter aux déclarations de Raphaël Glucksmann à France Inter, le 25 février dernier. A ses déclarations et à ses frayeurs. Il y trouverait d'assez sérieuses réponses à ses interrogations. Joffrin préfère jouer l'optimisme de gauche. Sa méthode est celle de la fausse naïveté. Raphaël Glucksmann est intellectuellement autrement plus honnête et plus lucide; ce jeune-homme distingué a des idées, des convictions - qui ne sont pas les nôtres - et de la passion. Mais lui, au moins, vend la mèche lorsqu'il alerte son camp : nous avons perdu l'hégémonie idéologique et culturelle ... Se reporter à la note que nous avons publiée le 27 février. Avec vidéo. •

Quand on a saisi que Clint Eastwood réalise la biographie filmée d'un authentique tireur d'élite qui a dégommé je ne sais plus combien de terroristes en Irak et qui a été assassiné, aux États-Unis, en février 2013 (c'est-à-dire il y a fort peu de temps) par un ancien Marine tourneboulé et dépressif, on comprend pourquoi le réalisateur ne fait grâce au spectateur d'aucune séquence.
Je suppose que l'image du héros national Chris Kyle, plutôt bien interprété par un certain Bradley Cooper (avec qui il a une réelle ressemblance physique, d'après les photos) devait être sculptée de façon marmoréenne et qu'aucun de ses exploits et aventures ne pouvait être élidé. D'où la répétitivité des séquences qui correspondent à ses quatre séjours au Proche-Orient qui auraient tout de même pu être largement condensées, fût-ce au détriment de la précision maniaque.
Autant le film s'étire démesurément, autant il commence bien, situe clairement ses personnages, fait quelques clins d’œil à Full Metal Jacket (entraînement des guerriers, bâtiments éventrés, flamboiement ici et là d'un arbre qui brûle, tireur dissimulé et efficace), pose clairement les enjeux, les dilemmes et les états d'âme d'un soldat qui doit, en quelques secondes décider de la vie et de la mort. Cette femme, ce gosse, qui s'avancent... de pauvres gens terrorisés qui viennent chercher du secours ou des kamikazes fous d'Allah ? Je tire (et je tue) ou non ?
Le problème de la guerre, aujourd’hui, c'est qu'il n'y a plus de guerre, qu'il n'y a plus deux armées qui se font face à face. Ou plutôt qu’en face d'une armée qui pourrait gagner la bataille en affrontant et en défaisant l'autre parce qu'elle est plus nombreuse, mieux armée, mieux commandée, qu’elle est formée de braves gars courageux dont tous ne sont pas obtus, qui ont un équipement d'une incroyable sophistication, qui sont appuyés, au sol et dans l'air par toute la force de la première puissance du monde il y a en face des miliciens fanatisés largement plus disposés à mourir que nous ne sommes prêts à les tuer. Comment gagner lorsque toute une population accepte de lancer comme autant de bombes humaines, des enfants fanatisés sur l'envahisseur ?
Ce qui fait un bout de polémique, dans le film de Clint Eastwood, c'est précisément que Chris Kyle et la plupart de ses compagnons d'arme n'ont pas nos délicatesses éthiques en magasin : ils mènent une guerre effarante où, de la moindre terrasse, de la moindre porte, de la moindre échancrure dans la dentelle des immeubles dévastés peut surgir la mort et le désastre. Ça rend fou, cela et nos sociétés amollies et compassionnelles n'ont plus le ressort nécessaire pour regarder en face les massacres. C'est comme ça, c'est sûrement un progrès, mais un progrès qui pourrait nous coûter cher.
Ah, oui, le film, alors... ? Si on a aimé Démineurs de Kathryn Bigelow, qui multiplie effets spéciaux, explosions diverses et corps hachés menu de la même façon, on pourra apprécier American sniper; mais l'un et l'autre film manquent tout de même beaucoup de dimension historique...
Et finalement, ce qui m'a le plus touché, dans le film d'Eastwood, ce sont les images d'archives où l'on voit les voitures qui conduisent au cimetière la dépouille mortelle de Chris Kyle, saluée, au long de son périple routier par des milliers de gens déployant fièrement la bannière étoilée.
Lorsque le convoi d'un soldat français tué en un des pays improbables où il a été criminellement envoyé par des potentats irresponsables, traverse le pont Alexandre III pour recevoir aux Invalides les honneurs militaires, je dois reconnaître que nous sommes beaucoup moins nombreux à venir lui rendre hommage. •
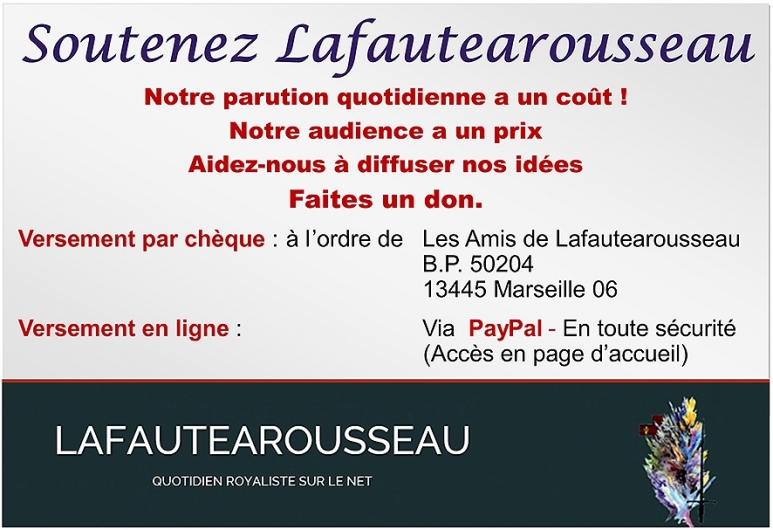
D'avance, merci à tous ceux qui voudront bien participer. A partir de 5 € !

Nous saluerons la reprise du montage poétique, consacré à des extraits de l’œuvre de Charles Péguy et à ses lettres écrites avant son départ pour le front de la Grande Guerre. Ils sont dits et interprétés par Michael Lonsdale. Cet acteur mystique, converti au christianisme à l’âge de vingt-deux ans est une sommité dans le monde du cinéma. Sa carrière théâtrale est aussi une des plus riches avec plus de 75 rôles et 16 mises en scène dont dernièrement, Yallah, Soeur Emmanuelle, spectacle créé par l’actrice Françoise Thuriès. L’acteur s’investit dans le parcours du poète qui tente d’unir le Charnel, la Terre et le Ciel. Poète qui, le 5 septembre 1914, premier jour de la bataille de la Marne, fut enlevé par la grande faucheuse, du monde des vivants, ou des survivants…
Cette splendide interprétation est mise en scène par l’acteur Pierre Fesquet, qui depuis 2007, crée des spectacles poétiques et musicaux. Le déroulement du spectacle est accompagné par Thierry Bretonnet à l’accordéon qui mêle ses improvisations musicales à la voix des comédiens.
On ne saura manquer d’assister à la reprise de ce spectacle en souvenir de l’auteur qui nous a laissé en testament la Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres :
Etoile de la mer voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l’océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers comblés,
Voici votre regard sur cette immense chape
Michael Lonsdale, le Frère Luc Des hommes et des dieux*, nous y attend ! •
Entre Péguy et Lonsdale
Théâtre de poche Montparnasse
75, Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
01 45 44 50 21
www.theatredepoche-montparnasse.com
Places : Plein tarif, 24 € / Tarif réduit : 18 € / Tarif jeune, moins de 26 ans : 10 €
Dimanche 29 mars à 15h ; Mercredi 1er avril à 19h ; Jeudi 2 avril à 19h ; Samedi 4 avril à 19h ; Dimanche 5 avril à 15h ; Mardi 7 avril à 19h ; Mercredi 8 avril à 19h ; Jeudi 9 avril à 19h ; Vendredi 10 avril à 19h.
* Des hommes et des dieux, film français réalisé par Xavier Beauvois, inspiré de l’assassinat des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Présenté le 18 mai 2010, au Festival de Cannes, il a obtenu le César du meilleur film.
Pour son rôle de Frère Luc, Michael Lonsdale a reçu :
Le César 2011 : Meilleur acteur dans un second rôle ;
Les Globes de Cristal 2011 : Meilleur acteur ;
Le Prix Henri-Langlois 2011 : Meilleur acteur ;
Le Prix Lumière 2011 : Meilleur acteur.
Source : Politique magazine

 « Le peuple français est en recherche d’un salut. Il le trouvera le jour où il comprendra que le système où il est enchaîné, ne peut pas lui en offrir. L’électoralisme induit des postures qui évitent d’aborder les problèmes de fond. Postures, contre-postures et impostures.
« Le peuple français est en recherche d’un salut. Il le trouvera le jour où il comprendra que le système où il est enchaîné, ne peut pas lui en offrir. L’électoralisme induit des postures qui évitent d’aborder les problèmes de fond. Postures, contre-postures et impostures.
Que peuvent-ils faire, tous ? Ces prétendus sauveurs qui cherchent à gagner les suffrages des Français en s’imaginant ou en faisant croire qu’ils ont des solutions. Or, dans le système politique actuel français, il n’y a pas de solution. » Hilaire de Crémiers •
Cliquer sur l'icône rectangle pour agrandir (Bas d'écran, à droite)

Il est loin le temps où les Grecs faisaient des cadeaux, mêmes empoisonnés. C’était celui des guerres en jupes courtes et jambières. Les dentelles sont venues plus tard. Mais, à bien y regarder, les menées d’Alexis Tsipras ne sont-elles pas un cadeau empoisonné ? Dénonçant le vrai problème mais appelant de leurs vœux les mauvaises solutions.
Au risque de caricaturer – c’est à la mode –, résumons la situation. Au commencement des années 2000, les Grecs, mal conseillés par quelque rusé Ulysse, falsifient leurs comptes pour s’introduire dans la zone Euro, moderne Cipango (le pays où tout se transforme en or). Une fois dans la place, la confusion des dettes d’état – et des investisseurs – leur permettait de s’endetter au même taux que l’Allemagne. Ils ne s’en privèrent pas et, entre 2000 et 2010, le produit intérieur brut grec doubla, le taux de chômage baissant de moitié. Pendant le même temps, le déficit annuel des paiements courants montait à 15 % du PIB.
La découverte de l’affaire déclencha une crise dont la monnaie unique ne sortit pas indemne. Les autorités européennes, pourtant coupables de négligence, imposèrent une cure d’austérité. La Grèce, qui avait péché par orgueil, était prise au piège : impossible de dévaluer sans sortir de l’euro et donc de « laisser filer » la monnaie, de renchérir les importations tout en rendant meilleur marché les exportations et de rétablir l’équilibre des comptes extérieurs. Restait la dévaluation interne.
Une bonne vieille saignée
Pour cela, on doit faire comme si on dévaluait… Mais on ne le fait pas, puisqu’on n’a plus la main sur la monnaie désormais gérée par des gens sérieux qui sont à Francfort. L’opération consiste à rétablir la compétitivité en abaissant la valeur du travail dans la zone considérée. Elle entraîne chômage massif et faillites en chaîne. La « main invisible », conceptualisée par Adam Smith, fait le reste : pour retrouver un emploi, les chômeurs acceptent un salaire inférieur et intègrent les entreprises intéressées par ces travailleurs bon marché – à condition, bien sûr, qu’il y ait encore des entreprises... La méthode, popularisée sous le nom « d’austérité », est longue à porter ses fruits. Comme pour une saignée, il s’agit de souffrir un bon coup, mais c’est pour du mieux – sauf, bien entendu, si le malade meurt pendant l’intervention…
C’est la potion avalée par la Grèce depuis 2010 : touchant aujourd’hui 25 % de la population active, le chômage a triplé, tandis que le produit intérieur brut a baissé de 30 %. En revanche, budget et compte courant sont à nouveau équilibrés. Petit couac : malgré un abandon de créance de 50 %, la dette est montée à 175 % du PIB...
Mais le peuple grec vit mal. Il proteste et a voté pour Alexis Tsipras qui leur a vanté les mérites d’un programme de relance fondé sur les déficits publics et la reflation monétaire. Ce programme a marché aux états-Unis et en Grande-Bretagne, pourquoi ne marcherait-il pas en Grèce ?
C’est oublier que la Grèce est un petit pays, qui demande que tout soit comme avant. Que les gens aient de nouveau de l’argent à dépenser, tout en restant dans la zone euro, si confortable.
Alexis Tsipras, aidé d’un ministre des finances à profil de parachutiste, a donc promis une embauche massive de fonctionnaires et une augmentation massive du salaire minimum. Des promesses qui ne sont pas sans rappeler le programme commun de la gauche en 1981. On sait comment cela s’est terminé : il avait presque fallu appeler le FMI à la rescousse.
Ainsi, si le diagnostic posé par le nouveau gouvernement grec est juste, le remède est inopérant. De plus, fort de comptes externes désormais équilibrés, sa menace de suspendre le paiement de sa dette revêt quelque substance. Alors que faire ?
Pas de sentiment national européen
L’urgence est à l’arrêt de la schizophrénie : il faut accepter la logique de ce qui est entrepris, ou changer de logique pour retrouver des moyens d’actions. La zone euro est une union douanière sur laquelle a été plaquée la monnaie unique. L’illusion est de penser que ses membres sauront faire preuve d’une solidarité à toute épreuve. Au contraire, leurs comportements restent égoïstes. En outre, ils se heurtent à un paradoxe : avant d’intégrer un nouveau membre, la Commission européenne pose l’orthodoxie financière comme prérequise à des pays souvent incapables d’y parvenir, en tous cas rapidement. Principe absurde. Comme il n’existe pas de « sentiment national » européen, tout naturellement, les pays refusent de payer les uns pour les autres – même pour un petit pays comme la Grèce ! Et puis cela risque de donner des idées à d’autres…
L’Allemagne a consenti des sacrifices pour sa réunification, avec l’aide de ses partenaires européens. En fera-t-elle autant pour l’Europe du Sud ? Rien n’est moins sûr. Les Allemands ne se déplacent plus, sauf pour affaires. C’est un changement. Ceux qui font remarquer que les Allemands ont bénéficié de moratoires financiers en 1953 et 1990 sont des esprits chagrins ou superficiels qui ont trop lu la fable du loup et de l’agneau. L’Europe du Sud veut-elle devenir allemande, qu’elle aille en Prusse.
Le manque de ressources des Grecs
Les demandes d’Athènes sont légitimes, mais les contreparties offertes sont inaudibles. Comme si les Grecs ne savaient que demander, parce qu’ils ont peu à offrir. Ont-ils les moyens et la volonté d’entreprendre ce qu’il convient aujourd’hui d’appeler des « réformes » ? La Grèce, contrairement à l’Argentine, qui a fait défaut en son temps, a peu de ressources, à part le tourisme. De même, le niveau de l’euro la gêne, même après 20 % de baisse. Pourtant, le problème est à peu près réglé. Mais pas à un niveau qui satisfasse les Grecs : la perte de pouvoir d’achat est trop forte.
C’est pour ses origines qu’on a accepté la Grèce dans le club fermé de la monnaie unique ; mais on ne veut plus fermer les yeux sur les expédients. On a oublié qu’Europe était fille du roi de Phénicie et non de Prusse. On préfère désormais le sérieux au chic et on ne souhaite plus faire les fins de mois des cousins éloignés, avec ou sans quartiers de noblesse. •
Source : Politique magazine
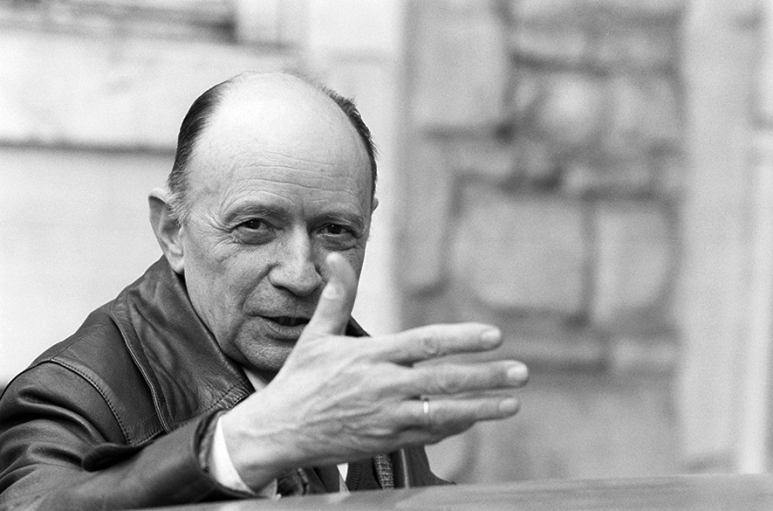
Les hommes de ce temps, avec plus de passion encore qu'au XIXe siècle, chargent le politique de leurs passions et de leurs espoirs, mais vivent dans un état d'hypnose singulièrement inquiétant. Malgré les expériences passées, il ne semble pas que l'on ait acquis une vue tant soit peu réelle de la chose, et l'interposition de mythes rend toujours aussi vaine la pulsion politique, aussi retardataire la pensée. Sans doute les circonstances nous ont conduits à remettre en question nos certitudes politiques d'hier, nous savons aujourd'hui la fragilité de l'opinion publique la plus fortement affirmée dans un glorieux plébiscite, nous savons que la souveraineté du peuple est un mythe étiologique sans incarnation possible, nous savons que « le suffrage universel n'est pas un procédé efficace pour contrôler et juger le pouvoir, ni un moyen de modérer réellement le combat entre les forces politiques et sociales opposées, ni un processus de sélection des gouvernants les plus aptes* ».
Jacques ELLUL
L'Illusion politique, Paris, Robert Laffont, 1965
* Citation du Club Jean Moulin, L'Etat et le Citoyen, Ed. du Seuil, 1961
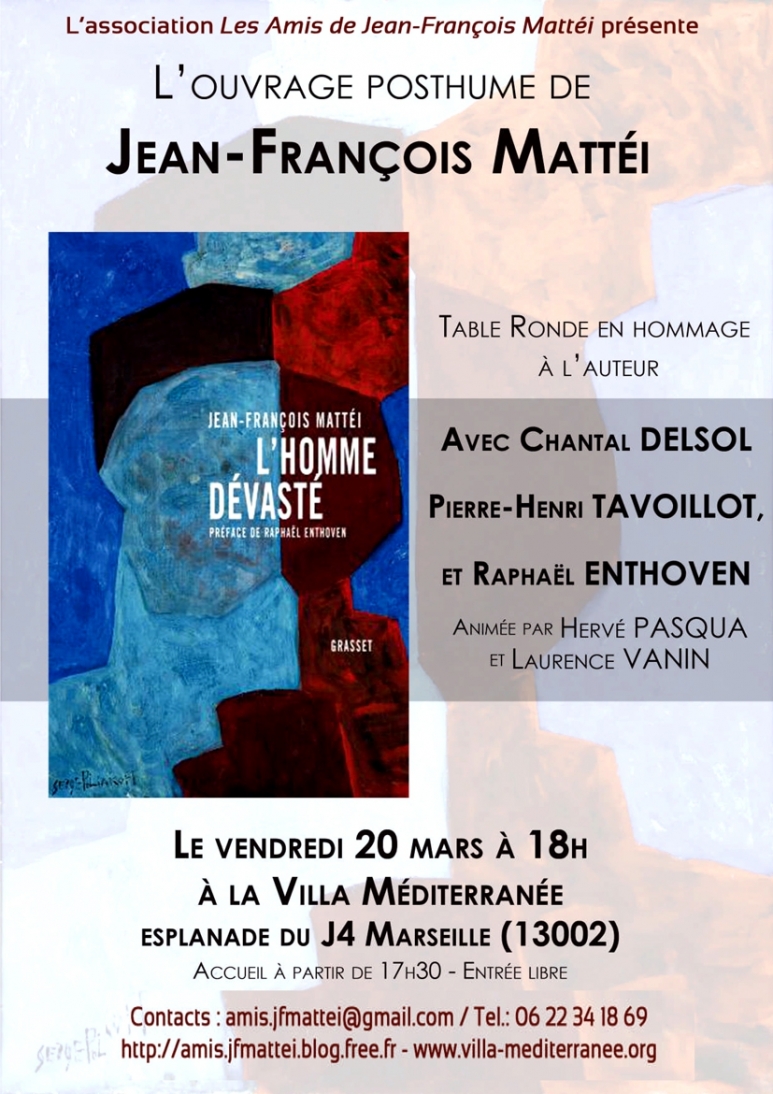
 Pour adhérer à l'Association des Amis de Jean-François Mattéi, veuillez cliquer ici : Bulletin d'adhésion JFM.doc.
Pour adhérer à l'Association des Amis de Jean-François Mattéi, veuillez cliquer ici : Bulletin d'adhésion JFM.doc.
Par ailleurs, nous participerons, bien entendu, à la table ronde qui est annoncée ci-dessus, à laquelle nous avons été aimablement invités.
Et d'autre part, nous n'oublions pas que Jean-François Mattéi faisait partie du Comité de Parrainage de Politique magazine; qu'il avait participé à nos rassemblements royalistes des Baux de Provence; qu'il assistait chaque année non seulement à la Messe du 21 janvier, à Marseille, mais qu'il est intervenu dans presque tous les dîners-conférences qui ont suivi; qu'il était présent, en septembre 2012 à la journée d'hommage à Charles Maurras, organisée à Martigues par les Amis de la Maison du Chemin de Paradis et que, précisément, il y était intervenu pour traiter du premier des livres de Charles Maurras, ouvrage qui, justement a pour titre Le Chemin de Paradis; nous n'oublions pas que Jean-François Mattéi a écrit dans Lafautearousseau; qu'il a donné de nombreuses et remarquables conférences dans nos Cafés politiques de Marseille et d'Aix-en-Provence; enfin qu'il est aussi intervenu dans plusieurs colloques de la Restauration Nationale et dans une réunion du CRAF*, à Paris.
Bref, Jean-François Mattéi nous honorait de son amitié et nous nous sommes largement nourris de sa réflexion et de ses travaux, comme en témoignent les nombreux documents écrits ou audiovisuels qui sont conservés dans nos archives.
Nous en donnerons d'ailleurs quelques-uns à lire ou relire, voir ou revoir, dans les semaines et les mois qui viennent.
En tout cas, le souvenir et l'amitié de Jean-François Mattéi demeurent très vivants et très présents dans nos pensées et nos mémoires. Ils ne s'effaceront pas. Lafautearousseau •
* C.R.A.F. : Centre Royaliste d'Action Française

Compte non tenu de leur soutien quasi inconditionnel envers Israël - sauf les quelques périodes ou circonstances où la France fit exception - les pays occidentaux, au cours des vingt-cinq dernières années, sont intervenus militairement au Proche-Orient et dans le monde musulman, à de multiples reprises et dans une perspective telle, fondée à la fois sur l'idéologie et la supériorité écrasante de leurs armes, que des conséquences graves ne pourraient manquer de survenir. Les dirigeants des Etats et coalitions d'Etats qui ont mené ces opérations ne se sont pas soucié de leurs suites. Hormis d'installer partout la démocratie, ils n'ont pas prévu les lendemains d'intervention; sans plan sérieux de reconstruction des structures, institutions, groupes dirigeants qu'ils détruisaient, ils s'y sont partout enlisés, ils y ont partout échoué (Irak, Afghanistan, Libye) ils ont installé partout le chaos. Au contraire, au lieu de se réduire, ce chaos, comme il était prévisible, s'est répandu très au delà des théâtres d'opération initiaux. A vrai dire, dans tout le Proche-Orient, tout le Levant, toute l'Afrique du Nord et dans de nombreux Etats africains après que l'intervention française en Libye eût ouvert et livré aux djihadistes les riches arsenaux que détenait et contrôlait Kadhafi ... Dans l'anarchie des Etats détruits a surgi Daech et l'ordre islamiste. Quant à l'Europe, elle subit, aujourd'hui, à la fois les attentats, les risques et les conséquences du terrorisme, un surcroît d'immigration du fait des guerres et du chaos du Proche-Orient, d'Afrique et même d'Asie qui poussent les populations à la fuite, et, pour ce qui est de la France, la charge lourde et difficile des opérations extérieures. L'armée française les mène brillamment malgré ses moyens limités - très diminués au cours des dernières décennies- mais avec des chances de résultats à l'évidence aléatoires.
Voilà, au lendemain des attentats du Bardo à Tunis, le constat et, en quelque sorte, le bilan que l'on peut dresser, selon nous, des vingt-cinq dernières années d'errements diplomatiques et géopolitiques, où les Etats-Unis ont sans-doute la part la plus importante, mais où les cercles dirigeants et médiatiques européens, français notamment, ne sont pas en reste. La fable des Printemps arabes montée et entretenue de toutes pièces par nos politiques et les médias, notamment français - qu'ils ne se décident pas, d'ailleurs, à mettre en sourdine - aura coûté cher aux intéressés comme aux occidentaux. Et comme il n'en existe et subsiste qu'un fragile vestige à Tunis, les attentats d'hier prennent une résonance, une importance particulières.
En somme, tout le monde paye aujourd'hui l'addition des illusions et des erreurs du dernier quart de siècle et d'un certain nombre d'hommes - pas si nombreux qu'on pourrait croire - qui ont tout simplement manqué de culture et de sagesse politiques, de réalisme et de bon sens. Qui plus est nous ignorons à ce jour à combien cette addition se montera ni jusqu'à quand elle continuera d'augmenter. •