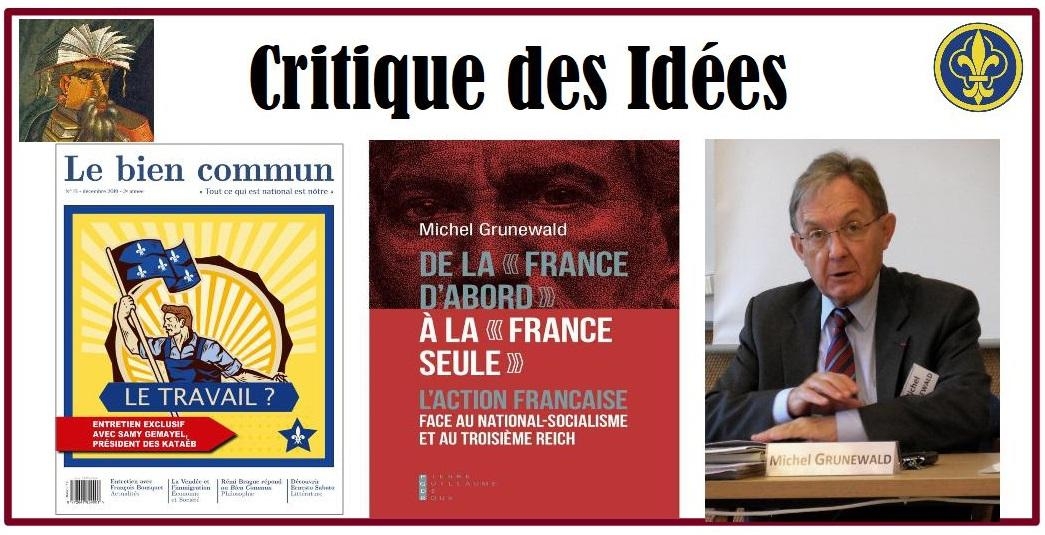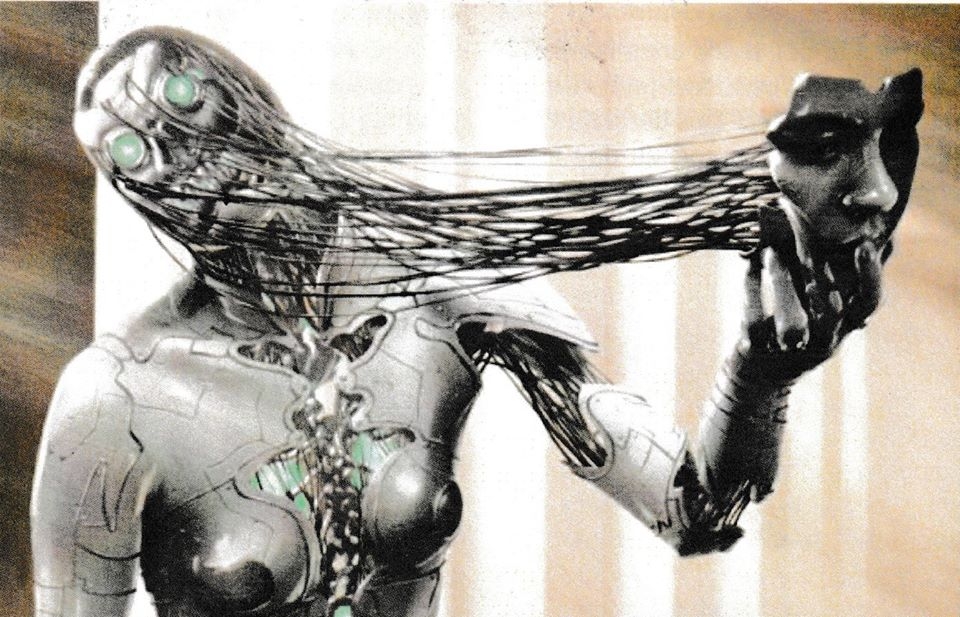Boualem Sansal : La France en voie de faire allégeance au Calife ? Discours sur l'Islamisme

Boualem Sansal et Daniel Pouzadoux
Intervention de Boualem Sansal devant la Fondation Varenne [13 décembre 2016]*. Importante tant par son contenu - nous laissons nos lecteurs le découvrir - que parce qu'elle a été faite devant de grands noms de la presse française et d'illustres personnalités. LFAR
Il ne faut désespérer ni Billancourt, ni le Qatar, ni l’institut
Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir,
Daniel Pouzadoux m’a fait l’amitié de m’inviter à votre cérémonie et il a poussé la gentillesse jusqu’à me demander de venir au pupitre dire quelques mots. Je le remercie très chaleureusement. Je vais le faire en essayant de ne pas vous ennuyer, j’ai tendance ces derniers temps à me répéter, et pas de la meilleure façon, je veux dire la politiquement correcte.
Je ne sais pas si vous l’entendez mais je vous le dis, parler devant vous n’est pas facile, dans la salle je vois de grands noms de la presse française… c’est impressionnant. Et flatteur pour moi, dans mon pays, l’Algérie, j’ai droit au traitement pour lépreux, on lâche les chiens, on jette des pierres. En ce moment, à la suite d’un supposé amalgame, blasphème, ou mauvaise pensée de ma part, on délibère à mon sujet, et la fumée n’est pas blanche, ça ne dit rien de bon. Mais passons, rien n’est certain tant qu’il n’est pas arrivé.
Je voudrais, avec la permission de Daniel, et la vôtre aussi, vous dire deux trois choses sur l’islamisme. Il y a d’autres sujets mais celui-ci les dépasse, il tient le monde en haleine, et la France en premier, elle est une pièce essentielle dans son programme de domination planétaire. C’est ici qu’il gagnera ou perdra face à l’Occident, il le croit, voilà pourquoi il s’y investit avec tant de rage, derrière laquelle cependant agit un monde étonnant de froide intelligence et de patience.
Personne ne peut mieux qu’un algérien comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, l’Algérie connaît l’islamisme, elle en a souffert vingt années durant.
Je ne veux pas laisser entendre que l’islamisme est fini dans ce pays, simplement parce que le terrorisme a reflué, c’est tout le contraire, l’islamisme a gagné, à part quelques voix dissonantes qui s’époumonent dans le désert, rien ne s’oppose à lui, il a tout en main pour réaliser son objet. Tout son programme, dont le terrorisme est un volet important mais pas le plus important, il en est dix autres qui le sont davantage, ne vise que cela : briser les résistances, éteindre les Lumières avec un grand L et installer les mécanismes d’une islamisation en profondeur de la société. On peut dire que l’islamisme ne commence véritablement son œuvre qu’après le passage du rouleau compresseur de la terreur, à ce stade la population est prête à tout accepter avec ferveur, humilité et une vraie reconnaissance.
On en est là en Algérie, le programme se déroule bien, les islamistes travaillent comme à l’usine, ils contrôlent tout, surveillent tout, le point de non-retour est franchi et le point final arrive comme un coup de poing. Encore quelques réglages et nous aurons une république islamique parfaite, tout à fait éligible au califat mondial. Vous en entendrez parler, je pense.
Un exemple pour le montrer : dans la petite ville où j’habite, à 50 kms d’Alger, une ville universitaire dont la population, 25000 habitants environ, se compose essentiellement d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants, il y avait avant l’arrivée de l’islamisme, dans les années 80, une petite mosquée branlante, coloniale par son âge, que ne fréquentaient que quelques vieux paysans des alentours ; aujourd’hui, après deux décennies de terrorisme et de destruction, et alors que le pays manque de tout, il y en a quinze, toutes de bonne taille et bien équipées, eau courante au robinet, hautparleurs surpuissants, climatisation et internet à tous les étages, et je vous apprends que pour la prière du vendredi elles ne suffisent pas pour accueillir tous les pénitents. Il faudrait clairement en construire quinze autres ou réquisitionner les amphis et les laboratoires. Attention, je ne fais pas d’amalgame, ni de persiflage, je ne dis pas que les pénitents sont des islamistes, aucun ne l’est, je vous l’assure, n’ayez crainte, je dis simplement que les islamistes ont bien travaillé, en peu de temps ils ont assaini le climat et fait de nous de bons et fidèles musulmans, ponctuels et empressés, et jamais, au grand jamais j’insiste, ils ne nous ont demandé de devenir des islamistes comme eux. « Point de contrainte en religion », c’est dans le Coran, sourate 2, verset 256.
En Algérie, on suit avec beaucoup d’inquiétude l’évolution des choses en France. Je ne parle pas de nos islamistes, ils se félicitent de leurs avancées chez vous, ni de notre gouvernement, tout entier mobilisé au chevet de son vieux président, M. Bouteflika, je parle de ceux qui ont de l’amitié pour vous et ceux qui ont des parents en France et qui voudraient les voir continuer de vivre leur vie française le mieux possible. Je vous le dis, ceux-là sont inquiets, très très inquiets et même désespérés. Ils vous en veulent pour cela.
Inquiets parce qu’ils constatent jour après jour, mois après mois, année après année, que la France ne sait toujours pas se déterminer par rapport à l’islamisme : est-ce du lard, est-ce du mouton, est-ce de la religion, est-ce de l’hérésie ? Nommer ces choses, elle ne sait pas, c’est un souci. Pendant ce temps, le boa constrictor islamiste a largement eu le temps de bien s’entortiller, il va tout bientôt l’étouffer pour de bon. Insouciante qu’elle est, la mignonne est allée faire amie-ami avec les gros cheikhs du Golfe que chacun sait être les géniteurs et les dresseurs du boa et surtout d’anciens redoutables détrousseurs de caravanes.
Inquiets de voir la France des libertés verser dans le maccarthysme. Que se passe-t-il, bon sang, il n’est plus possible, pour personne, de parler de certains sujets liés à la Chose sans se voir aussitôt traîné au tribunal et condamné sévèrement. On en sort encore avec des amendes, des sursis et des marques à l’épaule, mais le jour n’est pas loin où on se verra appliquer la vraie charia.
Inquiets et dégoutés de voir cette grande nation laïque et avant-gardiste exhiber à tout bout de champ ses imams et ses muftis, ses pachas de l’UOIF, ses commandeurs du CFCM, et, pour la note moderne, deux trois sœurs cagoulées à l’arrière-plan, comme jadis au temps des colonies de papa elle promenait de cérémonies en cérémonies ses caïds chamarrés bardés de médailles, ses marabouts en boubous et autres sorciers en plumes, et repousser fermement ceux qui peuvent parler aux gens sans réciter un seul verset ou lever de doigt menaçant au ciel. On croirait que la France n’a pas été décolonisée en même temps que ses colonies ou que la laïcité y a été abrogée par un édit du grand imam.
Inquiets et en colère de voir que les algériens de France, pourtant instruits de la vraie nature de l’islamisme, et pis, qui savent qu’il a lancé une OPA sur leurs enfants, ne s’engagent pas plus que ça dans la lutte contre lui, pas au-delà des protestations de principe : « C’est pas ça l’islam » ; « L’islam est paix, chaleur et tolérance », « l’islam est une chance pour la France ». Misère, comment le dire : l’urgent n’est pas de sauver l’islam de l’amalgame mais de sauver les enfants de la mort
Inquiets et effarés de voir l’Europe se déliter et devenir un amplificateur de crises et fabricant d’un islamisme européen véritablement monstrueux, qui par ses prétentions totalitaires et ses haines tous azimuts, s’apparente au nazisme-fascisme d’antan, qu’il contribue de la sorte à ressusciter.
Désespérés en fin de compte de voir que la France et l’Europe sont à mille lieues de pouvoir concevoir et mener ensemble le seul combat qui puisse venir à bout de l’islamisme : le contre-djihad, conçu sur le principe même du djihad. Et le djihad n’est pas la guerre, c’est mille chamboulements dans mille domaines différents, menées sans restriction ni frein, dans un mouvement brownien accéléré irréversible.
Après tout ça, y-a-t-il de l’espoir ? Oui, il existe, il est puissant, la France est un grand pays avec une immense histoire pleine de ressort et d’énergie, il continue de vivre et de se projeter dans l’avenir, mais chacun sent que l’effort coûte de plus en plus, que le poison islamiste court dans ses veines, que la langueur de la décadence le travail, que le pays perd de sa cohérence et de son unité, que le gouvernement n’y entend goutte, que l’Europe est un boulet, bref chacun comprend que la fin approche. L’espoir est précisément là, dans cette horrible sensation que l’Histoire est finie, c’est là que le désespoir trouve sa meilleure énergie.
Il y a une condition cependant, un vrai challenge de nos jours, la France doit retrouver l’usage de la parole libre et en faire une arme. Si le terrorisme se combat dans la discrétion et la patience, par le renseignement et l’infiltration, l’islamisme se combat par la parole, dite au grand jour, haut et fort. Ce combat a toujours été celui des journalistes et des écrivains, qu’ils reprennent le flambeau, il est à eux.
On n’oubliera pas de mener ce combat en premier contre l’armée des idiots utiles et des bienpensants, qui avec une poignée de

 Emmanuel Macron se pense un chef. Il l’a dit et répété ; et comme un chef charismatique dont le jeune âge et la fulgurante carrière rehaussent le prestige.
Emmanuel Macron se pense un chef. Il l’a dit et répété ; et comme un chef charismatique dont le jeune âge et la fulgurante carrière rehaussent le prestige. 
 Il y a quelques jours, dans un lycée professionnel de Gagny, une enseignante était molestée par un élève qui, l'ayant acculée contre le tableau, lui avait asséné une gifle, pendant qu'un autre filmait et que des rires gras résonnaient dans la classe, constituant la désolante bande-son de cette courte vidéo.
Il y a quelques jours, dans un lycée professionnel de Gagny, une enseignante était molestée par un élève qui, l'ayant acculée contre le tableau, lui avait asséné une gifle, pendant qu'un autre filmait et que des rires gras résonnaient dans la classe, constituant la désolante bande-son de cette courte vidéo.