Qu'est-ce qu'être français ? Le point de vue charnel de Polémia.....
( Source : Polémia http://www.polemia.com/article.php?id=2475 )
Nicolas Sarkozy s’est fait élire président de la République sur le thème de « l’identité nationale ». A quelques mois des élections régionales de 2010, il remet le sujet sur le devant de l’actualité et charge Eric Besson d’organiser un « débat national sur l’identité nationale ».
Or dès l’origine du débat, Eric Besson définit son objectif final en rappelant la « commande » qu’il a reçue du président de la République pour lequel : « notre nation est métissée. L’immigration constitue une source d’enrichissement permanent de notre identité nationale ». Et Eric Besson de rappeler : « On a un président de la République qui a dit : “Je suis un homme de sang mêlé à la tête d’une nation métissée”. »
Lancer ainsi un débat sur l’identité nationale c’est une imposture : « Etre français » ne se réinvente pas tous les jours. Au contraire, c’est s’inscrire dans une continuité, non dans une rupture !
Voici le point de vue charnel de Polémia.
1/ Etre français, c’est appartenir à une lignée ; une lignée « qui vient du fond des âges » (Charles De Gaulle). Parler de « nos ancêtres les Gaulois » est globalement vrai ; car c’est reconnaître que le peuple français demeure l’héritier des Gallo-Romains ; sa composition ethnique est restée quasiment inchangée jusqu’au début des années 1970 : blanche et européenne. Dans sa monumentale Histoire de la population française, le démographe Jacques Dupâquier le rappelle aux ignorants et aux malveillants.
2/ Etre français, c’est appartenir à une civilisation : la civilisation européenne et chrétienne. L’héritage spirituel et culturel prolonge ici l’héritage ethnique. Etre français, c’est partager des croyances communes et un imaginaire commun. Etre français, c’est partager la mémoire des poèmes homériques, des légendes celtes, de l’héritage romain, de l’imaginaire médiéval, de l’amour courtois. Etre français, c’est, qu’on soit chrétien pratiquant ou non, participer de la vision et des valeurs chrétiennes du monde car le catholicisme est un élément de l’identité française.
3/ Etre français, c’est être de langue française ; « la langue française notre mère » qui façonne notre esprit et est le merveilleux outil d’exercice de notre intelligence et de découverte des « humanités ». Un Français, c’est un Européen d’expression française.
4/ Etre français, c’est partager une histoire, une mémoire, c’est avoir en commun « un riche legs de souvenirs » (Renan) ; car « La nation, comme l’individu, est l’aboutissement d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime » (Renan). Etre français, c’est partager la fierté de la grande épopée nationale de la Monarchie, de l’Empire et de la République. « La patrie, c’est la terre et les morts » (Barrès). Etre français, c’est avoir son patronyme inscrit, dans un village, sur un monument aux morts commémorant la grande ordalie de 1914. Et c’est s’interroger sur le sens de ce sacrifice et sur les exigences qu’il nous impose aujourd’hui.
5/ Etre français, c’est partager l’amour d’un territoire : de ses terroirs, de ses paysages, de ses hauts lieux. Etre français, c’est aimer la France, ses rivages, ses vallons et ses sommets, ses vignes et ses prairies, ses champs et ses forêts, ses chênaies, ses châtaigneraies, ses oliveraies, ses villages, ses bourgs, ses collines inspirées, ses cathédrales, ses églises, ses chapelles, ses sources, ses halles au grain, ses maisons de maître et ses fermes fortifiées, ses châteaux, ses palais et ses villes. Etre français, c’est aimer le Mont Saint-Michel, Saint-Émilion et Camembert.
6/ Etre français, c’est partager des musiques et des sons, ceux de la lyre et de la cornemuse, du piano et de la guitare, de l’accordéon ou de l’orchestre symphonique. Etre français, c’est avoir le sens du travail bien fait, c’est rechercher une certaine perfection dans le métier. C’est aussi, pour les meilleurs des artisans d’art, le sens de ce qui relie l’esprit à la main.
7/ Etre français, c’est partager des goûts et des odeurs. Etre français, c’est partager à table des moments de bonheur. Etre français, c’est manger du cochon, de l’andouillette, du petit-salé, du cassoulet et du saucisson. Etre français, c’est partager la baguette et le fromage, l’époisses et le maroilles, le brie de Meaux et le coulommiers, le reblochon et le roquefort, le cantal et le laguiole. Etre français, c’est goûter la Blonde d’Aquitaine et le Charolais, l’Aubrac et la Limousine. Etre français, c’est boire du vin de Loire ou de Bordeaux, d’Alsace ou de Bourgogne. Etre français, c’est déguster de vieux alcools, du cognac, de l’armagnac, du calvados et de la mirabelle.
8/ Etre français, c’est partager « Le désir de vivre ensemble », « la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. (…) Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. (…) Le chant spartiate : “Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes” est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute patrie » (Renan).
Epilogue
Les mosquées et les tam-tams, le ramadan et les gris-gris, les minarets et les boubous, la charia et la sorcellerie africaine, la langue arabe ou l’ouolof, la arica et le manioc, le palmier et le baobab ne sont nullement méprisables ; seulement voilà : ils ne font pas partie de la civilisation française.
Bien sûr, les hommes et les femmes qui viennent d’autres mondes peuvent devenir français – au sens culturel, pas seulement administratif et social du terme – s’ils veulent et parviennent à s’assimiler. Mais ce n’est évidemment pas à eux de changer l’identité nationale !
Il faut ici citer le sage propos de Charles De Gaulle : « C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne » (Cité dans Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, t. 1, éditions de Fallois/Fayard, 1994, p. 52).

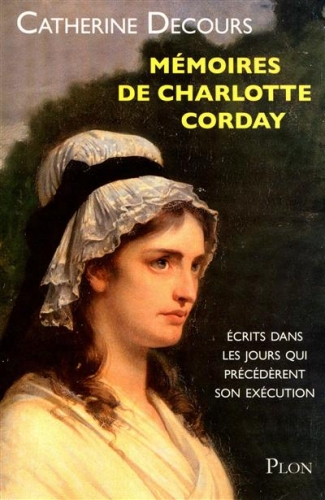







 La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande.
La Coupe du monde de rugby s’est donc achevée sur la victoire prévisible de la Nouvelle-Zélande. Valérie Trierweiler, Éric Zemmour, tels sont les deux plus fortes diffusions de cet automne et non sans raison. Entre les deux un abîme où gît le vrai mal français.
Valérie Trierweiler, Éric Zemmour, tels sont les deux plus fortes diffusions de cet automne et non sans raison. Entre les deux un abîme où gît le vrai mal français. La version anglaise des confessions de Valérie fait se gausser les Britanniques. Ce sera bientôt le tour des Italiens, des Chinois et des Russes. La planète ondule d’une vaste rigolade ! « Ainsi me reconstruis-je, moi, Valérie », a signifié hautement l’héroïne. En attendant, l’image de notre président est à jamais détruite.
La version anglaise des confessions de Valérie fait se gausser les Britanniques. Ce sera bientôt le tour des Italiens, des Chinois et des Russes. La planète ondule d’une vaste rigolade ! « Ainsi me reconstruis-je, moi, Valérie », a signifié hautement l’héroïne. En attendant, l’image de notre président est à jamais détruite.

 Beyrouth-sur-Seine : avec leur générosité imbécile pour toute la misère du monde, leur géopolitique du Bien et du Mal et leur fausse diplomatie des droits de l’homme, leur « Padamalgam » pour toute morale pratique, leur « France ouverte » et leur multiculturalisme comme horizon indépassable de l’humanité, leur « république de la diversité », leurs « chances pour la France », leur société inclusive, ils sont comblés. Faire France, comme ils disaient ! Engagez-vous, rengagez-vous dans le camp de la mondialisation heureuse. La France est devenue un village festif.
Beyrouth-sur-Seine : avec leur générosité imbécile pour toute la misère du monde, leur géopolitique du Bien et du Mal et leur fausse diplomatie des droits de l’homme, leur « Padamalgam » pour toute morale pratique, leur « France ouverte » et leur multiculturalisme comme horizon indépassable de l’humanité, leur « république de la diversité », leurs « chances pour la France », leur société inclusive, ils sont comblés. Faire France, comme ils disaient ! Engagez-vous, rengagez-vous dans le camp de la mondialisation heureuse. La France est devenue un village festif.
 C’était il y a près de cent ans. La Première Guerre mondiale venait de s’achever. Le traité de Versailles avait été signé. Un grand économiste, le plus grand de son temps, l’Anglais John Maynard Keynes, publiait un ouvrage, Les Conséquences économiques de la paix, pour expliquer que la France et les vainqueurs avaient été trop durs envers l’Allemagne vaincue, et qu’en particulier celle-ci ne pourrait jamais payer les énormes réparations pécuniaires réclamées. Un grand historien français, journaliste de profession, Jacques Bainville, lui répondit dans un livre intitulé Les Conséquences politiques de la paix. Il expliqua au contraire que le traité de Versailles avait été, selon sa célèbre formule qu’on apprenait naguère dans les cours d’histoire, « trop mou pour ce qu’il avait de dur et trop dur pour ce qu’il avait de mou ». Mais cet affrontement de points de vue sur le traité de Versailles n’intéresserait plus aujourd’hui que les historiens si, dans son livre, Jacques Bainville n’avait, avec une prescience extraordinaire, annoncé tous les événements qui conduiraient à la guerre, la remilitarisation de la Rhénanie, l’Anschluss avec l’Autriche, le dépeçage de la Tchécoslovaquie, le pacte germano-soviétique et l’attaque de la Pologne, avant celle de la France et de l’Angleterre.
C’était il y a près de cent ans. La Première Guerre mondiale venait de s’achever. Le traité de Versailles avait été signé. Un grand économiste, le plus grand de son temps, l’Anglais John Maynard Keynes, publiait un ouvrage, Les Conséquences économiques de la paix, pour expliquer que la France et les vainqueurs avaient été trop durs envers l’Allemagne vaincue, et qu’en particulier celle-ci ne pourrait jamais payer les énormes réparations pécuniaires réclamées. Un grand historien français, journaliste de profession, Jacques Bainville, lui répondit dans un livre intitulé Les Conséquences politiques de la paix. Il expliqua au contraire que le traité de Versailles avait été, selon sa célèbre formule qu’on apprenait naguère dans les cours d’histoire, « trop mou pour ce qu’il avait de dur et trop dur pour ce qu’il avait de mou ». Mais cet affrontement de points de vue sur le traité de Versailles n’intéresserait plus aujourd’hui que les historiens si, dans son livre, Jacques Bainville n’avait, avec une prescience extraordinaire, annoncé tous les événements qui conduiraient à la guerre, la remilitarisation de la Rhénanie, l’Anschluss avec l’Autriche, le dépeçage de la Tchécoslovaquie, le pacte germano-soviétique et l’attaque de la Pologne, avant celle de la France et de l’Angleterre.


 Emmanuel Macron a-t-il le sens de la mesure ? Saura-t-il ne pas aller trop loin ? Son discours de Versailles, devant le Congrès, n’a pas eu l’effet escompté : la presse oligarchique elle-même, qui a pourtant fait en grande partie son élection mais envers laquelle il se montre désormais ingrat, la tenant à distance de ses déplacements ou la privant de 14-Juillet, a moqué un discours «
Emmanuel Macron a-t-il le sens de la mesure ? Saura-t-il ne pas aller trop loin ? Son discours de Versailles, devant le Congrès, n’a pas eu l’effet escompté : la presse oligarchique elle-même, qui a pourtant fait en grande partie son élection mais envers laquelle il se montre désormais ingrat, la tenant à distance de ses déplacements ou la privant de 14-Juillet, a moqué un discours « 


 Question désormais récurrente, même si elle apparaît, pour l'heure, sans effet immédiat ; discussion de principe plutôt qu'efficiente, donc, mais question posée de plus en plus souvent et qui traverse tous les milieux, tous les médias ; évocation - voire invocation - de plus en plus fréquente de la figure du Roi, bien au-delà des cercles royalistes traditionnels et qui surgit des profondeurs de l'opinion sans que les dits cercles royalistes y soient - apparemment - pour grand-chose. Le temps, la crise ouverte du Système politique et idéologique, le désamour des Français pour les politiques, les médias, la doxa dominante, travaillent pour leurs idées plus et mieux qu'ils ne savent eux-mêmes le faire ...
Question désormais récurrente, même si elle apparaît, pour l'heure, sans effet immédiat ; discussion de principe plutôt qu'efficiente, donc, mais question posée de plus en plus souvent et qui traverse tous les milieux, tous les médias ; évocation - voire invocation - de plus en plus fréquente de la figure du Roi, bien au-delà des cercles royalistes traditionnels et qui surgit des profondeurs de l'opinion sans que les dits cercles royalistes y soient - apparemment - pour grand-chose. Le temps, la crise ouverte du Système politique et idéologique, le désamour des Français pour les politiques, les médias, la doxa dominante, travaillent pour leurs idées plus et mieux qu'ils ne savent eux-mêmes le faire ... 
 Il n’est pas certain que la classe politique française ait mesuré toute l’importance du discours du roi Mohammed VI pour le soixante-troisième anniversaire, le 20 août dernier, de la Révolution du Roi et du Peuple, qui devait conduire à la fin du protectorat français sur le Maroc.
Il n’est pas certain que la classe politique française ait mesuré toute l’importance du discours du roi Mohammed VI pour le soixante-troisième anniversaire, le 20 août dernier, de la Révolution du Roi et du Peuple, qui devait conduire à la fin du protectorat français sur le Maroc.
 L'Europe traverse depuis des décennies une crise qui, hélas, n'est pas seulement politique, économique ou institutionnelle.
L'Europe traverse depuis des décennies une crise qui, hélas, n'est pas seulement politique, économique ou institutionnelle.