Le scandale des éoliennes, par Fabien Bouglé.
Table des matières
1 Par Fabien Bouglé, lanceur d’alerte écologique, Le Bien Commun
1.1 En quoi sommes-nous concrètement des victimes ?
1.2 Ces infrasons sont aussi un danger pour les populations humaines…
1.4 Un business qui coûte cher au contribuable…
1.5 Entrevoyez-vous un motif d’espoir pour les lecteurs du Bien Commun ?
L’implantation d’éolienne est souvent soutenue par des lobbys qui se prétendent écologistes ou des organisations politiques comme Europe Écologie Les Verts. Votre livre Éoliennes : la face noire de la transition écologique semble prendre le contrepied de ces gens-là.

 L’écologie c’est du bon sens et, avant tout, un acte de préservation. Ce n’est pas l’apanage d’un parti politique, c’est universel. Nous considérons donc que tout doit être fait pour préserver la nature, la vie des animaux et la vie de l’homme. Nous pourrions même dire l’oeuvre de Dieu. En somme, la véritable écologie se résume à bien vivre, dans un environnement sain, non contaminé par la pollution.
L’écologie c’est du bon sens et, avant tout, un acte de préservation. Ce n’est pas l’apanage d’un parti politique, c’est universel. Nous considérons donc que tout doit être fait pour préserver la nature, la vie des animaux et la vie de l’homme. Nous pourrions même dire l’oeuvre de Dieu. En somme, la véritable écologie se résume à bien vivre, dans un environnement sain, non contaminé par la pollution.
Certains ont dévoyé ce principe. C’est notamment le cas des promoteurs éoliens qui ont créé un business. D’autres comme Europe Écologie Les Verts s’emploient à faire de la basse politique, une écologie idéologique et malthusienne. Ces gens-là détestent l’humain. Les promoteurs éoliens, les partis écologistes, les ONG environnementales, et même plus grave la Mafia, communient dans un business désastreux. Pour eux l’écologie c’est la préservation de la nature à l’exception de l’homme. Nous ne pouvons le tolérer. Nous sommes victimes de cette approche biaisée.
En quoi sommes-nous concrètement des victimes ?
Au nom de l’injonction « sauver la planète » avec un biais idéologique, on détruit le cadre de vie des humains. C’est l’environnement qui est directement atteint. Nos côtes sont industrialisées et nos paysages détruits. On implante désormais des éoliennes qui font 240 mètres de haut à 500 mètres des habitations. C’est l’âme de nos contrées, celle de laFrance en particulier que l’on attaque. Les éoliennes installées dans notre paysage sont autant de blessures de notre pays et autant de dégradations de la vie de nos concitoyens. Avec les éoliennes, la nature est saccagée au nom du principe de défense de la nature. Il faut bien se rendre compte qu’une éolienne c’est d’abord une chose extrêmement polluante. Onpeut reconnaître que le mât est facilement recyclable. Mais pour le reste, c’est une autre histoire. Le socle est constitué de 1500 tonnes de béton sur un ferraillage de 50 tonnes et les pales sont en fibres de carbone… Si on incinère celles-ci, elles font une fumée cancérigène. Elles sont donc enterrées dans des décharges… Enfin, le pire reste la nacelle qui contient des terres rares : 200 kg pour une petite, une tonne pour les éoliennes en mer. Elles sont extraites à Baotou en Chine, où il existe un lac toxique à cause des déchets d’extraction. On exporte donc notre pollution. Dans les quartiers bobos, on peut se permettre d’être écolo pour l’éolien en détruisant le cadre de vie de nos campagnes et l’environnement en Asie. On détruit des écosystèmes entiers. Dans les champs, les chauves-souris sont massivement broyées par les pales d’éoliennes qu’elles ne semblent pas percevoir et les rapaces – notamment les faucons et les milans royaux – sont déchiquetés par ces sortes de hachoirs géants qui tournent à 300 km/heure. Pour ce qui est de l’éolien en mer, les infrasons détruisent la faune maritime. On assiste d’une part à une disparition conséquentedes oiseaux marins, d’autre part à des échouages massifs de baleines et de dauphins à cause des infrasons.
Ces infrasons sont aussi un danger pour les populations humaines…
Oui, la santé des citoyens est considérablement affectée. La NASA l’a établi dans des rapports, il y a déjà 30 ans. Ces sons basses fréquences, non-audibles par l’oreille humaine, conduisent à une modification de la pression atmosphérique.Elles perturbent jusqu’à 20 km et peuvent amener des modifications cellulaires. Le biologiste Wolfgang Müller a écrit un livre en juillet 2019 à ce sujet-là. Verdict : ces vibrations sonores sont responsables de ce qu’on appelle le syndrome éolien : nausées, vertiges, tachycardie, problèmes cardio-vasculaires…
Vous nous parlez de rapports de la NASA. Les sources de votre livre sont-elles donc assez accessibles ?
Toute ma documentation n’est quasiment que de la source ouverte. D’ailleurs, le contenu de mon bouquin est rarement contesté sur le fond. Toute personne qui veut se plonger sur le sujet a une masse conséquente de documents à disposition. Et c’est édifiant ! L’éolien est une imposture. Cela saute aux yeux de toute personne qui se penche vraiment dessus. Ce qui est intéressant c’est qu’il est présenté comme un acteur ou un outil qui va sauver la planète. Sur le fondement faux que les éoliennes empêchent l’émission de gaz à effets de serre.
Cela a été prouvé à maintes reprises. Comme je l’écris dans lelivre : en France, le président de la Commission de régulation de l’énergie et le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur le sujet l’ont encore affirmé. En plus, c’estencore plus absurde dans notre pays où l’électricité est – grâce au nucléaire – décarbonée à 90 %. En raison de l’intermittence des éoliennes, on est obligé d’utiliser des « back-up » quandelles ne tournent pas. Ces derniers fonctionnent au gaz et au pétrole, chez nous, et au charbon en Allemagne. Vouloir imposer l’éolien c’est remplacer de l’électricité nucléaire décarbonée par une électricité intermittente. En Allemagne, ils ont dépensé 500 milliards d’euros en éoliennes et la baisse desémissions de gaz à effet de serre est nulle, selon un rapport de la Cour des comptes fédérale. Les promoteurs éoliens répondent désormais à ces faits établis que l’éolien permet un mix énergétique. Plus prosaïquement, que cela permet de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. C’est un peu court comme argumentaire. Depuis 30 ans, on a de cesse de se faire déstabiliser par des lobbys aux mains de puissances étrangères qui ne rêvent que d’une chose : c’est de détruire notre indépendance énergétique pour détruire notre compétitivité. Ces éoliennes n’ont qu’un objectif : remplacer une électricité pas chère par quelque chose de plus coûteux. Qui y a intérêt ? L’Allemagne. L’éolien est un business industriel.
Un business qui coûte cher au contribuable…
Au travers de ce combat, j’ai découvert que le tarif de rachat de l’éolien en mer était de 220 euros le méga watter soit cinq fois le prix habituel. En faisant un calcul simple (5 minutes) on peut affirmer que cela revient à une subvention de plus de 40 milliards d’euros. Le gouvernement a renégocié mais cela fait toujours 30 milliards par an… Au passage, ce qui est extraordinaire c’est que le tarif de rachat subventionné est rémunéré par un fonds alimenté notamment par la hausse de lataxe sur l’essence. Il y a un lien direct entre la crise des gilets jaunes et le financement des éoliennes. De plus ce qui est ahurissant, c’est que ces subventions n’ont pas lieu d’être. En effet de l’aveu même des promoteurs le marché de l’électricité éolienne est compétitif. Si c’est compétitif, ils gagnent déjà de l’argent. Alors pourquoi le contribuable devrait financer dessubventions ? Ces subventions ne servent à rien si ce n’est enrichir les promoteurs éolien. C’est ça que j’ai découvert et que je dénonce et dévoile dans mon bouquin.
Entrevoyez-vous un motif d’espoir pour les lecteurs du Bien Commun ?
Oui, bien sûr ! L’éolien est mort. Il n’existera plus dans quelques années. La Pologne, après la COP 24, a arrêté toute implantation d’éoliennes. Elle a même un plan de désinstallation. En République tchèque, le ministre de l’écologie parle de « monstre blanc ». La Norvège vient de suspendre son programme national d’installation d’éoliennes. L’Allemagne a baissé de 82 % son nombre d’éolienne, l’année dernière. C’est évident et inéluctable, l’éolien disparaîtra. Je suis d’ailleurs en désaccord profond avec des associations de défense des paysages et du patrimoine qui prônent des adaptations dans l’installation d’éolienne. Il faut être au contraire d’une très grande fermeté. Je n’ai pas écrit un livre qui explique : les éoliennes c’est pas bien, c’est polluant, ça ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre et ça coûte cher, pour faire de la demi-mesure ensuite. Cela n’aurait aucunsens. Il ne faut plus ériger de nouvelles éoliennes et démonter la totalité de celles qui existent.
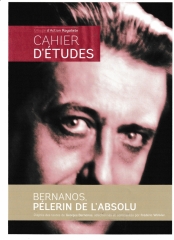







 Mais ce concordat à la mode AMIF est inutile… car il existe déjà un concordat de fait. La France n’a pas jugé bon de procéder comme le Canada à d’officiels accommodements raisonnables ; elle s’est contentée de promulguer des lois tout en incitant à ne pas les faire respecter. Si Redoine Faïd a pu rester caché trois mois en se déplaçant en burqa, dont le port dans l’espace public est illégal, c’est que personne ne contrôle, verbalise, arrête les femmes en burqa – parce que la hiérarchie conseille de ne pas contrôler, comme en témoignent les policiers. Si Gérard Collomb parle de deux populations « côte à côte » (tout en laissant son successeur face à face avec ce problème), c’est que tout a été fait pour que la population musulmane, sécularisée ou non, puisse se constituer de manière autonome. Manuel Valls parlait d’apartheid, ce qui avait effarouché les bons esprits). D’une part, en refusant tout traitement statistique qui aurait pu alerter officiellement sur les mutations démographiques en cours. D’autre part, en favorisant l’afflux d’immigrés musulmans, le sommet de l’absurdité étant atteint avec la Fraternité comme principe d’absolution des passeurs qui introduisent illégalement des immigrés (cf. Politique Magazine n° 172). Tout l’appareil judiciaire fonctionne en permanence dans la validation des mœurs islamistes, voile ou burkini par exemple, en amont et en aval, dans l’installation de zones de non-droit par le laxisme des jugements prononcés et des peines effectuées, les juges refusant de considérer et la lettre de la loi et le contexte sécessionniste des infractions. Les procédures sont compliquées à loisir et détournées à l’envi sans que jamais elles soient modifiées dans un sens efficace. Même le combat intellectuel est mené par la Justice contre les adversaires de l’islamisme, comme en témoigne le procès Bensoussan : non seulement le parquet avait jugé recevable la première plainte, mais il a fait appel du jugement de relaxe ! Et a laissé plaider le CCIF, pourtant irrecevable… Le CCIF et le PIR instrumentalisent une justice qui leur aplanit toute difficulté.
Mais ce concordat à la mode AMIF est inutile… car il existe déjà un concordat de fait. La France n’a pas jugé bon de procéder comme le Canada à d’officiels accommodements raisonnables ; elle s’est contentée de promulguer des lois tout en incitant à ne pas les faire respecter. Si Redoine Faïd a pu rester caché trois mois en se déplaçant en burqa, dont le port dans l’espace public est illégal, c’est que personne ne contrôle, verbalise, arrête les femmes en burqa – parce que la hiérarchie conseille de ne pas contrôler, comme en témoignent les policiers. Si Gérard Collomb parle de deux populations « côte à côte » (tout en laissant son successeur face à face avec ce problème), c’est que tout a été fait pour que la population musulmane, sécularisée ou non, puisse se constituer de manière autonome. Manuel Valls parlait d’apartheid, ce qui avait effarouché les bons esprits). D’une part, en refusant tout traitement statistique qui aurait pu alerter officiellement sur les mutations démographiques en cours. D’autre part, en favorisant l’afflux d’immigrés musulmans, le sommet de l’absurdité étant atteint avec la Fraternité comme principe d’absolution des passeurs qui introduisent illégalement des immigrés (cf. Politique Magazine n° 172). Tout l’appareil judiciaire fonctionne en permanence dans la validation des mœurs islamistes, voile ou burkini par exemple, en amont et en aval, dans l’installation de zones de non-droit par le laxisme des jugements prononcés et des peines effectuées, les juges refusant de considérer et la lettre de la loi et le contexte sécessionniste des infractions. Les procédures sont compliquées à loisir et détournées à l’envi sans que jamais elles soient modifiées dans un sens efficace. Même le combat intellectuel est mené par la Justice contre les adversaires de l’islamisme, comme en témoigne le procès Bensoussan : non seulement le parquet avait jugé recevable la première plainte, mais il a fait appel du jugement de relaxe ! Et a laissé plaider le CCIF, pourtant irrecevable… Le CCIF et le PIR instrumentalisent une justice qui leur aplanit toute difficulté.

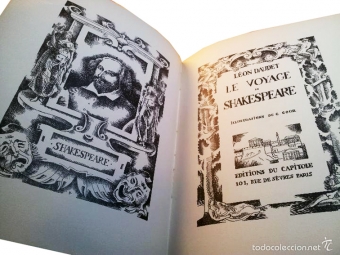 Dans la mouvance de l’Action française, il est permis, certes, de lui préférer le « libre réactionnaire » Léon Daudet, auteur de l’admirable Voyage de Shakespeare ou Jacques Bainville dont la pertinence historiographique n’a cessé d’être corroborée par les événements qui suivirent sa disparition prématurée, mais ni l’un ni l’autre n’eussent trouvé le centre de gravitation de leur pensée sans l’influence de Charles Maurras. Il est certes légitime d’être accablé par l’immense masse de ses éditoriaux quotidiens souvent répétitifs, et parfois fallacieux, dont on ne peut se défendre de penser qu’ils dissipèrent son talent et défavorisèrent son cheminement de poète et de philosophe, mais dans cette masse, les incidentes lumineuses ne manquent pas et la langue française y trouve un de ses beaux élans combatifs .
Dans la mouvance de l’Action française, il est permis, certes, de lui préférer le « libre réactionnaire » Léon Daudet, auteur de l’admirable Voyage de Shakespeare ou Jacques Bainville dont la pertinence historiographique n’a cessé d’être corroborée par les événements qui suivirent sa disparition prématurée, mais ni l’un ni l’autre n’eussent trouvé le centre de gravitation de leur pensée sans l’influence de Charles Maurras. Il est certes légitime d’être accablé par l’immense masse de ses éditoriaux quotidiens souvent répétitifs, et parfois fallacieux, dont on ne peut se défendre de penser qu’ils dissipèrent son talent et défavorisèrent son cheminement de poète et de philosophe, mais dans cette masse, les incidentes lumineuses ne manquent pas et la langue française y trouve un de ses beaux élans combatifs . L’écriture de Charles Maurras, plastique, surprenante, saisie d’incessantes variations de vitesse et d’humeur est bien loin d’avoir livré tous ses secrets. Cet auteur qui, jeune homme, fut mallarméen, pythagoricien et proudhonien porte dans son style une puissance libertaire sans cesse contrariée et renaissante. Sa fougue exigeait d’être jugulée pour mieux se dire. Quelque profond sentiment d’effroi n’est pas à exclure, dont ses premières œuvres gardent la trace, – contre lequel il éprouva le besoin d’armer son intelligence. Peut-être eût-t-il trop d’ardeur à contenir le vertige de l’étoile dansante du chaos dont parle Nietzsche ? Mais qui peut s’en faire juge ?
L’écriture de Charles Maurras, plastique, surprenante, saisie d’incessantes variations de vitesse et d’humeur est bien loin d’avoir livré tous ses secrets. Cet auteur qui, jeune homme, fut mallarméen, pythagoricien et proudhonien porte dans son style une puissance libertaire sans cesse contrariée et renaissante. Sa fougue exigeait d’être jugulée pour mieux se dire. Quelque profond sentiment d’effroi n’est pas à exclure, dont ses premières œuvres gardent la trace, – contre lequel il éprouva le besoin d’armer son intelligence. Peut-être eût-t-il trop d’ardeur à contenir le vertige de l’étoile dansante du chaos dont parle Nietzsche ? Mais qui peut s’en faire juge ? Maurras n’oppose point à l’infini romantique un plat réalisme mais une pensée de la forme nécessaire et salvatrice. Ainsi, la France sera pour lui une forme, au sens grec, une Idée: « N’être point un profane, entendre le mystère de conciliation que suppose une chose belle, sentir avec justesse le mot du vieux pacte conclu entre la savante fille du ciel et le tendre enfant de l’écume, enfin de rendre compte que ce parfait accord ait été proprement la Merveille du Monde et le point d’accomplissement du genre humain, c’est toute la sagesse qu’ont révélée successivement à leurs hôtes la Grèce dans l’Europe, l’Attique dans la Grèce, Athènes dans l’Attique, et, pour Athènes, le rocher où s’élève ce qui subsiste de son cœur. »
Maurras n’oppose point à l’infini romantique un plat réalisme mais une pensée de la forme nécessaire et salvatrice. Ainsi, la France sera pour lui une forme, au sens grec, une Idée: « N’être point un profane, entendre le mystère de conciliation que suppose une chose belle, sentir avec justesse le mot du vieux pacte conclu entre la savante fille du ciel et le tendre enfant de l’écume, enfin de rendre compte que ce parfait accord ait été proprement la Merveille du Monde et le point d’accomplissement du genre humain, c’est toute la sagesse qu’ont révélée successivement à leurs hôtes la Grèce dans l’Europe, l’Attique dans la Grèce, Athènes dans l’Attique, et, pour Athènes, le rocher où s’élève ce qui subsiste de son cœur. »

 En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.
En définitive, les Gilets jaunes ne sont ni un mode de lutte nouveau, ni une résurgence du poujadisme, du boulangisme, des ligues des années 1930, ni une manifestation quelque peu spectaculaire du populisme. Ils sont l'image d'un peuple qui souffre, se sent sacrifié et méprisé, et ne parle que pour exprimer son désarroi, sans même formuler de revendications claires et sans souscrire en rien à quelque projet de société. Un peuple au pied du mur, au bout du rouleau, réduit à sa plus simple expression.
 Cette question, dont nous faisons un titre, mérite examen. On serait tenté, de prime abord, d’y répondre par la négative, au regard de l’insigne médiocrité de notre personnel politique et de la déliquescence continue de notre nation, dans tous les domaines. Pourtant, quelques signes semblent démentir un peu cette vision pessimiste de la situation, et autoriser un timide début d’espoir pour l’avenir.
Cette question, dont nous faisons un titre, mérite examen. On serait tenté, de prime abord, d’y répondre par la négative, au regard de l’insigne médiocrité de notre personnel politique et de la déliquescence continue de notre nation, dans tous les domaines. Pourtant, quelques signes semblent démentir un peu cette vision pessimiste de la situation, et autoriser un timide début d’espoir pour l’avenir. Jordan Bardella est, à ce jour celui qui suscite la plus grande curiosité. Ce benjamin de la classe politique (il a seulement 23 ans) a, depuis sa désignation à la tête de la liste du Rassemblement national pour les européennes, montré qu’il n’était pas un simple produit de la com, qui gagne toute la classe politique. Très bien informé des questions débattues durant cette campagne, doué d’une assez grande facilité d’élocution et d’une grande capacité argumentative, il est la révélation de cette compétition électorale. Au risque d’exagérer, on peut affirmer qu’il représente l’espoir de la réunification du peuple français. Né en Seine-saint-Denis (le tristement célèbre « 9.3 »), issu d’une très modeste famille d’origine italienne, ayant passé sa jeunesse dans une cité HLM exposée aux incivilités, à la délinquance et à la violence en même temps qu’abreuvée de propagande communiste, il a pourtant fait le choix de ne pas céder à la pente naturelle de l’engagement à gauche. Au contraire, dès l’adolescence, il voit l’espoir du changement dans le camp adverse. Dès 2013, à peine âgé de 18 ans, il prend la direction du FN de son département, et, en 2015, à moins de 20 ans, il se voit élu conseiller régional d’Île-de-France. Il connaîtra pourtant la défaite aux départementales de 2015 et aux législatives de 2017. Très actif, il trouve encore le temps de lire et de s’instruire, puisant certaines de ses idées dans l’œuvre de Christophe Guilluy, le géographe des milieux péri-urbains qui critique les effets de la mondialisation sur les classes populaires. À ses yeux, la solution aux difficultés des plus pauvres ne réside pas dans une surenchère socialiste et révolutionnaire telle que la pratique l’extrême gauche, mais dans une critique raisonnée de la mondialisation. Ce qui l’amène à une critique de la politique monétaire de la BCE, et à demander la réorientation de la politique économique européenne dans la sens de la lutte contre le chômage et la maîtrise par les États de leur pleine souveraineté en matière de défense de leur industrie et de leur action sociale. Son modèle est Matteo Salvini. Il le loue d’avoir contesté la politique migratoire européenne, les directives économiques de Bruxelles, et d’avoir remis en cause le CETA. Pour autant, il ne donne pas dans les rodomontades du chef de la Ligue du Nord. Il s’inscrit dans le sillage de la politique d’ouverture de Marine Le Pen, sans servilité, et il conteste la politique du président de la République sur la base de critiques pertinentes et précises. Affirmant représenter, au RN, « la fibre sociale », revendiquant la modestie de son origine familiale, il ne donne pas, pour autant dans un populisme grossièrement populacier, et il montre, de par ses déclarations émues sur la tragédie de l’incendie de Notre-Dame, et le passé millénaire de la France, que, pour lui, la défense de l’identité de notre nation ne se confond pas avec une franchouillardise de comptoir.
Jordan Bardella est, à ce jour celui qui suscite la plus grande curiosité. Ce benjamin de la classe politique (il a seulement 23 ans) a, depuis sa désignation à la tête de la liste du Rassemblement national pour les européennes, montré qu’il n’était pas un simple produit de la com, qui gagne toute la classe politique. Très bien informé des questions débattues durant cette campagne, doué d’une assez grande facilité d’élocution et d’une grande capacité argumentative, il est la révélation de cette compétition électorale. Au risque d’exagérer, on peut affirmer qu’il représente l’espoir de la réunification du peuple français. Né en Seine-saint-Denis (le tristement célèbre « 9.3 »), issu d’une très modeste famille d’origine italienne, ayant passé sa jeunesse dans une cité HLM exposée aux incivilités, à la délinquance et à la violence en même temps qu’abreuvée de propagande communiste, il a pourtant fait le choix de ne pas céder à la pente naturelle de l’engagement à gauche. Au contraire, dès l’adolescence, il voit l’espoir du changement dans le camp adverse. Dès 2013, à peine âgé de 18 ans, il prend la direction du FN de son département, et, en 2015, à moins de 20 ans, il se voit élu conseiller régional d’Île-de-France. Il connaîtra pourtant la défaite aux départementales de 2015 et aux législatives de 2017. Très actif, il trouve encore le temps de lire et de s’instruire, puisant certaines de ses idées dans l’œuvre de Christophe Guilluy, le géographe des milieux péri-urbains qui critique les effets de la mondialisation sur les classes populaires. À ses yeux, la solution aux difficultés des plus pauvres ne réside pas dans une surenchère socialiste et révolutionnaire telle que la pratique l’extrême gauche, mais dans une critique raisonnée de la mondialisation. Ce qui l’amène à une critique de la politique monétaire de la BCE, et à demander la réorientation de la politique économique européenne dans la sens de la lutte contre le chômage et la maîtrise par les États de leur pleine souveraineté en matière de défense de leur industrie et de leur action sociale. Son modèle est Matteo Salvini. Il le loue d’avoir contesté la politique migratoire européenne, les directives économiques de Bruxelles, et d’avoir remis en cause le CETA. Pour autant, il ne donne pas dans les rodomontades du chef de la Ligue du Nord. Il s’inscrit dans le sillage de la politique d’ouverture de Marine Le Pen, sans servilité, et il conteste la politique du président de la République sur la base de critiques pertinentes et précises. Affirmant représenter, au RN, « la fibre sociale », revendiquant la modestie de son origine familiale, il ne donne pas, pour autant dans un populisme grossièrement populacier, et il montre, de par ses déclarations émues sur la tragédie de l’incendie de Notre-Dame, et le passé millénaire de la France, que, pour lui, la défense de l’identité de notre nation ne se confond pas avec une franchouillardise de comptoir. François-Xavier Bellamy, tête de liste des « Républicains », illustre, lui aussi, cette évolution. Professeur agrégé de philosophie, il a eu le courage de faire justice de certains présupposés à l’origine de la décadence que nous connaissons. En cela, il a fait œuvre de penseur plus que d’homme politique. Dans son livre Les déshérités (2014), il a montré que la crise de l’éducation et de l’enseignement dont nous souffrons depuis cinquante ans tient au refus de la transmission culturelle et morale, et il fait remonter l’origine de ce refus à Descartes, avec sa « table rase », Rousseau, père de l’anti-culture et de la révolte contre la civilisation, et Bourdieu, qui a assimilé à l’excès transmission et culture de classe. Dans Demeure (2018), il discerne le vice rédhibitoire de notre monde moderne dans le culte du changement, conçu comme une fin en soi, et dénonce l’institution d’un monde fluide, dénué de repères et d’ancrage culturel, prolongeant ainsi la description faite trente ans plus tôt (mais dans une perspective moderniste) par Lipovetsky de « l’empire de l’éphémère » et de « l’ère du vide ». Bellamy refuse de passer sous les fourches caudines morales imposées à la droite depuis des décennies. Au rebours des attitudes stéréotypées de la droite « républicaine » depuis une quarantaine d’années, il s’est prononcé en faveur de la tradition, de la morale, du mariage traditionnel, de la famille, d’un contrôle strict de l’immigration, de la primauté de l’instruction et de la transmission culturelle sur l’ « éducation », et s’est prononcé contre le TAFTA et le CETA, contre le refus bruxellois des formes de patriotisme économique, contre la permissivité, le mariage pour tous, la PMA et la GPA. Cela sans véhémence ni propos emberlificotés, avec netteté, franchise et clarté. Espérons que ce jeune intellectuel, encore bien peu présent sur le terrain politique, et encore inexpérimenté, puisse exercer une influence salutaire sur son camp.
François-Xavier Bellamy, tête de liste des « Républicains », illustre, lui aussi, cette évolution. Professeur agrégé de philosophie, il a eu le courage de faire justice de certains présupposés à l’origine de la décadence que nous connaissons. En cela, il a fait œuvre de penseur plus que d’homme politique. Dans son livre Les déshérités (2014), il a montré que la crise de l’éducation et de l’enseignement dont nous souffrons depuis cinquante ans tient au refus de la transmission culturelle et morale, et il fait remonter l’origine de ce refus à Descartes, avec sa « table rase », Rousseau, père de l’anti-culture et de la révolte contre la civilisation, et Bourdieu, qui a assimilé à l’excès transmission et culture de classe. Dans Demeure (2018), il discerne le vice rédhibitoire de notre monde moderne dans le culte du changement, conçu comme une fin en soi, et dénonce l’institution d’un monde fluide, dénué de repères et d’ancrage culturel, prolongeant ainsi la description faite trente ans plus tôt (mais dans une perspective moderniste) par Lipovetsky de « l’empire de l’éphémère » et de « l’ère du vide ». Bellamy refuse de passer sous les fourches caudines morales imposées à la droite depuis des décennies. Au rebours des attitudes stéréotypées de la droite « républicaine » depuis une quarantaine d’années, il s’est prononcé en faveur de la tradition, de la morale, du mariage traditionnel, de la famille, d’un contrôle strict de l’immigration, de la primauté de l’instruction et de la transmission culturelle sur l’ « éducation », et s’est prononcé contre le TAFTA et le CETA, contre le refus bruxellois des formes de patriotisme économique, contre la permissivité, le mariage pour tous, la PMA et la GPA. Cela sans véhémence ni propos emberlificotés, avec netteté, franchise et clarté. Espérons que ce jeune intellectuel, encore bien peu présent sur le terrain politique, et encore inexpérimenté, puisse exercer une influence salutaire sur son camp. Le simple souci d’honnêteté oblige à reconnaître que les signes encourageants (jusqu’à un certain point, ne rêvons pas trop) de renouveau de la classe politique au plan des nouveaux venus ne se trouvent pas uniquement à droite. La gauche en présente également quelques-uns.
Le simple souci d’honnêteté oblige à reconnaître que les signes encourageants (jusqu’à un certain point, ne rêvons pas trop) de renouveau de la classe politique au plan des nouveaux venus ne se trouvent pas uniquement à droite. La gauche en présente également quelques-uns.



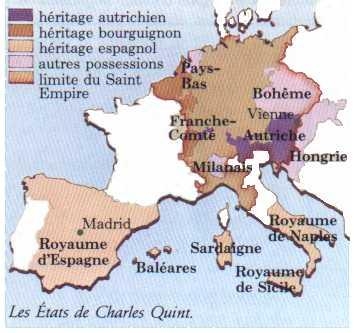
 Nous poursuivons la publication d'une série qui devrait faire date ; qui forme un ensemble à lire en entier : une étude de Pierre Debray parue en novembre 1985 dans le mensuel Je Suis Français, sous le titre Une politique pour l'an 2000.
Nous poursuivons la publication d'une série qui devrait faire date ; qui forme un ensemble à lire en entier : une étude de Pierre Debray parue en novembre 1985 dans le mensuel Je Suis Français, sous le titre Une politique pour l'an 2000. 







 Les soixante-huitards colonisèrent les maisons de la culture, les centres dramatiques, le cinéma, la télévision. Sous prétexte d'apporter la culture au peuple, ils lui infligèrent des spectacles prétentieux et bavards. D'autres devinrent animateurs de ceci, éducateurs de cela, conseillers d'on ne sait quoi. Les plus doués s'infiltrèrent dans la magistrature, les moins chanceux se résignèrent à devenir instituteurs. Certes l'idéologie gauchiste est bien oubliée mais la révolution de 1968 finalement s'est révélée plus durable que celle de 1848, même si elle risque de tenir moins de place dans les manuels scolaires. Pour la première fois une révolution visait à changer non les structures mais les mentalités. La plupart des objectifs qu'elle s'était fixés furent atteints : libéralisation de l'avortement, divorce par consentement mutuel, reconnaissance du concubinat, aménagement du système fiscal afin de pénaliser les gens mariés. Les Français renoncèrent à épouser et à faire des enfants. La vente libre du ciné-cochon, l'ouverture des sexshops attesta qu'il était désormais interdit d'interdire. Mais surtout la liquidation de l'enseignement fut menée à bien, par une série de ministres, réputés de droite. Il fallut M. Haby pour réaliser le projet du socialiste Langevin et du communiste Wallon, d'école unique, tous les enfants coulés dans le même moule afin que l'idéologie égalitaire puisse triompher.
Les soixante-huitards colonisèrent les maisons de la culture, les centres dramatiques, le cinéma, la télévision. Sous prétexte d'apporter la culture au peuple, ils lui infligèrent des spectacles prétentieux et bavards. D'autres devinrent animateurs de ceci, éducateurs de cela, conseillers d'on ne sait quoi. Les plus doués s'infiltrèrent dans la magistrature, les moins chanceux se résignèrent à devenir instituteurs. Certes l'idéologie gauchiste est bien oubliée mais la révolution de 1968 finalement s'est révélée plus durable que celle de 1848, même si elle risque de tenir moins de place dans les manuels scolaires. Pour la première fois une révolution visait à changer non les structures mais les mentalités. La plupart des objectifs qu'elle s'était fixés furent atteints : libéralisation de l'avortement, divorce par consentement mutuel, reconnaissance du concubinat, aménagement du système fiscal afin de pénaliser les gens mariés. Les Français renoncèrent à épouser et à faire des enfants. La vente libre du ciné-cochon, l'ouverture des sexshops attesta qu'il était désormais interdit d'interdire. Mais surtout la liquidation de l'enseignement fut menée à bien, par une série de ministres, réputés de droite. Il fallut M. Haby pour réaliser le projet du socialiste Langevin et du communiste Wallon, d'école unique, tous les enfants coulés dans le même moule afin que l'idéologie égalitaire puisse triompher.

