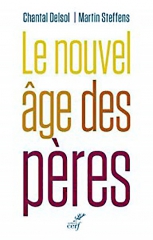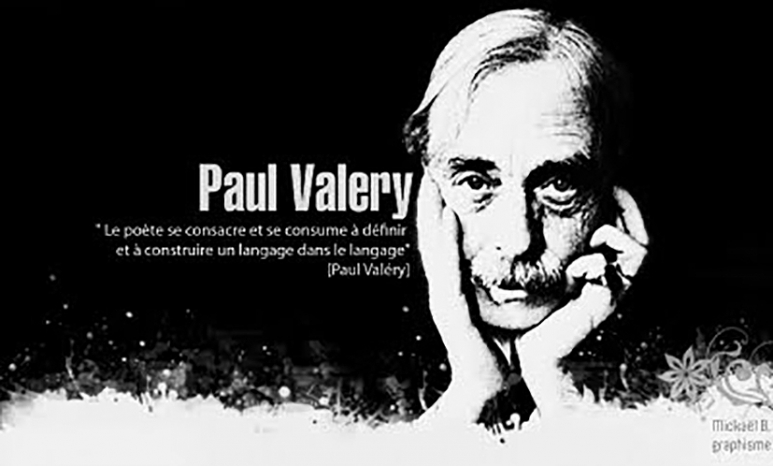Comme un marronnier dans la presse, la question du « droit du sol », stupidement opposé au « droit du sang » — la France connaît les deux — revient à intervalles réguliers dans le débat politique à la faveur des raz-de-marée migratoires que subit le pays sur son sol non seulement métropolitain, mais aussi ultra-marin.
Comme un marronnier dans la presse, la question du « droit du sol », stupidement opposé au « droit du sang » — la France connaît les deux — revient à intervalles réguliers dans le débat politique à la faveur des raz-de-marée migratoires que subit le pays sur son sol non seulement métropolitain, mais aussi ultra-marin.
Sarkozy, qui n’est pas à une indécence prêt, y est même allé de son petit couplet, à la faveur du déplacement de Manuel Valls, le 13 juin dernier, à Mayotte, notre 101e département. Les Mahorais auraient souhaité que le Premier ministre prononçât des paroles fortes sur la question des clandestins. Les pouvoirs publics les estiment en effet à 70 000, soit un tiers de la population, essentiellement des Comoriens qui, contrairement aux Mahorais, ont choisi l’indépendance en 1975. C’est ainsi que Mamoudzou, la capitale de l’île, est devenue la première maternité de France, l’indépendance ne s’étant pas traduite pour les Comoriens par une élévation de leur niveau de vie... Mais peut-être le refus de traiter la question des clandestins n’a-t-elle pour seul objectif, partagé par une droite qui fit tout pour exclure en 1975 Mayotte-la-Française de la communauté nationale, de créer une situation irréversible de submersion de la population de souche, justifiant à terme le largage d’une île où les Mahorais seraient devenus minoritaires... On sait que les Comores n’ont jamais renoncé à l’annexion de Mayotte.
Quoi qu’il en soit, Valls n’a pas répondu à l’attente des Mahorais. Et ne s’est même que fort peu intéressé à la question des clandestins sur une île, rappelons-le, conservée à la France grâce à l’Action française et à la détermination de Pierre Pujo — ce qu’Olivier Stirn, le ministre de Giscard chargé à l’époque de brader nos territoires ultra-marins, reconnut publiquement. Faut-il s’en étonner quand le gouvernement accepte l’arrivée en métropole chaque année de dizaines de milliers de clandestins dont aucun, ou presque, n’est reconduit à la frontière ? Quand il est prêt à encourager l’appel d’air que constituerait, par dérogation au Règlement Dublin II, la répartition entre les différents Etats membres de l’Union, à la demande du président de la Commission européenne, des migrants qui atteignent, toujours plus nombreux, l’ « Eldorado » européen via la Méditerranée et l’Italie ? Quand, une fois arrivés en Europe, Schengen leur permet d’y voyager librement et de s’installer là où les prestations sont les plus avantageuses, avant d’y être — c’est du moins le cas en France — naturalisés par brassées ? Quand, enfin, nos politiques, de droite comme de gauche, font du droit du sol un sacro-saint « principe républicain », alors qu’il remonte à un arrêt du Parlement de Paris de 1515, voire à l’édit du 3 juillet 1315 de Louis X le Hutin ? Encore faut-il qu’il y ait un « sol », c’est-à-dire un Etat souverain, maître de ses frontières, ce qui n’est plus le cas de la France. Dès lors le « droit du sol » est devenu le droit d’être envahi. Remettre en cause, au moins pour mieux l’encadrer, ce qui n’est pas un dogme, mais une pratique historique correspondant à une période de maîtrise des flux migratoires, est devenu une nécessité vitale.
Ce n’est pas la provocation du recteur de la mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubakeur, appelant sur Europe 1 le lundi 15 juin à « utiliser des églises vides pour servir au culte musulman », c’est-à-dire au grand remplacement d’un culte par un autre, qui favorisera le « vivre ensemble » si cher à nos élites. Nos églises devraient-elles faire les frais des dissensions internes à l’ « islam de France » et de la peur de Dalil Boubakeur de se voir dépasser par les fondamentalistes ? Il avait déjà appelé le 5 avril dernier, au cours du rassemblement annuel des musulmans de France, organisé chaque année lors des fêtes pascales, à doubler le nombre des mosquées. A-t-il cette fois cherché, pour montrer son intransigeance, à saborder la première réunion, organisé ce même jour, de l’instance de dialogue avec l’islam de France voulue par Manuel Valls ? Selon ce dernier, « l’islam suscite encore des incompréhensions, des a priori, du rejet chez une partie de nos concitoyens, des amalgames. [...] Il faut donc [...] faire jaillir au grand jour ce qu’est la réalité de l’islam de France. » Il n’est pas certain que par sa provocation Dalil Boubakeur ait aidé Valls à lever les « incompréhensions » et à « faire jaillir au grand jour ce qu’est la réalité de l’islam de France », du moins dans le sens souhaité par le Premier ministre. « Les églises ne sont pas des bâtiments multi-usage », a rappelé l’évêque de Pontoise, Mgr Lalanne, également représentant de la Conférence des évêques de France, qui s’est dit, sur RTL, ce même lundi, « totalement opposé » à ce projet. Et de rappeler que « les églises sont des lieux sacrés, qui [...] ne peuvent être utilisées à un autre dessein qu’à l’expression de la foi chrétienne. [...] on ne doit pas jouer avec les symboles. » Il est dommage que Dalid Boubakeur n’apparaisse plus comme cet interlocuteur dans lequel Pierre Pujo, voyait un « grand musulman français » (L’AF du 12 février 1995) préconisant « un islam modéré, respectueux des mœurs et des traditions françaises » (L’AF du 6 novembre 2003). Dans nos propres colonnes (L’AF du 12 juin 1997), le recteur souhaitait, après avoir évoqué le sacrifice des musulmans français lors des deux conflits mondiaux, « gagner l’estime et la sympathie » de nos lecteurs et « améliorer une situation psychologique actuellement défavorable aux musulmans de France » en rappelant que, « dans l’Islam, l’amour de la Patrie est un élément de la foi ». Dans son commentaire de la Charte du culte musulman en France de 1994, n’avait-il pas du reste souligné « l’attachement tout maurrassien des musulmans à la France » avant de se réclamer (Le Point du jeudi 20 avril 2006) d’ « un amour de la patrie aussi fort que celui de Maurras ou de Barrès » ?
Un islam français acculturé, c’est-à-dire respectueux de l’identité nationale, qui est indéfectiblement chrétienne, est non seulement possible mais nécessaire. Encore faut-il que ses représentants les plus écoutés ne jettent pas de l’huile sur le feu des passions identitaires en justifiant, par des provocations inutiles, des craintes qu’il est facile d’instrumentaliser en ces temps troublés. •
PS : Le fait que la mosquée de Paris ait par la suite envoyé un communiqué de presse aux médias, dans lequel le président du CFCM revient sur ses propos, ne change rien au nôtre.



 Patrimonial, car la moitié des pieds plantés, soit trois hectares, sont issus d’une sélection massale sur des plants pré-phylloxériques certifiés d’avant 1840. Ce sont des plants dits « francs de pied », n’ayant subi aucun greffage ni aucune transformation génétique. «
Patrimonial, car la moitié des pieds plantés, soit trois hectares, sont issus d’une sélection massale sur des plants pré-phylloxériques certifiés d’avant 1840. Ce sont des plants dits « francs de pied », n’ayant subi aucun greffage ni aucune transformation génétique. «  Les ceps ont été mis en terre de manière très officielle vendredi 12 juin. Elus locaux et autorités de l’Etat ont été invités à chausser les gants pour la plantation symbolique autour de Guillaume Garot. L’ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire et député PS de la Mayenne est depuis décembre 2014 président du conseil d’administration du Domaine National de Chambord. « Nous recréons la vigne de François 1er et nous élaborerons le vin de Chambord », s’enthousiasme Guillaume Garot. Cette idée inscrite dans le projet d’établissement du Domaine permettra, selon les prévisions, de récolter 300 000 €, voire plus. « Cet argent sera destiné à l’entretien du Domaine, particulièrement du mur d’enceinte », précise Jean d’Haussonville.
Les ceps ont été mis en terre de manière très officielle vendredi 12 juin. Elus locaux et autorités de l’Etat ont été invités à chausser les gants pour la plantation symbolique autour de Guillaume Garot. L’ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire et député PS de la Mayenne est depuis décembre 2014 président du conseil d’administration du Domaine National de Chambord. « Nous recréons la vigne de François 1er et nous élaborerons le vin de Chambord », s’enthousiasme Guillaume Garot. Cette idée inscrite dans le projet d’établissement du Domaine permettra, selon les prévisions, de récolter 300 000 €, voire plus. « Cet argent sera destiné à l’entretien du Domaine, particulièrement du mur d’enceinte », précise Jean d’Haussonville. Le classement du Domaine en site « Natura 2 000 » impose certaines obligations, notamment pour le maintien de la biodiversité. C’est Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, qui a exigé un travail biologique de ces vignes. Le savoir-faire de la famille Marionnet permettra même de produire un vin naturel, sans ajouts de soufre ou de produits œnologiques. En prime, le ministère octroie 800 000 € au Domaine National de Chambord pour créer un parcours promenade dans les vignes.
Le classement du Domaine en site « Natura 2 000 » impose certaines obligations, notamment pour le maintien de la biodiversité. C’est Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, qui a exigé un travail biologique de ces vignes. Le savoir-faire de la famille Marionnet permettra même de produire un vin naturel, sans ajouts de soufre ou de produits œnologiques. En prime, le ministère octroie 800 000 € au Domaine National de Chambord pour créer un parcours promenade dans les vignes.  « Nous prévoyons une production annuelle de 60 000 bouteilles »,
« Nous prévoyons une production annuelle de 60 000 bouteilles », 

 La déclaration est un peu passée inaperçue. Pourtant, il est rare qu’une institution comme l’Académie française prenne position contre une réforme gouvernementale. À ma connaissance, la dernière fois qu’elle a été partie prenante d’une polémique politique, c’était en 1990, à l’occasion de la réforme de l’orthographe menée par le gouvernement Rocard, et l’Académie était plutôt favorable à cette réforme. Jamais, en revanche, elle ne s’était prononcée sur une réforme scolaire.
La déclaration est un peu passée inaperçue. Pourtant, il est rare qu’une institution comme l’Académie française prenne position contre une réforme gouvernementale. À ma connaissance, la dernière fois qu’elle a été partie prenante d’une polémique politique, c’était en 1990, à l’occasion de la réforme de l’orthographe menée par le gouvernement Rocard, et l’Académie était plutôt favorable à cette réforme. Jamais, en revanche, elle ne s’était prononcée sur une réforme scolaire. 
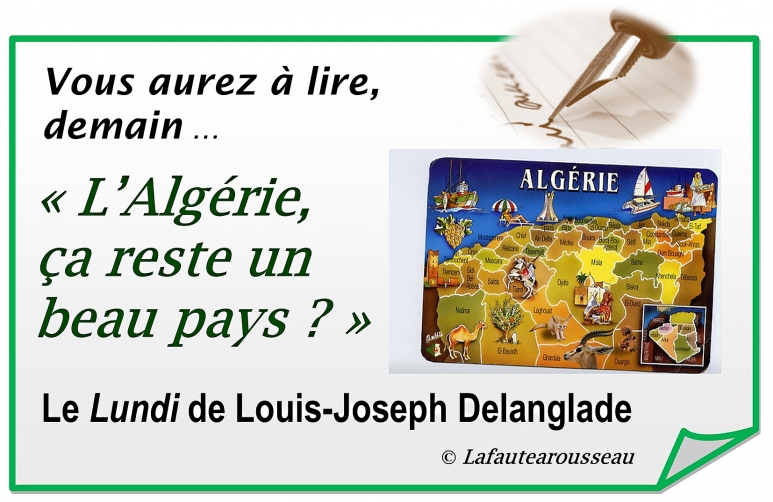


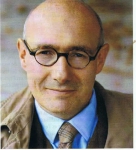 « Une famille qui a construit la nation et fabriqué l'état français au fil des siècles, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la famille de France. Quand le prince Jean, qui sera le chef de cette maison à la mort de son père, se promène dans Paris, il parcourt en quelque sorte la galerie de ses ancêtres. Le Palais Bourbon est pour lui, non seulement un bâtiment public, mais aussi une maison qui fut construite pour l'un de ses grands-oncles. Lorsqu'il admire la Sainte Chapelle, il peut penser à l'un de ses aïeux qui l'a fait édifier. Notre-Dame de Paris lui rappelle cet ensemble de rois, ses ancêtres, qui y ont entendu la messe. Si cette famille ne possède pas matériellement ou juridiquement les « palais de la République » - qui sont en réalité d'anciens palais royaux - elle est réellement chez elle en France. Elle n'est pas une famille comme les autres et se trouve à cet égard dans une situation absolument singulière. »
« Une famille qui a construit la nation et fabriqué l'état français au fil des siècles, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la famille de France. Quand le prince Jean, qui sera le chef de cette maison à la mort de son père, se promène dans Paris, il parcourt en quelque sorte la galerie de ses ancêtres. Le Palais Bourbon est pour lui, non seulement un bâtiment public, mais aussi une maison qui fut construite pour l'un de ses grands-oncles. Lorsqu'il admire la Sainte Chapelle, il peut penser à l'un de ses aïeux qui l'a fait édifier. Notre-Dame de Paris lui rappelle cet ensemble de rois, ses ancêtres, qui y ont entendu la messe. Si cette famille ne possède pas matériellement ou juridiquement les « palais de la République » - qui sont en réalité d'anciens palais royaux - elle est réellement chez elle en France. Elle n'est pas une famille comme les autres et se trouve à cet égard dans une situation absolument singulière. »
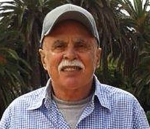 C'est un fait : depuis février 2014, à force de manœuvres souterraines mais efficaces, le lobby socialo-algérien, assez puissant actuellement en France, a multiplié chausse-trappes et coups d'épingle pour entraver la bonne marche des relations Rabat-Paris. En contraste, brille en même temps avec une intensité particulière, la coopération artistique entre Royaume alaouite et République française.
C'est un fait : depuis février 2014, à force de manœuvres souterraines mais efficaces, le lobby socialo-algérien, assez puissant actuellement en France, a multiplié chausse-trappes et coups d'épingle pour entraver la bonne marche des relations Rabat-Paris. En contraste, brille en même temps avec une intensité particulière, la coopération artistique entre Royaume alaouite et République française.
 À Prunelli-di-Fiumorbu, en Corse, deux enseignantes ont eu une bien curieuse idée pour la fête de l’école : les élèves devaient chanter « Imagine » de John Lennon en cinq langues, dont l’arabe. C’était sans compter sur la réaction salutaire de certains parents qui ont manifesté, de manière virile, leur désaccord. Pour eux, hors de question que leurs enfants puissent chanter ne serait-ce qu’un couplet d’une chanson en arabe. Le recteur d’académie, Michel Barat, a alors dénoncé une « attitude inqualifiable contre les valeurs que représente l’école ». Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, a, pour sa part, dénoncé « le racisme au quotidien dans toute la splendeur de sa bêtise et de sa violence ».
À Prunelli-di-Fiumorbu, en Corse, deux enseignantes ont eu une bien curieuse idée pour la fête de l’école : les élèves devaient chanter « Imagine » de John Lennon en cinq langues, dont l’arabe. C’était sans compter sur la réaction salutaire de certains parents qui ont manifesté, de manière virile, leur désaccord. Pour eux, hors de question que leurs enfants puissent chanter ne serait-ce qu’un couplet d’une chanson en arabe. Le recteur d’académie, Michel Barat, a alors dénoncé une « attitude inqualifiable contre les valeurs que représente l’école ». Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, a, pour sa part, dénoncé « le racisme au quotidien dans toute la splendeur de sa bêtise et de sa violence ».