Michel Onfray : « Michel Houellebecq a diagnostiqué l'effondrement spirituel de notre époque »

Entretien par Alexandre Devecchio
A l'occasion de la parution de son dernier livre, Miroir du nihilisme, Houellebecq éducateur, Michel Onfray décrypte, dans ce long et remarquable entretien, la philosophie de l'auteur de Soumission [Figarovox, 30.09]. Une philosophie qui a pour toile de fond la situation de notre civilisation, de notre société. Bien-sûr, sa certitude que « nous allons mourir » n'est pas la nôtre. Mais sur le diagnostic porté par Onfray à travers l'oeuvre de Houellebacq, on ne peut qu'être presque en tous points d'accord. Pour qui ne veut pas mourir - et ni Houllebecq ni Onfray n'en forment le souhait - il y a là d'importantes analyses, de profondes réflexions et quelques maximes superbes. LFAR
 Vous publiez aux éditions Galilée, Miroir du nihilisme, un essai consacré à Soumission de Michel Houellebecq. Vous êtes longtemps passé à côté de l'œuvre de ce dernier. Pourquoi son dernier roman vous a-t-il fait changer de point de vue ?
Vous publiez aux éditions Galilée, Miroir du nihilisme, un essai consacré à Soumission de Michel Houellebecq. Vous êtes longtemps passé à côté de l'œuvre de ce dernier. Pourquoi son dernier roman vous a-t-il fait changer de point de vue ?
J'avais aimé la performance littéraire d'Extension du domaine de la lutte qui était vif et bref, rapide et percutant. Les autres romans m'avaient paru techniquement moins rapides. J'aime les stylistes et les textes qui vont vite. Voilà pour la forme.
Pour le fond, j'avais commis l'erreur de croire que le diagnosticien du nihilisme consentait au nihilisme, s'en réjouissait même, voire, s'y complaisait… C'était une erreur. C'est confondre le cancérologue qui diagnostique la pathologie avec le cancer, la pathologie qu'il a diagnostiquée. J'étais, selon l'image bien connue, l'imbécile qui regarde le doigt quand le sage lui montre la lune !
Soumission m'a plu parce qu'il renoue avec la vitesse d'Extension. Il m'a éloigné du doigt et ramené à la lune quand j'ai constaté chez Michel Houellebecq la grande souffrance qui était la sienne à se savoir, se voir, se constater, s'expérimenter corporellement et spirituellement tel un sismographe de notre époque en cours d'effondrement.
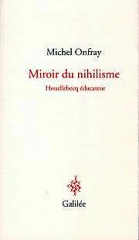 En termes hégéliens, il est le grand homme choisi par l'Histoire pour qu'il en fasse la narration. Il est au cœur nucléaire du processus de Ruse de la raison. Le savoir, ce qui est son cas, car il est d'une redoutable lucidité, c'est affronter les plus grands tourments.
En termes hégéliens, il est le grand homme choisi par l'Histoire pour qu'il en fasse la narration. Il est au cœur nucléaire du processus de Ruse de la raison. Le savoir, ce qui est son cas, car il est d'une redoutable lucidité, c'est affronter les plus grands tourments.
En quoi Houellebecq est-il le romancier du nihilisme ?
En tant que sismographe, il enregistre toutes les secousses en rapport avec la tectonique des plaques civilisationnelles : il a diagnostiqué l'effondrement spirituel des générations produites par des parents soixante-huitards, l'écœurement d'une sexualité indexée sur la seule performance, la marchandisation des corps et des âmes, des carrières et des pensées, la contamination de l'art contemporain par le snobisme et le marché, la tyrannie de l'argent en régime libéral, la fin de la France depuis l'abandon de sa souveraineté lors du Traité de Maastricht.
Mais aussi la veulerie du tourisme sexuel en Asie, le caractère inéluctable de l'engagement de nos civilisations occidentales vers le projet transhumaniste, l'effondrement de la religion judéo-chrétienne et des valeurs qui l'accompagnaient, et, avec Soumission, le processus de collaboration des élites avec les idéologies liberticides - ici un islam francisé.
Depuis 1994, Michel Houellebecq dépèce minutieusement le Veau d'or - c'est en cela qu'il est le grand romancier du nihilisme occidental.
Houellebecq s'inscrit volontiers dans la filiation d'Auguste Comte qui était positiviste…
Mais aussi de Schopenhauer - ou de Huysmans. Il n'est pas homme à s'enfermer dans des cases, à aimer l'un, donc pas l'autre, à choisir celui-ci, donc à écarter celui-là… Il est un homme authentiquement libre.
Ce qu'il aime chez Auguste Comte, c'est sa réflexion sur la place de la religion dans la société, sur la possibilité d'une liaison d'un certain type de sacré avec le social. Qui dira qu'il ne s'agit pas d'une question essentielle si l'on veut aujourd'hui penser la question politique ?
Le positivisme n'est pas la philosophe un peu bêtasse de Monsieur Homais, mais la pensée mal connue d'un homme qui estimait que la religion sociologique des Hommes pouvait remplacer la religion théologique de Dieu.
La question de la religion est un leitmotiv dans la pensée de Michel Houellebecq : que faire dans un monde vidé de toute transcendance ? Lui qui décrit dans le détail le désespoir qu'il y a à vivre dans un monde de pure immanence (ce qui n'est pas mon cas : je crois que la sagesse tragique permet de vivre dans la seule immanence sans désespoir…) , il est normal qu'Auguste Comte lui parle.
Votre livre est sous-titré Houellebecq éducateur. Comment peut-on être à la fois nihiliste et éducateur ?
En enseignant la nature tragique du monde, autrement dit, en évitant deux chose : la lecture optimiste du monde et… la lecture pessimiste ! L'optimiste voit le meilleur partout et ne veut pas entendre parler du pire ; le pessimiste voit le pire partout et ne veut pas entendre parler du meilleur.
Le tragique quant à lui sait qu'il y a du pire et du meilleur partout… Michel Houellebecq nous enseigne où est le pire, ce qui n'a pas besoin d'être démontré, mais aussi le meilleur - qui provient chez lui, paradoxalement, de Schopenhauer pour qui il existe des solutions à ce monde sombre dans la pitié et la contemplation esthétique.
N'oublions pas que Schopenhauer a aussi écrit un Art d'être heureux… On connaît sa vision du monde animal, elle est d'une grande compassion. Il y a dans sa conversation en tête à tête la même présence attentive à l'autre. On n'ignore pas non plus qu'il trouve dans l'art un sens à sa vie: il a produit des romans, des essais, des poèmes, des films, des photographies, des performances d'art contemporain…
En tant qu'il dit le monde tel qu'il est, sans faux-semblants, et qu'il vit une vie poétique sans l'imposer ou la conseiller à qui que ce soit, il invite chacun à construire sa propre existence dans un temps de détresse.
Beaucoup ont vu dans Soumission une critique de l'islam radical. Vous y voyez plutôt un grand roman de la collaboration. Qui sont les « collabos » d'aujourd'hui ?
Ceux qui estiment que l'Islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour et ne veulent pas entendre parler d'un Islam de guerre, d'intolérance et de haine.
Certes, il existe un islam pratiqué par des gens qui voient en cette religion une coutume familiale ou un signe d'appartenance dans laquelle dominent effectivement la tolérance, la paix et l'amour.
Mais il y a aussi, dans le Coran et dans l'histoire de l'islam, terrorismes inclus, une autre voie qui est celle de la misogynie, de la phallocratie, de l'homophobie, de l'antisémitisme, du bellicisme, de la guerre qui constituent des valeurs à exporter par le djihad guerrier.
Le collaborateur ne veut voir que le premier islam en estimant que le second n'a rien à voir avec l'islam. Le Coran est un livre dont les sourates justifient aussi bien le premier que le second islam.
Concrètement, ces collaborateurs sont les islamo-gauchistes qu'on trouve ici ou là au NPA, dans la France Insoumise, dans l'aile gauche du PS, au PCF, ou à EELV. Il y en a également dans l'aile gauche des Républicains - chez les juppéistes par exemple.
C'est aussi une critique acerbe du monde universitaire. Un monde avec lequel vous avez toujours pris vos distances …
Michel Houellebecq se contente de décrire cette institution qui fonctionne à la cooptation, au piston, donc au phénomène de cour ; avec retard, elle suit les modes qu'elle ne crée jamais ; elle se prétend du côté de la science alors qu'elle est le lieu de l'idéologie ; elle est un lieu de rituels d'écriture scrupuleux et de reproduction institutionnelle - comme l'a bien vu Bourdieu ; elle dit être un lieu de recherche mais on y cherche ceux qui y trouveraient - précisons que je parle des seuls secteurs littéraires, sociologiques, philosophiques…
C'est pour ma part un monde contre lequel je n'ai rien puisque j'ai refusé de l'intégrer après ma soutenance alors que ma directrice de thèse me proposait d'y faire carrière et que j'ai préféré rester professeur de philosophie dans un lycée technique.
Mais, en effet, l'Université est une institution et, en tant que telle, elle est un lieu où la liberté, l'autonomie et l'indépendance soufflent peu ! Ni Montaigne ni La Boétie, ni Descartes ni Voltaire, ni Nietzche ni Proudhon, ni Alain ni Camus n'ont eu besoin de l'université pour penser - et leurs pensées furent vraiment libres…
Presque aussi intéressant que le livre lui-même a été son accueil au moment même où la réalité rejoignait la fiction avec les attentats de janvier 2015. Comment analysez-vous son rejet par une partie des médias ?
J'ai repris le dossier de presse de l'accueil de ce livre pour essayer de voir comment on avait lynché l'homme sans avoir lu l'œuvre pour ne pas avoir à la lire et à la commenter - parce qu'elle mettait le doigt dans la plaie…
Il est intéressant de constater combien les instruments et les personnes de la pensée dominante dans les médias de l'islamo-gauchisme ont sali l'homme Michel Houellebecq en lançant une polémique comme ils savent le faire pour souiller l'homme afin de discréditer l'œuvre.
Il est également intéressant de mettre en perspective ceux qui ont écrit ou parlé en faveur de Mehdi Meklat (blogueur islamophile, antisémite, phallocrate, misogyne, antisémite, belliciste ) dans Libération , Le Monde , Les Inrockuptibles ou France-Inter et de rappeler ce que les mêmes ont écrit contre Houellebecq.
Ce travail a été riche d'enseignements pour moi sur le fonctionnement du dispositif collaborationniste français… Je vous renvoie au détail de l'analyse (noms, lieux, citations, analyse de tweets, etc) dans mon livre…
C'est aussi un livre sur la perte de sens dans notre civilisation occidentale. Le christianisme et l'idéologie totalitaires ont laissé la place à la religion du marché et à l'islam conquérant. En tant qu'athée et matérialiste, que cela vous inspire-t-il ? Pourquoi la raison a-t-elle échoué à être le ciment d'une nouvelle civilisation ?
Une civilisation n'est possible qu'avec une spiritualité qui la soutient et qui, elle-même, découle d'une religion. Depuis que le monde est monde, c'est ainsi. L'Histoire témoigne.
Elle témoigne également qu'il n'y eut pas de civilisation construite sur l'athéisme et le matérialisme qui , l'un et l'autre, sont des signes, voire des symptômes, de la décomposition d'une civilisation - je le sais au premier chef puisque je suis athée et matérialiste… On ne lie pas les hommes sans le secours du sacré.
J'en profite pour m'opposer à cette scie musicale chantée par un certain nombre de philosophes pour lesquels la religion serait ce qui relierait les hommes entre eux - sur le principe du religare, relier… C'est une vision étroite de… matérialiste, voire… d'athée !
Car, si la religion relie bien, elle ne relie pas les hommes entre eux, sur le terrain de l'immanence, mais avec le sacré, sur le terrain de la transcendance. Elle n'est pas un lien des hommes entre eux, mais des hommes avec ce qui les dépasse. Or nous sommes dans une civilisation qui a congédié toute transcendance.
 Vous publiez également, Thoreau le sauvage, un livre sur Henry-David Thoreau. Qui était ce « penseur de champs » ?
Vous publiez également, Thoreau le sauvage, un livre sur Henry-David Thoreau. Qui était ce « penseur de champs » ?
C'est un homme qui montre qu'il existe une philosophie américaine loin de la philosophie européenne - et qui, ostensiblement, lui tourne le dos… L'Europe philosophique aime les Idées éthérées et les concepts purs, elle chérit plus que tout le beau raisonnement même s'il est faux, elle aime les cathédrales utopiques même si elles sont inhabitables.
Thoreau se moque des concepts et des idées, des beaux raisonnements et des cathédrales utopiques : il veut que la philosophie soit l'art de parvenir à une sagesse qui est connaissance de la nature et invitation à y trouver sa place.
Thoreau est un marcheur, un herboriste, un géologue, un nageur, un chasseur, un pécheur, un jardinier qui mène une vie philosophique. Il n'imagine pas une seule seconde une idée découplée de ce qu'elle doit produire : une action concrète, un comportement, une pratique. C'est un penseur existentiel comme je les aime…
Sa philosophie ne peut-elle être une alternative au nihilisme que vous décrivez ?
C'est une solution, oui. Pas forcément la seule.
Il faudrait ajouter que ce sympathique na


 De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.
De Gaulle disait volontiers de l'Allemagne de son temps qu'elle avait "les reins cassés". Elle était amputée des cinq länder de l'Est, de 110 000 km2, près du tiers de son étroit territoire actuel (à peine 357 000 km2), et de 17 millions d'Allemands. L'Allemagne de l'Ouest, sans la Saxe, la Thuringe, le Brandebourg, était rhénane, sa capitale était à Bonn, au bord du Rhin, et Konrad Adenauer, son vieux chancelier, avait été, avant-guerre, maire de Cologne, capitale rhénane s'il en est. Avec cette Allemagne-là, vaincue mais déjà renaissante, prospère et bourgeoise, avec Adenauer, De Gaulle n'eut pas de peine, autour de 1960, â sceller la réconciliation franco-allemande qui s'imposait après un siècle de guerre. Les deux vieillards en inventèrent les symboles et le traité de l'Elysée la formalisa. Bien qu'il ne fût pas sans ambigüités et qu'il y eût déjà de notables disparités entre l'Allemagne et la France, sur le plan de leur population comme de leur économie - l'industrie et l'agriculture françaises étaient alors florissantes - le couple franco-allemand était équilibré.










 Partout, mais surtout en Europe, la ligne à peu près droite qui avait débuté en 1945 se tord. Cette année-là s’était achevée une guerre de trente ans entrecoupée d’une fausse paix. Une guerre perdue par l’Europe. Bien sûr, ce conflit mondial étant d’abord un conflit européen, il y eut des nations européennes vainqueurs et d’autres vaincues. Mais à l’exception de la Russie, l’Europe en tant qu’entité était la grande perdante. Vassalisée par les États-Unis et l’Union soviétique, elle entrait dans une longue dormition dont elle n’est encore pas sortie. Quoiqu’antagonistes, les deux suzerains partageaient la même détestation de la vieille Europe et la même croyance en leur propre vocation messianique. Leur objectif était en définitive identique : la création d’un homo oeconomicus standardisé, sans racine, sans culture, sans histoire. Seule la méthode différait. Les Soviétiques entendaient l’asservir à l’État communiste par la brutalité et de la planification. Les Américains, au Marché dominé par eux-mêmes, en diffusant l’american way of life avec sa culture de masse et sa production de masse.
Partout, mais surtout en Europe, la ligne à peu près droite qui avait débuté en 1945 se tord. Cette année-là s’était achevée une guerre de trente ans entrecoupée d’une fausse paix. Une guerre perdue par l’Europe. Bien sûr, ce conflit mondial étant d’abord un conflit européen, il y eut des nations européennes vainqueurs et d’autres vaincues. Mais à l’exception de la Russie, l’Europe en tant qu’entité était la grande perdante. Vassalisée par les États-Unis et l’Union soviétique, elle entrait dans une longue dormition dont elle n’est encore pas sortie. Quoiqu’antagonistes, les deux suzerains partageaient la même détestation de la vieille Europe et la même croyance en leur propre vocation messianique. Leur objectif était en définitive identique : la création d’un homo oeconomicus standardisé, sans racine, sans culture, sans histoire. Seule la méthode différait. Les Soviétiques entendaient l’asservir à l’État communiste par la brutalité et de la planification. Les Américains, au Marché dominé par eux-mêmes, en diffusant l’american way of life avec sa culture de masse et sa production de masse.  L’invasion migratoire présente le triple avantage d’importer de la main d’œuvre à bon marché mais plus encore des consommateurs subventionnés par l’impôt prélevé sur les indigènes, et de détruire les identités nationales. On sait que l’invasion migratoire - cela fut confirmé par les révélations de Wikileaks de 2010 - est souhaitée et favorisée par les États-Unis pour détruire l’Europe de l’intérieur.
L’invasion migratoire présente le triple avantage d’importer de la main d’œuvre à bon marché mais plus encore des consommateurs subventionnés par l’impôt prélevé sur les indigènes, et de détruire les identités nationales. On sait que l’invasion migratoire - cela fut confirmé par les révélations de Wikileaks de 2010 - est souhaitée et favorisée par les États-Unis pour détruire l’Europe de l’intérieur. C’est alors que la farce sociétale revêt le masque de l’« opposition progressiste » au Système. On y trouve pêle-mêle les « cultureux » subventionnés par le ministère de la Culture, les minorités activistes (LGBT, indigénistes, ultragauche…), les « féministes 2.0 », bref toutes les chapelles du « jouir sans entrave ». La confrontation est évidemment factice. En réalité, si le Système feint de se démarquer de ces pantalonnades, c’est pour mieux s’en servir : en révolution permanente, le Capitalisme trouve dans les délires sociétaux de l’« opposition progressiste » la caution nécessaire à sa fringale destructrice. C’est pourquoi, après une résistance de bon aloi, il promulgua bien volontiers le mariage pour tous, consacrant du même coup les homosexuels en communauté et en segment de marché, et qu’il érigera bientôt PMA et GPA pour tous en droit de l’Homme.
C’est alors que la farce sociétale revêt le masque de l’« opposition progressiste » au Système. On y trouve pêle-mêle les « cultureux » subventionnés par le ministère de la Culture, les minorités activistes (LGBT, indigénistes, ultragauche…), les « féministes 2.0 », bref toutes les chapelles du « jouir sans entrave ». La confrontation est évidemment factice. En réalité, si le Système feint de se démarquer de ces pantalonnades, c’est pour mieux s’en servir : en révolution permanente, le Capitalisme trouve dans les délires sociétaux de l’« opposition progressiste » la caution nécessaire à sa fringale destructrice. C’est pourquoi, après une résistance de bon aloi, il promulgua bien volontiers le mariage pour tous, consacrant du même coup les homosexuels en communauté et en segment de marché, et qu’il érigera bientôt PMA et GPA pour tous en droit de l’Homme.  En Europe, les immigrés se comportent comme le souhaite le Système : ils s’adonnent à la consommation de masse et constituent des communautés qui affaiblissent les nations. Mais leur refus de s’assimiler provoque chez les indigènes une renaissance du sentiment national. Aux États-Unis, le peuple fatigué de l’immigration massive et du capitalisme débridé, élit un président populiste, avouant par là-même l’échec de la domination américaine du Marché. L’Europe de l’Est instruite par des siècles de luttes contre l’empire ottoman et par cinquante ans d’occupation soviétique ne veut ni d’une invasion migratoire musulmane ni de la tyrannie de l’UE, ces deux derniers phénomènes étant d’ailleurs liés. L’Autriche et l’Italie sont maintenant gouvernées par des « populistes » et ouvrent peut-être la voie à l’Europe de l’Ouest. En France le mouvement des Gilets Jaunes, sonne la révolte contre l’oligarchie. Sans doute ne dénonce-t-il pas l’invasion migratoire. Mais ne faut-il pas voir dans ce silence une « pensée de derrière » à la Pascal, dont l’« habileté » serait de taire ce qu’on ne peut encore hurler ? Peut-être, tant la crainte de passer pour raciste obère la parole. Pourtant, quels que soient les défauts de ce mouvement et la récupération dont il peut faire l’objet, on peut espérer que sa spontanéité et son origine éminemment populaire marquent le retour de la nation.
En Europe, les immigrés se comportent comme le souhaite le Système : ils s’adonnent à la consommation de masse et constituent des communautés qui affaiblissent les nations. Mais leur refus de s’assimiler provoque chez les indigènes une renaissance du sentiment national. Aux États-Unis, le peuple fatigué de l’immigration massive et du capitalisme débridé, élit un président populiste, avouant par là-même l’échec de la domination américaine du Marché. L’Europe de l’Est instruite par des siècles de luttes contre l’empire ottoman et par cinquante ans d’occupation soviétique ne veut ni d’une invasion migratoire musulmane ni de la tyrannie de l’UE, ces deux derniers phénomènes étant d’ailleurs liés. L’Autriche et l’Italie sont maintenant gouvernées par des « populistes » et ouvrent peut-être la voie à l’Europe de l’Ouest. En France le mouvement des Gilets Jaunes, sonne la révolte contre l’oligarchie. Sans doute ne dénonce-t-il pas l’invasion migratoire. Mais ne faut-il pas voir dans ce silence une « pensée de derrière » à la Pascal, dont l’« habileté » serait de taire ce qu’on ne peut encore hurler ? Peut-être, tant la crainte de passer pour raciste obère la parole. Pourtant, quels que soient les défauts de ce mouvement et la récupération dont il peut faire l’objet, on peut espérer que sa spontanéité et son origine éminemment populaire marquent le retour de la nation. De ces quatre nations sœurs, on peut espérer que la France sera la première à relever l’étendard du sursaut. Mais son système politique souffre d’un grave manque de représentativité. Contrairement aux Italiens, les Français ne peuvent compter sur aucun parti ni aucune alliance propre à renverser l’oligarchie qui gouverne depuis quarante sous l’apparence d’une fausse alternance. C’est d’ailleurs pourquoi le référendum d’initiative populaire demeure la principale revendication des Gilets Jaunes.
De ces quatre nations sœurs, on peut espérer que la France sera la première à relever l’étendard du sursaut. Mais son système politique souffre d’un grave manque de représentativité. Contrairement aux Italiens, les Français ne peuvent compter sur aucun parti ni aucune alliance propre à renverser l’oligarchie qui gouverne depuis quarante sous l’apparence d’une fausse alternance. C’est d’ailleurs pourquoi le référendum d’initiative populaire demeure la principale revendication des Gilets Jaunes. 















